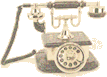Faux-pendants
De même qu’il existe de faux-amis, il existe de faux-pendants où tout semble prouver une correspondance entre deux tableaux, alors qu’ils n’ont jamais été conçus pour cela.
Voici quelques exemples pas si faciles à démêler.
 Saint Marc exécute plusieurs miracles (La découverte du corps de Saint Marc), Brera,Milan Saint Marc exécute plusieurs miracles (La découverte du corps de Saint Marc), Brera,Milan |
 Le corps de Saint Marc sauvé de l’Incendie, Gallerie dell’Accademia, Venise Le corps de Saint Marc sauvé de l’Incendie, Gallerie dell’Accademia, Venise |
|---|
Tintoret,1562-1566
Ces deux tableaux proviennent de la Salle capitulaire de la Grande Scuola di San Marco, et présentent des compositions complémentaires : perspective spectaculaire et présence du commanditaire Tommaso Rangone (l’homme à la barbe blanche et au riche manteau, au centre).
La discordance des tailles pourrait s’expliquer par le fait que le second a été fortement recoupé en 1815, voici son état initial :
Gravure de Silvestro Manaigo et Andrea Zucchi, 1720
L’iconographie de ces deux panneaux a été longtemps incertaine, et on les présente souvent comme des pendants.
 Saint Marc libère un esclave Saint Marc libère un esclave |
 Saint Marc sauve un Sarrasin de la noyade Saint Marc sauve un Sarrasin de la noyade |
|---|
Tintoret,1562-1566, Gallerie dell’Accademia, Venise
Les études récentes [1] ont montré qu’il s’agissait en fait d’un cycle de quatre tableaux, présentés dans l’ordre chronologique :
- sur le mur sud, Saint Marc libère un esclave ;
- sur le mur Est, nos deux « pendants », suivis par « Saint Marc sauve un Sarrasin de la noyade »
Bien qu’exposés côte à côte, ils n’ont jamais été conçus en pendants : seulement comme numéros 2 et 3 de la série.
On dirait deux soeurs posant dans le jardin familial. Pourtant, la réalité est plus complexe et bien plus intéressante. Dans la suite, nous résumons la remarquable analyse de Margaretta M. Lovell [2].
Mrs. Benjamin Pickman
Mary Toppan, 19 ans, issue d’une bonne famille de Salem, venait en 1763 de se marier avec Benjamin Pickman. Elle porte dans ses cheveux un petit diadème nommé mercury et tient dans ses mains une ombrelle, objet aussi onéreux à l’époque que le tableau lui-même. Ces deux objets sont de ceux qu’une jeune fille de bonne famille pouvait confectionner elle-même et assortir selon ses goûts, en achetant seulement les matériaux.
Mrs. Daniel Sargent
Mary Turner, 19 ans, issue d’une bonne famille de Salem, venait en 1763 de se marier avec son cousin Daniel Sargent, un armateur fortuné de la ville voisine de Gloucester.
Dans une chute d’eau jaillissant entre deux pierres de tailles, Mary plonge de la main droite une coquille, du bout des doigts et en tournant le poignet vers le haut, selon la manière de donner ou de recevoir que prescrivent les traités de savoir-vivre de l’époque. De la main gauche, elle tient sa robe entre le pouce et l’index, seule manière distinguée de toucher un vêtement.Tout est ainsi calculé pour mettre en scène l’aisance naturelle et l’expression de digne retenue qui caractérisent les dames de la meilleure société.
Quant à la coquille Saint Jacques, c’est un manière élégante de faire référence à la beauté de l’épouse (Vénus), à l’origine de la fortune du mari (la mer) et à la moitié du couple.
Deux jeunes épouses
Le fait qu’elles n’aient pas été représentées avec leur mari, contrairement à d’autres pendants de couple commandés à Copley par les mêmes familles, peut s’expliquer, selon Margaretta M. Lovell , par le statut du mariage comme l’évènement le plus important de la vie d’une femme ; mais aussi par le fait que le mari n’avait pas le temps de se soumettre aux interminables séances de pose exigées par la méticulosité et les repentirs de Copley : pas moins de seize séances de six heures, selon les mémoires du fils de Mary Turner. Tandis que Reynolds, à Londres, se vantait de peindre un portrait en cinq à huit heures de pose.
La logique apparente
Le décor minimaliste, aux couleurs ternes, est similaire dans les deux tableaux : à gauche une maçonnerie en pierres de taille vue de côté ébauche une perpective : au fond, un mur plat est barré par une ombre diagonale, qui attire l’oeil vers le visage..
Les deux tableaux ont le même format, les deux femmes sont vues de trois quarts. La seconde tourne les yeux vers la première, laquelle à son tour fixe le spectateur, établissant un cycle de regards.
Mary Pickman, avec son ombrelle et son mercury dans les cheveux, est plutôt du côté des objets manufacturés, tandis que Mary Sargent, avec sa coquille et les trois roses fichées dans son chignon, fait référence à la nature. Ainsi, au centre du pendant, le parapluie et la cascade se trouvent affrontés, telles l’industrie de l’homme face à celle de la nature.
Reste à savoir pour quelle raison ces deux jeunes voisines auraient choisi de se faire représenter de manière symétrique, et chez laquelle était exposé le « pendant ».
Un faux-pendant
La taille identique s’explique par la standardisation des formats des portraits ( ici half-length, soit 50 par 40 inch), qui réglait également le cadrage du corps et l’emplacement de la tête.
Le décor, lui aussi standardisé, illustre l’idée que des coloniaux excentrés pouvaient se faire d’un jardin luxueux. Il sert surtout à mettre en valeur la magnificence de la robe à panier et du corset à baleines, un type de vêtement pratiquement réservé aux femmes mariées. La soie bleue, importée donc très onéreuse, est un signe de richesse.
Au terme d’une analyse serrée, Margaretta M. Lovell a établi que les deux familles habitaient la plus vieille rue de Salem, Essex Street, et se connaissaient depuis l’enfance. Les deux jeunes voisines, mariées la même année, et sans doute amies, ont très logiquement demandé au peintre local de les représenter dans leur nouvelle dignité d’épouse, sans que les deux tableaux aient été destinés à être accrochés en pendant.
L’énigme de la robe bleue
Il existe un autre exemple où Copley a peint trois portraits de femmes où seul le visage change, la pose et la robe, recopiée d’après une gravure anglaise, restant exactement les mêmes. Les trois femmes, pourtant apparentées, n’ont manifestement pas pris ombrage de cette uniformité. Car ce que la clientèle appréciait alors dans les portraits était la ressemblance du visage, non l’originalité des vêtements : ils étaient parfois peints en dehors des séances de pose, d’après des modèles stéréotypés, par des artistes spécialistes des étoffes.
Dans le cas présent, le réalisme méticuleux de la robe, peinte sous des angles différents, exclut qu’elle ait pu être recopiée d’après une gravure. Margaretta M. Lovell a examiné toutes les hypothèses :
- une robe miniature peinte après coup, en se servant d’un mannequin de peintre ? Peu probable pour la même raison ;
- une robe appartenant au peintre, et qu’il aurait prêtée à ses modèles cette année-là ? Peu probable, vu le coût élevé d’un tel vêtement pour un peintre de 36 ans (envron 15 livres sterling, soit deux fois le prix du tableau) , tandis que ses modèles pouvaient aisément faire face à la dépense.
Une explication plausible
Mrs. James Warren (Mercy Otis Warren)
John Singleton Copley, 1763, Museum of Fine Arts, Boston
Il se trouve que la même année, Copley a réalisé un troisième portrait avec la même robe : celui d’une femme plus âgée, qui deviendrait un peu plus tard une poétesse et historienne reconnue et jouerait un rôle important au moment de la Révolution : Mercy Otis, épouse de James Warren depuis 1754. Margaretta M. Lovell a trouvé une connexion entre celle-ci et les deux familles Toppan et Pickman, via des camaraderies à Harvard, ainsi que via un procès avec les marchands de Salem.
D’où sa proposition que la robe ait en fait appartenu à Mercy Otis, qui l’aurait donnée à Mary Toppan à l’occasion de son mariage, laquelle l’aurait prêtée à Mary Turner en signe d’amitié.
 Mercy Ottis Warren Mercy Ottis Warren |
 Mary Turner Mary Turner |
|---|
Margaretta M. Lovell remarque d’ailleurs que les dentelles qui ornent les manches sont plus luxueuses dans le portrait de Mercy Ottis que dans les deux autres : preuve que la robe avait été remaniée entre temps. De telles dentelles, individualisées et indicatrices du statut social, étaient à l’époque plus coûteuses que le tableau lui-même, et constituaient des biens d’importation de grande valeur.
On peut aussi y voir l’emblème du réseau complexe de déférences et de préséances qui soutendent les tableaux de Copley, et nous sont devenues à peu près indéchiffrables.
Partager la même robe, c’était partager la même distinction.
http://www.jstor.org/stable/1215242