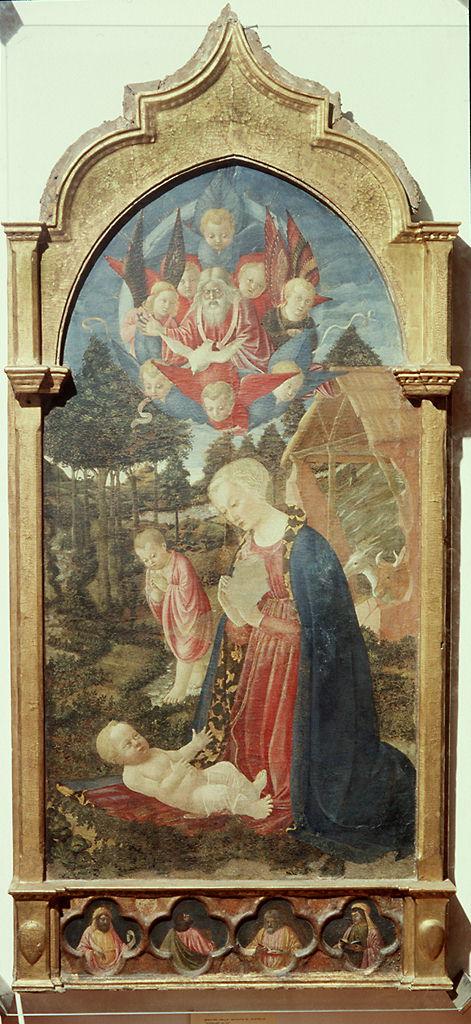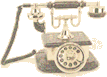Sur la méthode historique (inédit)
 La muse Clio écrivant l’Histoire
La muse Clio écrivant l’Histoire
Franz Ignaz Günther, vers 1763, Wallraf-Richartz Museum, Cologne
![]()
Introduction
En 1972, le rapport du club de Rome décrivait assez exactement ce qui était en train de se passer. Le rythme soutenu de la croissance, qui ne faisait que s’accélérer, ne pouvait se poursuivre indéfiniment dans un monde fini. Nous étions en train de saccager les ressources naturelles et de rendre le monde invivable. Dans les pays industriels, cette croissance bénéficiait alors à toute la population: c’était la période des vaches grasses et la mauvaise nouvelle fut reçue avec le plus grand scepticisme. On se demandait même s’il ne s’agissait pas d’une désinformation perfide pour enlever aux travailleurs les fruits de la croissance. On savait certes qu’il y avait des problèmes, comme celui des déchets atomiques, mais on faisait confiance à la technologie pour les résoudre. Cinquante ans plus tard, les problèmes sont devenus bien plus graves et on attend toujours la solution technologique qui ne vient pas. Suite à la catastrophe de Fukushima, on se contente donc de rejeter les déchets atomiques à la mer. Aujourd’hui, les conséquences fatales d’une croissance échevelée qui ne profite plus guère qu’aux actionnaires des grosses entreprises sont devenues évidentes, à commencer par le dérèglement climatique dont il est devenu grotesque de nier les causes humaines. Pour pouvoir espérer nous sauver du pire, il faudrait des mesures radicales qui n’épargneraient personne et qui seraient politiquement suicidaires. On tente donc de continuer le plus possible comme avant.
Autour de 1972, l’histoire s’écrivait comme une théodicée du progrès. Les guerres effroyables du XXe siècle, telles qu’on n’en avait jamais vues, n’étaient qu’une aberration momentanée et le nazisme un mauvais souvenir. L’histoire racontait la manière dont nous avons surmonté nos limites mentales et dont nous sommes sortis plus forts de toutes les crises. Maintenant que les Trente Glorieuses ne sont plus les prémices d’un futur heureux, qu’elles relèvent à leur tour du passé et que la misère et la violence s’étendent toujours davantage dans le monde, il serait temps d’écrire l’histoire autrement.
Mais en sommes-nous capables ou continuerons-nous à croire aux progrès de l’esprit humain? On se propose ici d’entreprendre une réflexion sans complaisance ni tabou sur les exigences que l’histoire devrait satisfaire pour se démystifier. Il s’agit d’abord – et ce sera notre première partie – d’analyser les biais qui réduisent le travail de l’historien à une contribution aux idéologies ambiantes, lui assurant un succès éphémère, puis un discrédit durable.
Mais on attend ici une objection: pour être plus qu’une contribution à l’idéologie, l’histoire devrait être une science. Or, les événements ne se répétant jamais à l’identique, elle s’occupe par définition du particulier et il n’y a pas de science du particulier. En plus, faute de pouvoir reproduire un événement, elle ne possède aucun caractère expérimental. La réponse à ces objections sera le sujet de notre seconde partie.
L’histoire est celle des hommes. On parle bien d’histoire du climat ou d’histoire des animaux, mais il s’agit en fait de l’histoire des hommes en rapport avec le climat ou les animaux, sans quoi ce serait de la climatologie ou de la zoologie. En dehors de l’histoire la plus contemporaine, les hommes dont elle s’occupe ne nous sont plus accessibles qu’à travers les textes et les objets qu’ils nous ont laissés. Comment comprendre la signification de ces textes et le sens de ces objets? Sommes-nous condamnés à une « herméneutique » subjective et proche de la divination, changeante au gré des préoccupations de chacun et plus encore de celles de chaque génération? C’est sans doute aujourd’hui l’opinion dominante, mais nous essayerons de montrer qu’il y a mieux à faire dans la troisième partie.
En allant à la rencontre des hommes du passé, l’historien est souvent abusé par une fausse familiarité, comprenant ce qu’ils disent et ce qu’ils font à travers le sens actuel des mots et l’exemple de nos propres comportements. Lorsqu’il a surmonté l’obstacle de l’assimilation anachronique, il risque de situer leurs discours et leurs actes dans une altérité
irréductible. Ce qu’ils disent est alors dévalorisé face au savoir de l’historien qui parle à leur place de ce qu’ils ne peuvent savoir sur eux-mêmes. Mais il ne s’agit pas là d’une spécificité de l’histoire, car c’est aussi bien le problème de l’ethnologue, mais finalement aussi du sociologue et du psychanalyste qui recherchent ce qui est supposé échapper à la conscience dans leur propre société. Il s’agit en somme d’un même problème qui fera l’objet de la quatrième et dernière partie. La conclusion portera sur l’éthique de l’historien.
![]()
Histoire et idéologie
Il va de soi que les historiens du passé présentaient des biais idéologiques, qu’ils écrivaient pour légitimer un prince, un groupe social ou une religion, que leur visée relevait de l’apologie et de l’eschatologie. En ce qui concerne les historiens contemporains, les mêmes reproches sont souvent faits à ceux dont on ne partage pas les convictions. Or, l’historien du passé affichait généralement ses choix: ses ouvrages pouvaient s’ouvrir par une lettre de dédicace à un prince ou à un autre puissant protecteur. Encore au XXe siècle dans les pays communistes, les avant-propos des historiens attestaient leur fidélité plus ou moins spontanée au marxisme-léninisme. En général, l’historien d’aujourd’hui ne gage son propos que sur sa compétence réelle ou supposée, laquelle le dispense d’expliciter ses présupposés. Lorsque ceux-ci ne sont pas assez partagés, il se marginalise. Mais il s’agit le plus souvent d’opinions établies qui passent pour des évidences et qu’il n’est pas facile de dénoncer, pour autant qu’on soit parvenu à les mettre en doute. En effet, le vocabulaire étiquette spontanément la contestation d’une opinion établie, non pas comme son contradictoire, mais comme son contraire, faute d’attention au carré des oppositions. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le contraire du blanc est le noir, mais que son contradictoire, le non-blanc, recouvre toutes les couleurs autres que le blanc. Et pourtant, il était difficile, au temps de la guerre froide, de dénoncer la responsabilité de l’anticommunisme dans l’instauration de dictatures sanglantes et de polices parallèles, sans se faire soupçonner de sympathies communistes. Il n’est pas plus facile aujourd’hui de dénoncer le génocide des Palestiniens sans passer pour antisémite. Cet essai critique – entre bien d’autres choses – le progressisme des historiens. Il y a fort à parier qu’il sera jugé réactionnaire, au sens que le XIXe siècle a définitivement donné à ce mot. Mais on prendra le risque de faire confiance au lecteur.
Progressisme
La notion de progrès au sens premier du mot, le progrès de ceci ou de cela, n’est pas en cause. On peut mettre en doute certains progrès de la médecine, mais pas ceux de la chirurgie qui sont une évidence. On est en droit de déplorer le progrès des armements, mais il serait stupide de le nier. Ce qui est en cause ici est le sens absolu du mot « progrès », au singulier, pour désigner une évolution globale des techniques et de la société, considérée a priori comme idéale. Comme l’avaient déjà compris Langlois et Seignobos, « la théorie du progrès nécessaire et continu » n’est qu' »une hypothèse métaphysique » et un succédané de la providence[1]. Elle apparaît avec les prémices de la société industrielle et le Trésor de la langue française la repère dès 1756 chez Victor Riquetti de Mirabeau, le père du député Honoré Gabriel Mirabeau[2]. Durant tout le XIXe siècle, elle a servi d’étendard aux courants républicains, libéraux ou socialistes pour révolutionner à la fois l’Etat, les modes et les rapports de production; elle se confondait pratiquement avec le rationalisme. Au siècle suivant, deux guerres mondiales insensées n’ont pas réussi à discréditer la notion. Plus exactement, elle l’a été par nombre de philosophes, de sociologues et d’écrivains. Elle est parfois camouflée sous d’autres appellations, telles que développement ou croissance, sans parler du paradoxal développement durable aujourd’hui à la mode. Mais, en fait, les décennies d’expansion économique qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont inscrit le sentiment du progrès dans l’histoire personnelle de toute une génération qui voyait se généraliser l’utilisation de l’automobile, du réfrigérateur, de la machine à laver le linge et de la télévision.
Il s’en est suivi une inconscience fatale dont nous sommes loin d’être sortis, face au désastre écologique. Le propos n’est pourtant pas d’évaluer les conséquences politiques et sociales du progressisme, mais d’analyser son impact sur la manière d’écrire l’histoire, car les historiens ont largement montré sur ce point leur aveuglement.
On pourrait, par souci d’équité, se livrer au même genre d’exercice sur les historiens réactionnaires, mais leur contribution à l’idéologie est aujourd’hui beaucoup plus secondaire (pour autant qu’on parle bien des historiens et non des auteurs de biographies plus ou moins romancées). Le cas de Roland Mousnier (1907-1993) peut servir d’exemple. Il avait soulevé beaucoup d’émoi à la fin des années 1960, en niant l’existence de classes sociales avant l’époque industrielle et en attribuant à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) une « société d’ordres » qui aurait été structurée de manière fondamentalement différente. En effet, l’économie ne constituait pas une force dominante et la propriété des moyens de production n’était pas le principal facteur de l’organisation sociale. Sa démarche reposait aussi sur une attention soutenue à la manière dont les sociétés se conceptualisaient et sur le rejet des analyses socio-économiques, marxistes ou prétendues telles, qui cherchaient la vérité d’une société en dehors et en dessous de ce qu’elle disait d’elle-même. A première vue, on pourrait lui attribuer une forte influence, entre autres chez les médiévistes qui ne parlent plus beaucoup de classes sociales dans leur domaine. En fait, son attention à la « superstructure » (comme disaient les marxistes) devait certainement beaucoup à un Lucien Febvre, par exemple. Elle venait aussi de l’anthropologie dont l’influence n’a fait que croître depuis chez les historiens. Il s’ensuit qu’il s’insérait dans une évolution méthodologique qu’il conduisait d’autant moins que ses prises de positions politiques rendaient difficile de se recommander de lui.
Le progressisme est né au XVIIIe siècle de la volonté de révolutionner la société, en disqualifiant comme héritage d’un passé honni tout ce qui restait des structures féodales. A une conception du changement historique comme une succession de variations accidentelles succédait alors une eschatologique profane interprétant les changements survenus et à survenir depuis la fin du Moyen Age comme l’avènement d’une ère de liberté et de prospérité. Les structures économiques, sociales et politiques en cours de destruction furent assimilées à une injuste oppression et l’idéologie qui les légitimait – celle de l’Église – à l’obscurantisme, c’est-à-dire à l’exploitation de l’absence d’instruction et de la crédulité. En soi, ce tableau n’était pas entièrement faux. A bien des égards, les Lumières et la Révolution pouvaient légitimement se prévaloir d’un gain de rationalité et l’invention des Droits de l’Homme témoigne d’une haute notion de l’éthique. Mais il en résulta une disqualification du passé qui affaiblit la réflexion critique sur le présent.
Le passé lointain fut en effet reconstruit sur une série d’anachronismes, en l’assimilant à l’ordre social qu’on était en train d’abolir, comme s’il ne s’était rien passé entre le Moyen Age et les Lumières. Alain Guerreau l’a bien montré, tant pour la projection de la notion moderne de propriété sur le système féodal que pour celle d’un catholicisme minable sur le christianisme médiéval[3]. Les hommes des Lumières ne pouvaient pas ne pas savoir que pratiquement tous les penseurs médiévaux appartenaient à l’Église et qu’il était difficile de citer beaucoup de penseurs d’envergure qui lui aient appartenu depuis la Renaissance, mais ils n’y virent qu’une raison de plus de ridiculiser les penseurs médiévaux. De fait, leur entreprise enthousiaste de transformation de la société était incompatible avec la lecture empathique d’une pensée radicalement différente que leurs adversaires revendiquaient sans la comprendre d’avantage.
La revalorisation de l’Église médiévale par les milieux réactionnaires du XIXe siècle n’a pas arrangé les choses. Elle n’était en fait qu’une conséquence de l’adhésion au catholicisme et ne faisait que confirmer la projection de cette attitude confessionnelle moderne sur le Moyen Age, auquel la fraîcheur naïve de la foi aurait donné le respect de l’autorité, lui épargnant ainsi les fractures sociales et la dissolution des mœurs. Mis à part les jugements de valeur, il s’agissait pour l’essentiel de la même image du passé dans les deux camps.
L’histoire progressiste bénéficiait cependant d’un avantage. Sensible aux changements et les pensant comme irréversibles, elle pouvait difficilement se contenter d’une vision statique des sociétés et cherchait à mettre en évidence des évolutions. Les historiens issus de la bourgeoisie étudièrent la constitution progressive de leur classe sociale et les étapes de son ascension triomphante, sans hésiter à la faire commencer dans les temps obscurs. Il s’ensuivit une nouvelle projection sur le passé, celle de structures sociales de leur époque. Friedrich Engels, par exemple, utilisait les notions anachroniques de grande et de petite bourgeoisie pour analyser la Guerre des Paysans de 1525[4]. En France, la naissance des communes – en particulier celle de la commune de Laon grâce au superbe récit de Guibert de Nogent – devint le premier acte de l’émancipation de la bourgeoisie[5]. Eugène Viollet-le-Duc interprétait les cathédrales gothiques comme l’expression artistique de cette émancipation, ce qui justifiait largement leur savante étude et leur restauration par cet architecte anticlérical.
Dès le milieu du XIXe siècle, le rapport au passé se complique, car son rejet et l’admiration qu’on lui porte ne font plus véritablement le partage entre progressistes et réactionnaires: il est devenu ambivalent du fait de la brutalité des changements provoqués par l’industrialisation. Il est en effet significatif que les styles historicistes, avec toute la nostalgie dont ils témoignent envers un environnement qui se dégrade, tendent à se généraliser. La montée du nationalisme, une mystique dans laquelle les deux camps finissent par communier, entraîne la sacralisation d’ancêtres qu’on aime malgré leurs défauts. A la suite des historiens, les romanciers et les peintres décrivent un passé d’une fascinante méchanceté, avec ses rois fainéants, ses inquisiteurs et ses intrigues de cour, tandis que le décor et le mobilier des maisons permet de se croire au temps de la Pompadour, sous Henri II, voire dans des châteaux-forts médiévaux. Car le passé est un héritage.
Les mêmes transformations brutales renouvellent le regard sur les perdants. L’étude de la paysannerie qui subit l’exode rural est supposée nous apprendre quelque chose sur ce que nous avons été. Pour autant que les colonisés ne soient pas congénitalement inférieurs aux Blancs, ils témoignent eux aussi d’un stade antérieur de l’humanité. Le folklore et l’anthropologie se développent donc dans l’hypothèse d’un monde à deux vitesses dans lequel la résistance au Progrès manifeste à la fois l’absence de maturité et le charme de l’enfance.
Les avatars de ces attitudes n’ont pas disparu au XXe siècle. On pense aux temporalités différentes imaginées par Fernand Braudel, mais aussi à l’opposition entre culture savante et culture populaire ravivée dans les années 1970 par la traduction du livre de Mikhaïl Bakhtine sur Rabelais[6]. On croyait avoir trouvé, sous la culture ennuyeuse des lettrés, une culture populaire orale beaucoup plus intéressante, car transgressive, qui renversait les valeurs du haut et du bas, tant corporel que social, et dont le carnaval était une manifestation privilégiée. On pensait parvenir à la restituer grâce aux bribes que la culture savante nous en aurait parcimonieusement transmises et auxquelles se limiterait son intérêt. Mais on avait oublié que le renversement du haut et du bas est un thème central du christianisme, lettré ou non, ce qu’aurait épargné aux historiens la lecture de Nietzsche ou tout simplement l’audition du Magnificat.
Du nationalisme à la xénophobie
A l’exaltation du progrès qui n’empêche pas la nostalgie de l’innocence primitive, se joint au cours du XIXe siècle une seconde tâche fondamentale pour l’historien, celle de glorifier la nation. Le cadre national devient la scène historique par excellence et la nation une héroïne qui traverse les siècles depuis nos lointains ancêtres les Gaulois, ceux du voisin, les Germains, ou les Huns en Hongrie. La nation date de la protohistoire, puisqu’elle existait avant de posséder une langue écrite, et pourtant ne cesse de se constituer, ce qui lui donne une certaine parenté avec l’Église, déjà en germe chez les patriarches et les prophètes et qui ne s’accomplira totalement qu’à la fin des temps.
Il est inutile de s’étendre sur les méfaits du nationalisme, qu’il s’agisse des guerres atroces qu’il a rendu possibles, des falsifications de l’histoire qu’il a provoquées ou de ses résurgences dans les populismes d’aujourd’hui. Tout cela est bien connu et évident – on l’espère – pour la plupart d’entre nous. Pour l’instant, le nationalisme semble régresser chez nos historiens au profit des attraits de la mondialisation et de la construction européenne. Mais les inconvénients de l’une et les incertitudes de l’autre entraînent des problèmes comparables. Les biais chauvins qu’on peut repérer actuellement chez nous concernent surtout l' »héritage chrétien » de l’Occident et la supériorité qu’il est censé lui donner. Un ouvrage polémique de Sylvain Gougenheim prétendant démystifier le rôle des Arabes dans la transmission à l’Europe chrétienne de la pensée grecque est caractéristique de cette tendance qui suscite encore l’indignation des historiens compétents[7]. Le christianisme a remplacé la nation chez Gougenheim comme détenteur d’une supériorité intellectuelle et morale. La dévalorisation de l’autre, mise ici au service du choc des civilisations, caractérisait déjà l’histoire des mentalités au temps du colonialisme.
Cadres mentaux
C’est le sociologue français Lucien Lévy-Bruhl qui a introduit la notion de mentalité dans les sciences humaines, publiant en 1910 Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures et en 1922 La mentalité primitive. Il s’agissait pour lui de parvenir à décrire et à expliquer des formes de pensée qu’il considérait comme radicalement différentes de la rationalité. Les primitifs auraient un comportement prélogique qui se caractériserait par l’ignorance du principe aristotélicien de non-contradiction. Au lieu de donner aux objets une identité exclusive, ils les concevraient en termes de participation, une attitude qui serait liée à la domination du groupe sur l’individu.
A la fin de sa vie, Lévy-Bruhl a compris que le clivage entre la mentalité prélogique des autres et la rationalité dont nous jouirions depuis Aristote était intenable. Il essaya de définir une mentalité mystique qui serait plus développée chez les primitifs mais également présente en nous et qui suspendrait en quelque sorte l’exercice de la pensée rationnelle[8]. Les discussions avec des anthropologues plus jeunes, comme Marcel Mauss et Edward Evans-Pritchard, ont joué un rôle dans cette évolution, car ceux-ci ont assez rapidement compris l’impasse dans laquelle menait le clivage. En revanche, les historiens se sont rués sur son œuvre antérieur pour importer la notion de prélogique, une filiation parfaitement explicite chez Lucien Febvre: « Hier, notre maître Lucien Lévy-Bruhl recherchait en quoi, et pourquoi, les primitifs raisonnent autrement que les civilisés. Mais ceux-ci, par partie, sont demeurés longtemps des primitifs »[9]. Le problème est donc de savoir comment se comportaient nos ancêtres avant d’être civilisés. J’ai fait depuis longtemps la critique de ses thèses et de celles de ses émules[10]. On se contentera d’en répéter ici un exemple pour montrer à quel point sa reconstitution des « cadres mentaux » du XVIe siècle est confuse et arbitraire: « Le sens intellectuel par excellence, la vue, n’avait pas encore conquis la première place, distancé tous les autres. Mais c’est qu’‘intellectuel’ et ‘intelligence’, ce sont là des mots qui demandent à être sinon définis, du moins datés. Et, lecteurs des beaux livres de Lévy-Bruhl, nous n’avons pas besoin qu’on nous le démontre péremptoirement »[11]. Ce serait donc le sous-développement du sens de la vue qui rendrait Léonard de Vinci et ses contemporains moins intelligents que nous, ce que traduirait l’absence du mot « intelligence » dans leur vocabulaire. Febvre semble en effet vouloir dire que le mot n’avait pas le sens moderne au XVIe siècle (en fait le Trésor de la langue française le repère dès le XIIe siècle) et que les gens n’avaient donc même pas la notion de la chose, en confondant selon son habitude les mots et les notions qu’ils traduisent. Mais on aimerait pouvoir lui demander quelle est sa notion de l’intelligence, car il propose de dater la notion qu’il confond avec le mot et ne définit pas, ce qui est méthodologiquement une double ineptie.
Le clivage entre la rationalité que nous possédons et l’irrationalité des autres ne sépare pas que les civilisés des primitifs et le présent du passé, mais aussi l’ »élite » du « peuple ». A nouveau, les notions forgées par l’anthropologie ont été empruntées par les historiens au moment où elles commençaient à poser problème dans cette discipline. Les anthropologues avaient baptisé « acculturation » les transformations qui surviennent dans une culture au contact d’une autre, sans trop s’inquiéter au départ des inconvénients d’une catégorie qui comprenait aussi bien l’introduction d’une denrée culinaire qu’un génocide: il s’agissait surtout d’évaluer la soumission des colonisés ou des immigrants et d’expliquer leurs résistances pour pouvoir les briser[12]. Et c’est bien le modèle colonial que des historiens français, principalement Pierre Chaunu et Jean Delumeau[13], ont plaqué sur l’évolution sociale de l’Europe dès les années soixante, c’est-à-dire en pleine décolonisation. La Réforme et la Contre-Réforme auraient difficilement triomphé des résistances d’une population majoritairement rurale, illettrée et superstitieuse, mais que les « élites » auraient finalement réussi à acculturer.
En fait, l’appel à une anthropologie dépassée ne faisait que légitimer une manière de réserver aux notables le rôle de sujets de l’histoire qui n’était ni neuve, ni spécifiquement française. En Allemagne, la sociologie historique d’un Norbert Elias donnait aux cours la même mission civilisatrice[14], tandis qu’un historien anglais comme Hugh Trevor-Roper opposait naïvement les lumières de l’érasmisme à la social pressure du peuple en parlant de la chasse aux sorcières à l’époque moderne, à peu près comme le français Robert Mandrou[15]. Si on voulait remonter plus loin dans l’historiographie, on s’apercevrait qu’à travers bien des médiations, le clivage a pris son origine dans la conception que l’Église se faisait de sa propre mission, luttant contre les « superstitions » païenne au nom de la vraie religion. L’historien peut ainsi se reposer sur les sources chrétiennes pour dresser un tableau pittoresque de l’état intellectuel et moral de ses ancêtres.
A la religion du peuple, crédule et conservatrice, s’oppose toujours l’affranchissement des « élites », qu’elles soient supposées plus ou moins déniaisées ou qu’on leur attribue une religion plus évoluée, car les historiens des mentalités sont souvent chrétiens. Il en résulte que la religion est toujours déjà là et que le fait religieux apparaît donc comme premier. C’est ainsi qu’un progressisme hérité de la volonté démystificatrice des Lumières se mue en obscurantisme, faisant cesser toute interrogation sur la production du fait religieux que l’époque moderne analysait encore à travers la problématique sulfureuse des inventeurs de religions.
Ces préjugés sont particulièrement évidents dans l’histoire économique et sociale française où on a l’impression qu’y rajouter une couche de mentalités était censé la convertir en histoire totale. Les paysans de Languedoc d’Emmanuel Le Roy Ladurie en donne un bon exemple[16]. L’analyse socio-économique méticuleuse, typique des grosses thèses françaises de l’époque, est au-dessus de tout reproche et donne une vue précise de l’évolution des prix, de la production, de la démographie et des propriétés qui tantôt se concentrent, tantôt se morcellent. A des phases de relatif bien-être succèdent des périodes d’oppression et de misère qui conduisent à des révoltes suivies d’impitoyables répressions. Jusque-là, on ne peut que louer le travail accompli.
On admettra avec l’auteur que le comportement humain n’est pas une réponse mécanique à ces évolutions, mais est-ce une raison pour faire entrer en scène des mentalités supposées a priori ? Prenons l’exemple du comportement des gros propriétaires terriens qui cherchent l’ascension sociale vers la noblesse plutôt que d’investir[17]. Est-ce vraiment dû à une absence d’esprit d’initiative ? Le Roy Ladurie avait pourtant clairement montré deux choses. D’une part, les blocages de nature matérielle, tels que la mauvaise qualité d’une grande partie des sols, rendaient difficile ou impossible une augmentation de la production. D’autre part, l’esprit d’initiative se portait très bien dans l’industrie textile, laquelle avait des opportunités d’expansion et d’exportation. Dès lors, plutôt que de faire état d’hypothétiques mentalités, l’historien ferait mieux de se demander ce qu’il aurait fait à leur place, à plus forte raison lorsqu’il estime appartenir à une élite contemporaine, dégagée d’une mentalité primitive.
Lesquelles mentalités primitives sont à leur comble chez les paysans. L’auteur n’arrête pas de qualifier leur attitude en termes désobligeants : balourds, stupidité, obscurantisme, arriérés, etc.[18]. Comme ils sont superstitieux, une vague de diabolisme les submerge, d’où l’expansion de la sorcellerie[19]. Il suffit, pour arriver à cette conclusion, de se servir d’aveux arrachés sous la torture. Il serait tout-de-même plus prudent de se demander si la sorcellerie progresse ou si les juges inventent et font confesser des méfaits imaginaires, tels que le déplacement dans les airs pour se rendre au sabbat et y baiser le derrière du diable[20]. Mais l’auteur poursuit sur sa lancée en assimilant les révoltes paysannes à une forme de sabbat. Concluons que l’appel aux mentalités a empêché toute réflexion sérieuse sur les stratégies mises en œuvre dans les différents groupes sociaux pour modifier les situations ou pour s’y adapter.
Optimisme technocratique et histoire
Si la certitude que nous sommes plus civilisés que nos ancêtres a joué un rôle essentiel dans l’histoire des mentalités, elle n’était pas la seule raison de son succès. Il est significatif que l’héritage de Lucien Febvre ait été explicitement revendiqué par Michel Foucault dans son ouvrage sans doute le plus influent, Les mots et les choses, paru en 1966. Or ce philosophe, à l’inverse de l’historien, avait une vision extrêmement critique du présent, du moins du point de vue éthique. Mais lui aussi croyait pouvoir définir le cadre contraignant dans lequel la pensée se serait enfermée à chaque palier de son évolution. C’est à nouveau le XVIe siècle qui sert de point de départ, caractérisé par une pensée strictement analogique qui se serait effondrée au siècle suivant pour faire place à des systèmes classificatoires, pensés en termes de représentation – voire de théâtre – du monde. Les observations justes ne manquent pas et Foucault a livré de bonnes pages sur la magie naturelle de la Renaissance, comme sur l’utopie de la langue naturelle et la pratique exubérante du commentaire qui sont incontestablement très caractéristiques de la période. D’autres révolutions épistémologiques sont parfaitement saisies, comme le rôle dominant que prend l’histoire au XIXe siècle dans l’organisation du savoir ou encore la constitution sous l’effet des sciences humaines d’une figure de l’homme tout à la fois comme objet d’un savoir empirique et comme sujet transcendantal, ce qu’il appelle le « doublet empirico-transcendantal ».
Or, toujours selon Foucault, l’évolution récente des sciences humaines nous laissait espérer qu’elles nous débarrasseraient de cette figure contradictoire en se déplaçant vers l’étude du langage et en y découvrant des structures formelles agissantes à l’insu de la conscience du sujet. Tout en effet semblait converger vers cette conclusion dans les années 1960, aussi bien l’analyse des structures de parentés, puis des mythes chez Claude Lévi-Strauss que l’hégémonie prêtée au « Signifiant » chez Jacques Lacan, le triomphe du formalisme dans la linguistique diachronique traçant une voie dans laquelle la science positive semblait valider une conception mystique du langage dont Mallarmé et Heidegger étaient les prophètes. Maintenant que les linguistes ont à peu près cessé de chercher la structure profonde du langage comme une pierre philosophale et qu’ils pratiquent avec pragmatisme une discipline auxiliaire de l’informatique et de la pédagogie, nous pouvons à la fois sourire de cet optimisme épistémologique et regretter l’élan qu’il avait momentanément donné à nos recherches.
La dimension eschatologique du grand livre de Foucault – tendu vers l’émergence d’une nouvelle positivité – est responsable d’énormes simplifications, à commencer par l’opposition entre la pensée analogique de la Renaissance et la pensée de la représentation à l’époque classique, comme si l’idéal du livre comme miroir, comme speculum, n’était pas déjà caractéristique du Moyen Age. La réduction de la pensée du XVIe siècle à ses formes les plus pittoresques, comme la magie naturelle et l’herméneutique sans garde-fous, lui a fait oublier la résistance de la scolastique, sans laquelle il serait difficile de comprendre la formation de Spinoza ou de Leibniz et certainement celle de Descartes. Les « socles épistémologiques » imaginés par Foucault l’ont amené très logiquement à faire naître l’organisation du savoir par ordre alphabétique, celle des dictionnaires et des index, à l’âge classique, alors qu’une vérification élémentaire lui aurait montré qu’elle était courante au Moyen Age. Un ouvrage comme l’Histoire de la folie, qui est aussi une réussite à bien des égards, manifestait déjà la même recherche illusoire d’un point de départ qui permettrait de faire naître progressivement la modernité par contraste, en l’occurrence un Moyen Age où les fous étaient bannis au lieu d’être enfermés. Il suffisait pour cela de confondre les Narren, les fous de carnaval mis à la mode par Sebastian Brant comme symboles des vices de son temps, censés voyager sur le Rhin, avec les aliénés mentaux qui ont toujours été enfermés lorsqu’on les jugeait dangereux. La sympathie dont Foucault faisait preuve envers le passé ne l’a pas empêché de rejoindre Febvre dans une sorte de darwinisme épistémologique.
Il ne suffit pas de dénoncer ce qui nous paraît inacceptable, du point de vue de la méthode, dans la conception de l’histoire des générations précédentes: il faut aussi essayer de comprendre ce qui donnait à des contrevérités l’allure de l’évidence. Que Foucault ait revendiqué l’héritage de Febvre et s’en soit inspiré est à première vue paradoxal. Autant l’historien se laissait aller à l’intuition psychologique et aux approximations lyriques, autant le philosophe pensait en termes de systèmes articulés. L’acceptation enthousiaste par Febvre des anciennes thèses de Lévy-Bruhl sur les « primitifs » est assez caractéristique de l’époque coloniale, tandis que Foucault a vécu sans traumatisme la décolonisation et s’en est certainement réjoui.
La leçon essentielle que Foucault tirait de Febvre était sans doute la thèse que les hommes d’une époque déterminée sont dans l’impossibilité radicale de penser en dehors d’un cadre épistémologique bien balisé par les limites d’un « outillage mental », que chaque époque a son « impensé ». Ce n’est pas entièrement faux: on voit mal comment le XVIIe siècle aurait pu raisonner sur les microparticules ou sur la radioactivité. Le problème est que l’ »impensé » en question ne contient forcément pour l’épistémologue que les connaissances qu’il possède et qu’il suppose à tort ou à raison étrangères à l’époque étudiée, car il pourrait difficilement connaître son propre « impensé ». Ce biais serait acceptable si l’on supposait que les connaissances progressent indéfiniment, que nous possédons aujourd’hui tout ce qu’il pouvait y avoir de valide dans les savoirs du passé et si ce que nous avons perdu méritait toujours de disparaître. Un épistémologue que Foucault admirait et qu’on continue à encenser a formulé cette thèse sans nuances: « On voit alors la nécessité éducative de formuler une histoire récurrente, une histoire qu’on éclaire par la finalité du présent, une histoire qui part des certitudes du présent et découvre, dans le passé, les formations progressives de la vérité. Ainsi la pensée scientifique s’assure dans le récit de ses progrès »[21].
Il est probable qu’une telle thèse soit encore majoritaire aujourd’hui dans l’opinion, mais il est sûr qu’elle est, en un demi-siècle, devenue désuète dans des pans considérables de la recherche et des autres pratiques sociales. Les différentes disciplines se mettent à interroger leur histoire, non plus toujours pour opposer les certitudes du présent aux égarements du passé, mais de plus en plus pour s’interroger sur la validité de leur trajectoire, pour retrouver les pistes abandonnées à tort, à la manière de la médecine qui a repris l’enseignement des techniques d’auscultation après les avoir considérées comme dépassées. Chez Foucault, la mise en question du présent en est restée au niveau éthique. Il appartenait encore à une génération dont les conceptions épistémologiques ne mettaient pas en cause la subordination de la science à la technocratie.
Structuralisme
Les progrès de la formalisation en linguistique avaient soulevé un immense espoir dans les sciences humaines. Les rapports étant étroits entre le langage articulé et la pensée (peut-être moins qu’on ne l’a cru et ne le croit souvent encore), la pensée elle-même pouvait se formaliser, ce qui aurait comblé le fossé entre les sciences de l’homme et celles de la nature, plus prestigieuses parce que supposées exactes. Le développement encore balbutiant de l’ordinateur ne pouvait qu’encourager cet espoir. Or le formalisme linguistique ne parvenait à se construire qu’en séparant artificiellement la synchronie de la diachronie, en oubliant que la langue vit dans une transition jamais achevée d’un état à un autre. Il supposait un système stable et clos dans lequel, selon la leçon de Ferdinand de Saussure, la valeur sémantique de chaque terme était donnée par ses relations à tous les autres, ce qui est vrai des langages formels de la logique, mais inimaginable dans un système en perpétuel renouvellement. Quoi qu’il en soit, la présentation formaliste des structures de parenté, puis des mythes par Claude Lévi-Strauss, directement influencé par le linguiste Roman Jakobson, ouvrait des perspectives entièrement neuves. Il s’agissait en même temps d’un défi pour l’histoire dont on n’élimine pas facilement la diachronie. Une histoire structuraliste de stricte obédience n’est sans doute même pas pensable. Inversement, l’entreprise emblématique de Lévi-Strauss s’accommodait parfaitement du présupposé que les peuples qu’il étudiait n’avaient pas d’histoire.
Néanmoins, le structuralisme a eu des répercutions globalement positives sur le travail des historiens, en favorisant une plus grande attention aux interactions synchroniques. Une société forme un tout composé de milieux qui ne vivent pas en autarcie. Les cloisonnements érigés par l’histoire des mentalités entre les « élites » et le « peuple », entre religion savante et populaire, et aussi bien les temporalités différentes dans lesquelles vivraient les uns et les autres selon Fernand Braudel devinrent suspects[22]. La notion de survivance, proche de celle de superstition, qui permettait d’expliquer par la référence au passé les archaïsmes réels ou supposés des classes sociales dominées, apparut comme contestable. Pour qu’une représentation survive, il faut qu’elle ait retrouvé un sens dans son nouveau contexte et c’est ce sens qu’il faut découvrir, au lieu de recourir au mythe des origines. En retour, la conception de la diachronie s’en trouve modifiée. Elle apparaît non plus comme un continuum, mais comme une succession de ruptures, isolant autant de synchronies successives. C’est d’ailleurs ainsi que se présente la succession des « socles épistémologiques » de Foucault qui ne se voulait pas structuraliste, mais se trouvait de fait au point de jonction entre le structuralisme et l’histoire.
Or la projection du modèle linguistique sur toutes sortes de structures a engendré une grave confusion entre la signification d’un message et le sens d’un acte, y compris d’un message qui est un acte de parole. Se servir d’un marteau pour planter un clou est une conduite rationnelle et toute conduite rationnelle a un sens. Mais planter un clou n’est pas produire un message et toute conduite rationnelle n’a donc pas nécessairement une signification. Inversement, je comprends immédiatement la signification d’une phrase comme « Paul aime les mirabelles », mais, hors d’un contexte particulier, elle n’a absolument pas de sens. La confusion entre sens et signification entraîne celle du message intentionnellement produit et du symptôme non intentionnel, nous y reviendrons. Dans le structuralisme, elle détourne l’attention de la production du message par un locuteur, comme si le code produisait le message. Elle peut s’appuyer sur la thèse freudienne de l’inconscient, en tout cas dans sa version lacanienne qui fait de l’inconscient un langage. D’où le succès rencontré par la célèbre formule de Lévi-Strauss: « Nous ne prétendons donc pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes, et à leur insu »[23].
L’ampleur et l’intérêt des Mythologiques de Lévi-Strauss ne sont pas en cause. S’il est un reproche à lui faire, c’est d’avoir érigé en principe théorique une difficulté méthodologique. En travaillant de seconde main sur les mythes récoltés par les ethnologues, il ne pouvait analyser la production de ces mythes et, même en travaillant de première main, ce n’était pas forcément possible. Il pouvait déceler des transformations entre un récit mythique et un autre, mais ni dire lequel est à l’origine de l’autre, ni à plus forte raison explorer les raisons de la transformation, tout au plus les corréler à des différences entre les cultures de deux groupes (ce qui est déjà un beau résultat). Mais ce n’était pas une raison pour nier que ces récits aient été pensés par les hommes qui les ont produits et pour imaginer qu’ils leurs sont tombés dessus comme une bosse sur le front.
Le structuralisme se donne comme une sémiologie avec une conception souvent radicale du signe. La linguistique de Ferdinand de Saussure, très influente dans les années soixante, délaissait le référent, c’est-à-dire l’objet dénoté par le signe. Le signe étant réduit au face à face du signifiant et du signifié dont la valeur se confond avec sa relation aux autres signifiés, le langage ne s’articulait plus sur le monde extérieur et devenait solipsiste, ou encore les signifiés se substituaient aux référents. Pour la même raison, les recherches sur l’image d’Umberto Eco ou de Nelson Goodman niaient la ressemblance, c’est-à-dire l’articulation de la représentation sur les objets du monde extérieur, comme si les images étaient des tableaux abstraits[24]. Il y a des objets représentés derrière les représentations et il est nécessaire de confronter les uns aux autres. Comme Pierre Bourdieu l’avait remarqué en étudiant le mariage préférentiel chez les Kabyles, ceux-ci tenaient un discours sur les structures de parenté qui ne correspondait pas à la réalité des pratiques[25]. Quelles que soient les avancées qu’il représente, le structuralisme a eu la faiblesse de gommer à la fois la production des discours et leur capacité à représenter la réalité ou à la dissimuler.
Le point de vue du consommateur
Si le structuralisme s’est théorisé en France, l’histoire de la réception est un apport allemand. Alors que le structuralisme tourne le dos à la phénoménologie, l’histoire de la réception s’en inspire et lui doit le rôle central accordé à l’interprète qui fait évoluer le sens des œuvres et détermine ainsi leur place dans l’histoire[26]. Or, malgré leurs origines distinctes et même opposées, les deux courants évacuent de manière comparable la production de l’œuvre. En effet, pour autant que l’œuvre ne persiste pas dans un statut ontologique stable, mais se reconstitue à chaque moment de la diachronie comme un nouveau nœud de relations contextuelles, son histoire tend à se confondre avec celle de ses réceptions successives, ce qui évacue le problème de sa production. Plus exactement, tout se passe comme si sa production se confondait avec ses interprétations successives, les intentions du producteur n’étant elles-mêmes qu’une interprétation comme les autres.
En soi, l’intérêt pour les réinterprétations successives des œuvres – littéraires, philosophiques et artistiques dans le cas de l’histoire de la réception – est plus que légitime. Il n’en va pas de même de la tendance à les diluer dans leurs interprétations, à réduire leur existence à leur perception par des sujets, à en dissoudre la signification dans celles qu’on leur a données. L’inspiration phénoménologie de l’histoire de la réception et cette histoire elle-même ne peuvent être globalement accusées de ce travers, mais elles semblent lui servir trop souvent d’alibi. En fait, dans la mesure où les réinterprétations d’une œuvre la transforment, il importe de connaître cette œuvre dans son authenticité, sans quoi on connaîtra le produit transformé, mais pas la nature de la transformation, autrement plus révélatrice du nouveau contexte. On peut désigner l’attitude contraire comme le point de vue du consommateur.
On comprend facilement le succès auprès des intellectuels d’une démarche qui valorise au plus haut point le critique ou l’exégète aux dépens de l’artiste ou de l’écrivain, le commentateur aux dépens de l’auteur. On s’étonne à première vue que la lourdeur de la manœuvre passe si facilement inaperçue. Mais une réflexion rapide sur la consommation des œuvres du passé permet de comprendre que cela arrange beaucoup de monde. La relativisation du sens des œuvres est au cœur de notre rapport avec le passé, particulièrement de notre rapport esthétique à ces œuvres. Elle fonde leur décontextualisation par le musée qui atteint ses sommets lorsque les œuvres anciennes et contemporaines sont confrontées dans les mêmes salles, avec le présupposé qu’elles s’éclairent réciproquement. Elle fonde la « mise en scène » anachronique des opéras du passé, en légitimant les contresens destinés à les rendre actuels. Elle fait système avec la transformation des édifices anciens aux dépens de leur restauration et avec le traitement des monuments sur le mode du Disneyland. On sait bien que le passage du temps fait perdre aux œuvres leur fonction première et modifie la perception que nous en avons. Mais le problème est de savoir si ce qui nous intéresse en elles est ce que nous en avons fait ou ce qu’il leur reste d’altérité. Éviter de se confronter à l’altérité, c’est détruire l’histoire. Du reste, les mêmes réflexions doivent se faire sur l’évolution récente de l’ethnologie, entre autres dans les musées, avec son repli sur le quotidien et le familier, sur le moulin à café de nos grand-mères.
Culture matérielle
L’histoire des mentalités n’articule pas sérieusement les phénomènes psychiques qu’elle prétend dégager sur la réalité sociale. C’est ainsi que le religieux, qui y occupe une forte place, est toujours un héritage qui ne sert guère qu’à expliquer les comportements jugés irrationnels et, si on se soucie de son origine, c’est pour supposer qu’il la prend dans la peur que les forces de la nature inspiraient aux hommes qui ne les maîtrisaient pas encore. Le structuralisme, tout comme l’épistémologie foucaldienne, est trop préoccupé par l’étude interne des phénomènes culturels pour les articuler davantage sur les transformations du contexte économique et social. Par ailleurs, ces différentes approches et à plus forte raison l’histoire de la réception ont en commun de ne guère se servir que des textes et des images. Cela finit par créer une béance, particulièrement sensible aux archéologues. La mauvaise réponse consista à accepter le partage et à inventer un domaine de recherche complémentaire: la culture matérielle.
Si la culture matérielle en question est autre chose que le résultat d’un mauvais partage des tâches, on aimerait en avoir une définition, mais apparemment, elle est difficile à trouver[27]. Si matériel s’oppose à immatériel, l’histoire de l’art appartient à la culture matérielle, mais il doit plutôt s’agir des formes socialement inférieures ou des formes triviales de l’existence. Matériel semble bien s’opposer à spirituel, mais alors il faudrait savoir si une hostie, voire un vulgaire bénitier, appartient à l’une ou à l’autre des deux cultures. Appliquée à l’histoire de l’alimentation, la culture matérielle risque de concerner la food plutôt que la cuisine. N’a-t-on pas pu croire qu’on réglerait le problème de la faim en nourrissant les sous-développés de soja comme les bestiaux? Plus généralement, on a à nouveau l’impression qu’une difficulté méthodologique est transformée en système. En effet, l’archéologie, surtout celle des peuples sans écriture, ne donne guère accès à l’ordre symbolique dans lequel s’insèrent les objets : on fait donc de ce qu’on parvient à étudier la culture matérielle. Bien entendu, un certain nombre de spécialistes se rendent compte du problème et veulent le régler en collaborant avec d’autres historiens ou des anthropologues, un peu comme un médecin appelle le psychologue à l’aide.
Finalement, on a l’impression que les rapports entre l’âme et le corps sont projetés sur l’histoire, non pas dans la perspective aristotélicienne et thomiste où l’âme est la forme substantielle du corps, mais plutôt dans celle du platonisme qui en fait des substances distinctes. Qu’est-ce en effet que la cuisine, sinon la forme substantielle de la nourriture humaine ? Elle est donc de nature spirituelle et ceux qui mangent ou veulent faire manger n’importe quoi on perdu l’esprit. Ou, pour le dire autrement, on ne peut séparer l’étude des objets, des plus triviaux aux plus sophistiqués, de celle de la pensée qui les organise. La seule légitimité d’une approche indépendante de l’objet est la détermination de ses caractères objectifs, tels que son âge, sa composition chimique et son état de conservation. Si l’archéologue a plus d’ambitions, il lui faut renoncer à la chimère de la culture matérielle.
En fait, les spécialistes de la culture matérielle à la fois ne se pressent pas de la définir et prétendent souvent ne pas séparer l’étude des objets de celle de leur appréhension. Dont acte. Ils nous disent aussi qu’ils s’intéressent plus particulièrement aux aspects triviaux de l’existence sur lesquels il n’y avait pas beaucoup de recherches, par opposition à l’histoire de l’art par exemple. Mais qu’est-ce que ces aspects triviaux, une fois admis que la cuisine n’est pas l’alimentation et même qu’elle est solidaire du système religieux ? A supposer qu’on parle d’histoire de la culture matérielle pour dire que le point de départ de la recherche est l’interrogation sur des objets de la vie quotidienne, cela peut se comprendre de la part du préhistorien ou de l’archéologue des sites villageois du haut Moyen Age qui sont bien obligés de se contenter de ce qu’ils ont et qui n’ont parfois pas grand-chose de plus. Mais la pénurie d’information ne constitue pas un domaine de recherche et ne justifie pas davantage le nom qu’on prétend lui donner. L’intérêt des travaux concernés n’est pas forcément en cause, mais plutôt l’aversion des historiens envers la réflexion abstraite.
L’histoire asservie
Certes, « l’histoire est fille de son temps ». Si cette sentence vise à déplorer les limites de nos interrogations, elle n’est que trop juste. S’il s’agit de s’en accommoder, elle justifie le confort de l’ignorance. La valeur d’un historien se mesure en effet à sa capacité de s’abstraire des fausses évidences idéologiques de sa propre société par la connaissance de sociétés qui se sont pensées et organisées différemment.
Il n’est pas juste de déplorer le poids des idéologies chez les historiens du passé, lorsqu’on les subit au même degré. Que les historiens des anciens Pays de l’Est aient été obligés de se conformer à l’idéologie marxiste est une évidence. Du moins, cette contrainte était loin d’être toujours intériorisée. Dans certains de ces pays, comme en Pologne, en Tchécoslovaquie et même en Allemagne de l’Est, si on ne touchait pas à une question politiquement trop sensible, il était possible de s’en tirer en affichant son conformisme dans l’introduction et dans la conclusion des travaux. Si la censure est inexcusable, elle n’empêche pas de penser, contrairement aux fausses évidences partagées par l’historien et son public. Il n’est pas nécessaire de développer davantage ce point, puisque toute cette partie du livre est consacrée aux fausses évidences dont beaucoup, à commencer par le progressisme, étaient des dogmes à l’Ouest autant qu’à l’Est.
Un phénomène que François Hartog a baptisé le « présentisme » est de nature à rendre les fausses évidences inévitables[28]. Le constat que les interrogations des historiens sont largement suggérées par les problèmes de leurs temps s’est transformé en injonction, pour l’histoire, de répondre aux problèmes que les gens se posent. Il s’agit probablement d’un cas particulier dans un phénomène plus général: à travers les choix imposés par les bailleurs de fonds, l’ensemble des sciences est soumis à un utilitarisme à courte vue, indifférent aux questionnements épistémologiquement légitimes. A titre d’exemple, on plaisante en Suisse, dans les milieux concernés, sur le moyen de décrocher un gros subside de recherche en sciences sociales : le meilleur moyen d’y parvenir est de proposer quelque chose sur les jeunes en Suisse ou sur les vieux en Suisse. Dans le cas de l’histoire, il s’agit essentiellement de manipuler la mémoire, d’où l’importance prise par les commémorations qui articulent directement la recherche sur les intérêts immédiats. Le comble du phénomène est probablement l’exploitation touristique du patrimoine qui transforme les monuments en vaches à lait, en les défigurant au lieu de prendre les mesures nécessaires à leur conservation. Sa manifestation la plus perfide est sans doute l’enseignement de l’histoire « par problèmes » qui exclut toute vision plus ou moins cohérente d’une autre société, tout en projetant sur le passé les problèmes à la mode.
Cela dit, le « présentisme » n’est pas seul à coucher la recherche historique dans un lit de Procuste. Que l’histoire du droit soit pratiquement un monopole des juristes, celle du calvinisme des calvinistes et celle du judaïsme des juifs, il y a à cela des raisons plus ou moins acceptables qui vont de la technicité du domaine à l’esprit de chapelle. Mais que l’histoire de l’homosexualité soit à peu près dans le même cas ne peut s’expliquer par une quelconque technicité. Cela semble montrer que chacun, appartenant ou non à la communauté considérée, pense qu’elle possède son histoire en propre et que ceux qui n’en sont pas n’ont pas à s’en mêler.
Le cas de l’histoire religieuse est devenu particulièrement problématique. Auteur d’un ouvrage sur Luther, je reçus un jour un courrier à la faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, comme s’il fallait être un théologien protestant pour s’intéresser au Réformateur. Autour de 1900, il était fréquent d’aborder les religions encore pratiquées d’un point de vue laïque ou encore d’un point de vue confessionnel hostile à la confession étudiée. La cinquième section de l’École Pratique des Hautes Études avait été créée en France pour promouvoir le point de vue laïque et personne n’aurait pu imaginer alors qu’elle abriterait dès la seconde moitié du XXe siècle un important pourcentage de chercheurs appartenant à la confession qu’ils étudient. Certaines recherches d’inspiration anthropologiques, comme en Allemagne celles de Hermann Usener, abordaient les religions sans fausse familiarité. Usener était un spécialiste des religions antiques, mais il a beaucoup apporté à la compréhension du christianisme médiéval et moderne grâce à sa démarche de comparatiste, avec une lucidité qui ne serait plus aujourd’hui si facilement acceptée. Dans un essai comme Heilige Handlung, il analysait la bénédiction des fonts baptismaux comme on le ferait des rites d’une religion à mystères de l’Antiquité, mettant en évidence un symbolisme sexuel totalement explicite dans le texte latin du missel, mais non moins totalement ignoré[29]. Il a fortement influencé l’histoire et la sociologie religieuses dans un premier temps, y compris chez les durkheimiens, mais ses émules ont préféré réserver ses méthodes aux religions exotiques ou disparues.
Les historiens confessionnels pratiquant la polémique doivent être lus avec beaucoup de méfiance, mais ils ont plus d’une fois fait surgir de vrais problèmes, camouflés par les apologistes des confessions qu’ils agressaient, avant qu’on ne cesse de les lire au nom de l’œcuménisme. A titre d’exemple, il serait difficile d’avoir une idée exacte de la trajectoire et de la doctrine de Luther sans avoir lu le dominicain Henri Denifle et le jésuite Hartmann Grisar, aujourd’hui considérés comme « dépassés »[30]. A l’intérieur d’une même confession, il arrive que la polémique débouche sur des ouvrages de valeur. On doit au dominicain Yves Congar, l’un des principaux inspirateurs du concile Vatican II, une belle étude sur l’histoire de l’ecclésiologie, précisément parce qu’il contestait celle qui était en vigueur[31]. On peut même trouver chez un historien catholique, une manière de déjouer la censure digne des anciens Pays de l’Est. Le jésuite Henri de Lubac est en effet parvenu à prouver que la notion de surnaturel n’est pas antérieure au XIIIe siècle, tout en affirmant en introduction qu’elle est consubstantielle à l’esprit humain[32]. La subordination de l’histoire à une cause reste un vilain défaut, mais rien n’est pire que la volonté de réconcilier tout le monde à ses dépens, à laquelle au moins ces savants avaient échappé.
Si l’histoire a été beaucoup tributaire au cours du XXe siècle de l’appartenance des historiens à des mouvements politiques, souvent vécue à la manière d’une appartenance religieuse, ce militantisme a régressé dans la seconde moitié du siècle au profit d’une attitude pragmatique et insidieuse, le lobbying. Cela s’explique facilement par l’échec des utopies sociales: faute d’espérer changer la société, il reste la possibilité d’obtenir des avantages de la société existante. Un lobby cherche à influencer avec des arguments divers, soit en prétendant que l’intérêt particulier qu’il défend se confond avec l’intérêt général, soit en réclamant la réparation d’un préjudice, les deux attitudes ne s’excluant pas. Le « présentisme » et la manipulation du point de vue historique sont donc deux ingrédients du lobbying.
Les gender studies constituent peut-être l’exemple le plus répandu aujourd’hui de l’histoire comme lobbying. C’est déplorable, car elles occupent un domaine, certes mal délimité, mais dont l’intérêt n’est pas douteux et même essentiel. On constate sans difficulté la conformité entre chaque théorie en présence et les préoccupations immédiates d’un groupe plus ou moins large, qu’il s’agisse de l’émancipation des femmes, des droits des homosexuels ou du statut des transsexuels. Il en résulte un flou remarquable sur la délimitation du domaine.
Il y a trois ou quatre ans, l’édition française de Wikipédia donnait la définition suivante: » Le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes ». C’était clair, mais limitatif, puisqu’il n’était pas question des différences de rôles sexuels à l’intérieur d’un même sexe, par exemple entre classes d’âge dans la pédérastie antique. Il s’agissait donc uniquement du point de vue féministe. La version anglophone était nettement plus compliquée: « Le genre est l’ensemble des caractéristiques appartenant à la masculinité et à la féminité et les différenciant. Selon le contexte, ces caractéristiques peuvent inclure le sexe biologique (c’est-à-dire le fait d’être mâle, femelle ou une variante intermédiaire qui peut compliquer l’assignement du sexe), des structures sociales fondées sur le sexe (incluant les rôles de genre et d’autres rôles sociaux), ou l’identité de genre »[33]. Elle commençait par éviter l’écueil d’une limitation aux rapports entre sexes différents, les notions de masculinité et de féminité s’appliquant indifféremment aux deux, puis devenait franchement confuse. On ne comprend pas bien le sens de gender role, car gender désigne entre autres ce qu’on nommait « rôle sexuel » il y a quelques décennies et qu’il s’agirait donc ici d’un rôle de rôle. Enfin, la possibilité d’inclure timidement le sexe biologique dans les caractéristiques du genre invite à se poser sérieusement la question: les Américains, auraient-ils fini par redécouvrir le sexe sans s’en apercevoir, en le baptisant gender?
En effet, si on accepte cette inclusion, on voit mal quelle différence il y aurait entre le genre et le sexe au sens large, à la fois biologique et culturel, excédant de toute part la génitalité, comme le comprenait Freud. Il est totalement imbriqué dans les rapports sociaux, à commencer par la parenté et les hiérarchies, que les pulsions sexuelles s’y soumettent ou qu’elles leur résistent. En même temps, on ne voit pas bien à quoi ressemblerait une sexualité humaine « naturelle », purement biologique[34].
Mais alors, pourquoi s’évertue-t-on à distinguer le genre et le sexe ? Il semble y avoir trois raisons:
- Il s’agit évidemment de mettre en évidence la composante culturelle du rapport entre les sexes, pour faire face à sa négation par ceux qui le veulent régi par Dieu ou par la nature. Mais c’est subordonner la recherche à l’apologétique, un peu comme si les paléontologues n’avaient rien d’autre en tête que de réfuter le créationnisme.
- Les gender studies constituent la part de la sexualité qui intéresse les « littéraires », abandonnant le reste aux « scientifiques », mais ce partage n’a pas la moindre valeur euristique.
- Il vaut mieux parler du sexe sans y toucher. Gender studies, cela fait tout de même mieux que sex studies, surtout pour obtenir des subventions.
Le troisième point n’est pas anecdotique, car le mot « genre » est tout simplement en train de prendre le relai du mot « sexe », un peu comme « sein » a remplacé « mamelle » ou « pis » au XVIIe siècle, de sorte qu’il a cessé de désigner le ventre. Prenons un exemple dans les journaux du 4 juillet 2020.
Le Parisien: « Le sexe des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur leur carte d’identité d’ici quelques années, annonce la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Science Ingrid van Engelshoven ».
Le Monde: « Le genre des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur leur carte d’identité d’ici quelques années, une inscription jugée ‘inutile’ par la ministre de l’éducation, de la culture et de la science, Ingrid van Engelshoven ».
Si « genre » est autre chose ici qu’un euphémisme pour « sexe », il faut espérer que Le Monde se trompe, sans quoi l’état-civil néerlandais serait bien renseigné sur la vie privée des citoyens. En fait, on peut se demander combien de décennies passeront encore avant qu’on ne s’aperçoive que le gender n’est qu’un sous-produit du puritanisme anglo-saxon.
![]()
L’histoire comme science
Le procès de la scientificité de l’histoire s’expédie souvent en quelques mots. Lorsqu’un chercheur scientifique suppose une loi, il en fait l’hypothèse puis la vérifie par une expérience. Lorsque l’expérience est positive et reproductible, la loi est vérifiée. Or nous ne pouvons pas reproduite expérimentalement un événement historique: on ne va pas refaire la révolution française en costumes d’époque. Donc l’histoire n’est pas une science. Mais les choses ne sont aussi simples ni du côté de l’histoire, ni du côté des sciences en général.
Scientificité de l’histoire ?
Parmi les rengaines les plus rabâchées qui prétendent mettre en doute la scientificité de l’histoire, il y a le couplet sur le vécu, l’individuel ou l’individuel vécu qui en serait l’objet. Et, comme on l’admet depuis Aristote, il n’y a pas de science de l’individuel. Passons sur les confusions entre d’une part l’individuel et d’autre part l’individu au sens de personne humaine, avec un vécu, une sensibilité, etc. Si on admet que l’objet de l’histoire n’est pas des personnes, mais des faits, le problème est celui de l’individualité du fait qui est toujours unique et ne se reproduit pas à l’identique. Mais qu’est-ce qu’une reproduction à l’identique ? Il s’agit toujours de l’identité selon une série de critères jugés pertinents, qu’on soit dans les sciences de l’homme ou de la nature. Les tours de main de l’artisan, par exemple, constituent un objet historique et sont par nature hautement répétitifs. Considérer que l’un de ces gestes, répétés des milliers de fois par des milliers de personne est à chaque fois unique n’aurait aucun sens. De même, on sait depuis Héraclite qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, mais cela n’intéresse pas spécialement l’hydrographie. La géologie étudie l’histoire de la terre et donc des faits individuels non reproductibles, mais personne ne doute de son caractère scientifique[35]. Objectera-t-on que l’histoire humaine est constituée de faits nettement plus complexes ? Mais si la simplicité des faits étudiés était un critère de scientificité, la physique des particules serait nettement moins scientifique que la phonologie par exemple.
L’objection de l’individuel vise souvent le caractère supposé non expérimental de l’histoire, le fait historique étant individuel au sens où il serait impossible dans la plupart des cas de le répéter expérimentalement. Mais cela vaudrait aussi bien pour la géologie: étudie-t-on les failles tectoniques en en provoquant? L’objection est d’autant plus curieuse que l’historien expérimente lorsqu’il le peut et le fait même de plus en plus dans un domaine comme l’archéologie, pour reconstituer les techniques du passé. C’est ainsi que des archéologues taillent des silex pour comprendre comment on procédait.
Que l’histoire s’occupe du vécu, individuel ou pas, est une objection encore plus étonnante à sa scientificité[36]. Cette objection vaudrait d’ailleurs pour l’ensemble des sciences humaines. Dans le cas de la médecine, on admet effectivement que ce n’est pas une science, mais un art. En revanche, la médecine légale est une science assez proche de l’histoire. Comme le médecin légiste, l’historien s’occupe du vécu après coup, une situation moins risquée. Mais l’objection du vécu peut viser autre chose: la recherche des intentions, d’une part l’intention d’exprimer ou de communiquer quelque chose, d’autre part ce qui, y compris dans un message, relève d’une autre intention, éventuellement de cacher quelque chose. Il y a bien là une originalité et une difficulté propres aux seules sciences humaines, dès lors qu’on n’imagine pas la nature comme une création divine, porteuse d’intentions providentielles. Pour étudier des actes intentionnels, il faut s’armer de méthodes bien différentes de celles de la
physique ou de la chimie par exemple, ce qui ne veut pas dire qu’elles soient moins scientifiques. Nous verrons lesquelles le moment venu.
Mais tout d’abord, il est réducteur de faire comme si l’histoire, parce qu’elle s’occupe d’actes intentionnels, se confondait avec celle des intentions des hommes. Cela suppose qu’elle s’intéresse au pourquoi des événements plutôt qu’au comment et que le pourquoi se confonde avec les intentions de sujets individuels comme les souverains ou de sujets collectifs comme une classe sociale. Des pans entiers de l’histoire échappent à ces problématiques. S’il est parfaitement légitime de se demander pourquoi le potier fait tel type de pot, pour une destination utilitaire ou cultuelle, par exemple, il ne l’est pas moins de se demander comment il le fait, quels sont les procédés qui permettent le résultat. Et cette question ne porte pas sur une intention. Si on étudie les conséquences d’une peste sur une population, on sait bien que les gens ont l’intention de se protéger, qu’ils s’en vont lorsqu’ils le peuvent, mais ce qu’on étudie n’est pas cette intention évidente: ce sont plutôt les vecteurs de la contagion et les méthodes prophylactiques. On multiplierait sans difficulté les exemples concernant l’histoire et les autres sciences humaines.
Le problème des intentions semble redoutable, parce que nous ne voyons pas ce qui se passe dans la tête des gens et pilote leurs actes. En fait, dans l’immense majorité des cas, l’intention se déduit de l’acte, comme lorsque les gens fuient devant la peste. Lorsqu’on s’aperçoit qu’une charte est falsifiée, il suffit de la lire pour comprendre quel avantage le faussaire comptait en retirer. Dans une partie d’échec, le sacrifice d’une pièce est souvent incompréhensible dans l’immédiat, mais les deux ou trois coups suivants font comprendre ce que voulait le joueur. Il y a bien sûr des cas où l’intention présidant à l’acte est impossible à déterminer. C’est évidemment le cas lorsque l’acte lui-même est insuffisamment documenté, mais alors c’est l’impossibilité de comprendre l’acte qui est le problème. Le problème n’est spécifiquement celui de déterminer l’intention que si l’acte est ou paraît irrationnel dans son contexte.
L’irrationnel en question ne doit être confondu ni avec les simples erreurs, ni avec les comportements symboliques. Il va de soi qu’une décision peut être malencontreuse sans être irrationnelle: elle ne manifeste qu’une information insuffisante ou de l’ignorance. Quant aux comportements symboliques, nous verrons qu’ils cohabitent avec les comportements rationnels dont ils sont une suspension, au lieu d’être produits par quelque mentalité archaïque. En définitive, les comportements authentiquement irrationnels sont quantité négligeable et ne posent pas plus souvent de problèmes en histoire que dans la vie quotidienne.
Une fausse démarcation
Le sociologue Max Weber a sans doute été le promoteur le plus influent du partage entre les sciences de la nature et les sciences humaines, en opposant aux lois scientifiques les assertions sur les faits humains qui relèveraient d’une interprétation (Deutung) et seraient seulement plausibles[37]. On est là aux origines d’une « herméneutique », toujours très vivante en Allemagne et très influente en France. La thèse de Weber a été reprise par le sociologue Jean-Claude Passeron pour prouver que la réfutabilité, critère proposé par Karl Popper pour distinguer ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas, n’est pas applicable aux sciences humaines[38]. Pour Popper, la scientificité d’une théorie est le fait de se prêter à la réfutation si elle est fausse, à la manière dont la proposition universelle « Tous les cygnes sont blancs » est réfutée par la découverte d’un seul cygne noir. Selon Passeron, les assertions des sciences humaines ne sont jamais qu’approximativement universelles, l’état initial du phénomène étudié n’étant jamais entièrement déterminable, de sorte que la découverte d’une exception ne les réfute pas. Ce ne sont donc pas des lois scientifiques, mais simplement des assertions plus ou moins plausibles.
L’ouvrage de Passeron est un bon exemple, à la limite de la caricature, de la vision scientiste des « sciences dures » qui règne chez les « littéraires ». On a l’impression en le lisant que la crise du fondement de l’arithmétique n’a jamais eu lieu et que l’optimisme scientiste du XIXe siècle n’a pas pris une ride. Or, l’opposition entre réfutabilité et plausibilité laisse échapper le problème des raisonnements probabilistes qui n’a rien de spécifique aux sciences humaines[39]. Pour que l’opposition ait un sens, il faut la fonder sur la théorie des probabilités dite « fréquentiste » qui distingue la probabilité de la plausibilité et réfuter la théorie bayésienne rivale qui incorpore la plausibilité dans la probabilité. Or il ne semble pas que cette question théorique soit tranchée. Au contraire, la théorie bayésienne connaît une faveur croissante, depuis que l’ordinateur a annulé le handicap que constituait la complexité des calculs[40].
Les probabilités fréquentistes mesurent le pourcentage de chances qu’un événement se produise et les probabilités bayésiennes la validité d’une prédiction, en fonction des données dont on dispose, d’où le choix assez malheureux de parler de probabilités « subjectives », la subjectivité n’étant ici que la limite des connaissances pertinentes, laquelle n’a rien de spécifique aux sciences humaines[41]. D’un point de vue bayésien, la distinction entre réfutabilité et plausibilité ne permet pas la démarcation entre deux types de sciences. Il en va de même de la distinction entre les lois que produiraient les sciences « exactes » et les modèles dont se serviraient les sciences humaines, comme les idéaltypes de Weber, l’utilisation de modèles étant courante dans les premières[42].
En outre, on oublie habituellement de remarquer que le célèbre exemple de Popper n’est pas ce qu’on appelle une loi scientifique. Que tous les cygnes soient blanc est un constat empirique banal et on imagine mal un programme de recherche destiné à le valider par l’expérimentation. Ce que dit Popper concerne la logique des propositions la plus élémentaire: une seule exception contredit une proposition universelle, qu’elle formule ou non une loi scientifique. Et l’exemple est heureux dans sa banalité, car on ne peut réduire la science à la seule formulation de lois sur la base de l’expérimentation. Un constat empirique correct peut avoir le plus grand intérêt scientifique, justement parce qu’il se prête à réfutation.
Le problème est donc en fait de savoir si le critère de réfutabilité fait la démarcation entre ce qui est science et ce qui ne l’est pas dans l’ensemble des disciplines, y compris l’histoire. Or, on a sérieusement douté de son efficacité et même de son bon sens[43]. En effet, il semble mettre radicalement en cause la validité de l’évidence. Si nous considérons l’assertion que le soleil se lèvera demain comme non réfutable, nous sommes condamnés à la considérer comme non-scientifique. Mais il faut noter d’abord que l’exemple est assez mal choisi car il s’agit autant d’une tautologie que d’une proposition sur le monde. La notion même de lendemain s’articulant sur la régularité du cours des astres, on voit mal ce que demain peut signifier d’autre que le jour du prochain levé de soleil. Si le soleil ne se lève pas demain, c’est parce qu’il n’y a pas de demain.
D’autres objections opposent au critère de Popper la réalité concrète des pratiques scientifiques. La réfutation des lois scientifiques une à une n’est pas possible, vu le nombre de celles que présuppose chacune d’elles. De plus, on aurait bien tort d’abandonner une bonne théorie pour une seule observation qui semble la réfuter et on a eu raison de ne pas mettre en cause celle de Newton, lorsqu’il a été observé que l’orbite de la planète Mercure la contredisait. Mais le critère de Popper n’est pas une description de la pratique scientifique et ne dit pas qu’il faut réfuter une théorie à la première observation gênante: il se contente d’écarter les théories qui ne se prêtent à aucune procédure de réfutation. En outre, l’adhésion à ce critère n’implique pas de cautionner globalement le positivisme logique de son auteur.
Au risque de passer pour rétrograde, on maintiendra le critère de réfutabilité qui définit clairement la scientificité en histoire. Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à des objections plus grossières, ainsi celle qui consisterait à mesurer la scientificité au degré de formalisation. La formalisation est un outil puissant qu’il faut l’utiliser chaque fois que c’est possible et utile, mais nous savons depuis les travaux de Kurt Gödel et d’Alfred Tarski que ni l’arithmétique, ni la logique ne peut formaliser ses propres présupposés. On trouvera nettement plus de raisonnements formalisés dans les histoires de la logique ou de la physique que dans celles des institutions ou de la peinture, mais cela ne leur assure pas un fondement dont les autres seraient privées. Un raisonnement exprimé en langage naturel peut être aussi valide qu’un raisonnement formalisé.
Tout cela pour dire que la démarcation entre les sciences humaines, dont l’histoire, et les autres, n’est que le produit de la surestimation de ces dernières chez ceux qui ne savent rien de leurs problèmes. Et encore, nous n’avons pas fait mention du plus grave: la privatisation progressive de pans entiers de la recherche dans les sciences dites dures, les États cédant à de puissants groupes privés une part croissante de son financement et donc de ses orientations ou les subventionnant pour faire la recherche qu’ils veulent. Si les objectifs de recherche favorisés par les États sont loin d’être toujours acceptables, ceux de groupes industriels et commerciaux ont toutes les chances de n’être dictés que par la seule considération du profit. Lorsque les États prennent comme experts les promoteurs d’une technologie dangereuse pour certifier son innocuité, on connaît d’avance le résultat. Or les sciences humaines ne sont pas celles qui intéressent le plus les opérateurs privés et l’histoire, tournée vers le passé, pourrait bien être celle qui les intéresse le moins. Dans de telles conditions, parler de l’histoire comme d’une discipline n’accédant pas à l’objectivité des sciences de la nature, c’est se tromper de siècle. Il y a bien sûr des conflits d’intérêts en histoire, mais ils sont proportionnels aux enjeux financiers et donc incommensurablement plus faibles.
La pire des solutions
A l’encontre de la recherche d’une démarcation entre l’histoire et la science, Lucien Febvre (encore lui!) prétendait remettre l’histoire à l’unisson des sciences exactes. Selon lui, ses prédécesseurs « positivistes » étaient des fétichistes des faits. Ceux-ci prétendaient les ramasser (en réalité les établir) et les disposer à leur convenance, comme dans les tiroirs d’une commode. Ému par les bouleversements scientifiques de son siècle, à commencer par la théorie de la relativité, il proposa une autre conception des faits. Parmi ses nombreuses tirades sur le sujet, on voici une de particulièrement révélatrice:
Un historien qui refuse de penser le fait humain, un historien qui professe la soumission pure et simple à ces faits, comme si les faits n’étaient point de sa fabrication, comme s’ils n’avaient point été choisis par lui, au préalable, dans tous les sens du mot choisi (et ils ne peuvent pas ne pas être choisis par lui) — c’est un aide technique. Qui peut être excellent. Ce n’est pas un historien[44].
Il est à craindre que beaucoup de monde souscrive aujourd’hui aux assertions de ce genre qui se répètent dans ses textes programmatiques. Elles posent pourtant quelques problèmes. Que n’importe quel chercheur choisisse les faits à étudier n’est pas une découverte et n’importe quel positiviste conviendra volontiers qu’il n’étudie pas tout et n’importe quoi. Mais on glisse un peu vite de l’idée de choisir les faits à celle de les fabriquer. Voulait-il dire que ses mentalités du XVIe siècle ne sont rien d’autre que son invention? Il faut plutôt supposer qu’il s’est laissé emporter par son pathos, car on dit plus couramment que les faits sont construits par le chercheur et c’est sur ce poncif qu’il faut s’interroger.
Il n’est pas difficile de comprendre ce qu’on veut dire par là. L’établissement d’un fait scientifique suppose une multitude de connaissances préalables, un dispositif expérimental, souvent des manipulations et ainsi de suite. Mais cela n’enlève rien à l’étrangeté de la formule qui repose sur la confusion entre la connaissance et l’existence du fait, comme si les faits n’existaient pas avant d’être « construits » par le chercheur, comme si la terre ne tournait pas autour du soleil avant qu’on le sache[45]. Or cette formule ne choque pas grand monde et il faut se demander pourquoi.
La raison en est dans la confusion entre science et technologie. Gaston Bachelard, qui a beaucoup fait pour transformer la confusion en dogme, semble éviter la formule, mais en trouve de très comparables. Dans la chimie selon lui, « le réel n’est plus que réalisation […] On s’exerce aussi à ne penser dans le réel rien autre chose que ce qu’on y a mis »[46]. La chimie n’est pas prise en exemple par hasard, car depuis l’origine, c’est peut-être la discipline où le rapport entre science et technologie est le plus étroit et où la découverte du réel est la plus dépendante de sa transformation. Il aurait été sensiblement plus difficile de tenir le même raisonnement sur l’astronomie par exemple. Mais peut-on croire que le tableau de Mendeleïev qui sert d’exemple à Bachelard aurait le moindre intérêt s’il n’était pas une description correcte d’un réel préexistant aux découvertes de la chimie ?
Ce qui donne une apparence de raison aux formulations aberrantes de Bachelard et de Febvre, c’est certainement l’idée que la science, pensée comme technologie, améliore le monde, que le problème n’est plus de le découvrir, mais de le remplacer par un monde meilleur. Or cette attitude persiste en pleine crise écologique, peut-être parce qu’on attend de la technologie qu’elle répare les désastres qu’elle a provoqués.
Mais il y a maldonne. Si la technologie a transformé le monde en poubelle, c’est parce que notre espace vital n’est pas infini, parce qu’il y a des limites qu’il importait non pas de construire, mais de découvrir, car elles sont un aspect de la résistance du réel et donc des faits. Bien sûr, l’écologie s’exprime avec le langage de la science et ces faits se découvrent à l’aide de calculs très complexes, mais cela n’en fait pas des inventions humaines. Laissons aux climato-sceptiques le soin de fabriquer les faits et contentons-nous de les découvrir. A supposer que nos technologies puissent nous aider à nous en sortir, ce ne sera qu’en affrontant un réel qui leur préexiste et découvrir ce réel est la tâche de la science.
Cela ne veut pas dire que la science, y compris la science historique, ne construise rien du tout. Mais ce qu’elle construit, ce sont des hypothèses et des théories, non pas des faits. Du point de vue poppérien que j’assume, une théorie n’est jamais vérifiée par les faits, mais cela ne l’empêche pas d’être satisfaisante. En considérant que le soleil tournait autour de la terre, on se trompait dans l’absolu, mais cette théorie rendait suffisamment compte de l’alternance régulière des jours et des nuits et a permis de construire les calendriers: on aurait eu bien tort de s’en passer. En revanche, ce sont les faits qui font abandonner les hypothèses et détruisent les théories. La physique des particules a découvert le caractère aléatoire des mécanismes quantiques, alors que ce n’est pas ce qu’elle cherchait. Ce n’est pas de gaîté de cœur qu’elle a renoncé à une explication déterministe de ces phénomènes. Elle n’a pas construit les faits qui ne s’y prêtaient pas : ils lui sont tombés dessus. De même, Frege n’a pas cherché le fondement de l’arithmétique pour découvrir qu’il n’y en avait pas et il a encore fallu un demi-siècle pour qu’on découvre qu’il ne pouvait pas y en avoir.
Conditions de scientificité
Le problème n’est pas de savoir si l’histoire est scientifique ou non, mais de faire une histoire conforme aux exigences scientifiques, en prenant en considération ces exigences au lieu de prétendre que la science construit les faits. Il nous faut donc examiner un certain nombre de difficultés qui ne sont pas propres à l’histoire, mais qui peuvent se présenter de manière particulière dans cette discipline.
Régularités
Il n’y a pas de lois de l’histoire ou, s’il y en a, personne ne les a découvertes. Il y a par contre des régularités en abondance, dues ou non à des initiatives humaines. Prenons un objet historique tel qu’une langue. Pour fonctionner, une langue suppose un nombre énorme de conventions plus ou moins bien respectées. Certaines sont des inventions humaines, à commencer par les noms de baptême affectés aux individus pour leur vie entière. Mais la plupart d’entre elles n’ont pas été décrétées: personne n’a jamais décidé que le verbe actif se placerait en français entre le sujet et les compléments ou encore que les substantifs seraient précédés d’articles. Elles ont été découvertes et plus ou moins codifiées après coup. Or elles ont toutes en commun de rendre la communication possible. Certes, elles sont constamment violées par des fautes de syntaxe ou d’orthographe et toutes sortes d’usages impropres. Mais les connaître permet de comprendre une langue.
Il y a un demi-siècle, certains structuralistes à la mode, comme Roland Barthes, assimilaient n’importe quelle pratique sociale à un langage, ce qui était abusif. En effet, toute pratique sociale ne vise pas à communiquer, ni même à exprimer quelque chose. En revanche, une pratique sociale met en œuvre aussi bien des règles imposées que des régularités ignorées des acteurs, tout comme un langage. Pour la comprendre, l’historien doit découvrir les unes et les autres. Comme elles ne sont pas des lois universelles et comptent des exceptions, leur application relève du probable.
L’impossibilité de mesurer les probabilités en question dans la plupart des cas peut passer pour un problème, mais qu’il ne faut pas surestimer. Nous n’aurions pas l’idée de sortir avec un parapluie en pleine canicule, même sans avoir consulté un bulletin météorologique. Un type de raisonnement que les historiens sont loin d’utiliser aussi fréquemment qu’il le faudrait permet, non pas de quantifier la probabilité qu’on événement ait eu lieu, mais de dire avec assurance qu’un événement a plus probablement eu lieu qu’un autre. En effet, quelle que soit la probabilité de p et de q, celle de p et q à la fois est moindre si ces propositions sont indépendantes et si la probabilité d’aucune d’entre elles n’est nulle, à plus forte raison celle de p et q et r. Inversement, si p et q et r sont vrais à la fois, une thèse qu’ils impliquent tous trois en reçoit une forte probabilité. C’est simple et approximatif, mais cela permet de résoudre des problèmes compliqués. Voyons deux exemples.
A partir de 1999, je me suis opposé avec des arguments de ce genre à la datation des églises majeures auvergnates dans la première moitié du XIIe siècle, considérant qu’elles avaient un demi-siècle de plus, en arrivant à la conclusion suivante:
La datation tardive des églises majeures repose […] sur la violation de trois principes probables:
- Il ne devrait pas s’écouler des décennies entre la fondation ou la donation d’une église et son éventuelle reconstruction.
- Les chapiteaux ont toutes les chances d’être contemporains de la partie de la construction dans laquelle ils se trouvent.
- Ce sont les petites églises qui imitent les grandes et non l’inverse.
Il est toujours possible qu’une chronologie violant l’un ou l’autre de ces principes soit néanmoins juste, mais il est très improbable qu’elle le soit si elle les viole les trois à plusieurs reprises. Il est raisonnable d’en conclure que les églises majeures datent bien du XIe siècle[47].
En fait, des doutes s’étaient déjà manifestés sur chacun de ces points et sur d’autres encore, mais ils n’avaient pas été réunis en faisceau de probabilités, de sorte que la chronologie établie n’en avait pas été ébranlée.
Il arrive également qu’une théorie de bon sens soit contredite à coup d’arguments ad hoc. Dans le cas de la cathédrale de Chartres, un article de Jan Van der Meulen en donne un exemple qui n’est pas à suivre[48]. Cet auteur met en doute la mise en service du chœur, et donc du chevet, en 1221, malgré le règlement des droits du chantre à disposer les chanoines dans les stalles selon un protocole très exact rédigé en janvier de cette année. On y apprend que « de nouvelles stalles de forme inusitée ont été posées dans le chœur de notre église selon une disposition nouvelle ». Selon Van der Meulen, il pouvait s’agir d’une disposition provisoire, en attendant la fin des travaux. Cela n’est pas totalement impossible, mais il faudrait qu’on ait eu des raisons sérieuses de faire un travail sur mesure dans un emplacement occupé par le chantier de construction et qu’on ait disposé pour cela de plans exacts, ce qui n’était pas évident à cette date. En outre, on comprendrait mal l’impatience à disposer d’un règlement des va-et-vient dans un lieu non encore disponible. Mais admettons provisoirement l’argument.
La datation de plusieurs vitraux du chevet avant 1221 s’accordait avec cette date selon la plupart des auteurs. Van der Meulen s’est appliqué à démonter l’argument, en faisant d’abord remarquer qu’un vitrail peut avoir été produit bien avant ou bien après la fenêtre qu’il occupe. S’il est incontestable qu’un vitrail puisse s’être fait attendre, il aurait été très délicat de le faire d’avance. En effet, les fenêtres sont loin d’avoir toutes les mêmes dimensions et les méthodes de travail de l’époque ne garantissaient pas une haute précision. Ce qui serait aisé dans les ouvertures rectangulaires et parfaitement identiques d’un mur de béton ne l’aurait pas été dans des arcs et des roses sculptés. Il est donc sinon certain, du moins très probable, que les vitraux ne précèdent pas la construction et donc que celle-ci n’est pas en retard sur les vitraux.
Notre auteur n’est pas pour autant à court d’arguments, car certains vitraux pourraient avoir été datés trop tôt. Pour ses collègues, la mort d’un personnage représenté en donateur est généralement considérée comme un terminus ante quem pour un vitrail, ainsi celle du chancelier Robert de Bérou en 1216, celle de Thibaut VI, comte de Chartres, en 1218 ou celle d’Alix de Thouars en 1221. Mais il objecte que ces donations ont très bien pu avoir été réalisées plus tard par des tiers, comme d’autres l’ont proposé avant lui: une confrérie de pèlerins pour Robert de Bérou, les moines bénéficiaires d’une donation du comte dans les deux fenêtres où il est représenté, Pierre Mauclerc, veuf d’Alix de Thouars, pour celle de cette dernière. C’est possible, encore que les donateurs préfèrent en général se mettre en valeur eux-mêmes. Au final, c’est l’accumulation d’objections ad hoc dont aucune prise isolément n’est totalement vaine qui rend le raisonnement absurde. Multipliées les unes par les autres, les probabilités des divers arguments finissent par devenir dérisoires.
Comme on le voit à ces deux exemples, les régularités qui gouvernent les pratiques humaines connaissent des exceptions. L’historien est loin de pouvoir toujours les traiter statistiquement, ce qui ressemble fort aux situations de la vie courante. Mais il suffit de voir se multiplier les facteurs rendant une hypothèse probable ou improbable pour obtenir, sinon une certitude, du moins une conclusion raisonnable. Ce résultat est nettement plus scientifique que les tentatives de quantifier ce qui n’est pas quantifiable.
L’impact de l’observateur
C’est certainement dans le cas de la physique quantique que l’impact de l’observateur sur le phénomène étudié a suscité le plus de questions. On s’est en effet aperçu de l’impossibilité de mesurer l’état initial de certains phénomènes sans les perturber, ce qui rendait probabiliste le résultat de l’expérimentation. En physique classique, un tel problème ne se pose pas : les appareils de mesure n’affectent pas sérieusement le phénomène et son état initial est donc suffisamment connu. En revanche, l’impact de l’observateur existe dans les sciences humaines et préoccupe aussi bien les psychologues que les sociologues ou les anthropologues. Dès lors que l’observateur est en situation de dialogue avec ceux qu’il observe, dès lors même que ceux-ci perçoivent sa présence silencieuse, cela affecte leurs réponses. Pour ne prendre qu’un exemple banal, un sondage a toutes les chances de sous-estimer les intentions de vote en faveur d’un candidat sulfureux.
En dehors de l’utilisation de témoignages en histoire contemporaine, l’historien a l’avantage de ne pas perturber le comportement de ceux qu’il étudie, ce qui ne signifie pas que son intervention soit sans conséquence sur l’objet de sa recherche. La fouille archéologique constitue un cas limite, un peu comparable à celui de la physique quantique, car elle détruit l’état initial du lieu en progressant. Une fois un objet retiré du sol, sa localisation dans la stratigraphie n’est plus garantie que par les relevés et la parole du chercheur. La parade consiste à ménager des « banquettes » intactes entre les carrés de fouille, de manière à permettre un jour une nouvelle exploration du site, confirmant ou infirmant les conclusions précédentes, ce qui corrige partiellement le caractère inévitablement destructeur de la fouille. La restauration d’œuvres d’art connaît des dilemmes comparables. Lorsqu’une statue de culte a connu sept ou huit polychromies successives, on ne peut accéder à ses états antérieurs qu’en détruisant les couches qui les camouflent, mais c’est aussi détruire une partie de son histoire. Cela dit, l’immense majorité des recherches historiques n’affecte pas ou très peu l’état des objets étudiés.
Les procédures de recherche qui n’affectent pas l’état de l’objet, mais compromettent les résultats défient en revanche l’énumération. Elles sont trop nombreuses et diverses, mais il faut être conscient qu’on ne peut les éviter toutes. Du fait même qu’aucune science ne peut formaliser ses fondements, le raisonnement le plus rationnel, formalisé ou non, dépend toujours en dernier lieu de présupposés implicites ou insuffisamment explicités. Cela dit, c’est justement la conduite rigoureuse du raisonnement qui rend possible la découverte et la critique de ces présupposés. Un exemple de ce qu’il ne faut pas faire peut aider à comprendre a contrario. Dans l’intelligentsia parisienne, il est coutumier de prétendre expliciter une notion par la formule « au sens de » suivie du nom d’un maître à penser, du genre « l’indicible au sens de Didi-Huberman ». Il serait plus économique pour un lecteur qui a autre chose à faire que de lire les maîtres à penser qu’on explicite ce « sens », lequel, du reste, n’est jamais que le produit d’une exégèse de l’œuvre du maître. Malheureusement, la tâche d’expliciter devient rapidement une toile de Pénélope, surtout lorsqu’on s’aperçoit que les notions courantes posent souvent encore plus de problèmes que celles qu’on croyait nécessaire de définir.
Le mieux pour exposer ce point est de se servir de son expérience personnelle. J’ai longtemps utilisé un mot comme « croyance » en imaginant qu’il désigne univoquement quelque chose de facile à appréhender, avant que la lecture d’un penseur comme Ludwig Wittgenstein, puis une discussion avec un anthropologue, Reiner Tom Zuidema, ne m’ouvrent les yeux et ne m’amènent à étudier l’histoire de la notion pour en montrer l’inconsistance[49]. De fait, il suffit de constater qu’on parle en général des croyances des autres, mais plutôt de sa foi, pour comprendre qu’il y a un problème. Il en va de même des mentalités qui caractérisent les primitifs, les gens du Moyen Age et les épiciers, mais rarement les « élites » dont les historiens font bien entendu partie. L’usage dissymétrique de ces notions trahit leur vacuité.
La notion d’atelier en parlant des chantiers médiévaux a moins d’implications éthiques et semble à première vue d’une parfaite neutralité. Je l’ai utilisée comme tout le monde sans y voir le moindre problème, avant de remarquer qu’elle impliquait un présupposé anachronique sur l’organisation du travail avant le XVe siècle : autour d’un maître se serait trouvé un groupe d’élèves ou de disciples dont la production serait parfois difficile à distinguer de la sienne. En fait, selon toute vraisemblance, les sculpteurs et les peintres étaient des maîtres, chacun possédant son style, et ils n’étaient secondés pour les tâches auxiliaires que par un ou deux apprentis et des valets[50]. Dès lors, parler du style d’un atelier, c’est attribuer à un groupe imaginaire ce qui caractérise un individu et cautionner l’idée sotte que l’individu serait né à la Renaissance.
Prise isolément, chacune des erreurs de ce type est évitable, mais il faut se demander combien de notions douteuses échappent encore aujourd’hui à notre vigilance, en rendant caduques des pans entiers de nos raisonnements. Il est impossible qu’il n’en soit pas ainsi.
Malgré leur apparente objectivité, les données quantifiées peuvent poser des problèmes insurmontables. Je n’en ai jamais aussi bien fait l’expérience qu’en étudiant avec une petite équipe les marges à drôleries des manuscrits gothiques entre 1250 et 1350 sur une zone assez homogène: la France du Nord, l’Angleterre et l’actuelle Belgique[51]. Un corpus de 12000 fiches informatiques recensant les drôleries de 80 manuscrits, semblait satisfaire largement au raisonnement statistique. La première idée était d’en tirer la variation des thématiques durant la période par décennies. Un problème est rapidement apparu : certains manuscrits contiennent des enluminures sur à peu près chaque page avec des centaines de drôleries, tandis que seule la page initiale est enluminée dans d’autres. Dans ces conditions, les particularités d’un seul manuscrit affectent le raisonnement général. C’est ainsi que l’un d’eux, le Psautier de Louis le Hutin (Tournai, Trésor de la cathédrale), est abondamment illustré, l’enlumineur ou son commanditaire ayant une prédilection pour les singes. Il s’ensuit que les thèmes simiesques semblent connaître un succès exceptionnel dans la décennie 1310-20, plus exactement en 1316. On ne corrige que très partiellement le biais en passant à la double décennie et, si on choisit un découpage encore plus large et non moins arbitraire, il devient trop lâche pour saisir les évolutions.
Dans ce cas, les chiffres absolus sont donc trompeurs, mais les pourcentages ne valent pas mieux. En effet, dire d’un manuscrit dont une seule page est enluminée de deux drôleries qu’elles sont chacune présente dans 50 % du décor du manuscrit est à la fois correct et absurde. Pour obtenir des résultats significatifs, il a fallu abandonner l’approche quantitative et se contenter d’observer la présence ou l’absence, totales ou presque, d’un thème avant ou après une date, dans un type de manuscrit et pour un type de destinataire (homme ou femme, religieux ou laïc). Cette approche binaire a donné des résultats inattendus et significatifs. C’est ainsi que les drôleries de caractère obscène se répartissent également entre les manuscrits qu’on sait destinés à des hommes ou à des femmes. En revanche, on épargne aux femmes la vue d’animaux répugnants au poil sombre, comme l’ours et le sanglier, tandis que les concerts peu mélodieux de râteaux et autres ustensiles leur sont réservés à une exception près concernant un évêque et restant inexpliquée.
Il y a bien sûr des évolutions chronologiques. Il apparaît par exemple que les concerts discordants apparaissent vers 1300, comme d’ailleurs la pratique du charivari, tandis qu’au même moment se multiplient les scènes de la vie quotidienne, ce qu’on appellera plus tard les scènes de genre, alors qu’elles étaient presque inexistantes auparavant. Mais, contrairement à la répartition des thèmes selon le sexe du destinataire, ce sont là des choses visibles à l’œil nu.
Il ne s’agit pas de renoncer aux recherches quantitatives, mais d’être conscient de leurs limites. D’une part, la fixation des seuils dans un continuum tel que la chronologie relève de l’arbitraire du chercheur et ne peut s’ajuster que sur des considérations pratiques. D’autre part, la quantification exige beaucoup de données homogènes pour permettre des résultats significatifs.
Des différents problèmes que pose l’impact de l’observateur aux sciences, celui de la modification de l’état initial ne concerne donc l’historien que dans des cas limites, comme celui de l’histoire orale. Il est en revanche concerné par l’impact inévitable de ses préconceptions et du découpage qu’il propose de la réalité, y compris lorsqu’il utilise des méthodes quantitatives.
La causalité est-elle une superstition?
Il est banal de le dire: l’historien ne se contente pas de raconter les événements, il en cherche les causes. Mais la causalité n’a pas bonne presse. Elle a été critiquée au moins de trois points de vue.
- Auguste Comte y voyait un glissement de la science à la métaphysique et opposait la recherche du comment à celle du pourquoi. La limite entre le pourquoi et le comment n’est certainement pas facile à tracer, mais on peut supposer que Comte craignait la régression du pourquoi au pourquoi du pourquoi, de la cause à la cause de la cause, laquelle mène rapidement assez loin de la science.
- L’empirisme, en particulier chez David Hume, mettait déjà la causalité en doute, à partir du constat que l’observation répétée d’une relation entre deux événements ne prouve jamais qu’elle soit nécessaire. Effectivement, rien ne prouve que le soleil se lèvera demain (du moins au sens qu’il n’y aura peut-être pas de demain).
- L’impossibilité d’établir un lien causal dans certaines expériences de physique des particules obligerait à ranger la causalité dans le tiroir des accessoires démodés.
Ces objections ont un caractère hyperbolique dont on n’est pas toujours assez conscient. De fait, un savant cherche des causes à partir d’un état initial, plus ou moins correctement appréhendé. Les causes de cet état initial sont une autre histoire. Le cas particulier de la physique des particules tient à l’impossibilité de mesurer cet état, pas forcément à son inexistence. Surtout, les objections empiriste et positiviste ne valent que si on demande à la Science d’énoncer la Vérité (avec des majuscules, bien sûr), plutôt que de nous donner des certitudes suffisantes, d’excellentes probabilités. On pourrait faire l’histoire de cette prétention qui s’enracine certainement dans le conflit entre science et religion à l’époque moderne, la lutte contre le dogmatisme de cette dernière entraînant chez les savants l’ambition de s’y substituer comme détenteurs de la Vérité. Inversement, une épistémologie sceptique s’était mise en place à la fin du Moyen Age, prenant appui à la fois sur l’arbitraire divin et sur les illusions des sens pour relativiser le savoir profane et éviter qu’il ne mette en cause des dogmes comme la conception virginale ou la résurrection du Christ. Dans cette perspective, le fait que les vierges tombent rarement enceintes et qu’on n’assiste pas fréquemment à une résurrection ne prouve rien du tout. Dans la nôtre, celle d’une science qui ne prétend pas détenir la Vérité, mais s’approcher de la vérité de manière probabiliste, cela nous donne une certitude raisonnable que de tels événements n’appartiennent pas à la réalité historique. Comme on l’a dit plus haut, il n’y a pas lieu de se comporter autrement que dans la vie courante: on ne se promène pas avec un parapluie en pleine canicule, bien que les prédictions météorologiques ne soient pas infaillibles.
Si on veut comprendre en quoi la causalité est un problème, il vaut mieux constater qu’on ne peut pas formaliser la conception que nous en avons dans le calcul des propositions et se demander pourquoi. Soit deux propositions:
- Si Napoléon n’était pas mort à Sainte-Hélène, Louis XIV ne serait pas mort dans son lit.
- Si Napoléon n’avait pas été vaincu à Waterloo, il ne serait certainement pas mort à Sainte-Hélène.
L’une et l’autre sont des renversements de l’implication et peuvent se noter: – p > – q. Du point de vue de la logique des propositions, l’une et l’autre sont correctes et signifient une relation telle entre p et q que la fausseté de p entraîne celle de q. Et pourtant, la première semble absurde et la seconde de bon sens. En fait, dans l’univers formalisé du calcul des propositions, il n’y a ni plus ni moins de relation entre deux faits qui semblent indépendants qu’entre deux faits que nous croyons dans un rapport causal. La vérité d’une proposition dépend de celle de toutes les autres. Cela peut vouloir dire que la causalité n’existe pas dans un tel système ou bien encore, que tout y est cause de tout.
Nous n’abordons pas le monde empirique de cette manière. Il est certes impossible d’affirmer qu’il n’y a pas une relation cachée entre la mort de Louis XIV et celle de Napoléon, mais non moins difficile d’imaginer laquelle. Nous considérons donc soit les deux événements comme indépendants soit comme liés par un réseau causal que nous ignorons. En revanche, on voit mal comment Napoléon aurait pu être exilé à Sainte-Hélène s’il avait mis en déroute la coalition de ses ennemis, de sorte que nous considérons sa défaite comme la cause de son exil.
L’apparente contingence du rapport entre la mort des deux souverains peut s’interpréter en termes ontologiques ou épistémologiques. En termes ontologique, nous présupposons le hasard et nous considérons que l’univers n’est pas entièrement déterminé. En termes épistémologiques, nous supposons que les deux événements, tout en n’étant pas la cause l’un de l’autre, sont déterminés par un réseau causal trop complexe pour que nous puissions en rendre compte. Les deux conceptions, indéterministe et déterministe, s’affrontent sans vainqueur ni vaincu, particulièrement dans l’interprétation de la physique quantique. L’une et l’autre ont été formalisées dans des logiques modales qui affaiblissent le calcul des propositions, mais ne semblent pas avoir une grande utilité pratique.
Il ne saurait être question de sous-estimer le problème, mais on peut se demander si la solution change quelque chose au travail de l’historien. Du fait des incertitudes, à commencer par celles qui sont dues aux lacunes des sources ou à leur manque de fiabilité, ce travail sera toujours probabiliste. Il le serait même si l’historien, impressionné par les critiques hyperboliques de la causalité, refusait de dire « parce que ». Le simple récit de faits successifs dont l’enchaînement serait traité comme aléatoire dépendrait encore d’une interprétation des sources disponibles, forcément probabiliste.
Pour comprendre ce qu’on entend par cause, on peut partir de l’opposition entre synchronie et diachronie. Il est raisonnable d’étudier un système en synchronie, dans la mesure où on peut faire abstraction de ses transformations. Les éléments qui le constituent s’expliquent les uns par les autres. S’il fait sombre la nuit, c’est parce que la terre tourne autour du soleil. Jusqu’à Copernic, il était clair que c’était le contraire, que le soleil tournait autour de la terre, mais les deux systèmes expliquent suffisamment l’obscurité nocturne. Or l’approche synchronique ne vaut que pour un système suffisamment stable, car elle fait abstraction de toute évolution. La notion de cause cède le pas à celle d’interdépendance dans un tel système. Mais, si le système était tel qu’il est représenté, il ne changerait jamais, une objection sans conséquence dans l’explication du jour et de la nuit, mais plus dérangeante en linguistique, par exemple.
A contrario, la causalité est ce qui fait passer d’un état de chose à un autre: c’est le moteur de l’histoire. C’est précisément pour cela qu’elle n’a pas cours dans un système formalisé. Or les systèmes formalisés représentaient l’idéal de la connaissance scientifique. Lorsque Gödel pour l’arithmétique, puis Tarski pour la logique, ont prouvé l’impossibilité pour un système de formaliser ses propres présupposés et donc de se clore sur lui-même, cet idéal s’est révélé inatteignable et l’impossibilité de formaliser la causalité ne se révéla plus qu’un aspect de l’impossibilité de tout formaliser. Non seulement l’historien ne peut pas se passer de la notion de causalité, mais il n’a plus de raison de le faire.
Il est rare qu’un historien réfléchisse sur la causalité. Marc Bloch l’a fait à la fin de son livre inachevé sur le métier d’historien[52]. Il est possible que les défaillances de ce texte auraient été au moins en partie surmontées s’il avait eu l’opportunité de le terminer. Il oppose les causes aux conditions du phénomène comme les conditions les plus caractéristiques et par opposition aux conditions qui peuvent rester identiques avant ou après l’événement. On dira qu’une chute en montagne a été provoquée par un faux pas, plutôt que par les lois de la pesanteur, le relief ou le tracé du chemin. Puis il se réfère à François Simiand pour dire que c’est aussi une question de point de vue. Une épidémie aura pour cause le virus selon le médecin, la malpropreté et la mauvaise santé dues au paupérisme pour le philanthrope.
En fait, ce qu’il entend par point de vue pourrait aussi être désigné comme biais. Si on attribue aux dysfonctionnements du système communiste l’accident de Tchernobyl, au tsunami celui de Fukushima, et celui qui risque un jour où l’autre d’arriver en France à une grève, on peut continuer à prétendre que le nucléaire est une technologie maîtrisée. Lors de la pandémie de covid, les médecins la désignaient volontiers comme cause de la mort, ce qui se ressentait dans les statistiques. De fait, la grande majorité des victimes étaient des personnes âgées au système immunitaire défaillant et la cause de leur mort était au moins autant celle-ci que celle-là. Il vaut en effet mieux avoir un bon système immunitaire lorsque circule ce virus qu’un système immunitaire affaibli par l’âge lorsqu’il ne circule pas.
Le plus curieux dans la réflexion de Marc Bloch est l’absence de la définition la plus banale de la cause, à savoir la condition nécessaire et suffisante à la modification de l’état de choses, plus exactement la condition ou la somme de conditions nécessaire et suffisante. C’est ainsi que dans l’exemple précédent, la cause de la mort est la conjonction de la faiblesse immunitaire d’une personne et d’un contact contagieux.
Toujours dans cet exemple, le produit des facteurs définit le moment et le lieu de la cause qui est aussi celui de la modification de l’état de choses, le passage à la maladie mortelle. Autrement dit, il possède les dimensions spatiales et temporelles du phénomène étudié. Il s’agit ici d’un cas individuel, mais si on raisonne sur l’ensemble des contaminations mortelles dues à la pandémie, il s’agit de trouver le produit des facteurs qui correspond à son extension, car il ne se rencontre ni avant, ni après, ni ailleurs.
Pour déterminer la cause d’un phénomène, on observe donc d’abord des corrélations, mais corrélation n’est pas raison. On utilise souvent un exemple plaisant pour l’expliquer: il y a, paraît-il, une forte corrélation entre l’obtention du prix Nobel et la consommation de chocolat, ce qui ne veut pas dire qu’il faut manger du chocolat pour devenir intelligent. En revanche, si on s’interroge sur la corrélation, qui est sans doute l’indice de quelque chose, on fera par exemple l’hypothèse que le nombre de prix Nobel par habitants et la consommation de chocolat dépendent l’un et l’autre du niveau de vie. L’hypothèse vaut ce qu’elle vaut, mais elle est réfutable si elle est fausse.
Ces remarques qui relèvent du simple bon sens obligent à s’interroger sur la délimitation des sujets de recherche par les historiens, entre autre sur les études de cas. Il n’y a pas de raison de les fustiger a priori, car il faut bien prendre un matériau par un bout et analyser méticuleusement un dossier bien délimité peut être un bon point de départ pour embrasser un problème plus général. Cela dit, la solution du problème ne peut guère apparaître que par la confrontation du dossier avec d’autres, de sorte qu’il faut ouvrir beaucoup de dossiers pour en comprendre un seul. Isoler un cas sans s’assurer qu’on ne le sépare pas de ce qui le détermine et de ce qu’il détermine est certainement la manière la plus sûre d’échouer. Bien sûr, on peut s’appuyer sur la littérature secondaire consacrée aux dossiers voisins, mais s’il s’agit aussi d’études de cas, le résultat risque d’évoquer la parabole des aveugles.
Un exemple suffira, en l’occurrence un problème de chronologie dont la solution ne repose pas tant, comme dans le cas auvergnat, sur la multiplication de probabilités négatives que sur la restitution d’un réseau de relations causales. Travaillant sur le jubé de la cathédrale de Strasbourg, j’avais toutes les raisons de le supposer achevé en 1252, comme d’autres l’avaient établi. Par ailleurs sa sculpture dépendait de celle des portails de la façade occidentale de la cathédrale de Reims, ce dont personne ne doutait. Or cette façade était désormais datée après 1252 dans un beau consensus des spécialistes. Cela m’amena à reprendre progressivement le dossier rémois, lourd et complexe. En fin de compte, je parvins à dater l’achèvement de l’édifice en 1234, sauf les quatre premières travées de la nef et la façade, soit une vingtaine d’années plus tôt qu’on le supposait, et le début de la construction de la façade en 1240, soit une quinzaine d’années plus tôt[53]. Cette conclusion a été rendue possible par l’examen d’un bon nombre d’autres dossiers, mais aussi en m’appuyant sur quelques excellents travaux qui auraient déjà dû semer le doute. Voici la liste très hétérogène des principaux constats successifs qui, de 1998 à 2017, me permirent cette révision:
- La datation tardive de la façade se fondait sur une erreur de diplomatique, celle de prendre un vidimus pour le renouvellement d’un bail, alors qu’il n’est qu’une copie conforme de ce bail.
- La datation tardive de la façade de la cathédrale d’Amiens qui entraînait celle du chantier rémois était également fondée sur une mauvaise lecture des textes.
- Celle du jubé de la cathédrale de Bourges avait déjà été corrigée par la bonne lecture d’un texte.
- A Reims, les fouilles archéologiques ont démenti la conservation de l’ancienne façade au-delà des années 1220 et donc la supposition que le choix de la remplacer était tardif.
- C’était la sculpture du portail Saint-Étienne à Notre-Dame de Paris qui dépendait de Reims et non l’inverse.
- Il avait été remarqué que la décision de donner au chevet un volume considérable supposait d’y placer le maître-autel, tandis que l’allongement de la nef supposait qu’on avait changé d’avis. La volte-face ne pouvait guère s’expliquer que par la mort de l’archevêque Henri de Braine en 1240 et l’interrègne qui a suivi, donnant tout le pouvoir aux chanoines.
- Il était impossible de croire que la révolte des bourgeois en 1234 n’avait pas interrompu le chantier, d’autant plus qu’on venait de démontrer grâce à la pétrographie que des tailleurs de pierre rémois s’étaient alors rendus sur le chantier de Noyon avec des matériaux qui provenaient du leur.
Comme on le voit, plusieurs de ces constats donnaient des doutes sur une chronologie trop facilement acceptée, mais c’est l’établissement de nouvelles relations causales à l’intérieur d’un large ensemble qui a permis de lui en substituer une autre. Autrement dit, la causalité est un réseau complexe qui chevauche à la fois les limites monographiques qu’on voudrait donner à un sujet et celles des disciplines.
Inter- et pluridisciplinarité
Dans l’exemple précédent, les disciplines mises à contribution sont, en dehors bien sûr de l’histoire de l’art, la diplomatique, l’archéologie, la pétrographie, la liturgie, l’histoire générale. Aurait-il été possible d’obtenir le résultat en organisant l’un de ces colloques interdisciplinaires qui sont à la mode? C’est peu probable, car pour inviter les spécialistes nécessaires, il aurait fallu savoir avant d’avoir fait ces constats où pouvaient se trouver les réponses, connaître, par exemple, l’étendue exacte des fouilles, penser que le problème liturgique de l’emplacement du maître-autel était pertinent, se douter que des tailleurs de pierre rémois ont pu se rendre à Noyon. Or ce sont des questionnements qui apparaissent l’un après l’autre durant la longue maturation d’une recherche. On ne peut qu’être frappé par la faible fécondité des colloques interdisciplinaires où les différents spécialistes ont le plus grand mal à s’appuyer les uns sur les autres et parviennent à des résultats disparates, comme s’ils ne s’étaient pas rencontrés. La rareté des références croisées montrant qu’un chercheur s’est appuyé sur la communication d’un autre témoigne plutôt d’une tendance au solipsisme.
L’organisation même des colloques encourage cette attitude. Les communications ne sont découvertes par les collègues que lorsqu’elles sont prononcées, puis discutées à chaud de manière forcément superficielle. On considère comme allant de soi qu’elles aient été terminées en dernière minute, éventuellement dans l’avion la veille au soir. Le simple bon sens voudrait pourtant qu’elles puissent être livrées à chacun des participants un mois auparavant, sous peine que leurs auteurs s’excluent du colloque. On voit mal comment de véritables échanges pourraient avoir lieu sans cette obligation.
Il n’en resterait pas moins qu’il est difficile d’éviter aussi bien un excès de méfiance que de crédulité envers les résultats d’une discipline qu’on ne domine pas. Généralement, la crédulité croît à mesure qu’on s’approche des sciences de la nature et la méfiance en sens inverse. En général, la confiance est totale envers la dendrochronologie et les exceptions sont bien rares. Rejetant dans une note les deux datations successives et contradictoires qu’elle a données de la galilée de l’abbatiale de Tournus, Alain Guerreau l’estime non fiable pour les objets antérieurs au XVIIe siècle, se fondant sur la complexité et l’opacité des calculs probabilistes mis en œuvre, et laisse espérer qu’il donnera une analyse plus poussée de ses méthodes[54]. Un groupe d’archéologues travaillant sur plusieurs vestiges romains à Tours a fait appel à la dendrochronologie et obtenu des datations présentant un écart d’un demi-siècle environ avec les leurs[55]. Ils organisèrent une table-ronde avec les dendrochronologues concernés, laquelle ne permit de déceler aucune faille méthodologique ni d’un côté ni de l’autre, puis eurent l’excellente idée de faire connaître la situation par un article.
Quel que soit le bien-fondé du verdict radical d’Alain Guerreau, on notera qu’il est rendu possible par une familiarité exceptionnelle chez un historien avec les méthodes du calcul des probabilités. Autrement dit, un scepticisme raisonné envers les résultats d’une autre discipline demande un certain degré de compétence pluridisciplinaire. Plus généralement, le bon usage de l’interdisciplinarité suppose le plus souvent ce degré de compétence, ce qui est généralement incompris, parce que l’interdisciplinarité est pensée comme un remède à l’incompétence. Il ne s’agit pas là d’une erreur propre aux sciences humaines. On en a eu un bel exemple récent, lorsque la prestigieuse revue The Lancet publia, puis dut retirer, un article prétendant dénoncer les méfaits de l’hydroxychloroquine dans la thérapie du covid-19[56]. Les auteurs s’appuyaient sur une base de données en trompe-l’œil fournie par une société spécialisée dénommée Surgisphère. Entretemps, les recherches de l’Organisation mondiale de la Santé concernant ce traitement avaient été interrompues sur la foi de cet article et il avait été interdit en France. L’utilisation si fréquente dans les sciences de banques de données dont on ne contrôle pas la production n’est légitime que si l’on est en mesure d’en évaluer le sérieux.
Il est vrai également qu’on est obligé dans certains cas de faire confiance, car l’effort que demanderait la compréhension de certaines disciplines deviendrait énorme. Dans l’exemple proposé plus haut de la cathédrale de Reims, il va de soi que je ne maîtrise pas les techniques de la pétrographie. Mais je n’ai aucune raison de douter qu’elle parvient à identifier la carrière dont les pierres sont tirées.
Les découvertes se font le plus souvent au croisement des disciplines. Lorsque les spécialistes ont tiré ce qu’ils pouvaient sur un problème dans le domaine qu’ils maîtrisent, il y a toutes les chances que ce qui leur échappe soit là. Or, lorsqu’on s’adresse au spécialiste voisin, celui-ci aurait bien des éléments de réponse s’il comprenait exactement ce qu’on cherche, alors qu’on ne le sait souvent soi-même que confusément. La rencontre entre disciplines permettant de résoudre le problème ne peut se faire qu’à deux conditions. Soit on connaît soi-même suffisamment les deux disciplines pour se passer de collaborations ; soit deux spécialistes en savent assez l’un sur la discipline de l’autre pour se faire comprendre et pour comprendre l’autre. Il ne peut y avoir d’interdisciplinarité sans un minimum de pluridisciplinarité. Bien entendu, cela concerne toutes les sciences.
La vérification des références
Qu’il s’agisse d’obtenir des renseignements dans sa spécialité ou dans une autre, le travail de base de l’historien est d’abord de lire les sources et la littérature secondaire. Les notes de bas de page en portent témoignage, pour autant qu’il s’agisse de références bibliographiques exactes et éventuellement de commentaires critiques sur les ouvrages consultés, non pas des adjonctions au texte principal du genre: « j’ai oublié de vous dire que… ». Ce sont elles qui rendent le travail de l’historien reproductible et permettent donc de le vérifier, à la manière dont la publication de l’ensemble des manipulations réalisées permet de reproduire une expérience. Elles sont donc pour la scientificité de l’histoire à la fois une exigence et une garantie.
Qu’on n’objecte pas qu’il s’agit là d’une conception « positiviste » de l’histoire, que l’histoire est interprétation et que les notes ne garantissent donc pas sa validité. Les sciences « exactes » interprètent aussi les phénomènes et, dans l’interprétation des données, les questions sont les mêmes: est-ce que leur récolte est fiable? est-ce que face aux données fiables, l’interprétation proposée est la meilleure possible?
Quant à la fiabilité des données, il s’avère que la vérification des notes est pratiquement toujours féconde, y compris dans les travaux réputés sérieux. Il s’agit là d’un travail tatillon et il ne saurait être question de vérifier une à une le millier de notes que peut contenir une thèse de doctorat. Cela n’a de sens que pour les allégations qu’on voudrait accepter ou réfuter. L’expérience m’a appris qu’on y avait facilement 10 % de surprises. Plus encore, l’absence de références adéquates pour soutenir une affirmation factuelle, lorsque le reste est correctement référencé, indique fréquemment une difficulté et suffit à rendre l’affirmation suspecte. Lorsque la note cite une source dans une langue ancienne, ou qu’en remontant d’une publication à l’autre, on finit par trouver cette source, le nombre de contresens est parfois étonnant. C’est rarement du temps perdu.
Un aspect plus subtil de la vérification consiste à se demander pourquoi un auteur dit ceci ou cela. Passons sur les cas triviaux, ainsi lorsqu’il s’agit d’un préjugé nationaliste ou d’un chauvinisme provincial. Dans le cas de la cathédrale de Reims, comme je l’ai dit, la supposition que la révolte des bourgeois n’avait pas affecté le chantier était franchement bizarre. Comment le chantier n’aurait-il pas été interrompu, alors que l’archevêque, le chapitre et les bourgeois n’ont cessé de s’affronter de 1234 à 1240, les bourgeois contre l’archevêque et le chapitre qui ont dû s’exiler, puis le chapitre et les bourgeois contre l’archevêque? Mais cette question en amène une autre : quelle raison les auteurs favorables à la datation tardive pouvaient avoir à prétendre cela ?
Lorsqu’un chantier s’arrête, les tailleurs de pierre et les maçons sont bien obligés d’aller trouver du travail ailleurs et, lorsqu’il reprend, il faut reconstituer une équipe. Cela se marque dans le monument par un changement de style : les nouveautés apparues sur d’autres chantiers apparaissent soudainement dans le monument. Dans le cas de Reims, il y a une grande continuité stylistique dans le plus gros de la nef et une rupture évidente sur la façade Est et dans les quatre premières travées de la nef qui lui sont contemporaines. Or cette rupture était située selon ces auteurs après 1252. Il ne pouvait donc être question pour eux d’admettre l’interruption du chantier en 1234, car elle explique la rupture stylistique et dément leur chronologie. C’était finalement l’interrogation sur la négation aussi paradoxale que péremptoire de cette interruption qui menait à la solution du problème.
Croissance de la documentation et exhaustivité
L’exhaustivité bibliographique est une notion qu’on peut comprendre de diverses manières et qui est toujours relative. Il va de soi qu’elle est impensable pour une étude très générale, du genre « Politique et religion au XVIIe siècle ». Mais, même dans une telle étude, il est souhaitable d’explorer toutes les sources et toute la littérature secondaire pertinentes sur les cas particuliers jugés décisifs, par exemple sur l’évolution des idées religieuses de Louis XIV.
L’une des limites à l’exhaustivité bibliographique est due à la croissance de la documentation dans certains domaines. Elle est extrêmement variable. Le cas le plus monstrueux que j’ai rencontré concernait Luther, déjà dans les années 1970. Il était le plus souvent impossible de savoir si un ouvrage méritait l’attention. La grande majorité d’entre eux mêlaient de la pire manière l’histoire à la théologie et à l’apologétique. Les plus récents le faisaient autant que les plus anciens, mais généralement avec une moindre compétence historique. Dans l’impossibilité de tout lire, j’étais passé à côté d’un petit livre de qualité qui m’aurait été bien utile, celui de Peter Blickle sur la Guerre des paysans[57].
Une autre limite à l’exclusivité des bibliographies est leur caractère non cumulatif. Il est normal qu’on ne cite pas tout, qu’on écarte de sa bibliographie les ouvrages qu’on juge insignifiants, voire totalement dépassés. Mais, comme on l’a vu à propos de Luther, il arrive aussi qu’un ouvrage soit supposé dépassé parce qu’il ne plaît plus, dans ce cas ceux de Heinrich Denifle et de Hartmann Grisar, pourtant fondamentaux. C’est ainsi qu’un texte non moins fondamental m’avait échappé jusqu’à une date récente. L’ouvrage d’Arthur Kingsley Porter, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads (qu’on ne lit plus, mais qu’on consulte pour les photographies et les notices) s’ouvre par un exposé de ses principes méthodologiques dans l’étude de l’art roman[58]. Il y remarque qu’on se plaint de la rareté des édifices datés par des textes, mais qu’on ne tient pas compte des dates que ceux-ci nous livrent, les trouvant généralement trop précoces par rapport au style du monument et considérant soit que le chantier avait traîné, soit qu’elles concernent une construction antérieure. Cela s’explique par une réaction contre l’historiographie locale et sa tendance à vieillir exagérément les monuments, une attitude qui passe donc pour vertueuse, alors qu’elle met en œuvre une théorie implicite selon laquelle il y aurait eu un progrès artistique linéaire. Il est stupéfiant de constater que, malgré la correction de certaines dates, la situation décrite par Porter est toujours actuelle et que j’ai été amené à répéter sans le savoir, parfois mot pour mot, le constat du savant américain, ce qu’aucun de mes contradicteurs n’a relevé[59].
Quels que soient les dangers qu’il fait courir à la société, le développement d’Internet a au contraire eu des conséquences positives sur la discipline par l’apparition de moteurs de recherche qui, loin d’être faits pour l’historien, lui rendent néanmoins de gros services. Certaines recherches sont certes difficiles, lorsqu’elles portent, par exemple, sur un personnage dont le nom se confond avec celui d’un joueur de football. Mais, si on cherche en revanche un bout de phrase en latin, il y a beaucoup de chances de trouver une référence utile, soit la source, soit une utilisation dans la littérature secondaire.
Par ailleurs, la numérisation des ouvrages vieux de plus d’un siècle a progressé rapidement de manière exponentielle pour le plus grand bonheur de l’historien. Lorsqu’il cherche les œuvres d’un érudit bénédictin de l’Ancien Régime, il est à peu près certain de les trouver. La masse globale des ouvrages anciens étant dérisoire par rapport à ce qu’on a écrit depuis, c’est tout bénéfice. Le temps gagné par rapport à la consultation dans les bibliothèques les mieux fournies est énorme. Il est encore démultiplié par l’indexation électronique des contenus. Lorsqu’on travaillait, il y a une trentaine d’années, sur les plus de deux cent volumes de la Patrologie latine de Jacques-Paul Migne avec ses index malcommodes, il était quasiment impossible de faire une recherche tant soit peu exhaustive sur l’évolution d’une notion ou d’une idée. Aujourd’hui, c’est enfantin.
En bref, l’apport d’Internet est un changement dans le travail de l’historien qu’on peut juger sans restriction comme positif. Il rend dans bien des cas disponible l’ensemble des sources et de l’ancienne érudition concernant le sujet traité.
Ce survol du problème de la scientificité de l’histoire nous a permis de nous débarrasser des positions de principe qui prétendent l’exclure des sciences et de passer à une question plus pertinente: quelles sont ses conditions de scientificité? Cela nous a menés à des remarques de plus en plus triviales sur l’interdisciplinarité, les notes de bas de page et la vérification des résultats supposés acquis. Mais une interrogation comparable sur les sciences dites dures aurait pu se conduire dans le même ordre, car leur principale faiblesse aujourd’hui est la rareté des vérifications consistant à recommencer les expériences pour voir si elles sont reproductibles, un travail moins gratifiant que l’invention de théories aussitôt qualifiées de vérités scientifiques, mais indispensable. Dans le cas de l’histoire, la vérification des notes et l’élargissement de la base documentaire sont aussi une manière de tester les théories à travers ce qui y tient lieu d’expériences.
![]()
L’histoire comme sémantique
On ne peut réduire l’histoire à l’étude des textes ou de l’ensemble des documents, textuels ou non. Elle comprend en tout cas l’archéologie. Mais l’étude des documents en reste l’essentiel. Ces documents, images comprises, possèdent une syntaxe et une sémantique. En utilisant une forme de langage, ils délivrent intentionnellement un contenu, ce qui n’est pas le cas des indices laissés involontairement à l’archéologue par les hommes du passé. Une charte s’adresse à des destinataires pour leur dire quelque chose. Le contenu d’un dépotoir nous livre des informations non moins précieuses, mais ne s’adresse ni à ses contemporains, ni à nous. Il ne témoigne d’aucune autre intention que de se débarrasser d’objets détruits ou dépourvus de valeur.
Le problème qui nous occupe ici n’est pas psychologique, comme le mot « intention » pourrait le laisser entendre. Avant de se demander dans quelles intentions est produit un objet, il s’agit de se demander s’il a une signification intentionnelle, s’il est un document. Les objets produits par l’homme ont évidemment une organisation intentionnelle, mais l’intention n’est pas toujours de signifier, d’envoyer un message. On n’enfonce pas un clou avec un marteau sans intention, mais ce n’est pas celle de signifier quelque chose. L’archéologue restitue l’organisation d’un édifice et lui donne une certaine signification: cela ne veut pas dire que l’édifice a été conçu pour signifier. Il arrive que ce soit le cas. C’est ainsi que le décor de l’opéra Garnier utilise des motifs de lyres pour que les archéologues du futur devinent sa fonction[60]. Mais il s’agit là d’une intention peu probable avant le développement de l’archéologie. En revanche, un document est produit pour être compris, organisé pour que le récepteur retrouve aussi exactement que possible la pensée de l’émetteur. Il convient donc de définir un document par une organisation signifiante a priori, en l’opposant à des indices qui n’ont d’organisation signifiante qu’à travers l’interprétation a posteriori de l’archéologue.
Signification et sens
Les sémiologues ne se sont jamais mis d’accord sur la manière de définir la signification et le sens et sur ce qui les distingue[61]. Je propose les définitions suivantes:
- La signification d’un message hors contexte. Si je lis l’énoncé « Paul aime les mirabelles » hors contexte, sans savoir de qui on parle, il est incomplet, mais il dénote quelqu’un que je ne connais pas et des fruits familiers, à l’aide de deux termes mis dans une relation signifiante. Néanmoins, je n’en comprends pas le sens, car je ne sais ni à qui il s’adresse, ni pourquoi. Même un énoncé dont la signification est complète, comme « il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade », n’a pas de sens hors contexte. Il peut s’agir d’une affirmation très générale, d’une allusion à la situation d’une personne que je ne connais pas ou tout aussi bien, comme dans ce texte, être livré comme exemple d’énoncé valide hors contexte. En pratique, l’historien et l’archéologue peuvent se trouver devant des inscriptions dont la lecture ne pose pas problème, mais dont le sens intentionnel leur échappe, alors que le contexte le rendait évident aux contemporains.
- La signification en contexte peut être qualifiée de sens intentionnel. A moins que les éléments du contexte soient immédiatement disponibles, le locuteur livre ceux qui sont nécessaires à la compréhension du message, soit de manière linguistique, par exemple en utilisant un pronom pour renvoyer au sujet de la phrase précédente, soit par des procédés non linguistiques, comme la monstration d’un objet du doigt pointé pour donner la référence d’un pronom. Les anaphores et les déictiques qu’il a mis en œuvre sont des signes intentionnels, directement compréhensibles si le locuteur et le récepteur du message sont compétents, à supposer que le locuteur souhaite être clair, car un message peut aussi relever de l’euphémisme, de l’insinuation ou même de la devinette. Les déictiques par lesquels ce locuteur désigne un contexte peuvent certes être qualifiés d’indices, mais doivent être bien distingués des indices non intentionnels. Les traces du gibier dans la neige peuvent être aussi claires que des signes intentionnels, mais elles n’en sont pas, car le gibier ne les fait pas pour faciliter la tâche aux chasseurs. En revanche, le chasseur qui désigne du doigt les traces les indique intentionnellement à ses compagnons.
- Le sens non intentionnel est celui que le locuteur ne cherche pas à livrer. C’est l’interprétation que nous faisons à tort ou à raison du message, par exemple comme un mensonge ou une vantardise, de la même manière que nous interprétons à tort ou à raison les nuages comme annonciateurs de la pluie.
Il importe de distinguer clairement le sens intentionnel, celui d’un message quelles que soient par ailleurs les intentions du locuteur, du sens de l’indice non intentionnel. La bonne réception d’un message intentionnel bien construit n’est pas une interprétation, comme le veulent les courants herméneutiques, à moins bien sûr que le message soit sibyllin, c’est-à-dire construit pour exiger des interprétations. Même une devinette ne demande pas d’interprétation lorsqu’elle possède une solution unique, alors que les interprétations sont par nature multiples. Rien ne montre mieux la différence entre la réception d’un message et son interprétation que l’objection du locuteur lorsqu’on comprend autre chose que ce qu’il veut dire, car il reproche précisément à son interlocuteur d' »interpréter » ce qu’il a dit.
Bien entendu, la distinction entre recevoir un message et l’interpréter n’est pas toujours évidente dans une situation pratique, qu’il s’agisse d’une conversation dans un lieu bruyant ou de la lecture d’un texte dont nous ne connaissons qu’imparfaitement la langue. La compréhension d’un texte du passé pose en principe plus de problèmes que celle d’un texte contemporain. Mais cela ne justifie ni la confusion, ni l’amalgame entre ce qui est de l’ordre de la réception d’un message et de son interprétation au nom d’un prétendu cercle herméneutique. Lorsque le sens intentionnel d’un texte nous est inaccessible pour des raisons accidentelles, ce n’est pas une raison pour faire comme s’il n’existait pas. Un texte quel qu’il soit possède un sens intentionnel irréductible aux interprétations qui ont pu se greffer sur lui.
La rhétorique des textes est certainement ce qui donne le plus de fil à retordre à l’historien. Faut-il prendre un énoncé au sens littéral ou au sens figuré? La réponse est souvent évidente, mais pas toujours, car il peut y avoir une double entente, grâce à laquelle son auteur dit une chose et en suggère une autre. Il faut parfois supposer une intention humoristique à des énoncés ordinairement pris au sérieux. C’est ainsi que l’humaniste Henri Cornelius Agrippa a écrit un ouvrage sur la supériorité du sexe féminin dans lequel il utilise volontiers des arguments équivoques[62]. On y apprend par exemple que les femmes sont plus pudiques que les hommes, parce qu’elles tombent toujours sur le dos! De deux choses l’une : ou bien Agrippa ne s’est pas rendu compte de l’équivoque, ou bien il a fait intentionnellement un double sens obscène. Le goût du paradoxe qui domine ce genre de littérature depuis l’Eloge de la folie d’Erasme nous fait choisir la seconde solution. Or il ne s’agit pas de deux lectures également légitimes. Même sans savoir laquelle, on peut affirmer que l’une des deux est la bonne.
Ce qui est dit ici des textes vaut aussi pour les images. On reconnaît en effet dans la distinction du sens intentionnel et non intentionnel les deuxième et troisième niveaux de la méthode iconographique d’Erwin Panofsky[63]. Le premier niveau est purement descriptif. Le deuxième correspond à la compréhension de ce que l’artiste exprime et donc à la lecture de l’œuvre qu’il approuverait. Le troisième n’est pas prévu par l’artiste. Il s’agit cette fois d’interpréter l’œuvre pour la situer historiquement, entre autres pour en dévoiler les intentions. Panofsky utilise avec raison le mot de symptôme pour désigner ce qu’on cherche alors dans l’œuvre.
Langage, métalangage et anachronisme
L’histoire ne répète pas et ne pastiche pas les textes du passé, mais elle les cite, les analyse et en tire des renseignements. Dès lors, elle travaille sur un langage avec son langage à elle. Il y a donc lieu de parler du langage-objet, celui des documents étudiés, et d’un métalangage, celui de l’historien. C’est là faire un usage assez large de la notion de métalangage, puisqu’il s’agit ici d’un langage qui est au mieux peu formalisé, mais on ne voit pas comment appeler autrement le langage avec lequel on en étudie un autre.
Le métalangage contient nombre de termes qui n’ont pas d’équivalents dans le langage-objet, comme les termes techniques de la paléographie, de la diplomatique ou des statistiques chez le médiéviste. Mais il en contient plus encore qui sont identiques, certains avec la même signification, d’autres avec une signification différente, d’autres enfin dont le sens ancien survit dans l’une de leurs acceptions. C’est ainsi qu' »épée » n’a pas changé de signification, alors que « faire l’amour » signifiait « faire la cour » et que le sens médiéval de « religion » survit dans « entrer en religion ». Les mots ne sont pas des concepts, de sorte que le même mot renvoie à des concepts plus ou moins différents selon le contexte et d’une époque à l’autre.
L’utilisation du métalangage n’est pas l’anachronisme. La notion de classe sociale n’apparaît qu’au début du XIXe siècle et semble progressivement disparaître dans la seconde moitié du XXe, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de classes sociales avant et qu’elles ont disparu depuis. Il est aussi possible qu’elles n’aient jamais existé. Tout dépend de ce qu’on entend par classe sociale. Si cela suppose une conscience de classe, une solidarité totale à l’intérieur de cette classe et un antagonisme frontal avec les autres, il s’agit sans doute d’un objet rare. Si on la définit simplement par rapport à la possession des moyens de production, il s’agit de quelque chose d’assez commun et d’une notion qui garde tout son intérêt. Il serait en effet absurde de ne pas voir de différence de statut social entre un laboureur, c’est-à-dire un paysan possédant sa terre, un fermier et un métayer.
Sans parler de langage et de métalangage, Marc Bloch distingue clairement les deux niveaux de langage d’un texte historique[64]. Il note d’abord l’instabilité du langage-objet, avec des exemples comme servus, désignant tour à tour l’esclave et les formes les plus variées de servage, de sorte que leur substitution au langage de l’historien est impossible. Mais ce langage-ci est aussi un héritage historique et il est difficile de donner une définition univoque de mots comme « féodal » ou « capitalisme », chargés de sens divers, mais aussi de trop de connotations. L’historien n’a pas la possibilité de recourir, comme le chimiste, à des symboles issus d’un consensus entre savants. Mais il faut aussi remarquer que les physiciens, par exemple, ont un problème comparable dès qu’ils s’expriment en langage naturel: un atome est supposé indivisible par son étymologie, mais ils n’arrêtent pas de les disséquer. Enfin, si on suppose un langage suffisamment purifié, il reste une difficulté qui mène à l’anachronisme. C’est ainsi que dans l’étude du servage, Bloch relève que des mots comme « demi libre » en viennent à remplacer l’analyse. De fait, les hommes étaient libres ou ne l’étaient pas: il s’agissait toujours d’une dichotomie et c’est la notion de liberté qui était fluctuante.
Sur ce point, la distinction implicite entre le langage-objet et le métalangage est en défaut chez Marc Bloch. Il n’y a en fait anachronisme que si on prête la notion de « demi libre » au langage-objet et, à supposer que cette notion soit utile dans le métalangage, il serait facile de régler le problème en précisant que ce qu’on appelait « liberté » n’était parfois qu’une demi liberté. En revanche, dès qu’un mot prend une couleur un peu technique, il y a effectivement des risques sérieux qu’il se substitue à l’analyse. L’exemple déjà signalé d' »acculturation » est typique.
La confusion entre les deux niveaux de langage, occasionnelle cher Bloch, est devenue assez générale ces derniers temps, comme en témoigne la fausse querelle sur l’anachronisme. Au départ, comme l’explique Nicole Loraux, il y a une réaction contre la fausse proximité avec le passé, due à la fiction d’un éternel humain qui nous permettrait de comprendre spontanément les Anciens[65]. Cette réaction se manifestait, par exemple chez un helléniste comme Jean-Pierre Vernant, par une tendance à truffer ses textes de mots grecs transcrits. Au lieu de traduire métis par « intelligence rusée » ou peithô par « persuasion », on se mit à utiliser le mot grec pour bien montrer que ce n’était pas exactement la même chose. Nicole Loraux plaide au contraire pour l’intérêt des similitudes en prenant l’exemple de l’amnistie. Qu’il s’agisse de celle d’anciens collaborateurs français des nazis ou celle qui a suivi en 403 avant J.-C. la chute du régime oligarchique des Trente à Athènes, il s’agit au fond de la même chose, du choix de la paix civile plutôt que du châtiment des crimes. Ces réflexions débouchent sur un éloge de l’anachronisme.
Notons d’abord que le choix entre peithô et « persuasion » n’est guère qu’un problème de rhétorique, une fois explicitées les différences éventuelles entre la conception grecque du phénomène et la nôtre. Il n’en va pas toujours de même. Il paraît difficile de se satisfaire du mot « amour » pour parler de l’éros ou de l’agapè, car le Moyen Age a réuni les deux notions, tant celle d’amour charnel que celle d’amour du prochain ou de Dieu, et nous a transmis l’équivoque. Avec l’exemple de l’amnistie, Nicole Loraux soulève un vrai problème. Y a-t-il dans ce cas une différence essentielle entre le comportement des Grecs et le nôtre? Bien sûr, l’histoire ne se répète pas à l’identique, mais les différences de comportement dans un tel cas pourraient bien n’être qu’accidentelles. Après avoir vénéré l’éternel humain, les historiens ne sont-ils pas devenus dévots du changement perpétuel ? Il est inutile de trancher sur le problème de l’amnistie pour en arriver à une conclusion sûre. Ou bien des différences significatives existent entre le phénomène passé et celui d’aujourd’hui, auquel cas la confusion des deux est anachronique et condamnable; ou bien il n’y en a pas et ce sont alors les distinctions inutiles qui constituent l’anachronisme. Lorsque Lucien Febvre prétendait que le sens de la vue était moins développé au XVIe siècle qu’il ne l’est aujourd’hui, c’est lui qui commettait ce qu’il appelait « le péché des péchés entre tous irrémissible: l’anachronisme »[66].
Nicole Loraux n’est pas seule à partir d’une conception malheureuse de l’anachronisme, léguée par des historiens de la génération précédente, pour qualifier d’anachronisme ce qui ne l’est pas. Georges Didi-Huberman, dont il ne serait pas question ici s’il n’arrivait que des historiens le prennent au sérieux, part de l’évidence que l’œuvre continue à vivre loin de son contexte originel et change de sens en changeant de contexte[67]. Dans ces conditions, l’anachronisme serait inévitable et constituerait même la condition d’existence d’un discours sur l’image ou sur l’art. L’œuvre vivrait dans l’achronie. Ici encore, on est épouvanté par les confusions de quelqu’un qui passe pour philosophe. Sa notion d’anachronisme mêle en effet au moins trois problèmes différents:
- Il est absurde de parler d’anachronisme lorsqu’un œuvre s’inspire de celles d’un passé même lointain. Il n’y a rien d’anachronique dans l’imitation de l’Antiquité au Moyen Age ou à l’époque moderne, car l’anachronisme est, jusqu’à nouvel ordre, une erreur relative au passé. Il y a par exemple anachronisme lorsqu’on croit une œuvre inspirée par une autre qui lui est postérieure, ce qui arrive souvent lorsque la chronologie est mal assurée. Autant dire qu’il y a un ordre implacable du temps dans lequel les œuvres s’inscrivent, mais il est plus difficile de dater les œuvres que de disserter sur l’achronie.
- Il n’y a rien d’anachronique dans les décalages culturels ou techniques. Il faut bien que les innovations prennent un certain temps et tous les ménages du XXe siècle n’ont pas bénéficié de la machine à laver en même temps.
- Lorsque les étranges zones colorées que Fra Angelico dispose dans ses retables rappellent Jackson Pollock à Didi-Huberman, il n’y a pas plus d’anachronisme que dans n’importe quelle association d’idées plus ou moins farfelue. L’anachronisme commence lorsqu’il interprète ce que dit Denys l’Aréopagite des images dissemblables comme une incitation à pratiquer l’art abstrait[68]. Il suffisait de lire cet auteur avec un minimum de sérieux pour s’apercevoir qu’il parlait d’images figuratives, de sorte que son influence sur l’art encourageait la figuration du divin. On peut qualifier d’image dissemblable le taureau ailé qui sert de symbole à saint Luc, en aucun cas un jeu de tâches colorées.
« Anachronisme » est un mot du métalangage de l’historien. Le Trésor de la langue française le fait remonter à Gabriel Naudé qui est précisément un historien, en tout cas un érudit, et le définit comme le fait de placer un fait, un usage ou un personnage dans une époque autre que la sienne. Il mentionne aussi un usage du mot par extension au XXe siècle, celui d’un décalage culturel ou technique. Mais la confusion du sens originel et du sens dérivé est le meilleur moyen de rendre le métalangage inopérant. Les podologues ne soignent pas les pieds des tables.
La logique de l’historien
L’historien est loin de toujours disposer de données formalisables en termes mathématiques, comme le langage des probabilités, et plus rarement encore en termes logiques, en dehors précisément de l’histoire de la logique. Mais cela ne met pas l’historien à l’abri des problèmes logiques et il en rencontre parfois de très ardus, le plus souvent sans les voir.
Le rejet de l’implicite
C’est souvent dans l’implicite que se cachent les problèmes, principalement dans l’absence de définitions claires. On sait bien que l’historien ne peut pas définir chaque mot qu’il emploie et, en fait, la plupart des imprécisions sont sans conséquences. Pour dire que Philippe Auguste a gagné la bataille de Bouvines, il n’y a pas besoin de fixer le champ de bataille sur une carte. Au contraire, l’abondance de précisions non pertinentes est une faute qui dilue le raisonnement lorsqu’il y en a un. Le problème, nous l’avons vu, est d’abord celui des notions mal définies qui se substituent à l’analyse ou la polluent, comme « croyance » ou « mentalité ». Contentons-nous ici de l’exemple simple d' »apotropaïque », assez à la mode aujourd’hui avec sa coloration anthropologique. Il suffit d’ouvrir un dictionnaire pour s’apercevoir qu’on ne sait pas très bien de quoi on parle. Selon le Larousse, cela « se dit d’un objet, d’une formule servant à détourner vers quelqu’un d’autre les influences maléfiques ». Le Robert a mis le temps à accepter le mot et le définit simplement comme « ce qui conjure le mauvais sort ». Enfin Wikipedia fait plus ou moins la synthèse: « ce qui conjure le mauvais sort, vise à détourner les influences maléfiques ».
Les deux premières définitions peuvent être utilisables si on se tient à l’une ou à l’autre. La première inclut des images effrayantes comme les têtes de Gorgones, obscènes comme le phallus, ou encore celles d’un objet de supplice comme la croix, lorsqu’on les porte sur soi pour renvoyer le mauvais œil à l’expéditeur. Elle inclut aussi des rituels, comme l’exorcisme par Jésus du possédé de Gérasa dont il chasse les démons dans un troupeau de cochons (pour autant qu’un cochon soit « quelqu’un »). La seconde définition se cantonne au monde particulier de la sorcellerie et ne pourrait s’appliquer au christianisme que lorsqu’il reconnaît l’existence des sorts. Or ce sont plutôt les châtiments que les conjurations qu’il utilise dans ce cas. La troisième définition est totalement inconsistante, car, s’il suffit de « détourner les influences maléfiques » pour être apotropaïque, elle inclut la totalité des systèmes religieux. Malheureusement, elle reflète assez bien l’usage inconséquent des grands mots chez trop d’historiens.
Comme on l’a dit, une autre manière d’éviter de définir est de se référer à l’usage d’un terme tel que l’utilise tel ou tel. En général, l’autorité sollicitée est plus ou moins philosophe. Dans ce cas, il vaudrait mieux répéter la définition du maître à penser, s’il en a réellement donné une, au moins pour montrer qu’on l’a comprise. Mais il y a fort à parier que cela se ferait si la définition était limpide.
L’assertion d’existence
Une description d’objet n’est pas une définition. Elle énonce des propriétés de l’objet, pas forcément toutes celles et rien que celles qui seraient nécessaires pour le définir. Mais une définition est une description d’objet qui obéit en plus à ces deux conditions. Dans la logique aristotélicienne, la définition porte sur des qualités substantielles nécessaires et suffisantes : l’homme, par exemple, se définit comme animal rationnel et mortel, sans qu’il soit opportun d’ajouter qu’il possède des mains et des pieds. Aujourd’hui, nous ne parlons plus guère de substances et d’accidents et nous disons que certains traits sont pertinents et que d’autres ne le sont pas, mais ça revient pratiquement au même. La description d’objet s’utilise plutôt pour identifier des individus. Que Philippe Auguste ait gagné la bataille de Bouvines était en partie accidentel, mais « le vainqueur de Bouvines » suffit, non pas certes à le définir, mais à l’identifier.
L’assertion d’existence se fait à partir d’une description d’objet, souvent aussi à partir d’un nom propre lorsqu’il s’agit d’un individu. Elle répond à des questions telles que: « Y a-t-il des habitants sur Mars? » ou « Homère a-t-il existé? ». Mais elle porte aussi sur des événements ou sur les notions de l’historien. « La réforme grégorienne a-t-elle existé? ». En général, on répond oui à condition d’appeler ainsi un phénomène qui commence bien avant Grégoire VII.
L’assertion d’existence est d’autant plus risquée que la description d’objet est plus précise et plus circonstanciée. Prenons un exemple simple : « Y avait-il un comte Roland à l’époque de Charlemagne ? ». La réponse est « oui ». « Était-il le fils naturel de Charlemagne et de sa sœur Gisèle ? ». Il faudrait pour cela que la légende corresponde à la réalité par un hasard exceptionnel. « A-t-il péri en combattant les Sarrazins ? ». Non, mais leurs ennemis, les Navarrais. Pour autant que la Vita Caroli d’Eginhard qui nous renseigne soit crédible – et elle l’est sans doute – cela ne pose pas problème.
La question de l’existence de Roland n’a vraiment de sens que si on parle de la victime des Navarrais ou de celle des Sarrazins. Mais il est des cas où la confusion est soigneusement entretenue, en général lorsqu’il y a un gros enjeu idéologique. Le plus caricatural est certainement celui de l’existence de Jésus. Lorsque quelqu’un pose la question, il est bon de savoir s’il parle d’un dieu né d’une vierge et ressuscité ou d’un rabbi plus ou moins subversif qui aurait prêché en Palestine au Ier siècle et dont les évangiles nous auraient rapporté quelques maximes. Face à la seconde hypothèse, la réponse la plus sensée est sans doute de remarquer qu’il y en a sans doute eu plus d’un. La confusion n’épargne pas les historiens. C’est ainsi que Henri-Irénée Marrou considère comme aussi aberrant de douter de l’existence de Jésus que de celle de Descartes[69]. Dès lors qu’on ne dit pas de quel Jésus on parle, il ne vaut même plus la peine de comparer la crédibilité des sources. Imaginons néanmoins que Descartes n’ait rien écrit et qu’il ne soit question de lui qu’une vingtaine d’années après la date supposée de sa mort. Tiendrions-nous son existence comme un fait historique incontestable?
Sans atteindre ce niveau d’absurdité, une des naïvetés les plus fréquentes en histoire consiste à postuler des nations sans très bien savoir sur quels critères. Le nationalisme d’il y a un siècle n’a plus bonne presse, mais l’effroi qu’ont suscité ses conséquences ne semble pas avoir produit suffisamment de réflexion sur ces critères. Peut-on appeler « nations » des ensembles de territoires que les rois peuvent échanger à l’occasion de traités? Lorsque la cantatrice américaine Jessye Norman vint à Paris chanter la Marseillaise lors des festivités de 1989, on put l’entendre dire à la radio qu’on fêtait « les deux cents ans de la France ». Il s’agissait bien sûr d’une bourde, mais qui contenait une part involontaire de vérité.
Sans remonter à « nos ancêtres les Gaulois », que signifie une expression comme « la France de Philippe Auguste » ? En étudiant les vitraux de la cathédrale de Chartres, on peut s’apercevoir où mène le présupposé implicite sur lequel elle repose. C’est ainsi qu’un historien (pourtant) anglais, John Buslag, parle du « nationalisme » des chanoines chartrains et fonde son interprétation d’un vitrail (116 dans la numérotation du Corpus vitrearum) sur ce contresens[70]. Il est vrai qu’une part importante des vitraux ont été commandés par la famille royale et son entourage, mais faut-il rappeler que deux des ensembles les plus importants sont dus respectivement à Pierre de Boulogne dit Mauclerc et à Philippe Hurepel, fils plus ou moins légitime de Philippe Auguste, que l’un et l’autre ont participé ensuite à la révolte des barons, et que le premier a été jusqu’à se mettre au service du roi d’Angleterre ? Une conséquence presque comique du présupposé implicite d’un cadre national a été l’impossibilité d’identifier le commanditaire du vitrail signé Colinus de camera regis (114). Il n’y avait en effet aucun Colin parmi les officiers de la chambre des comptes. En fait, le personnage apparaît deux fois dans une autre chambre des comptes, le Grand Échiquier de Normandie à Caen, autrement dit chez Richard Cœur-de-Lion, en 1195 et 1198[71]. Le vitrail datant vraisemblablement de 1220 environ, Colin était encore en vie. Il n’était plus au Grand Échiquier, supprimé après la conquête de la Normandie par Philippe Auguste, et, comme il avait gardé son titre, il s’était vraisemblablement replié à Westminster. On voit bien ce qui empêchait une identification pourtant facile : l’existence supposée d’un cadre national impliquait que le roi non spécifié ne pouvait qu’être le roi de France.
L’inconsistance dans le langage-objet
En admettant que l’historien ait purifié son langage, il lui reste une difficulté, car il ne peut pas purifier le langage-objet. Il parle constamment de notions qu’il n’admet pas, comme l’influence des astres, de personnages qui à ses yeux n’existent pas, comme le chien Cerbère qui garde les enfers ou Méduse, décapitée par Persée. Or, du point de vue de la logique formelle, il est impossible de parler de telles choses autrement que pour les nier. Concrètement, la proposition: « Si Cerbère est un chien, alors Méduse est un écureuil » est vraie. Comme l’a montré William Quine dans un article célèbre, il y a une différence essentielle entre nommer et signifier[72]. Le mot « Cerbère » ne nomme (ou, si on préfère : ne dénote) rien du tout, mais signifie. Le problème est alors de savoir ce qu’il signifie et, pour cela, il faudrait pouvoir décrire l’objet. Or, dans un langage formel, on ne peut donner la description d’un objet sans affirmer son existence. Il est donc impossible de montrer que Cerbère qui n’existe pas n’est ni Persée, ni Méduse qui n’existent pas davantage. Tout ce qu’on peut admettre, c’est que l’idée-de-Cerbère est distincte de l’idée-de-Méduse.
Une autre solution, équivalente quant aux résultats, mais modélisant mieux l’approche historique, est de distinguer des univers de discours, comme le font Robert Martin ou Gilles Fauconnier en proposant des formalisations de cette démarche[73]. Elle permet de décrire un univers ou « le chien Cerbère garde les enfers » est vrai et « Méduse est un écureuil » faux, sans pour autant que le métalangage décrivant l’univers réel n’accepte l’existence de l’un ou de l’autre.
On objectera que le rigorisme logique de ces remarques équivaut à l’utilisation d’un fusil pour tuer une mouche, car les historiens se débrouillent très bien avec les fictions sans avoir besoin de la logique formelle, mais les choses sont un peu plus compliquées.
Il faut d’abord remarquer avec Quine que tout système, aussi formalisé qu’il soit, possède des fondements indécidables, ce qu’on a expérimenté à travers les paradoxes de Russell et qui a été prouvé quant aux mathématiques par Gödel, quant à la logique formelle par Tarski. La complétude d’un système est toujours bornée par des axiomes que le système ne peut justifier. Il est donc inacceptable d’opposer notre rationalité à l’irrationalité des systèmes qu’on étudie.
Mieux encore, un système consistant peut contenir des monstres qui valent bien Cerbère, mais doivent être distinguées des passages au-delà du principe de non-contradiction. Partons d’un problème bien connu, le paradoxe du barbier. L’affirmation bien naturelle que les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes se font raser par le barbier est contradictoire, car elle implique à la fois que le barbier se rase lui-même et qu’il ne se rase pas lui-même. Le problème sous-jacent oblige la théorie des ensembles à stipuler que les ensembles ne sont pas une somme d’élément, qu’ils n’appartiennent pas à la même catégorie que les éléments et que le rapport entre ensembles et éléments n’est pas définissable. Cette règle n’a aucun sens intuitif, mais elle rend le système non-contradictoire. On pourrait aussi bien introduire l’existence de Cerbère dans un système, mais pas celle du cercle carré, lequel est intrinsèquement contradictoire. Il est vrai que pour axiomatiser une mythologie, il faudrait contrevenir au principe d’économie des axiomes, car il en faudrait beaucoup. Néanmoins, on peut déduire de tout cela que, même lorsqu’on respecte le principe de non-contradiction, la validité d’un système est toujours relative.
Dans un système formalisé, il n’y a pas de doute possible sur ce qui est contradictoire et ce qui ne l’est pas. Dans le langage naturel, les choses sont plus compliquées et nous avons tendance à parler de contradiction dans des cas où la logique n’est pas en cause. Prétendre que le minotaure a existé défierait les lois de la biologie et non celles de la logique, professer la conception virginale ne contredit que la gynécologie. Le dogme de la transsubstantiation, de la transformation du pain en vrai corps du Christ par les paroles sacramentelles du prêtre, violait en fait la définition aristotélicienne des substances, c’est-à-dire une construction métalogique qui n’a plus beaucoup d’adeptes, mais viole aussi nos conceptions des lois de la nature. Il n’y a guère que le dogme de la Trinité, proclamant à la fois la distinction des personnes divines et l’unicité de Dieu, qui soit contradictoire au même titre que le cercle carré.
Boèce, l’auteur de la Consolation de la philosophie et du principal commentaire de l’Organum aristotélicien, a aussi écrit un De Trinitate moins connu. Il considère Dieu « qui est celui qui est » comme l’unité du multiple. A sa différence, les créatures ne sont pas ce qu’elles sont, car elles sont composées de forme et de matière, le principe d’identité régissant pour sa part le monde spirituel. Il s’agit là d’un platonisme absolument cohérent avec une pensée qui se détourne du monde physique pour s’intéresser aux idéaux, en particulier aux propriétés des nombres, en somme d’une forme radicale de « platonisme mathématique ». Pour Boèce, le Trinité est non-contradictoire et c’est le monde physique qui repose sur une contradiction. Mais est-ce plus fou que de considérer la relation entre un ensemble et ses éléments comme indéfinissable?
De tels cas obligent à se défaire, en abordant des systèmes plus ou moins cohérents et différents des nôtres, de tout ce qui reste du partage entre des mentalités logiques et prélogiques. Il n’y a pas de rationalité absolue et il y a plutôt, derrière les comportements humains, une forme de rationalité à découvrir, ce qui est plus intéressant que de sous-estimer les autres et le passé. Il ne s’agit pas de les réfuter, mais de les comprendre. De ce point de vue, les exemples que nous avons pris et qui appartiennent au domaine qu’on définit approximativement comme religieux se caractérisent par un caractère hyperbolique et une suspension du sens commun qui n’exclut pas un comportement rationnel le reste du temps.
On connaît l’exemple célèbre du sacrifice du concombre chez les Nuer, analysé par Evans-Pritchard[74]. Lorsqu’ils ne peuvent sacrifier un bœuf, les Nuer utilisent un concombre en considérant qu’il s’agit d’un bœuf, ce qui fait évidemment penser à l’eucharistie. Mais, dans la vie courante, ils ne confondent pas plus les concombres et les bœufs que les catholiques le pain et la chair du Christ. Qu’il s’agisse des actes liturgiques ou des mythes et des dogmes qui peuvent les sous-tendre, l’écart avec le sens commun n’est pas dû à une déficience intellectuelle, car il est systématiquement hyperbolique pour exiger une soumission respectueuse de la part de la raison. Le cas du réalisme eucharistique permet de le montrer[75]. Saint Augustin ne croyait pas aux lois de la nature, car la toute-puissance divine faisait ce qu’elle voulait. Pourtant, sa doctrine eucharistique est symbolique, plus proche de celle des calvinistes que du réalisme eucharistique qui triompha entretemps: il comprend la formule évangélique et liturgique « ceci est mon corps » comme « ceci signifie mon corps ». Cette doctrine reste dominante dans le haut Moyen Age, à un moment d’étiage des sciences physiques. Or c’est en 1215, au quatrième concile du Latran, alors que l’idée aristotélicienne d’un monde régit par des lois physiques s’est imposée, que fut proclamé le dogme de la transsubstantiation, faisant définitivement de l’eucharistie un véritable sacrifice avec consommation de la chair et du sang de l’Homme-Dieu. Il s’agit donc de tout sauf de la survivance d’une mentalité primitive. En fait, l’acceptation des lois de la nature oblige la religion à se placer au-dessus d’elles.
Ce parcours des problèmes sémantiques qu’affronte l’histoire s’est ouvert sur la distinction entre la signification intentionnelle et intrinsèque du document et le sens que lui donne l’interprétation que nous en faisons. C’est le refus de cette distinction qui fait de l’histoire une vague herméneutique qui noie son objet dans un bavardage sans fin. Une seconde confusion est celle du langage des documents et du langage de l’historien, du fait qu’ils utilisent souvent les mêmes mots, tantôt avec la même signification, tantôt avec une signification différente. Elle semble assez fréquente, comme en témoigne le flou qui entoure actuellement la notion d’anachronisme, qu’il s’agisse de dénoncer comme anachronique un raisonnement qui ne l’est pas ou de faire l’éloge de l’anachronisme en le croyant constitutif de la réalité historique. En fait, une source d’anachronismes particulièrement fréquente est l’utilisation de notions dont la définition reste implicite, facilitée par le fait que l’historien s’exprime normalement en langage naturel, de sorte qu’il est impossible de s’en débarrasser totalement. On peut tout de même limiter beaucoup cet inconvénient en évitant de conférer l’existence à des objets non définis. Cela dit, les inévitables limites de la consistance du discours historique, comme des autres discours scientifiques, doivent nous prévenir contre une disqualification hâtive des discours que nous étudions dont la validité ne peut, pas plus que celle du nôtre, être absolue. Il reste maintenant à étudier une autre manière de déposséder le passé de sa rationalité en lui retirant cette fois la conscience de ses actes.
![]()
L’histoire comme anthropologie
Comme on l’a vu, ce sont des anthropologues qui ont compris les premiers que la notion de mentalité était inconsistante, tandis que les historiens s’en emparaient pour raconter des tissus de balivernes sur la religion des paysans, l’acculturation des « masses » par les « élites » ou la peur en Occident. Les mentalités tendent à passer de mode, même en histoire, mais un autre présupposé permet de retirer aux hommes leur rationalité, celui de l’inconscient. En revanche, il est nettement plus difficile de s’en défaire, car il rend bien compte de quelque chose et il va falloir se demander de quoi.
Le présupposé de l’inconscient
Que les gens ne sachent pas ce qu’ils font n’est pas une idée neuve. Dans les évangiles, Jésus demande à son Père céleste de pardonner à ses bourreaux pour cette raison (Luc, 23, 34). Les prêtres ne manquent pas de compassion pour les pécheurs qui se damnent en refusant la Vérité et les déniaisés plaignent les bigots maintenus dans l’ignorance par les prêtres.
Un savoir – sacré ou profane – portant sur le monde extérieur, taxe forcément ses adversaires de méconnaissance. Lorsqu’il s’agit de la méconnaissance de soi, cela devient l’inconscience. Si les hommes comprenaient ce qu’ils font, la sociologie ne serait pas très utile. L’un de ses pères fondateur, Emile Durkheim, s’accorde avec Marx pour expliquer la vie sociale « non par la conception que s’en font ceux qui y participent, mais par des causes profondes qui échappent à la conscience »[76].
Ce présupposé culmine dans les sciences humaines des années 1960 par la conjonction du marxisme, de l’économisme, du structuralisme et de la psychanalyse. La tâche du chercheur est alors de découvrir les puissants mécanismes qui gouvernent l’idéologie et le comportement à l’insu des sujets et de leur révéler leur « inconscient ».
Inconscient et habitus
Il n’en reste pas moins que le présupposé de l’inconscient ne va pas de soi pour tout le monde. Les historiens ont longtemps eu tendance à analyser les événements comme les actes intentionnels des rois et des grands de ce monde et ce point de vue reste très présent dans les biographies destinées au grand public. L’économie classique continue à présupposer des acteurs rationnels dont les choix sont déterminés par l’intention de maximiser leurs profits. Ces points de vue ont été souvent critiqués à bon droit, mais la notion d’inconscient présente également des difficultés.
En effet, si les hommes n’étaient pas vraiment conscients de ce qu’ils vivent, comment pourraient-ils progresser? On ne parle pas ici du Progrès avec un grand P qui est une fiction, mais des progrès qui sont bien réels, tout comme les régressions. Autant en effet, une régression peut donner le spectacle d’hommes qui n’ont aucun contrôle sur leur destin, autant un progrès est difficile à imaginer dans cette situation. Le progrès des techniques au cours du Moyen Age répond à des déterminismes bien connus: la fin de l’esclavage, par exemple, a suscité un progrès technique compensant le coût de la main-d’œuvre, avec des innovations comme le collier d’attelage, la charrue et le moulin à eau. Mais ce n’est pas le coût de la main-d’œuvre qui invente et innove. Il faut bien faire intervenir quelque part des stratégies rationnelles, quitte à ce qu’elles visent autre chose que le profit.
En fait, il ne s’agit pas de nier la conscience, en dehors de formulations extravagantes comme celle de Lévi-Strauss lorsqu’il prétend que les sauvages ne pensent pas leurs mythes, que ce sont les mythes qui pensent. Ni Freud ni Marx ne nie l’existence d’une vie consciente et la possibilité de rendre conscient ce qui ne l’est pas. Le principe durkheimien vise la vie sociale, non pas la pensée technologique, voire scientifique. Il peut en effet y avoir de fortes discordances entre les deux, ainsi lorsqu’un savant comme Pasteur « laisse ses convictions au vestiaire » en entrant dans son laboratoire. De ce point de vue, la notion d’habitus que le sociologue Pierre Bourdieu emprunta à la scolastique par l’intermédiaire de l’historien de l’art Erwin Panofsky, est bienvenue, car elle assigne ces manières de penser et de faire à des domaines d’activité:
Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d’existence produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées disposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et « régulières » sans être en rien le produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre[77].
La notion a l’avantage de pouvoir concerner l’ensemble des pratiques, des plus triviales à la pratique scientifique, mais, telle que la présente Bourdieu, elle entraîne à son tour un problème. Non seulement, son habitus n’est pas conscient, mais il produit la méconnaissance de sa propre existence, assurant ainsi sa pérennité. Aussi résiste-t-il aux informations suggérant d’autres comportements possibles: « … l’habitus tend à assurer sa propre constance et sa propre défense contre le changement à travers la sélection qu’il opère entre les informations nouvelles, en rejetant, en cas d’exposition fortuite ou forcée, les informations capables de mettre en question l’information accumulée et surtout en défavorisant l’exposition à de telles informations »[78].
Il n’y a aucune raison de douter qu’il existe quelque chose comme des habitus, qu’il s’agisse des comportements routiniers ou des préjugés sociaux et qu’on se défend contre leur remise en cause. Mais cet habitus qui se défend lui-même à l’insu de ceux qu’il habite ressemble beaucoup à un deus ex machina destiné à sortir de l’alternative entre l’explication des comportements par la conscience du sujet et l’appel à un déterminisme totalement passif[79].
Les paradoxes de la méconnaissance
Il semble parfois y avoir de la confusion dans les débats sur l’inconscient entre différentes formes de méconnaissance, de limites de la conscience, de non-conscient ou d’inconscient. Il y a d’évidentes ressemblances entre ce que Bourdieu traite plus ou moins d’inconscient dans le fonctionnement de l’habitus et l’inconscient freudien. Dans les deux cas, il s’agit de quelque chose qui agit indépendamment des intentions du sujet et qui refoule ce qui ne lui plaît pas. Mais la notion d’habitus recouvre beaucoup de comportements banals dont la conscience n’a pas beaucoup d’intérêt et qu’il n’y a aucune raison de refouler. J’aurais bien du mal à dire quelle partie exactement de mes plantes de pieds touchent le sol en premier lorsque je marche, mais cela ne relève ni de la psychanalyse, ni de la sociologie et, si je demande à un podologue de me l’apprendre, je n’en tirerai aucun profit tant que je marche sans difficulté. Je sais ce que je fais lorsque je mange chinois avec des baguettes et je peux expliquer à quelqu’un d’autre comment on fait, parce que je l’ai appris adulte, mais j’aurais plus de mal à expliquer précisément à un Chinois ce que je fais lorsque je mange avec un couteau et une fourchette. Une grande partie des habitus d’un individu n’ont aucun besoin de résister à la conscience pour persister, car il n’y a aucune raison d’en changer ou même d’en avoir conscience. Inversement, lorsqu’on a conscience d’un habitus et qu’on aimerait le vaincre, le problème devient banal et rentre dans la catégorie chère aux économistes des choix stratégiques conscients. J’aimerais arrêter de fumer, car ça nuit à la santé, mais le désagrément que cela me causerait est tel que je continue, en espérant mourir un jour d’autre chose.
Le problème de Bourdieu se réduit donc aux habitus méconnus dont la transformation serait une bonne chose: il y en a sans aucun doute plus d’un. Mais est-il vraiment nécessaire de transformer l’habitus en deus ex machina pour expliquer la résistance? Il y a ceci de commun entre la sociologie de Bourdieu et l’économisme le plus classique que l’information nécessaire ici à la conscience de l’habitus, là au choix économique, est pensée comme disponible, comme s’il s’agissait de la ramasser dans la rue. En réalité, s’informer est un gros travail: tout chercheur sait que cela ne consiste pas à faire confiance au dernier qui a parlé. Une information doit être vérifiée et c’est loin d’être toujours facile. Ce ne l’est pas pour le chercheur dont c’est pourtant le métier et à bien plus forte raison pour les autres. En plus, le chercheur est payé pour ça[80], alors qu’un cordonnier qui arrêterait de réparer les chaussures comme il l’a toujours fait pour se familiariser avec une technique prétendue plus efficace risquerait rapidement de perdre son revenu pour un gain aléatoire.
Les comportements routiniers qui relèvent de l’habitus économisent de la réflexion et du temps : je marche sans avoir à réfléchir à chaque pas lorsque le chemin est plat. Un cadre français élevé dans la tradition catholique de droite n’a aucune raison de la mettre en cause, tant que son salaire est élevé, sa femme fidèle, ses enfants bien éduqués et obéissants, ses loisirs somptueux. La reproduction des mêmes conditions d’existence se profilant à la génération suivante, on voit mal pourquoi il se poserait des questions et quelle force inconsciente serait nécessaire pour que l’habitus subsiste. Pour qu’il y ait des raisons de se poser des questions et donc de se fatiguer, il faut une crise, par exemple un burnout, l’infidélité de l’épouse ou encore la révolte des enfants. Dès lors, la vie cesse d’être un long fleuve tranquille.
Si une telle crise se produit, on peut supposer, outre des causes matérielles, une situation psychologique malsaine. Le cadre avait refusé de voir son propre épuisement, son manque d’égard pour son épouse ou son autoritarisme maladroit envers ses enfants. Les aspects névrotiques du système religieux seront peut-être mis en cause. Tant que tout se passe bien, un psychanalyste freudien considérera que la religion n’est dans ce cas qu’une névrose bénigne qui ne mérite pas d’être traitée. Sinon, l’habitus se confond plus ou moins avec l’inconscient freudien et les problèmes que posent l’un et l’autre pourraient bien être les mêmes.
Les paradoxes de l’inconscient
La théorie freudienne de l’inconscient a en effet soulevé des critiques. Que des actes du sujet puisse échapper à sa conscience n’est pas le problème, car c’était quelque chose de généralement admis bien avant Freud. Contemporain de Freud et proche de lui par son milieu, Ludwig Wittgenstein critique le passage de l’adjectif au substantif, de l’idée que quelque chose puisse ne pas être conscient à celle que l’inconscient soit quelque chose et qu’il puisse se comporter comme un agent efficace et rusé. Dès lors, il s’agit de plus que d’une réification, d’une personnification: « Imaginez un langage dans lequel, au lieu de dire ‘Je n’ai trouvé personne dans la pièce’, on dirait ‘J’ai trouvé M. Personne dans la pièce’ »[81].
Une autre critique, déjà présente chez Wittgenstein, consiste à se demander s’il y un sens à parler d’un contenu inconscient. Il y en a en tout cas un lorsqu’une personne fait un lapsus sans s’en rendre compte: elle n’est pas consciente de ce qu’elle a dit. En outre, n’importe qui, lorsqu’il ne dort pas seul, a pu remarquer que la personne auprès de lui s’agitait et parlait même dans son sommeil, mais souvent, ne se souvenait de rien au réveil. Il doit bien y avoir alors un scénario qui échappe à la conscience. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a, dans le récit d’un rêve par exemple, un contenu latent sous le contenu manifeste. Et, lorsque l’interprétation d’un rêve est considérée comme la découverte de cet autre message, il pourrait bien y avoir un contresens.
Prenons un cas simple qu’on rencontre assez facilement. Une personne ayant eu une éducation puritaine a besoin pour éprouver la satisfaction sexuelle de s’imaginer contrainte, voire violée. Il s’agit d’une histoire qu’elle se met dans la tête au moment de l’acte, mais qui n’implique pas une accusation de viol, car elle sait qu’elle laisse aller son imagination. Il est bien probable que le fantasme de viol lui permette de mettre en veilleuse ses scrupules moraux en apaisant son sentiment de culpabilité. Cela peut aussi faire l’objet d’un rêve, mais, dans un cas comme dans l’autre, il n’y a aucune raison de parler d’un contenu latent. L’interprétation correcte n’est pas la découverte d’un message sous-jacent selon lequel la personne commettrait l’acte sexuel de son plein gré, lequel est inexistant dans le rêve et n’a pas à être recherché dans la situation réelle où le consentement est évident. Il s’agit simplement d’expliquer pourquoi le fantasme est tel qu’il est.
Les Ecrits de Jacques Lacan sont pleins de calembours qui se substituent au raisonnement, mais ils contiennent une forte intuition : le supposé contenu inconscient n’est pas enfoui dans les profondeurs de l’âme humaine comme des vestiges archéologiques, mais se situe plutôt, bien visible, au ras du langage, de sa rhétorique et même parfois des calembours. Il n’appartient pas à l’historien de juger sa conception de l’analyse et ses effets thérapeutiques, mais elle peut lui inspirer une bonne manière d’aborder les symbolismes en se détournant d’une impasse. Freud est loin, en effet, d’avoir donné un exemple à suivre dans son essai sur un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci. Il voyait dans la Sainte Anne un contenu caché : le contour des personnages dessinerait secrètement la silhouette d’un vautour qui témoignerait d’un traumatisme survenu durant l’enfance. Il s’agit là typiquement du genre de trouvailles qu’on ne peut ni confirmer, ni réfuter, et qui n’a donc aucun intérêt. Freud est mieux inspiré en analysant le Moïse de Michel-Ange, lorsqu’il commente l’instabilité des tables de la Loi sous son bras gauche. Sont-elles sur le point de lui échapper et de tomber à terre ? On peut en discuter, mais la question se pose réellement, car il n’aurait vraiment pas été compliqué pour l’artiste de poser les tables bien à plat et non pas en équilibre instable sur un angle. En plus, la chute des tables de la Loi existe dans la tradition iconographique. La statue de la Synagogue les laisse en effet échapper à la cathédrale de Strasbourg et de manière encore plus incontestable à la cathédrale de Bamberg. Autant le vautour de la Sainte Anne aurait été un contenu caché, autant l’instabilité des tables de la Loi est manifeste.
Que le pain et le vin eucharistiques soient le corps et le sang du Christ n’est pas un secret bien caché, mais le contenu littéral des paroles évangéliques reprises par le prêtre lors de la consécration. Les nombreuses images médiévales de la crucifixion où l’Église recueille le sang du Crucifié qui jaillit de la plaie du côté pour le donner à boire au fidèle ne sont pas moins explicites. Que le jardin clos, fréquent dans l’iconographie de la fin du Moyen Age, représente l’utérus de la Vierge Marie, clos par la virginité, est affirmé dans les commentaires mariaux du Cantique des cantiques, déjà chez saint Ambroise, car il est écrit « Tu es un jardin clos, ma sœur, mon épouse, une fontaine scellée » (Cantique 4, 12). Il n’y a pas besoin de faire appel à la psychanalyse pour découvrir le symbolisme anthropophagique ou sexuel dans le système religieux. Si un dévot vous demande où vous avez trouvé tout ça, vous pouvez répondre que c’est explicite : les chrétiens mangent leur dieu et les mystiques lui sucent la plaie du côté. Mais l’expérience montre qu’il ne sera pas forcément convaincu.
Qu’on me permette de rapporter ici un souvenir personnel. Faisant il y a quelques décennies une conférence, je montrais que, dans l’iconographie de la fin du Moyen Age, les peintres donnaient très fréquemment au Crucifié un périzonium transparent révélant l’absence de sexe. On aurait pu y voir une forme de pudeur, mais la solution pudique consiste en réalité à rendre le périzonium opaque, comme on le faisait avant 1300 et comme on le fait à nouveau depuis 1430 environ. Quelques temps plus tard, je rencontre l’épouse d’un collègue qui me raconte qu’elle s’était rendue depuis au Musée des Beaux-Arts de la ville et y avait vu un nombre appréciable d’exemples, mais se plaignait que ma conférence avait fait travailler son imagination et laissait entendre qu’il s’agissait d’une illusion !
Comment expliquer cette attitude ? Il peut tout simplement s’agir du refus de dire qu’on est passé des centaines de fois devant quelque chose sans l’apercevoir. Il peut aussi s’agir d’éviter une complication intellectuelle. Nous avons une certaine idée du christianisme médiéval. Une observation qui la contredit devrait nous obliger à mettre en doute ce que nous croyions savoir. La tentation est alors très grande de refuser l’observation, car c’est du travail en moins. Mais il peut y avoir plus : concevoir la religion comme un domaine éthéré où ne peut entrer aucune représentation liée à la sexualité, pour ne rien dire du cannibalisme, et ne pas vouloir souiller ce havre de paix par des pensées impures.
Quelle que soit la bonne solution, il apparaît que la reconnaissance d’un état de choses perturberait l’économie du sujet et qu’il préfère encore nier l’évidence. De manière infiniment plus grave, le refus d’admettre le réchauffement climatique pour sauver les bénéfices immédiats qu’apporte la destruction de l’environnement est une réaction du même type. En somme, la réalité met le sujet dans une situation dérangeante et, à partir de là, on rencontre tous les phénomènes que Freud a si bien mis en valeur: l’oubli de ce qui dérange, son refoulement par dénégation, sa déformation par déplacement ou condensation dans le retour du refoulé, et ainsi de suite.
Mais en quoi cela obligerait-il à faire état d’un contenu inconscient ? Ne serait-ce pas plutôt les mécanismes de défense qui ne sont pas conscients ? L’idée de contenu inconscient n’est peut-être rien d’autre que la contrepartie de la notion indistincte de Deutung dans laquelle l’herméneutique confond lecture et interprétation d’un discours. Lorsqu’un discours névrotique cache quelque chose, il ne nous adresse pas deux messages dont l’un serait caché dans l’autre. Le contenu de ce discours est manifeste, mais il reste à comprendre pourquoi son auteur dit cela plutôt qu’autre chose. Autant la comparaison entre les mécanismes du rêve ou du fantasme et ceux du mot d’esprit est intéressante et féconde, autant l’assimilation de l’un à l’autre est une erreur fatale. Le mot d’esprit, lui, est réellement construit à partir d’un discours préexistant et caché qu’il s’agit de deviner. Prenons un exemple chez Freud. Deux associés ont fait faire leurs portraits et offrent une réception pour les inaugurer. Un journaliste présent remarque qu’on aurait dû mettre un crucifix entre les deux. La compréhension du mot d’esprit suppose une déduction : dans une crucifixion, le Christ est entouré de deux larrons. Il y a donc un contenu latent, mais conscient et intentionnel de la part de son auteur, qui est que les deux hommes d’affaire sont des larrons. Ne pas le trouver, c’est ne pas comprendre son message.
Dans le cas d’un processus inconscient, ce qui est déformé n’est pas un message du sujet, mais la réalité à laquelle il est confronté. Il peut s’agir aussi bien d’un stimulus, comme un bruit qui menace le sommeil et qui est réinterprété par le rêve pour permettre de continuer à dormir, que d’une information déplaisante. Cela peut éventuellement être un message, celui qui lui parvient de quelqu’un d’autre et qu’il préfère mal comprendre. Il peut encore s’agir d’une réalité intérieure, car le sujet est rarement dépourvu de contradictions, entre ses désirs et la moralité par exemple. Ce que les chrétiens appellent une pensée impure n’est pas quelque chose qui échappe à la conscience, mais une représentation qu’elle ne peut pas refouler et subit malgré elle. Ce qui est oublié n’est pas quelque chose de caché qui agit en nous ; c’est l’oubli et donc la disparition du message qui porte à conséquence. Enfin, un secret de famille est bien un contenu caché, mais il ne l’est pas à l’intérieur du sujet puisque ce sont les parents qui le cachent. Ce qui perturbe le sujet est alors un malaise à l’intérieur de la famille dont il souffre, mais dont il ne connaît pas l’origine.
Alors, qu’y a-t-il éventuellement d’inconscient ? C’est le processus mis en œuvre par le sujet et cela n’a rien d’anormal. On parle avant d’avoir conscience de le faire, ou sans avoir conscience de le faire, comme dans les rêves. On pratique les formes grammaticales et logiques avant même de savoir qu’elles en sont et il n’y a pas besoin de fonder l’arithmétique pour compter. Les opérations de l’esprit ne sont pas explicites tant qu’elles n’ont pas été explicitées et on n’attend pas de les comprendre pour s’en servir. Comprendre et expliciter sont des travaux qui peuvent être extrêmement difficiles, parfois impossibles à mener à bout, comme de fonder l’arithmétique. Ces opérations sont donc des habitus qui guident notre pratique que nous en ayons conscience ou non. Il n’y a pas besoin de faire intervenir un deus ex machina pour le comprendre.
Parler sans connaître la grammaire expose à des fautes et seule une conscience réflexive de la logique empêche les paralogismes. Les limites de nos connaissances et de notre conscience ne sont évidemment pas la cause de fantasmes, lesquels sont des tentatives pour concilier la réalité et nos désirs, mais elles les rendent plus ou moins crédibles. Dans le rêve, nous les prenons pour la réalité, dans un demi-sommeil ou sous l’effet de psychotropes, la conscience est suffisamment émoussée pour leur donner libre cours. Dans la vie courante éveillée, nous évaluons normalement la probabilité d’un événement de manière approximative, mais généralement suffisante, de sorte, comme on l’a déjà dit, qu’on ne prend pas son parapluie pour sortir par beau temps. Mais il y a des exceptions, comme l’excès de précaution caractéristique de la névrose obsessionnelle, et là aussi, le fantasme l’emporte. Et nous avons remarqué que l’envie de justifier son hypothèse à tout prix conduit trop souvent un chercheur à défier le bon sens.
Faire un rêve ou un mot d’esprit sont deux activités radicalement différentes du sujet, puisqu’il manipule consciemment un contenu pour le rendre latent en faisant un mot d’esprit, tandis qu’il déforme la réalité dans le rêve. Mais ce qui justifie leur comparaison est l’identité des processus mis en œuvre, comme le déplacement ou la condensation. A première vue, cette remarque paraît contradictoire avec ce qui vient d’être dit : s’il y a déplacement ou condensation, cela suppose un contenu déplacé ou condensé, car déplacer ou condenser du réel relèverait de la magie. L’assimilation par Lacan de l’inconscient à un langage et, sous l’influence du linguiste Roman Jakobson, du déplacement à la métonymie et de la condensation à la métaphore ne peut que rendre l’objection plus vigoureuse.
Prenons le cas d’une métaphore. Lorsque je traite quelqu’un de vipère, je n’entends pas qu’il s’agit d’un reptile, mais qu’il est tout aussi dangereux par sa perfidie. Mon interlocuteur n’a pas à proprement parler un travail d’interprétation à faire, à moins d’être idiot (ou belge si on en croit les blagues). En revanche, si je rêve que cette personne est une vipère, ma réaction n’est pas de me protéger, par exemple, contre ses calomnies, mais de chercher un gros caillou pour l’écraser. Il n’y a pas un contenu latent qui serait sa perfidie, mais une transformation fantasmatique du réel dans un état d’inconscience. Le réel est bien condensé et déplacé, mais seulement dans le fantasme. Cela n’empêche pas le langage d’y être pour quelque chose. Il est en effet probable que si le cobra y servait de métaphore à une personne perfide, le rêve concernerait un cobra. En somme, la rhétorique, le mot d’esprit et le rêve sont des activités bien distinctes, mais elles s’apparentent par les procédés mis en œuvre, car ces procédés régissent tous les univers symboliques.
Le point de départ de cette réflexion était la fragilité de la notion d’inconscient qui rend bien compte de quelque chose, mais pas de manière satisfaisante, car elle suppose un contenu latent lorsqu’il n’y en pas, comme l’avait parfaitement vu Wittgenstein. Il y a pourtant bien quelque chose qui échappe souvent à la conscience ou plus simplement à la connaissance, ce sont les processus que nous mettons en œuvre pour saisir la réalité ou pour ne pas la voir. Les univers symboliques reposent sur ces processus.
Les univers symboliques
On ne peut comprendre un univers symbolique sans étudier la rhétorique, explicite ou pas, qui lui donne sens. Plaquer sur lui une herméneutique passe-partout n’entraîne que des contresens, tandis que sa rhétorique propre engendre un symbolisme plus ou moins intentionnel. Pour prendre l’exemple dans un domaine qui m’est familier, l’image médiévale recourt constamment à un procédé que j’ai désigné comme le littéralisme[82]. Cela consiste à représenter un objet ou une notion par le référent du mot pris au sens littéral, voire étymologique. C’est ainsi que le sein (au sens de ventre ou d’utérus) se désigne par le latin sinus, originellement la courbe du vêtement sur le ventre. Aussi, pour figurer la métaphore biblique du Sein d’Abraham qui abrite les âmes des justes, les peintres représentent-ils le patriarche tenant devant lui un drap formant une courbe dans lequel les âmes sont représentées comme de petits enfants nus, parce que la mort est une seconde naissance et qu’elles ne sont plus « vêtues » de chair. Un mourant est censé « expirer », de sorte que son âme, ainsi représentée, sort par sa bouche. Le siège (sedes) d’une institution peut se représenter comme un trône à baldaquin, couronné de formes architecturales évoquant une ville, une église ou un château, ainsi celui sur lequel trône la Vierge Marie, elle-même symbole de l’Église. Et ainsi de suite.
Les procédés symboliques sont probablement universels, mais ce n’est le cas ni de la valeur, ni des fonctions qu’on leur attribue. Ils peuvent être censés manifester un savoir prophétique. La ressemblance entre le mot virgo (« vierge ») et virga (« branche ») est au XIIe siècle à l’origine du thème iconographique de l’arbre de Jessé, un arbre qui sort du bas-ventre du patriarche endormi et représente sa descendance, jusqu’à la Vierge à l’Enfant, ce qui montre que la prophétie d’Isaïe, « une branche sortira de la racine de Jessé… » (Isaïe 11, 1) s’applique à l’Incarnation. Le mot virga a déjà pris le sens anatomique au Moyen Age et le calembour visuel substituant l’arbre au sexe du patriarche est transparent. Mais Apollinaire a écrit un roman érotique, Les onze mille verges, où le jeu de mot utilisant le sens anatomique de « verge » permet une allusion bouffonne aux onze mille vierges qui auraient connu le martyre à Cologne. Il va de soi que la similitude des procédés ne rend pas l’iconographie de l’arbre de Jessé blasphématoire et ne fait pas du roman une méditation théologique.
Les univers symboliques n’obéissent pas aux lois de la raison. Les analogies y jouent un rôle majeur, conduisant à des contradictions: A est B, B est C, mais A n’est pas C. Il s’agit souvent d’identifier le propre au figuré et inversement, ce qui rend la contradiction inévitable. Les littéralismes donnés plus haut en exemples ne permettent pas la consistance. La nudité représente ici la perte du corps, mais dans d’autres contextes la perte ou le dépouillement des biens de ce monde (« suivre nu le Christ nu »), parfois la perte de la raison, ainsi dans certaines représentations de l’insensé du psaume 52. Lorsqu’il s’agit d’Adam et d’Eve au paradis, elle ne possède aucune de ces valeurs: en l’absence de travail, les vêtements n’étaient pas encore inventés. Cela n’est pas propre aux systèmes iconographiques. Le pain eucharistique est le corps du Christ et la communauté des chrétiens l’est aussi, mais il ne s’ensuit pas que le pain eucharistique soit la communauté des chrétiens. Bien entendu, le mot « est » peut être pris dans un sens plus ou moins symbolique. Il suffit de penser aux discussions sur la nature de l’eucharistie à propos de la parole du Christ: « Ceci est mon corps ». Mais, si on ne comprend pas « est » dans un sens un petit peu plus que symbolique, on sort du système religieux.
Les analogies comprennent les homologies. En gros, le système social sert de modèle à la représentation des dieux, ce qui contribue à la rendre crédible, et, en retour, le modèle divin légitime le système social. Pour en rester au Moyen Age chrétien, Dieu et les saints forment une cour céleste. Comme il se doit, ces courtisans sont le plus souvent de très haute naissance. On adresse ses suppliques au Seigneur par l’intermédiaire des saints qui servent volontiers d’intercesseurs lorsqu’ils reçoivent suffisamment d’offrandes. Dit autrement, c’est le système du piston et des pots-de-vin. Parmi les saints, Notre Dame est celle qui a le plus facilement l’oreille du Seigneur qui l’aime et ne peut rien lui refuser. Les fidèles du Seigneur auront la récompense suprême, accéder à la cour et le voir face à face, alors qu’il leur a été inaccessible de leur vivant.
Pour opérer, le système répond à des désirs, à commencer par celui d’une vie heureuse et sans fin à la cour. Il est érotisé au cours du Moyen Age: Marie devient la plus belle des dames et reste toujours jeune. Les images donnent à la plupart des saints des tenues somptueuses, symboles de la gloire qu’ils ont acquise, en légitimant indirectement le luxe aristocratique. S’agit-il là de quelque chose dont les contemporains ne pouvaient pas se rendre compte? Il suffit de lire des auteurs hussites pour s’apercevoir que c’est justement ce qu’ils dénoncent[83].
Autre caractéristique fréquente des univers symboliques: leurs utilisateurs interdisent ou esquivent les questions qui mettraient en cause leur légitimité. Ils comportent donc un non-dit. S’il est affirmé que A est B et que B est C, le rapport entre A et C n’est ni affirmé, ni nié, mais tu. Ou bien on n’y a pas pensé, ou bien on préfère ne pas y penser.
Mais il n’est pas impossible d’y penser, car les adversaires du système ou ceux d’une partie du système le font. C’est évidemment le cas des hérétiques, plus exactement de ceux qui sont déclarés hérétiques parce qu’ils le font, comme les cathares qui opposent la pauvreté évangélique au mode de vie du clergé. Lorsque la doctrine change, le respect de la Tradition peut finir par devenir hérétique. Le développement du réalisme eucharistique, de la doctrine selon laquelle le pain consacré est (au sens le plus fort du mot) le corps du Christ en donne un bon exemple. Une majorité de théologiens a fini par l’accepter aux XIe et XIIe siècles, mais ceux qui défendaient l’ancienne doctrine ont posé les questions qu’il implique pour en prouver l’incohérence. Ils ont donc demandé si une souris ayant mangé une hostie consacrée en était sanctifiée, ce qu’il arrivait au corps du Christ dans le cadavre d’un pendu ou tout simplement si ce corps finissait dans les latrines des chrétiens. Mais la mise en cause de cette évolution doctrinale est devenue hérétique. Les catholiques ont conservé la doctrine réaliste et ne se sont plus guère posé ce genre de questions après le Moyen Age. Pour les éviter, on ne dit plus qu’on mange le corps du Christ, mais qu’on le reçoit.
Il est aussi possible dans certains cas de poser des questions gênantes sans se faire exclure. Au début du XIIe siècle, l’abbé Guibert de Nogent s’est attaqué aux reliques douteuses avec une verve comparable à celle des Réformés du XVIe siècle, demandant, par exemple, si saint Jean Baptiste était bicéphale, puisqu’on conservait sa tête aussi bien à Saint-Jean d’Angély qu’à Constantinople, ou remarquant que la Vierge Marie était juive et qu’une mère juive ne conserverait pas un dent de lait de son fils[84]. La doctrine hylémorphique de Thomas d’Aquin est incompatible avec le culte des reliques et on le lui a beaucoup reproché, mais il a finalement échappé au sort des hérétiques et est même devenu un saint. En outre, la pratique de la dispute quodlibétique, une joute verbale caractéristique de la scolastique, se tournait volontiers vers les sujets scabreux, du genre: faut-il vénérer les vers issus du cadavre d’un saint ?[85] Mais il est plus prudent d’éviter ces questions.
L’euphémisme est en effet fréquent dans le système religieux, précisément pour détourner les esprits des déductions gênantes. Il repose sur le respect qui interdit d’utiliser le même mot pour la même chose selon qu’elle est profane ou sacrée. « Enterrer un cadavre » se dit « inhumer une dépouille mortelle » dans le langage des faire-part; on ne dit pas le cadavre du saint, mais ses reliques corporelles. Cela n’est pas propre au système religieux mais caractérise les idéologies les plus diverses. Parmi les exemples contemporains les plus caricaturaux, les États qu’on appelait jadis les « valets de l’impérialisme » sont souvent devenus la « communauté internationale ». Le métalangage de l’historien peut devenir précieux pour mettre de l’ordre, non pas en faisant de « cadavre » le contenu latent de « dépouille mortelle », puisque ces mots sont synonymes, mais en appelant un chat un chat.
Inversement, il arrive aussi que ce soient les plus engagés dans l’univers symbolique qui l’utilisent de la manière la plus transparente. On l’a dit pour la signification sexuelle du jardin clos. Les commentaires du Cantique des cantiques qui l’expriment ouvertement sont produits à l’intérieur du milieu monastique, car c’est là que la spiritualité offre un érotisme de substitution. Il y a encore une catégorie de textes qui pousse l’univers symbolique dans ses implications les plus gênantes, les œuvres comiques. Si on hésite à constater l’intention de représenter les crucifix asexués, il suffit de lire les fabliaux et autres nouvelles qui leur sont consacrés, comme Le prêtre crucifié[86]. Un prêtre libidineux est surpris par un sculpteur auprès de sa femme et va se cacher dans l’atelier où il se tient immobile les bras en croix, afin d’être pris pour un crucifix. Le sculpteur l’aperçoit, se dit qu’il devait être saoul pour avoir donné un sexe au Crucifié et châtre le prêtre. Les choses sont claires à défaut d’être expliquées et, pour trouver l’explication, il faut encore prendre en considération les textes théologiques qui, depuis saint Augustin, retirent au Christ la puissance d’engendrer[87].
Il y avait en fait une difficulté: le fabliau du Prêtre crucifié, qui pourrait être le plus ancien sur le thème, ne porte pas de date, mais sa langue fait supposer le début du XIIIe siècle, alors que les crucifix asexués n’apparaissent pas avant la fin du siècle. La solution était donc dans la théologie qui donnait déjà son sens au fabliau, avant de permettre et de justifier le motif iconographique.
Les exemples que nous avons donnés pour caractériser les systèmes symboliques vont de simples manières de parler ou de peindre, en somme du langage imagé, à des dogmes religieux dont le refus pouvait être criminel, ce qui peut donner l’impression de tout mélanger. Mais il suffit de constater que l’interprétation littérale des formules eucharistiques, « Ceci est mon corps », « ceci est mon sang », n’a pas toujours été un dogme et n’est guère plus qu’une manière de parler dans le protestantisme le plus sécularisé. Bien sûr, toutes les religions n’ont pas mis en place une dogmatique élaborée et il s’agit plutôt d’un trait caractéristique du christianisme, mais il est évident qu’il y a aussi des choses à ne pas dire dans les autres religions.
Plutôt que de considérer comme une absurdité l’ambivalence du symbolique, il faut remarquer qu’elle donne du jeu au système religieux et permet de le faire évoluer. Prenons l’exemple des conceptions du diable chez les chrétiens. Cela varie d’une entité psychologique à une présence physiquement constatable. Pour les hommes d’Église carolingiens, le diable, c’est l’erreur, la superstition voire la bêtise. A partir du XVe siècle, lorsque la répression de la sorcellerie se met en place, il commence à laisser des traces. Jeanne d’Arc prisonnière avait été accusée de sorcellerie. Aussi appela-t-on un médecin pour vérifier sa virginité. Lorsqu’il l’eut confirmée, l’accusation de sorcellerie fut retirée et on se contenta de l’hérésie, qui la conduisit aussi facilement au bûcher. Tout cela parce que désormais, les démonologues associent au pacte le coït avec le diable qui laisse forcément des traces. S’agit-il d’un changement de mentalité ? Pas du tout, car au temps de la chasse aux sorcières, les partisans de l’ancienne doctrine sont restés nombreux et, toujours aujourd’hui, beaucoup de bons chrétiens ne croient pas à l’action physique du diable et considèrent la persécution de la sorcellerie comme un crime.
La rationalité dans l’histoire
Dans les pages qui précèdent, nous avons souvent mis sur le même plan la rationalité du passé et la nôtre, montrant que les raisonnements des uns n’étaient pas plus paradoxaux que ceux des autres. Le lecteur nous accusera peut-être de « fixisme » en trouvant dans cette attitude une négation du changement historique. Après avoir lu avec enthousiasme dans notre jeunesse les travaux de Lévi-Strauss, de Foucault et de tant d’autres, nous serions revenus à une conception antérieure de l’histoire, celle d’un ‘ »éternel humain » invariable.
La critique de l’histoire évolutionniste de la rationalité, nous l’avons faite et il ne reste qu’à la résumer. Le point de départ est la confrontation de Lévy-Bruhl avec les « sociétés inférieures ». Pour lui, la rationalité occidentale est là depuis Aristote et il n’y a donc pas à en faire l’histoire. En revanche, elle nous distingue clairement de ces sociétés qui ne connaissent pas le principe d’identité. Le problème devient historique avec l’histoire des mentalités qui projette sur nous-mêmes l’opposition entre la pensée primitive qui aurait été la nôtre et la rationalité que nous aurions progressivement acquise. Le changement de paradigme se durcit encore dans le structuralisme qui tend à enfermer chaque société dans une synchronie autarcique. Du coup, la présente d’héritages du passé, non pas des prétendues survivances primitives qui ont été suffisamment dénoncées, mais d’œuvres de la pensée et de l’art transmises avec respect, devient l’anachronisme chez des historiens qui ne comprennent même plus ce que le mot veut dire. Il est donc temps de poser clairement la question: la rationalité, a-t-elle une histoire?
Constatons d’abord que le problème est généralement conçu comme global. La rationalité serait une, présente ici dans tous les comportements et totalement absente là. Or nous avons vu assez d’exemples de rationalité partielle, tant dans le passé que dans le présent pour considérer ce point de vue comme erroné. Qu’on pense par exemple à l’attitude des catholiques et des Nuer d’une part dans la vie courante et d’autre part dans le contexte sacrificiel où le pain se fait chair et le concombre bœuf. Souvent, ce sont les présupposés du raisonnement que nous jugeons faux chez les théologiens scolastiques, alors que sa conduite est d’une logique implacable.
Le problème se simplifie dès qu’on se demande de quel domaine on parle. En matière scientifique, les changements sont colossaux. Pensons simplement à l’arithmétique. L’Antiquité et le Moyen Age possédaient un système de chiffres peu maniables jusqu’à l’introduction des chiffres arabes. Le zéro n’existait pas. Il était compliqué de faire une soustraction en chiffres romains et la division ne pouvait être correcte faute de prise en considération des nombres irrationnels. Le développement des langages formels, à commencer par l’algèbre (encore un apport arabe), a multiplié les possibilités du calcul. De découvertes en découvertes, notre univers est devenu déterministe jusqu’à ce que la physique des particules mette le déterminisme en échec.
La transformation de la science en technologie au cours du XXe siècle, à travers un subventionnement utilitariste et une privatisation rampante n’est évidemment pas un progrès, mais il s’agit aussi d’un changement décisif. On voit mal comment une découverte comparable à celle des lois de la relativité serait désormais possible.
En revanche, un progrès incontestable est la liberté d’expression, consacrée en 1789 par la Déclaration des droits de l’homme. Elle est aujourd’hui en net recul dans le monde et même en France où elle est progressivement rognée, avec toutes sortes de bons prétextes. Mais elle a modifié sensiblement la nature des textes, principalement des textes publiés, la manière d’écrire et de lire. Lorsque nous lisons un texte antérieur à sa proclamation, nous nous demandons constamment si nous sommes en face de ce que pense vraiment l’auteur. Les exégètes de Montaigne en sont un bon exemple, car certains en font un athée, d’autres un catholique fervent. Une pensée philosophique et politique révolutionnaire comme celle de Marx n’aurait jamais pu s’exprimer sans la liberté d’expression. Il est même probable qu’elle n’aurait pas pu être conçue.
Il est inutile de continuer à énumérer les changements qui affectent l’exercice de la rationalité et font que nous avons parfois de la peine à la déceler dans les pensées du passé. Mais il faut se demander pourquoi nous pouvons encore admirer des pensées que ces changements nous ont rendues étrangères. La réponse en est dans l’invariabilité des principes logiques essentiels. Une fois compris que les entorses au principe d’identité chez les catholiques et les Nuer ne les affectent pas, que ces entorses n’auraient d’ailleurs aucun sens si ce principe n’existait pas, il faut se demander pourquoi ce principe est universel. Il l’est parce que le langage humain ne pourrait fonctionner sans lui. La dénomination des objets composant le monde doit être assez univoque pour qu’on puisse s’entendre. L’univocité du langage naturelle est certes bien moindre que celle des langages formels. C’est ainsi qu' »appeler un chat un chat » n’a rien de tautologique, puisque le chat qu’on appelle ainsi est le sexe de la femme. L’humour de l’expression vient justement de la transgression d’une règle de langage. Mais lorsqu’on dit « le chat est sur le tapis », il n’y a généralement pas de double sens. Un langage dans lequel « chien » vaudrait pour « chat » et inversement ne pourrait pas fonctionner. Lorsque quelqu’un transgresse le principe d’identité sans faire exprès, on dit qu’il se contredit. La contradiction est une faute de langage.
Le principe d’identité n’est pas seul à être inhérent au langage et universel. Il y a aussi l’usage de catégories. Ces catégories sont hautement variables: c’est ainsi que celles de substance et d’accident, fondamentales dans la logique aristotélicienne, ne le sont plus dans la nôtre. Mais nous utilisons toujours un empilement des désignations comparable à celui des genres et des espèces d’Aristote: les chats (au sens propre du mot) se divisent en chartreux, siamois, maine coon, chats de gouttière, etc. Cela vaut pour la géologie comme pour la vie courante. La copule « est » telle que nous l’utilisons pour dire « le chat est un animal » (sauf emploi métaphorique) n’équivaut pas exactement à la copule « ɛ » du langage formel russellien, mais celle de Stanisław Leśniewski a exactement le même sens dans son langage formel concurrent, preuve qu’elle est formalisable. Cela ne met pas le langage naturel sur le même plan que les langages formels. Contrairement au langage naturel, les langages formels ont l’avantage d’interdire la contradiction. Mais personne n’est obligé de se contredire lorsqu’il utilise le langage naturel. Surtout, le langage naturel peut énoncer une contradiction et dire pourquoi c’en est une. Lui seul permet la critique de l’irrationnel et, quelle que soit la valeur des langages formels, il leur est supérieur de ce point de vue.
On distinguera donc des rationalités, diverses comme les systèmes scientifiques auxquels elles appartiennent, d’un fond commun de rationalité qui est inscrit dans le langage et que, de tout temps, on a appelé la raison. En prenant position sur la sémantique, nous avons distingué la réception d’un message de son interprétation. Lorsque le message et celui qui le reçoit sont compétents, la réception est objective et ne constitue pas une interprétation. En revanche, lorsque nous nous demandons pourquoi ce message plutôt qu’un autre, nous en cherchons non plus la signification, mais le sens s’il en a un, car le considérer avec raison comme l’œuvre d’un insensé est aussi une possibilité. Lorsque l’interprétation du message confirme son bien-fondé, il nous délivre une connaissance, qu’il vienne d’un pays ou d’un passé lointain. Et c’est la raison pour laquelle nous ne sommes prisonniers ni de notre village, ni de la synchronie. La raison rend ainsi possible aux textes de franchir les siècles en gardant leur intelligibilité.
![]()
L’éthique de l’historien
En prétendant pouvoir juger de la raison ou de la déraison des textes du passé, nous rejetons la condescendance, voire l’indifférence, de l’histoire des mentalités envers ces textes. Mais alors, nous ne pouvons échapper à une autre tâche qui est celle de juger d’un point de vue éthique.
Il est arrivé plusieurs fois ces dernières décennies que des historiens jouent un rôle d’expert au tribunal, en particulier des spécialistes de la période contemporaine face aux agissements des nazis et de leurs collaborateurs. L’historien de l’architecture des époques antérieures peut aussi être amené à jouer un rôle d’expert, lorsqu’il s’agit de savoir si tel monument mérite d’être classé. Dans les deux cas, on leur demande des renseignements aussi factuels que possible à partir desquelles prendre une décision. Cela pose un problème assez général dans l’expertise.
Il ne s’agit pas ici du problème le plus classique, celui de l’industriel de l’amiante chargé de se prononcer sur ses méfaits ou de l’architecte-bétonneur sur la conservation d’un monument ancien, mais du passage de l’exposé de faits à la formulation d’un jugement. En général, tout se passe comme si la connaissance des faits et du droit rendait ce passage automatique. Du point de vue du droit positif, Maurice Papon et Paul Touvier ont agi conformément aux lois de leur pays au moment des faits, ils sont donc innocents. L’autre point de vue est celui du droit naturel, sur lequel se fonde la notion de crime contre l’humanité. Elle entraîne forcément l’imprescriptibilité de ces crimes, sans quoi même le procès de Nuremberg aurait été impossible, mais il serait difficile de nier que c’est une loi rétroactive qui entraîne non moins mécaniquement la condamnation. J’omets ici bien des aspects du problème de la collaboration (continuité de l’État, obéissance à l’occupant, légitimité de l’État Français, et ainsi de suite) pour ne retenir que l’opposition des deux grandes conceptions du droit.
Dans cette alternative, un troisième terme est absent : les mentalités. Heureusement ! Trop de monde s’est empressé et s’empresse toujours de justifier les crimes de guerre, mais il serait inacceptable d’expliquer le nazisme par une mentalité nazie, à la manière dont l’histoire des mentalités donne aux massacres d’un passé plus lointain l’excuse de la croyance.
Il reste donc le choix entre droit positif et droit naturel. L’historien ne peut pas, à proprement parler, juger le passé selon le droit positif, car il ne s’agirait pas d’un jugement, mais d’un constat : un acte était légal lorsqu’il n’était pas interdit par la loi, illégal sinon. Il peut en revanche juger en termes de droit naturel : il s’agit alors d’un jugement de valeur. Marc Bloch lui demande de renoncer à de tels jugements, tout en admettant que les actes humains peuvent être présentés comme des réussites ou des échecs. Pourtant, l’historien s’expose souvent autant en les présentant ainsi. Y a-t-il une réponse objective à cette autre question dans le cas de la révolution française ? En outre, il est souvent impossible d’éviter les jugements implicites. D’une étude sur Robespierre, il ressortira implicitement qu’il était soit un héros, soit un criminel sanguinaire, éventuellement les deux.
Le jugement de l’historien est très différent de celui du juge. En justice, on peut être présumé coupable, mais il n’y a pas de présumé innocent : si la culpabilité n’est pas établie, on est innocent. L’historien a parfaitement le droit de dire sur de simples indices d’une personne qui vivait autrefois qu’elle était probablement coupable ou innocente, car son jugement n’a aucune conséquence pour cette personne. En définitive, le problème est éthique et non juridique.
Il a deux mauvaises solutions, le relativisme et son contraire : le jugement du passé selon les normes d’aujourd’hui. Le relativisme enferme chaque société dans sa bulle, interdisant aussi bien d’en reconnaître les faiblesses que les accomplissements les plus enviables. Faire de la nôtre la norme interdit de se mettre en question. L’histoire des mentalités réussit même à combiner les deux travers en supposant la rationalité des autres inférieure à la nôtre tout en refusant de la déconsidérer. Selon un présupposé plus ou moins implicite, leur rationalité était encore dans l’enfance et méritait donc l’indulgence des adultes que nous sommes. Mais il est possible d’éviter le dilemme en prenant de la distance par rapport à la société dans lesquelles on vit et rien mieux que l’histoire et l’anthropologie ne peut nous apprendre à le faire. Il en va de même pour les normes esthétiques. Va-t-on juger Michel-Ange à l’aune de Jeff Koons ? Ne serait-ce pas plutôt la connaissance des arts du passé qui conduit à se poser des questions sur l' »art » contemporain ?
Parmi les pionniers d’une approche du passé radicalement opposée à l’apologie du présent, il y a un historien du droit : Ernst Kantorowicz (1895-1963). Prussien de naissance juive, mais d’extrême droite, il comprit l’inconfort de sa position lorsque les nazis vinrent au pouvoir et sut se dégager de ses convictions. Exilé aux États-Unis, il apprit à nouveau à ses dépens qu’il ne s’agissait pas du « pays de la liberté » lorsqu’il fut poussé à la démission de son poste à Berkeley par la « chasse aux sorcières » du maccarthysme, refusant de signer un serment anti-communiste an nom de la liberté d’expression. L’originalité de son œuvre est de faire de l’histoire non pas pour montrer comment nous sommes devenus intelligents, mais pour y chercher les étapes qui mènent au totalitarisme contemporain, en somme comment nous sommes devenus si serviles[88].
Une autre approche, également en rupture totale avec l’histoire condescendante du passé, est bien moins connue: celle de Desmond Paul Henry (1921-2004). Philosophe de formation, il est surtout mentionné comme pionnier du computer art. Son apport à l’histoire de la logique est pourtant capital[89]. Il analyse les problèmes essentiellement sémantiques que discute la scolastique médiévale en se servant d’algèbres logiques, comme celle de Stanisław Leśniewski (1886-1939) et en démontrant leur parfaite actualité. Il parvient surtout à évaluer le degré exact de consistance des systèmes médiévaux et à en situer les apories qui ne sont pas si éloignées des nôtres. Ses recherches ne sont pas à la portée de tous les historiens et c’est dommage, parce qu’elles leur permettraient de réviser quelques a priori sur l’histoire de la rationalité. Si la sémantique des scolastiques n’égale pas la nôtre, c’est largement, comme l’a montré Henry, parce qu’ils ont dû se contenter d’un latin semi-formalisé, là où nous disposons d’une algèbre. Cela dit, nos capacités de calcul logique n’ont dépassé les leurs que depuis Gottlob Frege et leur niveau était misérable entretemps.
Des exemples aussi différents que ceux de Kantorowicz et de Henry illustrent un principe qui guidait leurs travaux, sans y être explicite, le principe de réciprocité. En étudiant l’un des textes juridiques, l’autre des traités logiques, ils se sont visiblement aperçu qu’ils nous interrogeaient sur nous-mêmes autant que nous les interrogions sur leur époque. Ce principe a été longtemps difficile à admettre, du fait de la tendance à considérer les catégories des autres et les nôtres comme irréductibles. Il fallait effectivement en finir, par exemple, avec la fiction de l’homo oeconomicus: anthropologues puis historiens ont compris que les Mélanésiens et les hommes du Moyen Age n’avaient rien à faire de la loi de maximisation du profit et que projeter sur eux les préoccupations du capitaliste idéal était absurde. Mais assez tôt, les esprits les plus lucides se sont demandé si l’homo oeconomicus n’était pas une fiction non moins incapable de rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Dès 1949, Georges Bataille considéra le plan Marshall comme une forme de potlatch[90]. C’était assez inexact, mais il y avait cela de juste que nos mœurs n’étaient pas incomparables à celles des sociétés les plus exotiques.
Un exemple plus tardif marque un tournant radical: l’étude de la parenté occidentale. Les systèmes de parenté des « primitifs » ou des « sauvages » passait jusque-là pour une caractéristique de leurs cultures auxquels l’histoire nous avait fait échapper. Claude Lévi-Strauss, auquel ces études doivent beaucoup, a été explicite à ce sujet : il y aurait des sociétés chaudes, douées d’une capacité de changement, qui s’évadent des systèmes de parenté et des sociétés froides qui ne se transforment pas et dans lesquelles ces systèmes sont immuables[91]. Par la suite, il a beaucoup nuancé cette vue simplificatrice, proposant que les sociétés puissent se réchauffer ou se refroidir à travers l’histoire et admettant que cette alternance touchait aussi la société occidentale[92]. Cette nouvelle attitude procédait d’un mouvement plus général, aboutissant à un développement fructueux des travaux sur la parenté occidentale de l’Antiquité à aujourd’hui.
La capacité de nous dépayser jusqu’à la mise en cause de nos propres catégories a été longtemps liée à l’espace, de la découverte de l’Amérique et du « bon sauvage » à l’anthropologie du XXe siècle, mais le filon tend à s’épuiser. En effet, la mondialisation tue l’altérité et transforme en même temps le sentiment d’altérité en haine identitaire de l’autre. Rien ne se ressemble plus qu’un islamiste radical et un chrétien évangéliste, mais ils ne risquent ni de le comprendre, ni de se comprendre. La reconversion de beaucoup d’anthropologues vers l’étude de notre quotidien risque d’affadir la discipline et de la faire tourner en rond. Il revient désormais à l’histoire de reprendre le flambeau en étudiant l’altérité du passé. Autant l’historien a pu la négliger, en prêtant aux rois du passé les préoccupations de ceux de son temps, voire des hommes politiques et des hommes d’affaire qui les ont remplacés, en imaginant la religion médiévale sur le modèle des religions confessionnelles qu’il connaissait, autant il a fini par croire que le passé et le présent n’avaient rien d’autre en commun que de concerner un bipède sans plumes. Face à ces impasses, on parle beaucoup d’anthropologie historique depuis quelques décennies. Ce qu’il reste à faire est de se donner les moyens d’accomplir au mieux ce beau programme, en mettant en question nos propres catégories. Face à la crise écologique dont nous sommes responsables, il est grand temps d’avoir la modestie de le faire.
![]()
Bibliographie
Agobard, De grandinis et tonitruis, éd. Lieven van Acker, Turnhout, 1981 (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 52, p. 3-15).
Agrippa (Henri Cornelius), De nobilitate atque praecellentia foeminei sexus, rééd. La Haye, 1603.
Bachelard (Gaston),
– La philosophie du non, Paris, 1966 (1ère éd. 1940).
– L’activité rationaliste de la physique contemporaine, Paris, 1951.
Bailey (Michael D.), « Magic and Disbelief in Carolingian Lyon », in: Civilizations of the Supernatural: Witchcraft, Ritual, and Religious Experience in Late Antique, Medieval, and Renaissance Traditions, éd. Fabrizio Conti, Budapest, 2020, p. 177-202.
Bakhtine (Mikhaïl), L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance, trad. Paris, 1970.
Bataille (Georges), La part maudite, Paris, 1949.
Blickle (Peter), Die Revolution von 1525, Munich, 1975.
Bloch (Marc), Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, 2e éd. 1952.
Bourdieu (Pierre), Le sens pratique, Paris, 1980.
Bouveresse (Jacques), Philosophie, mythologie et pseudo-science. Wittgenstein lecteur de Freud, rééd. Paris, 2015.
Buslag (James), « Ideology and Iconography in Chartres Cathedral: Jean Clément and the Oriflamme », Zeitschrift für Kunstgeschichte, t. 61 (1998), p. 491-508.
Büttgen (Philippe) et alii, Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur l’islamophobie savante, Paris, 2009.
Chaunu (Pierre), Le temps des réformes. Histoire religieuse et système de civilisation, Paris, 1975.
Congar (Yves), L’ecclésiologie du haut Moyen Age, Paris, 1968.
Crawford (J. R.), Witchcraft and Sorcery in Rhodesia, Londres, 1967.
Cristiani (Marta), Tempo rituale et tempo storico. Comunione cristiana et sacrificio. Le controversie eucaristiche nell’alto medioevo, Spolète, 1997.
De Lubac (Henri),
– Corpus mysticum. L’eucharistie et l’Église au Moyen Age. Etude historique, Paris, 1944.
– Surnaturel. Etudes historiques, Paris, 1946.
Delumeau (Jean), La peur en Occident, Paris, 1978.
Denifle (Heinrich), Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung, Mayence, 1904-1909.
Dewerpe (Alain), « La ‘stratégie’ chez Pierre Bourdieu », Enquête [En ligne], t. 3 (1996).
Di Iorio (Francesco), « L’Espace poppérien du raisonnement historique: trois critiques contre le dualisme méthodologique de Jean-Claude Passeron », Nuova Civiltà delle macchine, t. 25-2 (2007).
Didi-Huberman (Georges), Devant l’image. Questions posées aux fins d’une histoire de l’art, Paris, 1990.
Dubar (Claude), compte rendu de Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Revue française de sociologie, t. 14 (1973), p. 550-555.
Durkheim (Emile), Compte rendu d’Antonio Labriola, Essais sur la conception matérialiste de l’histoire, Revue philosophique, t. 44 (1897), p. 643-655.
Eco (Umberto), La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, trad. Paris, 1972 (1ère éd. italienne, 1968).
Elias (Norbert), La civilisation des mœurs, Paris, 1973 (1ère éd. allemande, 1939).
Engels (Friedrich), Der deutsche Bauernkrieg, Hambourg, 1850.
Evans-Pritchard (Edward E.), Nuer Religion, Oxford, 1956.
Fauconnier (Gilles), Espaces mentaux. Aspect de la construction du sens dans les langues naturelles, Paris, 1984.
Favret-Saada (Jeanne), Les mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage, Paris, 1977.
Febvre (Lucien),
– Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, rééd. Paris, 1968.
– « La sorcellerie, sottise ou révolution mentale? », Annales E.S.C., t. 3 (1948), p. 9-15.
Ferdière (Alain) et alii, « Discordances chronologiques à Tours aux Ier et IIe s. apr. J.-C.: questions posées à l’archéologie et à la dendrochronologie », Archéosciences. Revue d’archéométrie, t. 38 (2014), p. 151-163.
Frege (Gottlob), Ecrits logiques et philosophiques, trad. Claude Imbert, Paris, 1971.
Garnier (Charles), Le nouvel opéra, Paris, 1678-1881.
Gerbron (Cyril), Fra Angelico. Liturgie et mémoire, Turnhout, 2016.
Goodman (Nelson), Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles, trad. Nîmes, 1990 (1ère éd. anglaise, 1968).
Gougenheim (Sylvain), Aristote au Mont Saint-Michel, Paris, 2008.
Grands Rôles des échiquiers de Normandie, éd. Amédée-Louis Léchaudé d’Anisy, Paris, 1845.
Grisar (Hartmann), Martin Luther, sa vie et son œuvre, trad. Paris, 1931.
Guerreau (Alain),
– L’avenir d’un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Age au XXIe siècle, Paris, 2001.
– Saint-Philibert de Tournus. La société, les moines, l’abbatiale, Tournus, 2019.
Guerreau-Jalabert (Anita), « Spiritus et caritas. Le baptême dans la société médiévale », in: La Parenté spirituelle, dir. Françoise Héritier et Élisabeth Copet-Rougier, Paris – Bâle, 1995, p. 133-203.
Guibert de Nogent, De sanctis et eorum pigneribus, éd. Robert B. C. Huygens, Tunhout, 1993 (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 127, p. 79-175).
Hartog (François), Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, 2003.
Henry (Desmond Paul),
– The Logic of Saint Anselm, Oxford, 1967.
– That Most Subtle Question (Quaestio Subtilissima), Manchester, 1984. –
Medieval Mereology, Amsterdam – Philadelphie, 1991.
Jauss (Hans Robert), Pour une théorie de la réception, Paris, 1978.
Kantorowicz (Ernst),
– Laudes regiae. Une étude des acclamations liturgiques et du culte du souverain au Moyen Age (1946), trad. Paris, 2004.
– Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Age (1957), in: Œuvres, trad. Paris, 2000, p. 643-1222.
– Mourir pour la patrie et autres textes, prés. Pierre Legendre, trad. Paris, 1984.
Keck (Frédéric), Le problème de la mentalité primitive. Lévy-Bruhl entre philosophie et anthropologie (thèse, Lille III), 2003.
Langlois (Charles-Victor) et Seignobos (Charles), Introduction aux études historiques, Paris, 1898.
Lavićka (Jan), Anthologie hussite, Paris, 1985.
Lévi-Strauss (Claude),
– Entretiens avec Georges Charbonnier, Paris, 1961.
– Le cru et le cuit, Paris, 1964.
– « Un autre regard », L’Homme, t. 126-128 (1993), p. 7-11.
Loraux (Nicole), « Eloge de l’anachronisme en histoire », Espace Temps, t. 87-88 (2005), p. 127-139.
MacFarlane (Alan), Witchcraft in Tudor and Stuart England. A Regional and Comparative Study, Londres, 1970.
Magni rotuli scaccarii Normandiae sub regibus Angliae, pars secunda, éd. Amédée-Louis Léchaudé d’Anisy et Antoine Charma, Caen, 1852.
Mandrou (Robert), Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, 1968.
Marrou (Henri-Irénée), De la connaissance historique, Paris, 1954.
Martin (Robert) Pour une logique du sens, Paris, 1983.
Meens (Rob), « Thunder over Lyon: Agobard, the Tempestarii and Christianity », in: Paganism in the Middle Ages. Threat and Fascination, éd. Carlos Steel, John Marenbon et Werner Verbeke, Louvain, 2012, p. 157-166.
Moody (Ernest A.), Truth and Consequence in Mediaeval Logic, Amsterdam, 1953.
Morin (Hervé), « The Lancet annonce le retrait de son étude sur l’hydrochloroquine », Le Monde, 5 juin 2020.
Nouveau recueil complet des fabliaux, éd. Nico van den Boogaard et Willem Noomen, Assen, 1983-2001.
Panofsky (Erwin), Essais d’iconologie, trad. Paris, 1967.
Passeron (Jean-Claude), Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, 1991.
Platelle (Henri), « Agobard, évêque de Lyon (+ 840). Les soucoupes volantes, les convulsionnaires », in: Apparitions et Miracles, Actes du colloque de l’U.L.B., Bruxelles, 1991, p. 85-93.
Poisson (Jean-Michel), « Archéologie médiévale et Histoire de la culture matérielle: quarante ans après », Palethnologie [En ligne], t. 9 (2017).
Quine (Willard V. O.),
– « On what there is? », Review of Metaphysics, t. 2 (1948), p. 21-38.
– Méthodes de logique, trad. Paris, 1984.
Reichenbach (Hans), « Les fondements logiques du calcul des probabilités », Annales de l’I. H. P., t. 7 (1935), p. 267-348.
Riquetti de Mirabeau (Victor), L’ami des hommes ou traité de la population, Avignon, 1756.
Schmitt (Jean-Claude), Le corps, les rites, les rêves, les temps. Essais d’anthropologie médiévale, Paris, 2001.
Sokal (Alain) et Bricmont (Jean), Impostures intellectuelles, Paris, 1997.
Tahon (Marie-Blanche), Sociologie des rapports de sexe, Ottawa – Rennes, 2003.
Thierry (Augustin), Lettres sur l’histoire de France, Ponthieu, 1827.
Trevor-Roper (Hugh), The European Witch-Craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries and Other Essays, New York, 1969.
Usener (Hermann), Kleine Schriften, Leipzig, 1913.
Van der Meulen (Jan), « Recent Literature on the Chronology of Chartres Cathedral », The Art Bulletin, t. 49 (1967), p. 152-172.
Veyne (Paul), Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, 1971.
Vidal-Naquet (Pierre), Les assassins de la mémoire. « Un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme, Paris, 2005.
Weber (Max), Economie et société. t. 1 Les catégories de la sociologie, Paris, 2007 (1ère éd. allem. 1922).
Wirth (Jean),
– Sainte Anne est une sorcière et autres essais, Genève, 2003.
– La datation de la sculpture médiévale, Genève, 2004, p. 146.
– L’image à la fin du Moyen Age, Genève, 2011.
– « Le cadavre et les vers selon Henri de Gand (Quodlibet, X, 6) », repris dans: L’image du corps au Moyen Age, Florence, 2013, p. 153-166.
– « Fondations, donations et chronologie des chantiers: le cas des églises d’Auvergne », repris dans: Art et image au Moyen Age, Genève, 2022, p. 375-401.
– La sculpture de la cathédrale de Reims et sa place dans l’art du XIIIe siècle, Genève, 2017.
– « L’emprunt des propriétés du nom par l’image médiévale », repris dans: Art et image au Moyen Age, Genève, 2022, p. 85-118.
– La sorcellerie et sa répression en Europe, Genève, 2023.
Wirth (Jean) et alii, Les marges à drôleries des manuscrits gothiques (1250-1350), Genève, 2008.
- Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études historiques, Paris, 1898, p. 233. ↑
- Victor Riquetti de Mirabeau, L’ami des hommes ou traité de la population, Avignon, 1756. ↑
- Alain Guerreau, L’avenir d’un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Age au XXIe siècle, Paris, 2001, p. 23 et ss. ↑
- Friedrich Engels, Der deutsche Bauernkrieg, Hambourg, 1850. ↑
- A partir d’Augustin Thierry, Lettres sur l’histoire de France, Ponthieu, 1827, principalement la lettre XVIII, p. 271 et ss. ↑
- Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance, trad. Paris, 1970. ↑
- Sylvain Gougenheim, Aristote au Mont Saint-Michel, Paris, 2008. Voir entre autres les réactions de Philippe Büttgen et alii, Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur l’islamophobie savante, Paris, 2009. ↑
- Frédéric Keck, Le problème de la mentalité primitive. Lévy-Bruhl entre philosophie et anthropologie (thèse, Lille III), 2003 (accessible sur Internet). ↑
- Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, rééd. Paris, 1968, p. 17. ↑
- A partir de 1977. Cf. les articles repris dans: Sainte Anne est une sorcière et autres essais, Genève, 2003. ↑
- Febvre, Le problème de l’incroyance, p. 404. ↑
- Jean Wirth, « Contre la thèse de l’acculturation », in: Sainte Anne est une sorcière, p. 177-198. ↑
- Pierre Chaunu, Le temps des réformes. Histoire religieuse et système de civilisation, Paris, 1975; Jean Delumeau, La peur en Occident, Paris, 1978. ↑
- Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Paris, 1973 (1ère éd. allemande, 1939). ↑
- Hugh Trevor-Roper, The European Witch-Craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries and Other Essays, New York, 1969; Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, 1968. ↑
- Emmanuel Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris, 1966. Nous utilisons la réédition abrégée de 1969, suffisamment longue et répétitive. ↑
- Id., p. 355 et s. ↑
- Comme le déplore l’ethnologue Mariel J. Brunhes-Delamarre dans son compte rendu du livre (Ethnologie française, n.s., t. 2 (1972), p. 383-385. ↑
- Le Roy Ladurie, op. cit., p. 237 et ss. ↑
- Jean Wirth, La sorcellerie et sa répression en Europe, Genève, 2023. ↑
- Gaston Bachelard, L’activité rationaliste de la physique contemporaine, Paris, 1951, p. 26. ↑
- Cette heureuse réaction est particulièrement évidente dans les articles que Jean-Claude Schmitt a réunis sous le titre: Le corps, les rites, les rêves, les temps. Essais d’anthropologie médiévale, Paris, 2001. ↑
- Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit, Paris, 1964, p. 20. ↑
- Umberto Eco, La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, trad. Paris, 1972 (1ère éd. italienne, 1968); Nelson Goodman, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles, trad. Nîmes, 1990 (1ère éd. anglaise, 1968). ↑
- Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, 1980, p. 271 et ss. ↑
- Hans Robert Jauss, Pour une théorie de la réception, Paris, 1978 (traduction d’une série d’essais). ↑
- Voir l’embarras de Jean-Michel Poisson, « Archéologie médiévale et Histoire de la culture matérielle: quarante ans après », Palethnologie [https://journals.openedition.org/palethnologie/285], t. 9 (2017), pour la définir. ↑
- François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, 2003. ↑
- Hermann Usener, Kleine Schriften, Leipzig, 1913, p. 429-435. ↑
- Heinrich Denifle, Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung, Mayence, 1904-1909, 5 vol.; Hartmann Grisar, Martin Luther, sa vie et son œuvre, trad. Paris, 1931. ↑
- Yves Congar, L’ecclésiologie du haut Moyen Age, Paris, 1968. ↑
- Henri de Lubac, Surnaturel. Etudes historiques, Paris, 1946. ↑
- Gender is the range of characteristics pertaining to, and differentiating between, masculinity and femininity. Depending on the context, these characteristics may include biological sex (i.e. the state of being male, female or an intersex variation which may complicate sex assignment), sex-based social structures (including gender roles and other social roles), or gender identity. La définition s’est encore modifiée pour traiter moins allusivement les autres catégories: Most cultures use a gender binary, having two genders (boys/men and girls/women); those who exist outside these groups fall under the umbrella term non-binary or genderqueer. Some societies have specific genders besides « man » and « woman », such as the hijras of South Asia; these are often referred to as third genders (and fourth genders, etc.) (28/03/2021). ↑
- La critique et le refus raisonné de l’opposition sex / gender sont parfaitement compatibles avec un féminisme lucide, comme le montre, par exemple l’ouvrage de Marie-Blanche Tahon, Sociologie des rapports de sexe, Ottawa – Rennes, 2003. ↑
- La remarque a déjà été faite dans Langlois et Seignobos, op. cit,, p. 201. ↑
- On pense entre autres à l’essai confus de Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, 1971, impeccablement réfuté dans le compte rendu de Claude Dubar, Revue française de sociologie, t. 14 (1973), p. 550-555. ↑
- Max Weber, Economie et société. t. 1 Les catégories de la sociologie, Paris, 2007 (1ère éd. allem. 1922). ↑
- Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, 1991. ↑
- Comme l’a montré Francesco Di Iorio, « L’Espace poppérien du raisonnement historique: trois critiques contre le dualisme méthodologique de Jean-Claude Passeron », Nuova Civiltà delle macchine, t. 25-2 (2007). ↑
- Philippe Gréa, « Probabilités et statistiques en psychologie et en linguistique », Texto!, t. 22-2 (2017). ↑
- Sur le problème dans le cas de la physique, cf. Hans Reichenbach, « Les fondements logiques du calcul des probabilités », Annales de l’I. H. P., t. 7 (1935), p. 267-348, en particulier p. 271 et ss. ↑
- Di Iorio, op. cit. ↑
- Certaines de ces critiques sont acceptées dans l’excellent livre d’Alain Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, 1997, p. 60 et ss., qui admet finalement le bien-fondé du critère. Le malaise des auteurs tient peut-être au fait que la physique des particules s’en affranchit volontiers. ↑
- Lucien Febvre, Combats pour l’histoire, Paris, 1992, p. 116. ↑
- Comme l’ont clairement exposé Sokal et Bricmont, op. cit., p. 94 et ss. ↑
- Gaston Bachelard, La philosophie du non, Paris, 1966, p. 56. ↑
- « Fondations, donations et chronologie des chantiers: le cas des églises d’Auvergne », repris dans: Art et image au Moyen Age, Genève, 2022, p. 375-401. ↑
- Jan Van der Meulen, « Recent Literature on the Chronology of Chartres Cathedral », The Art Bulletin, t. 49 (1967), p. 152-172. ↑
- « La naissance du concept de croyance (XIIe-XVIIe siècles) », repris dans: Sainte Anne est une sorcière, Genève, 2003, p. 113-176. ↑
- La datation de la sculpture médiévale, Genève, 2004, p. 146 et ss. ↑
- Les marges à drôleries des manuscrits gothiques (1250-1350), Genève, 2008. ↑
- Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, 2e éd. 1952, p. 99 et ss. ↑
- La sculpture de la cathédrale de Reims et sa place dans l’art du XIIIe siècle, Genève, 2017. ↑
- Alain Guerreau, Saint-Philibert de Tournus. La société, les moines, l’abbatiale, Tournus, 2019, p. 14. ↑
- Alain Ferdière et alii, « Discordances chronologiques à Tours aux Ier et IIe s. apr. J.-C.: questions posées à l’archéologie et à la dendrochronologie », Archéosciences. Revue d’archéométrie, t. 38 (2014), p. 151-163. ↑
- Hervé Morin, « The Lancet annonce le retrait de son étude sur l’hydroxychloroquine », Le Monde, 5 juin 2020. Mais il y a peut-être plus grave. Comme le dit ce journaliste: « Reste désormais à analyser comment Surgisphere, une petite société inconnue il y a quelques semaines encore, aura pu s’associer à des chercheurs de renom… ». ↑
- Peter Blickle, Die Revolution von 1525, Munich, 1975. ↑
- Arthur Kingsley Porter, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, Boston, 1923, vol. I, p. 3-17. Je dois à Alain Guerreau la connaissance de ces pages. ↑
- En particulier La datation de la sculpture médiévale, Genève, 2004 et « Fondations, donations et chronologie des chantiers: le cas des églises d’Auvergne », repris dans: Art et image au Moyen Age, Genève, 2022, p. 375-401. ↑
- Charles Garnier, Le nouvel opéra, Paris, 1678-1881, t. 1, p. 75 et ss. ↑
- Il faut préciser que « signification » et « sens » ne traduisent pas l’opposition frégéenne entre Sinn et Bedeutung qu’on a traduit par « sens » et « dénotation ». Cf. Gottlob Frege, « Sens et dénotation », in: Ecrits logiques et philosophiques, trad. Claude Imbert, Paris, 1971, p. 102-126. ↑
- Henri Cornelius Agrippa, De nobilitate atque praecellentia foeminei sexus, rééd. La Haye, 1603, p. 17. ↑
- Erwin Panofsky, Essais d’iconologie, trad. Paris, 1967, p. 13 et ss. ↑
- Bloch, op. cit., p. 79 et ss. ↑
- Nicole Loraux, « Eloge de l’anachronisme en histoire », Espace Temps, t. 87-88 (2005), p. 127-139. ↑
- Febvre, Le problème de l’incroyance, p. 15. ↑
- Georges Didi-Huberman, Devant l’image. Questions posées aux fins d’une histoire de l’art, Paris, 1990. ↑
- Cf. sa réfutation par Cyril Gerbron, Fra Angelico. Liturgie et mémoire, Turnhout, 2016, p. 141 et ss. ↑
- Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, 1954, p. 137. ↑
- James Buslag, « Ideology and Iconography in Chartres Cathedral: Jean Clément and the Oriflamme », Zeitschrift für Kunstgeschichte, t. 61 (1998), p. 491-508. ↑
- Grands Rôles des échiquiers de Normandie, éd. Amédée-Louis Léchaudé d’Anisy, Paris, 1845, p. 46; Magni rotuli scaccarii Normandiae sub regibus Angliae, pars secunda, éd. Amédée-Louis Léchaudé d’Anisy et Antoine Charma, Caen, 1852, p. 78. ↑
- Willard V. O. Quine, « On what there is? », Review of Metaphysics, t. 2 (1948), p. 21-38; voir aussi Id., Méthodes de logique, trad. Paris, 1984, p. 225 et ss. ↑
- Robert Martin, Pour une logique du sens, Paris, 1983; Gilles Fauconnier, Espaces mentaux. Aspect de la construction du sens dans les langues naturelles, Paris, 1984. ↑
- Edward E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, Oxford, 1956, p. 128 et passim. ↑
- Les historiens catholiques se sont acharnés à nier l’évolution de la doctrine eucharistique, en dehors d’Henri de Lubac qui la montre fort bien tout en la niant (Corpus mysticum. L’eucharistie et l’Église au Moyen Age. Etude historique, Paris, 1944). Voir aussi l’étude non biaisée de Marta Cristiani, Tempo rituale et tempo storico. Comunione cristiana et sacrificio. Le controversie eucaristiche nell’alto medioevo, Spolète, 1997. ↑
- Emile Durkheim, Compte rendu d’Antonio Labriola, Essais sur la conception matérialiste de l’histoire, Revue philosophique, t. 44 (1897), p. 643-655, en particulier p. 643 et s. ↑
- Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, 1980, p. 88 et s. ↑
- Id., p. 102. ↑
- Pour une analyse serrée des thèses de Bourdieu: Alain Dewerpe, « La ‘stratégie’ chez Pierre Bourdieu », Enquête [En ligne], t. 3 (1996). ↑
- Malheureusement, ce n’est plus toujours le cas. Dans les sciences rentables, les recherches si nécessaires consistant à vérifier des expériences prétendues concluantes ne sont guère financées. ↑
- Cité d’après Jacques Bouveresse, Philosophie, mythologie et pseudo-science. Wittgenstein lecteur de Freud, rééd. Paris, 2015, p. 82 et s. ↑
- « L’emprunt des propriétés du nom par l’image médiévale », repris dans: Art et image au Moyen Age, Genève, 2022, p. 85-118. ↑
- Bon aperçu de ces critiques dans Jan Lavićka, Anthologie hussite, Paris, 1985. ↑
- Guibert de Nogent, De sanctis et eorum pigneribus, éd. Robert B. C. Huygens, Tunhout, 1993 (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 127, p. 79-175). ↑
- Jean Wirth, « Le cadavre et les vers selon Henri de Gand (Quodlibet, X, 6) », repris dans: L’image du corps au Moyen Age, Florence, 2013, p. 153-166. ↑
- Nouveau recueil complet des fabliaux, éd. Nico van den Boogaard et Willem Noomen, Assen, 1983-2001, t. 4, n° 27, p. 106 et s. ↑
- Jean Wirth, L’image à la fin du Moyen Age, Paris, 2011, p. 153 et ss. ↑
- Cette entreprise sous-tend aussi bien Les deux corps du roi (1957) que Laudes regiae (1946). Elle est encore plus évidente dans la série d’articles dont Pierre Legendre présente la traduction sous le titre Mourir pour la patrie (Paris, 1984). ↑
- Desmond Paul Henry, The Logic of Saint Anselm, Oxford, 1967; That Most Subtle Question (Quaestio Subtilissima), Manchester, 1984; Medieval Mereology, Amsterdam – Philadelphie, 1991. Il est significatif que le long article qui lui est consacré en anglais sur Wikipedia ne mentionne pas ces œuvres. Notons par ailleurs que déjà Ernest A. Moody avait utilisé une algèbre pour analyser celle des logiciens médiévaux (Truth and Consequence in Mediaeval Logic, Amsterdam, 1953). ↑
- Georges Bataille, La part maudite, Paris, 1949. ↑
- Claude Lévi-Strauss, Entretiens avec Georges Charbonnier, Paris, 1961. ↑
- Claude Lévi-Strauss, « Un autre regard », L’Homme, t. 126-128 (1993), p. 7-11. ↑


 De l’Antiquité à la Renaissance, il n’y a simplement aucun mot pour ce que nous appelons l’art. Le mot « art » désigne les arts libéraux et par « artiste », on entend au Moyen Age un diplômé de la faculté des arts, par exemple un logicien ou un géomètre. Il désigne aussi les arts mécaniques, par exemple la cordonnerie ou l’agriculture. On lit souvent que l’art au sens moderne du mot appartenait à ces derniers au Moyen Age, mais, outre que la distinction entre arts libéraux et mécaniques n’était pas rigide, l’architecture, la sculpture et la peinture faisaient appel à l’art libéral de la géométrie pour se valoriser. En fait, aucun mot avant « beaux-arts » n’a réuni ces trois disciplines dans un concept commun les distinguant de la logique ou de l’art militaire. Jusque-là, les finalités technique et esthétique étaient indissociables. Rien ne distinguait l’architecte de l’ingénieur et la tâche du cordonnier était de faire de belles chaussures. Le problème est comparable pour ce que nous appelons la littérature: l’importante production de poésie scientifique correspond mal à la notion que nous en avons.
De l’Antiquité à la Renaissance, il n’y a simplement aucun mot pour ce que nous appelons l’art. Le mot « art » désigne les arts libéraux et par « artiste », on entend au Moyen Age un diplômé de la faculté des arts, par exemple un logicien ou un géomètre. Il désigne aussi les arts mécaniques, par exemple la cordonnerie ou l’agriculture. On lit souvent que l’art au sens moderne du mot appartenait à ces derniers au Moyen Age, mais, outre que la distinction entre arts libéraux et mécaniques n’était pas rigide, l’architecture, la sculpture et la peinture faisaient appel à l’art libéral de la géométrie pour se valoriser. En fait, aucun mot avant « beaux-arts » n’a réuni ces trois disciplines dans un concept commun les distinguant de la logique ou de l’art militaire. Jusque-là, les finalités technique et esthétique étaient indissociables. Rien ne distinguait l’architecte de l’ingénieur et la tâche du cordonnier était de faire de belles chaussures. Le problème est comparable pour ce que nous appelons la littérature: l’importante production de poésie scientifique correspond mal à la notion que nous en avons. Les conceptions de l’harmonie sont très variables, car les différentes musiques divisent l’octave différemment, mais les fondements de l’harmonie sont universels, ainsi la satisfaction provoquée par les consonances, riches en harmoniques. Nous distinguons un son d’un bruit, y compris face aux musiques les plus exotiques et jugeons les chants de différents oiseaux comme plus ou moins harmonieux. En général, nous préférons le chant du rossignol au croassement du corbeau. Il en va de même pour les rythmes et les intensités sonores: le bruit léger et régulier d’un ruisseau est plus agréable que des claquements soudains et imprévisibles.
Les conceptions de l’harmonie sont très variables, car les différentes musiques divisent l’octave différemment, mais les fondements de l’harmonie sont universels, ainsi la satisfaction provoquée par les consonances, riches en harmoniques. Nous distinguons un son d’un bruit, y compris face aux musiques les plus exotiques et jugeons les chants de différents oiseaux comme plus ou moins harmonieux. En général, nous préférons le chant du rossignol au croassement du corbeau. Il en va de même pour les rythmes et les intensités sonores: le bruit léger et régulier d’un ruisseau est plus agréable que des claquements soudains et imprévisibles. A regarder les portraits, le ventre est devenu indispensable, au point que la mode invente le ventre d’oie, un pourpoint facile à rembourrer, pour les hommes qui ne parviennent pas à grossir. De Titien à Rubens et au-delà, le canon féminin est aussi éloigné de la diététique médiévale que de la nôtre. Mais le gavage des femmes dans certains pays d’Afrique centrale va aujourd’hui bien plus loin dans la même tendance.
A regarder les portraits, le ventre est devenu indispensable, au point que la mode invente le ventre d’oie, un pourpoint facile à rembourrer, pour les hommes qui ne parviennent pas à grossir. De Titien à Rubens et au-delà, le canon féminin est aussi éloigné de la diététique médiévale que de la nôtre. Mais le gavage des femmes dans certains pays d’Afrique centrale va aujourd’hui bien plus loin dans la même tendance. C’est ainsi qu’une frise de volutes d’origine grecque, les postes, peut être pensée comme un motif géométrique ou comme la représentation de vagues. Cela dit, le chaud et le froid forment également un continuum et, de même qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le chaud ou le froid absolu pour constater que le chaud fait transpirer et le froid greloter, il n’y a aucune raison de ne pas faire état des propriétés de l’abstraction et de la mimésis. Nous verrons en conclusion de cette première partie que l’idée de l’art comme imitation de la nature au sens large est finalement fondée. En ce sens, on pourrait dire que l’abstraction n’existe pas, mais, en définissant cette dernière comme l’absence d’imitation d’objets déterminés, réels ou imaginaires, on évite toute confusion.
C’est ainsi qu’une frise de volutes d’origine grecque, les postes, peut être pensée comme un motif géométrique ou comme la représentation de vagues. Cela dit, le chaud et le froid forment également un continuum et, de même qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le chaud ou le froid absolu pour constater que le chaud fait transpirer et le froid greloter, il n’y a aucune raison de ne pas faire état des propriétés de l’abstraction et de la mimésis. Nous verrons en conclusion de cette première partie que l’idée de l’art comme imitation de la nature au sens large est finalement fondée. En ce sens, on pourrait dire que l’abstraction n’existe pas, mais, en définissant cette dernière comme l’absence d’imitation d’objets déterminés, réels ou imaginaires, on évite toute confusion. En étant conscient de l’intérêt de ces pratiques, on comprend mieux la peinture de l’Egypte ancienne. Elle renonce au point de vue unique du spectateur pour représenter les différentes parties du corps dans l’axe jugé le plus favorable, de sorte que le tronc est vu de face et les membres, tête comprise, de profil. On trouve le même procédé dans la peinture préhistorique, lorsque les cornes des bovidés sont présentées de face sur une tête de profil, au lieu que leur superposition en cacherait une. Le choix de peindre sur un plan est loin d’être universel, comme le montrent les peintures préhistoriques sur le support accidenté des parois d’une caverne et à plus forte raison la sculpture polychrome, mais la peinture sur support plan et plus encore le dessin sont aussi des réductions des possibilités expressives visant souvent un gain de clarté.
En étant conscient de l’intérêt de ces pratiques, on comprend mieux la peinture de l’Egypte ancienne. Elle renonce au point de vue unique du spectateur pour représenter les différentes parties du corps dans l’axe jugé le plus favorable, de sorte que le tronc est vu de face et les membres, tête comprise, de profil. On trouve le même procédé dans la peinture préhistorique, lorsque les cornes des bovidés sont présentées de face sur une tête de profil, au lieu que leur superposition en cacherait une. Le choix de peindre sur un plan est loin d’être universel, comme le montrent les peintures préhistoriques sur le support accidenté des parois d’une caverne et à plus forte raison la sculpture polychrome, mais la peinture sur support plan et plus encore le dessin sont aussi des réductions des possibilités expressives visant souvent un gain de clarté.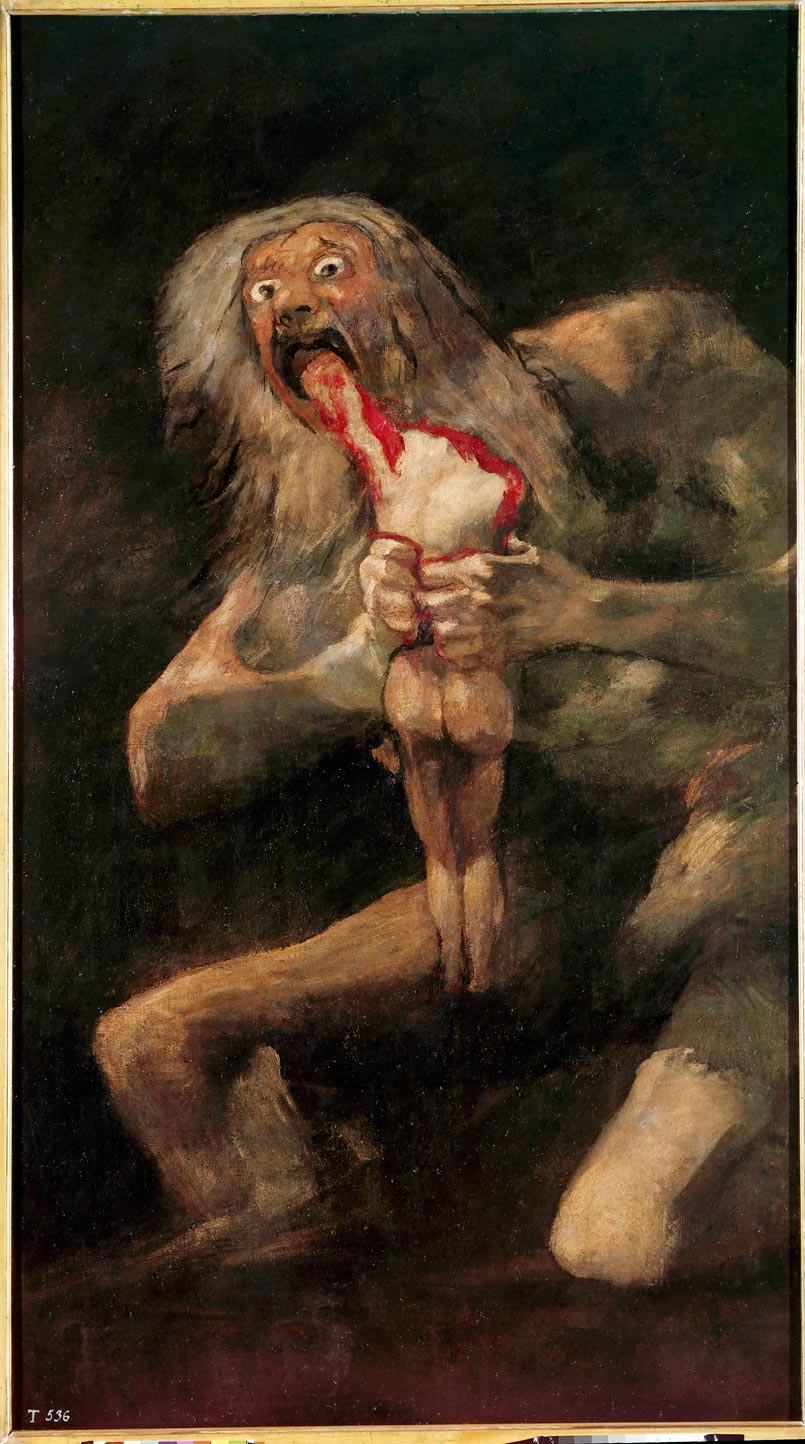 Goya avait peint Saturne dévorant son enfant (aujourd’hui transposé sur toile, Madrid, Prado) sur le mur de sa salle à manger et on raconte qu’il s’agissait de couper l’appétit à ses hôtes, lui-même tournant le dos à son œuvre.
Goya avait peint Saturne dévorant son enfant (aujourd’hui transposé sur toile, Madrid, Prado) sur le mur de sa salle à manger et on raconte qu’il s’agissait de couper l’appétit à ses hôtes, lui-même tournant le dos à son œuvre. L’histoire du sculpteur Pygmalion qui tomba amoureux de sa propre statue, aurait voulu qu’elle soit vivante et fut exhaussé par Vénus qui l’anima, donne une bonne idée de l’esthétique antique et médiévale. Qu’on la lise dans les Métamorphoses d’Ovide ou dans la continuation du Roman de la Rose par Jean de Meun, elle témoigne au plus haut point d’une esthétique fondée sur le plaisir des sens
L’histoire du sculpteur Pygmalion qui tomba amoureux de sa propre statue, aurait voulu qu’elle soit vivante et fut exhaussé par Vénus qui l’anima, donne une bonne idée de l’esthétique antique et médiévale. Qu’on la lise dans les Métamorphoses d’Ovide ou dans la continuation du Roman de la Rose par Jean de Meun, elle témoigne au plus haut point d’une esthétique fondée sur le plaisir des sens Et pourtant, le goût du connaisseur n’est pas indépendant de l’esthétique de son temps et il est évident que personne aujourd’hui ne reprendra à son compte les jugements de Vasari sur l’art médiéval ou sur les Vénitiens, ou encore les notes que Roger de Piles distribuait aux peintres comme à des collégiens
Et pourtant, le goût du connaisseur n’est pas indépendant de l’esthétique de son temps et il est évident que personne aujourd’hui ne reprendra à son compte les jugements de Vasari sur l’art médiéval ou sur les Vénitiens, ou encore les notes que Roger de Piles distribuait aux peintres comme à des collégiens Mais on oublie vite qu’il s’agit d’approximations. Tout n’est pas symétrique dans le corps humain, certains organes, comme le cœur, étant désaxés, tandis que la spirale du nautile n’a pas la rigueur qu’on obtiendrait à l’aide d’une machine. Le visage humain est symétrique, mais une expérience (courante sur internet) consiste à dédoubler l’une des deux moitiés d’un visage régulier pour le rendre rigoureusement symétrique: on s’aperçoit ainsi qu’il l’était bien moins qu’on ne le croyait. Quant au visage obtenu par le report d’un côté, on dira qu’il manque de « naturel ».
Mais on oublie vite qu’il s’agit d’approximations. Tout n’est pas symétrique dans le corps humain, certains organes, comme le cœur, étant désaxés, tandis que la spirale du nautile n’a pas la rigueur qu’on obtiendrait à l’aide d’une machine. Le visage humain est symétrique, mais une expérience (courante sur internet) consiste à dédoubler l’une des deux moitiés d’un visage régulier pour le rendre rigoureusement symétrique: on s’aperçoit ainsi qu’il l’était bien moins qu’on ne le croyait. Quant au visage obtenu par le report d’un côté, on dira qu’il manque de « naturel ». La perspective, pratiquée à partir de Giotto sous une forme empirique, puis complètement géométrisée par Brunelleschi un siècle plus tard, assure la domination de la peinture en lui donnant le pouvoir illusionniste de mimer la troisième dimension, non seulement dans la figuration, mais aussi en remplaçant corniches et modillons par des trompe-l’œil, comme c’est déjà le cas dans la basilique d’Assise. La prouesse se substitue au prix du matériau.
La perspective, pratiquée à partir de Giotto sous une forme empirique, puis complètement géométrisée par Brunelleschi un siècle plus tard, assure la domination de la peinture en lui donnant le pouvoir illusionniste de mimer la troisième dimension, non seulement dans la figuration, mais aussi en remplaçant corniches et modillons par des trompe-l’œil, comme c’est déjà le cas dans la basilique d’Assise. La prouesse se substitue au prix du matériau. Le paysan en est l’antithèse exacte, celui qui nourrit les autres de son travail. Avant même la Révolution, il est relayé dans l’iconographie par les vieux Romains, symboles de vertu républicaine et guerrière. L’art est devenu un champ de bataille idéologique, ce qui est une nouveauté. Il pouvait glorifier le pouvoir auparavant, mais cela ne se traduisait pas par des affrontements esthétiques: la diffusion du gothique français, de la Renaissance italienne ou du style versaillais et les résistances à ces styles ne suivaient pas des lignes de démarcation politiques. La Querelle des Anciens et des Modernes, au XVIIe siècle, opposait les inconditionnels de l’imitation de l’Antiquité à ceux qui cherchaient de nouvelles sources d’inspiration, mais il serait difficile de trouver entre les uns et les autres, tous au service du roi, le moindre clivage politique.
Le paysan en est l’antithèse exacte, celui qui nourrit les autres de son travail. Avant même la Révolution, il est relayé dans l’iconographie par les vieux Romains, symboles de vertu républicaine et guerrière. L’art est devenu un champ de bataille idéologique, ce qui est une nouveauté. Il pouvait glorifier le pouvoir auparavant, mais cela ne se traduisait pas par des affrontements esthétiques: la diffusion du gothique français, de la Renaissance italienne ou du style versaillais et les résistances à ces styles ne suivaient pas des lignes de démarcation politiques. La Querelle des Anciens et des Modernes, au XVIIe siècle, opposait les inconditionnels de l’imitation de l’Antiquité à ceux qui cherchaient de nouvelles sources d’inspiration, mais il serait difficile de trouver entre les uns et les autres, tous au service du roi, le moindre clivage politique. En Allemagne et en Autriche, une rupture se produit avec le goût étranger, menant au style qu’on a nommé Biedermeier par dérision, en fait d’une audace et d’une modernité comparables à celles de la musique de Beethoven, avant qu’il ne finisse dans la mièvrerie. Mais une lassitude envers le présent se fait aussi jour. Les Anglais ont toujours eu à cœur leur architecture gothique et on passe progressivement de l’entretien ou de l’aménagement des monuments à l’imitation du style, en somme au néo-gothique. Les Allemands suivent bien avant les Français, mais la peinture de style Troubadour entre en scène dès l’Empire et des arcatures gothiques commencent à décorer les meubles sous Charles X. L’historicisme est né, formant une composante stylistique durable, souvent associée au catholicisme réactionnaire, mais de loin pas toujours.
En Allemagne et en Autriche, une rupture se produit avec le goût étranger, menant au style qu’on a nommé Biedermeier par dérision, en fait d’une audace et d’une modernité comparables à celles de la musique de Beethoven, avant qu’il ne finisse dans la mièvrerie. Mais une lassitude envers le présent se fait aussi jour. Les Anglais ont toujours eu à cœur leur architecture gothique et on passe progressivement de l’entretien ou de l’aménagement des monuments à l’imitation du style, en somme au néo-gothique. Les Allemands suivent bien avant les Français, mais la peinture de style Troubadour entre en scène dès l’Empire et des arcatures gothiques commencent à décorer les meubles sous Charles X. L’historicisme est né, formant une composante stylistique durable, souvent associée au catholicisme réactionnaire, mais de loin pas toujours. Cela concerne des compositeurs secondaires, comme Paganini, mais aussi les plus grands, à commencer par Beethoven. Enfin, un écart se creuse entre la complexité de la musique professionnelle qui élargit sans cesse son langage harmonique et les œuvres destinées au pianiste ou au guitariste amateur, conventionnelles et pauvres, avec des titres significatifs comme Bagatelles ou Petits riens. De manière générale, on peut parler d’une perte du juste milieu.
Cela concerne des compositeurs secondaires, comme Paganini, mais aussi les plus grands, à commencer par Beethoven. Enfin, un écart se creuse entre la complexité de la musique professionnelle qui élargit sans cesse son langage harmonique et les œuvres destinées au pianiste ou au guitariste amateur, conventionnelles et pauvres, avec des titres significatifs comme Bagatelles ou Petits riens. De manière générale, on peut parler d’une perte du juste milieu. Cela concerne les sujets chez Manet, la mise en cause de l’espace perspectif dans le japonisme, le grossissement de la touche qui devient une marque de fabrique chez Van Gogh et Cézanne, ou l’application d’une théorie optique discutable chez les pointillistes. Le cubisme qui prétend présenter les objets sous plusieurs points de vue à la fois, mais se contente de les disloquer est sans doute le point ultime de ce jeu.
Cela concerne les sujets chez Manet, la mise en cause de l’espace perspectif dans le japonisme, le grossissement de la touche qui devient une marque de fabrique chez Van Gogh et Cézanne, ou l’application d’une théorie optique discutable chez les pointillistes. Le cubisme qui prétend présenter les objets sous plusieurs points de vue à la fois, mais se contente de les disloquer est sans doute le point ultime de ce jeu.
 Songeons que la Fontaine de Duchamp est contemporaine des dernières œuvre de Jean-Paul Laurens et que, dans la seconde moitié du XXe siècle, Balthus produisait une peinture figurative encore proche de celle des Nabis, voire de Courbet. La disparition des critères de goût et des styles qui les satisfaisaient a en effet interdit toute évolution artistique collective et régulière, de sorte que la recherche de l’originalité et la répétition lassante des mêmes postures font bon ménage. Les tentatives de créer un nouveau langage, comme l’abstraction, ont fait leur temps, mais la provocation à la limite de la blague, telle que la pratiquait Duchamp, semble devenue constitutive de la notion d’art contemporain. Surtout, la référence au beau a disparu du discours des artistes, des critiques et finalement des historiens de l’art. Même pour les arts du passé, ils la considèrent implicitement comme subjective, désuète et inutile.
Songeons que la Fontaine de Duchamp est contemporaine des dernières œuvre de Jean-Paul Laurens et que, dans la seconde moitié du XXe siècle, Balthus produisait une peinture figurative encore proche de celle des Nabis, voire de Courbet. La disparition des critères de goût et des styles qui les satisfaisaient a en effet interdit toute évolution artistique collective et régulière, de sorte que la recherche de l’originalité et la répétition lassante des mêmes postures font bon ménage. Les tentatives de créer un nouveau langage, comme l’abstraction, ont fait leur temps, mais la provocation à la limite de la blague, telle que la pratiquait Duchamp, semble devenue constitutive de la notion d’art contemporain. Surtout, la référence au beau a disparu du discours des artistes, des critiques et finalement des historiens de l’art. Même pour les arts du passé, ils la considèrent implicitement comme subjective, désuète et inutile. Bien sûr, il y a des causes évidentes: les acheteurs les plus en vue sont des milliardaires et leur mode de vie passionne le public. En outre, le prix atteint par des œuvres que les non-initiés considèrent le plus souvent comme des stupidités sans valeur attise la curiosité, ainsi que le scandale provoqué par l’exposition de ce genre de choses dans des lieux vénérables, comme le château de Versailles. Il y a deux siècles que les scandales artistiques se multiplient, de plus en plus codifiés, et qu’on ne s’en lasse pas.
Bien sûr, il y a des causes évidentes: les acheteurs les plus en vue sont des milliardaires et leur mode de vie passionne le public. En outre, le prix atteint par des œuvres que les non-initiés considèrent le plus souvent comme des stupidités sans valeur attise la curiosité, ainsi que le scandale provoqué par l’exposition de ce genre de choses dans des lieux vénérables, comme le château de Versailles. Il y a deux siècles que les scandales artistiques se multiplient, de plus en plus codifiés, et qu’on ne s’en lasse pas.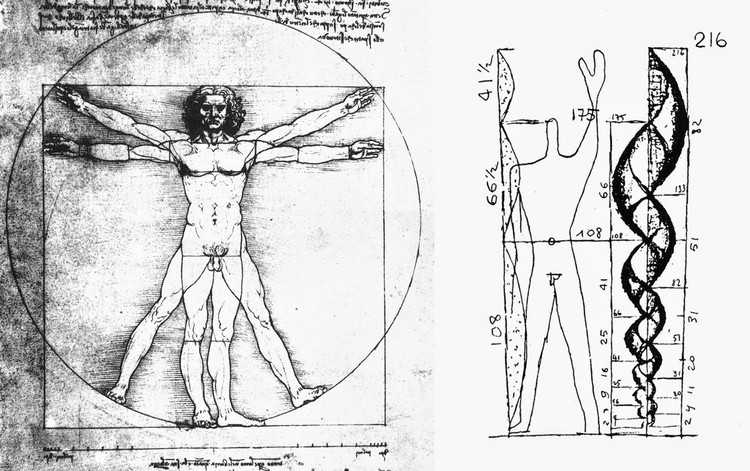 S’il suffisait de l’uniformité pour définir un style, notre habitat en aurait un. Il se caractérise depuis la première moitié du XXe siècle par la disparition de la pierre et du bois, le refus de l’ornement, la parcimonie des espaces, éventuellement légitimée par le modulor ésotérique du Corbusier, l’absence de toute hiérarchie des parties. Les portes sont des panneaux rectangulaires tous identiques, qu’elles ouvrent sur le salon, les toilettes ou la cuisine, lorsque la cuisine n’est pas dans le salon. Les murs sont blancs, ce que compense parfois le plastique du mobilier par des couleurs criardes.
S’il suffisait de l’uniformité pour définir un style, notre habitat en aurait un. Il se caractérise depuis la première moitié du XXe siècle par la disparition de la pierre et du bois, le refus de l’ornement, la parcimonie des espaces, éventuellement légitimée par le modulor ésotérique du Corbusier, l’absence de toute hiérarchie des parties. Les portes sont des panneaux rectangulaires tous identiques, qu’elles ouvrent sur le salon, les toilettes ou la cuisine, lorsque la cuisine n’est pas dans le salon. Les murs sont blancs, ce que compense parfois le plastique du mobilier par des couleurs criardes. A la fin de la vie de Bernard Buffet, la côte de ses œuvres s’est effondrée. On peut supposer qu’il s’agissait d’un grand artiste, victime d’une évolution de la mode ou d’un faiseur, ce dont le public aurait fini par se rendre compte. On peut encore renvoyer le peintre et son public dos-à-dos en considérant que la nullité de l’un n’a d’égale que la versatilité de l’autre. Le choix de l’un ou de l’autre de ces jugements de valeur est inévitable, à moins de renoncer à comprendre ce qui s’est passé.
A la fin de la vie de Bernard Buffet, la côte de ses œuvres s’est effondrée. On peut supposer qu’il s’agissait d’un grand artiste, victime d’une évolution de la mode ou d’un faiseur, ce dont le public aurait fini par se rendre compte. On peut encore renvoyer le peintre et son public dos-à-dos en considérant que la nullité de l’un n’a d’égale que la versatilité de l’autre. Le choix de l’un ou de l’autre de ces jugements de valeur est inévitable, à moins de renoncer à comprendre ce qui s’est passé.
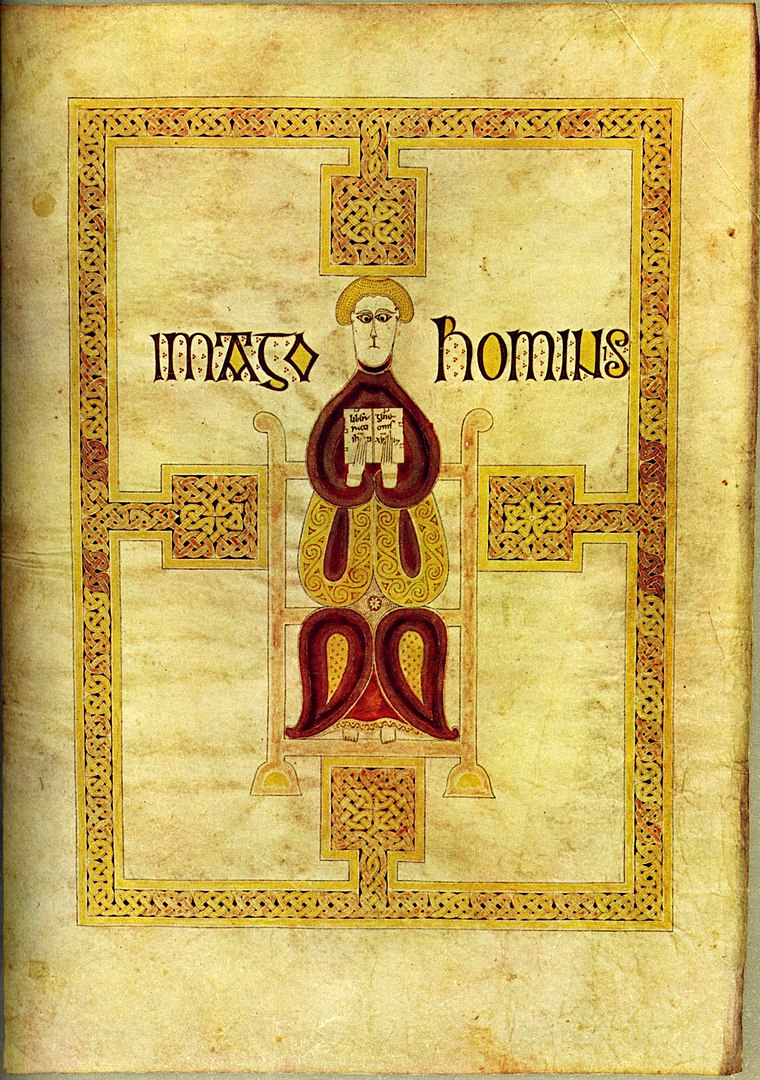 mérovingien, le passé devient synonyme de grandeur et on en imite les arts comme on peut. A mesure que les choses progressent – cette fois-ci pour de bon, comme à l’époque carolingienne – une nouvelle culture et des productions artistiques de haut niveau, originales sans chercher l’originalité, récompensent l’humilité et l’effort…
mérovingien, le passé devient synonyme de grandeur et on en imite les arts comme on peut. A mesure que les choses progressent – cette fois-ci pour de bon, comme à l’époque carolingienne – une nouvelle culture et des productions artistiques de haut niveau, originales sans chercher l’originalité, récompensent l’humilité et l’effort…
 2. Saint Louis, église de Mainneville (Thierry Leroy/Inventaire)
2. Saint Louis, église de Mainneville (Thierry Leroy/Inventaire) 3. Vierge à l’Enfant, église d’Écouis (S.W.)
3. Vierge à l’Enfant, église d’Écouis (S.W.) 4. Vierge de Mainneville (détail, S.W.)
4. Vierge de Mainneville (détail, S.W.) 5. Saint Louis de Mainneville (détail, S.W.)
5. Saint Louis de Mainneville (détail, S.W.) 6. Vierge à l’Enfant, Anvers, Musée Mayer van den Bergh (musée)
6. Vierge à l’Enfant, Anvers, Musée Mayer van den Bergh (musée) 7. Vierge à l’Enfant Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée)
7. Vierge à l’Enfant Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée) 8. Vierge de Meulan, Baltimore, Walters Art Gallery (musée)
8. Vierge de Meulan, Baltimore, Walters Art Gallery (musée) 9. Vierge de Montmerrei, Sées, Musée d’art religieux (S.W.)
9. Vierge de Montmerrei, Sées, Musée d’art religieux (S.W.) 10. Vierge Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée)
10. Vierge Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée) 11. Vierge de Mainneville (archives départementales de l’Eure)
11. Vierge de Mainneville (archives départementales de l’Eure) 12. Vierge du portail nord du transept, Paris, Notre-Dame (J.W.)
12. Vierge du portail nord du transept, Paris, Notre-Dame (J.W.) 13. Vierge du portail Saint-Honoré, Amiens, cathédrale (Thomon)
13. Vierge du portail Saint-Honoré, Amiens, cathédrale (Thomon) 15. Vierge de Jeanne d’Évreux, Paris, Louvre (Shonagon)
15. Vierge de Jeanne d’Évreux, Paris, Louvre (Shonagon) 16. Vierge de l’église de Lisors (médiathèque de patrimoine)
16. Vierge de l’église de Lisors (médiathèque de patrimoine)

 19. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée)
19. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée) 20. Vierge, Paris, Musée de Cluny cl. 3270 (musée)
20. Vierge, Paris, Musée de Cluny cl. 3270 (musée)






 28. Vierge de l’église de Varennes-sir-Seine (tous droits réservés)
28. Vierge de l’église de Varennes-sir-Seine (tous droits réservés) 29. Vierge de l’église d’Esmans (médiathèque du patrimoine)
29. Vierge de l’église d’Esmans (médiathèque du patrimoine) 30. Vierge de l’église de Bornel (Poschadel)
30. Vierge de l’église de Bornel (Poschadel)
 32. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée)
32. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée) 33. Vierge de Fontenay (Daniel Villafruela)
33. Vierge de Fontenay (Daniel Villafruela) 34. Vierge de l’église d’Omerville (Poschadel)
34. Vierge de l’église d’Omerville (Poschadel) 35. Vierge de l’église de Brignancourt (J.W.)
35. Vierge de l’église de Brignancourt (J.W.) 36. Vierge de l’église de Champdeuil (S.W.)
36. Vierge de l’église de Champdeuil (S.W.) 37. Vierge de la Porte de l’Horloge, Amboise, musée Morin (J.W.)
37. Vierge de la Porte de l’Horloge, Amboise, musée Morin (J.W.) 38. Vierge à l’Enfant, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés)
38. Vierge à l’Enfant, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés) 39. Vierge de l’Annonciation, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés)
39. Vierge de l’Annonciation, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés) 40. Apôtre de la chapelle de Rieux, Toulouse, musée des Augustins (musée/Daniel Martin)
40. Apôtre de la chapelle de Rieux, Toulouse, musée des Augustins (musée/Daniel Martin) 41. Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles, Toulouse, musée des Augustins (musée)
41. Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles, Toulouse, musée des Augustins (musée)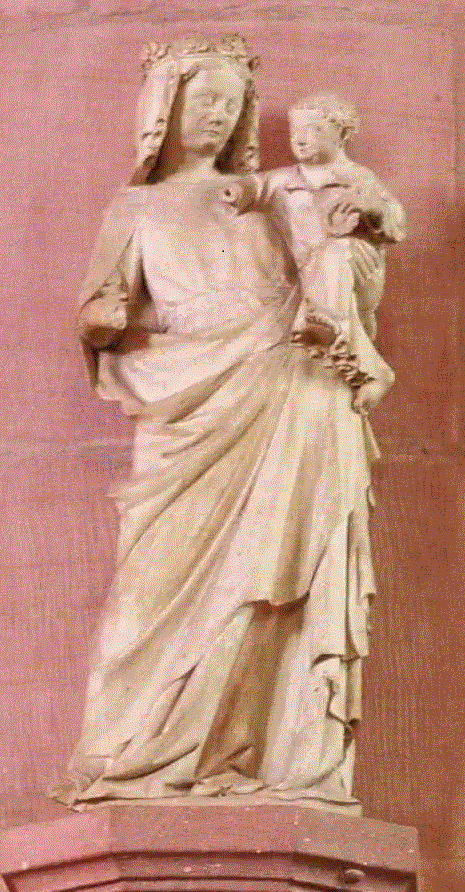 42. Vierge du cloître de la cathédrale de Saint-Dié (tous droits réservés)
42. Vierge du cloître de la cathédrale de Saint-Dié (tous droits réservés) 43. Vierge de Châtenois, New York, Metropolitan Museum (musée)
43. Vierge de Châtenois, New York, Metropolitan Museum (musée)
 45. Vierge à l’Enfant, église de Mussy-sur-Seine (médiathèque du patrimoine)
45. Vierge à l’Enfant, église de Mussy-sur-Seine (médiathèque du patrimoine) 46. Vierge à l’Enfant, église de Chamant (Poschadel)
46. Vierge à l’Enfant, église de Chamant (Poschadel) 47. Vierge de l’église de Bayel (GO69)
47. Vierge de l’église de Bayel (GO69) 48. Vierge provenant d’Ubexy (Olivier Petit, tous droits réservés)
48. Vierge provenant d’Ubexy (Olivier Petit, tous droits réservés)
 50. Prophète, Troyes, musée des Beaux-Arts (S.W.)
50. Prophète, Troyes, musée des Beaux-Arts (S.W.) 51. Vierge à l’Enfant, basilique Saint-Nicolas-de-Port (G. Garitan)
51. Vierge à l’Enfant, basilique Saint-Nicolas-de-Port (G. Garitan)
 53. Vierge de la cathédrale d’Anvers (S.W.)
53. Vierge de la cathédrale d’Anvers (S.W.) 54. Vierge de Diest New York, Metropolitan Museum (musée)
54. Vierge de Diest New York, Metropolitan Museum (musée) 55. Vierge de l’église de Villers-Saint-Frambourg (Poschadel)
55. Vierge de l’église de Villers-Saint-Frambourg (Poschadel) 56. Vierge mosane, Lille, musée des Beaux-Arts (S.W.)
56. Vierge mosane, Lille, musée des Beaux-Arts (S.W.)
 58. Retable de Maubuisson, l’ange aux burettes, Paris, Louvre (Langopaso)
58. Retable de Maubuisson, l’ange aux burettes, Paris, Louvre (Langopaso) 59. Groupe sculpté mosan en l’église Notre-Dame de Louviers (médiathèque du patrimoine)
59. Groupe sculpté mosan en l’église Notre-Dame de Louviers (médiathèque du patrimoine) 60. Vierge de l’église de Muneville (médiathèque du patrimoine)
60. Vierge de l’église de Muneville (médiathèque du patrimoine) 61. Vierge à l’Enfant, Lisbonne, fondation Gulbenkian (musée)
61. Vierge à l’Enfant, Lisbonne, fondation Gulbenkian (musée)
 63. Vierge de l’église Saint-Just d’Arbois (médiathèque du patrimoine)
63. Vierge de l’église Saint-Just d’Arbois (médiathèque du patrimoine) 64. Vierge des malades de la cathédrale de Tournai (Institut du patrimoine)
64. Vierge des malades de la cathédrale de Tournai (Institut du patrimoine)
 Adoration des Mages
Adoration des Mages





 Panneau du retable de Thomas Beckett
Panneau du retable de Thomas Beckett
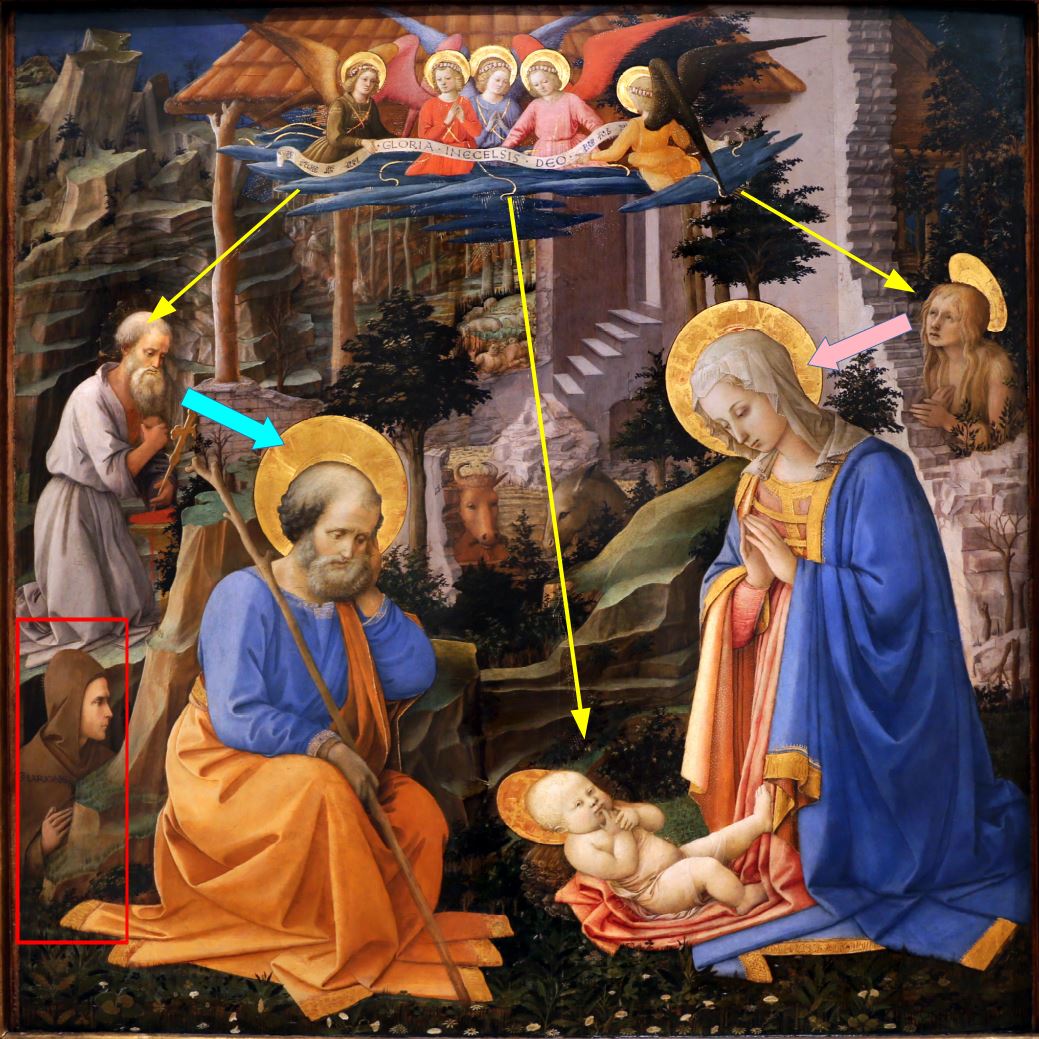



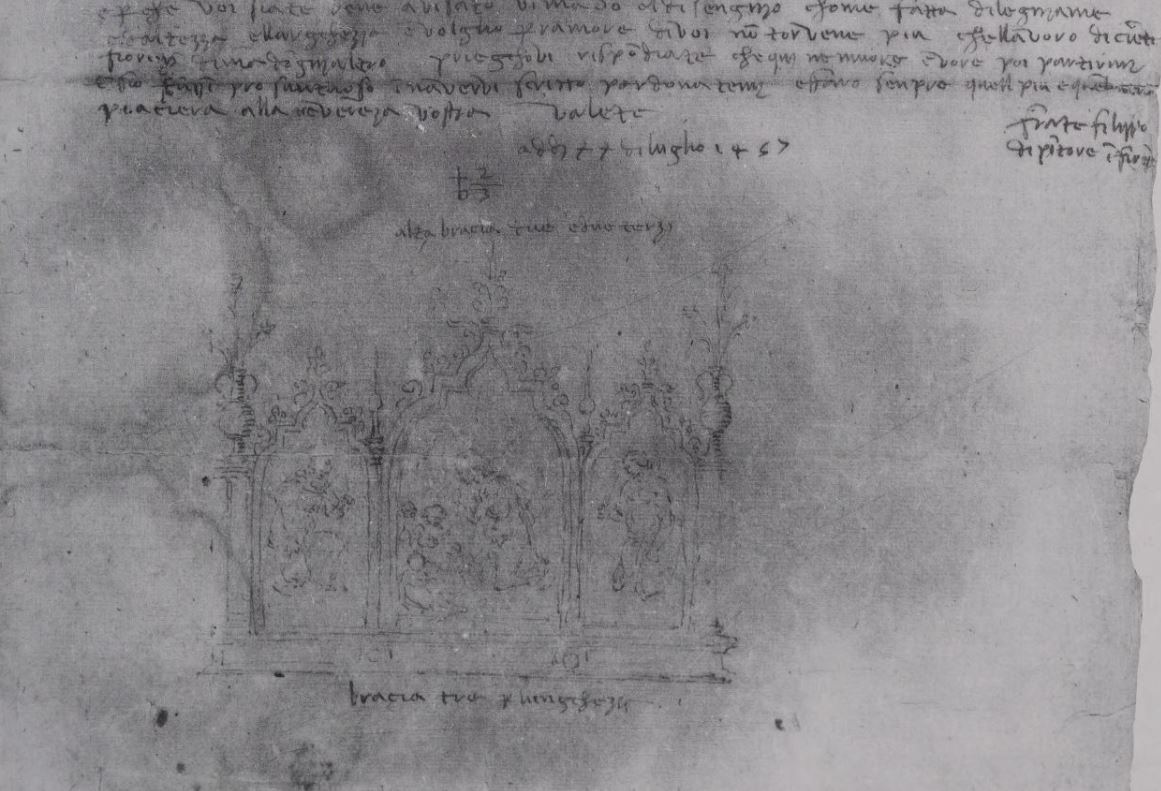 Lettre du 20 Juillet 1457 à Giovanni di Cosimo de Medici ( [1] p 36)
Lettre du 20 Juillet 1457 à Giovanni di Cosimo de Medici ( [1] p 36) Reconstitution du triptyque pour Alphonse V d’Aragon, Musée de Cleveland
Reconstitution du triptyque pour Alphonse V d’Aragon, Musée de Cleveland Adoration dans la Forêt
Adoration dans la Forêt


 Icone signée Angelos Akotantos, 1400-25, Byzantine museum, Athènes
Icone signée Angelos Akotantos, 1400-25, Byzantine museum, Athènes

 Vers 1480, NGA
Vers 1480, NGA Vers 1485, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest
Vers 1485, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest






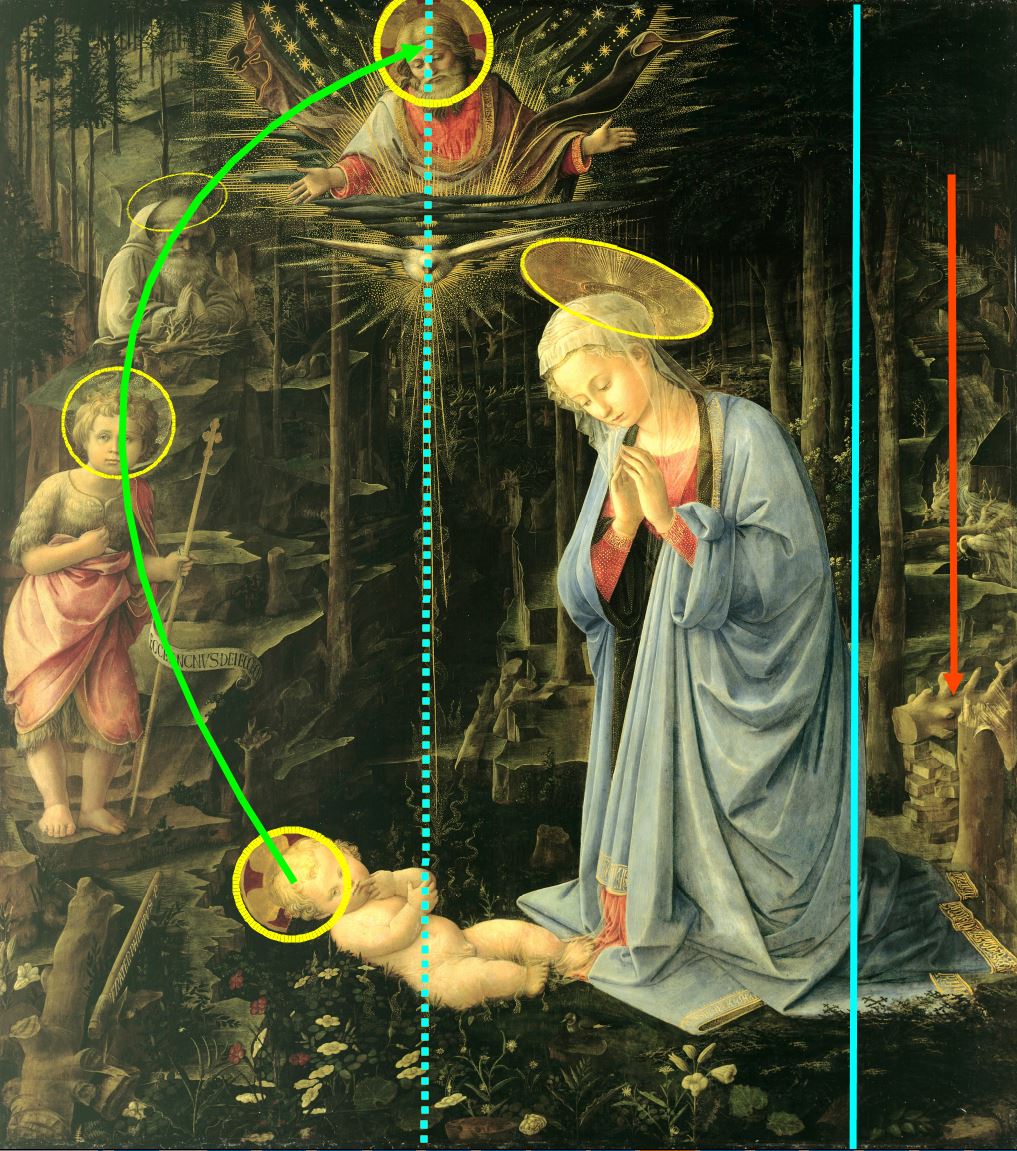


 Modèle 3D ZeuxisVR [9]
Modèle 3D ZeuxisVR [9]
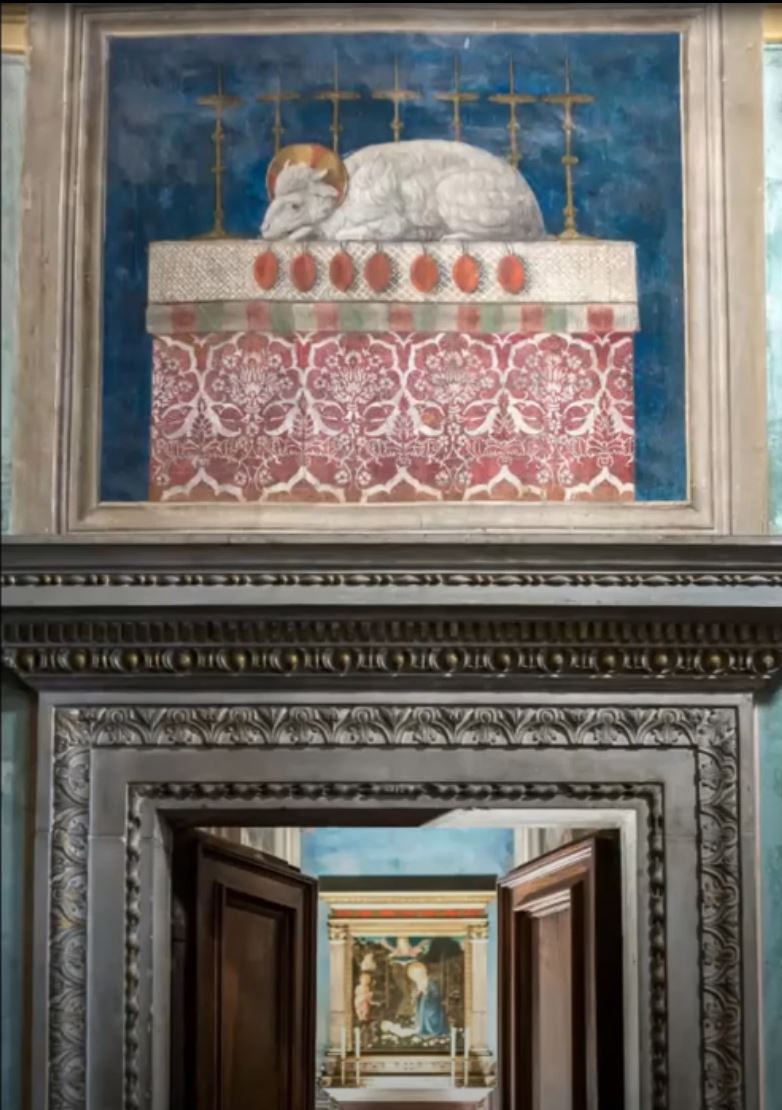


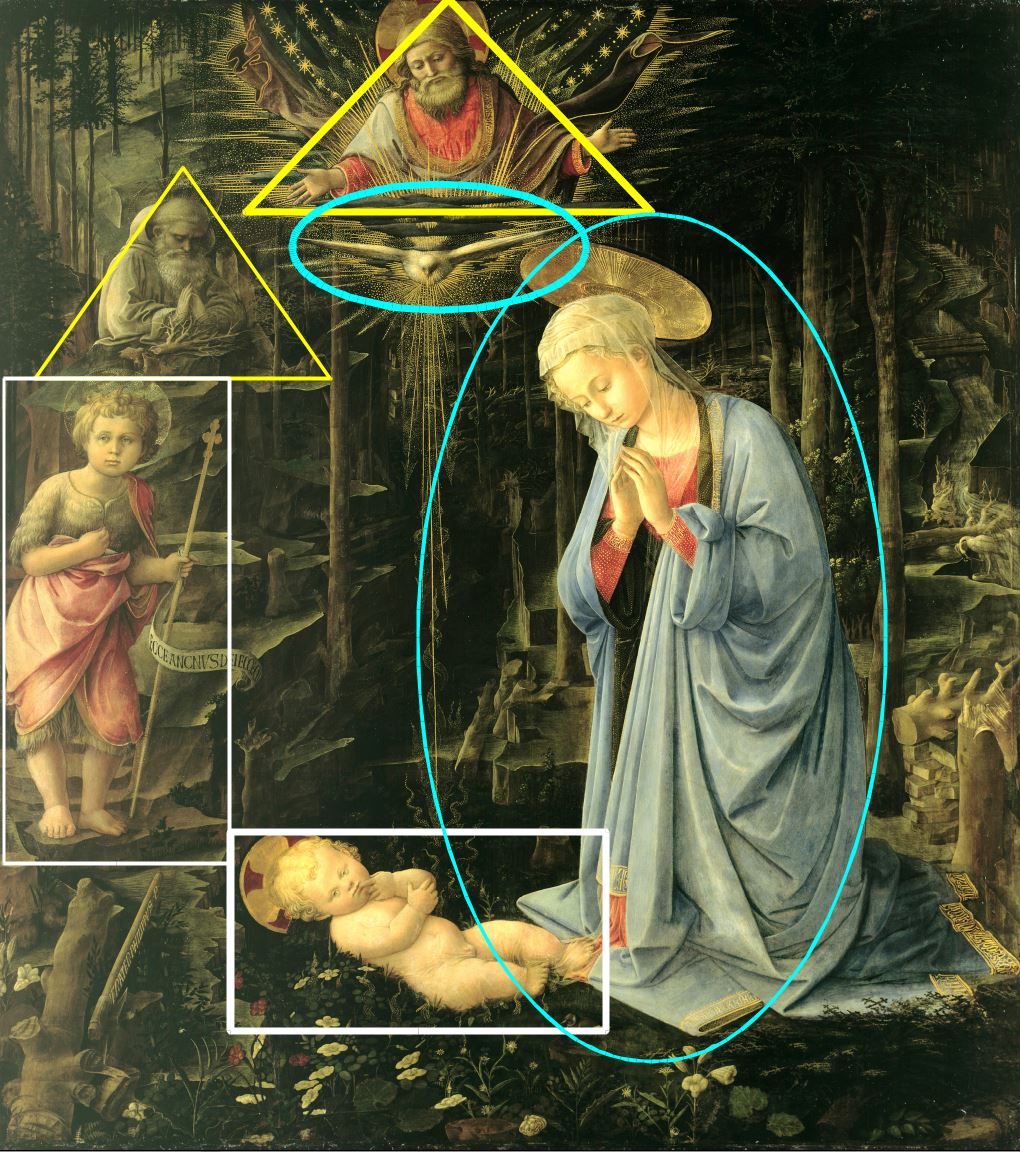

 Adoration de Camaldoli, avec Saint Jean Baptiste Enfant de Saint Romuald
Adoration de Camaldoli, avec Saint Jean Baptiste Enfant de Saint Romuald



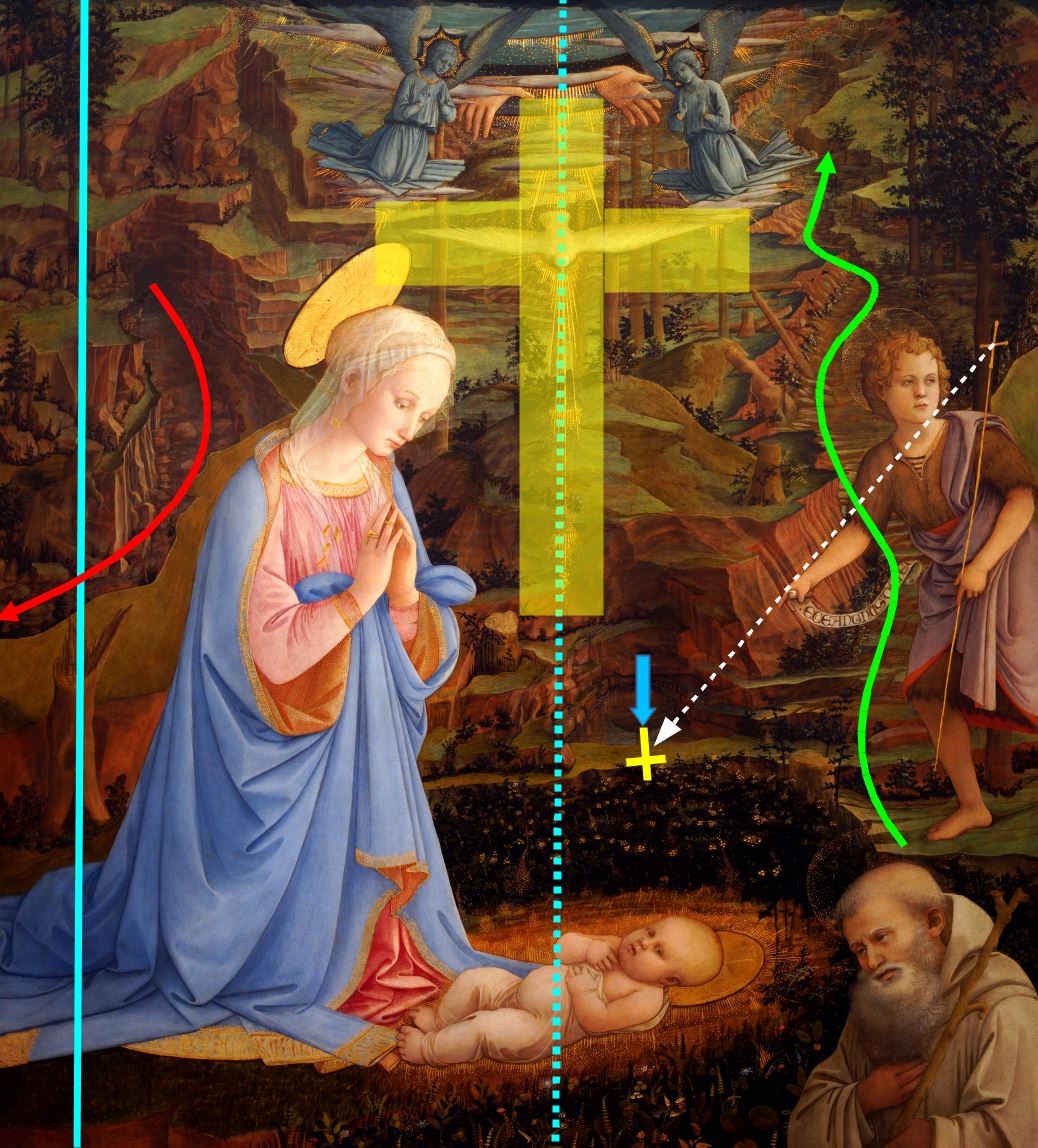

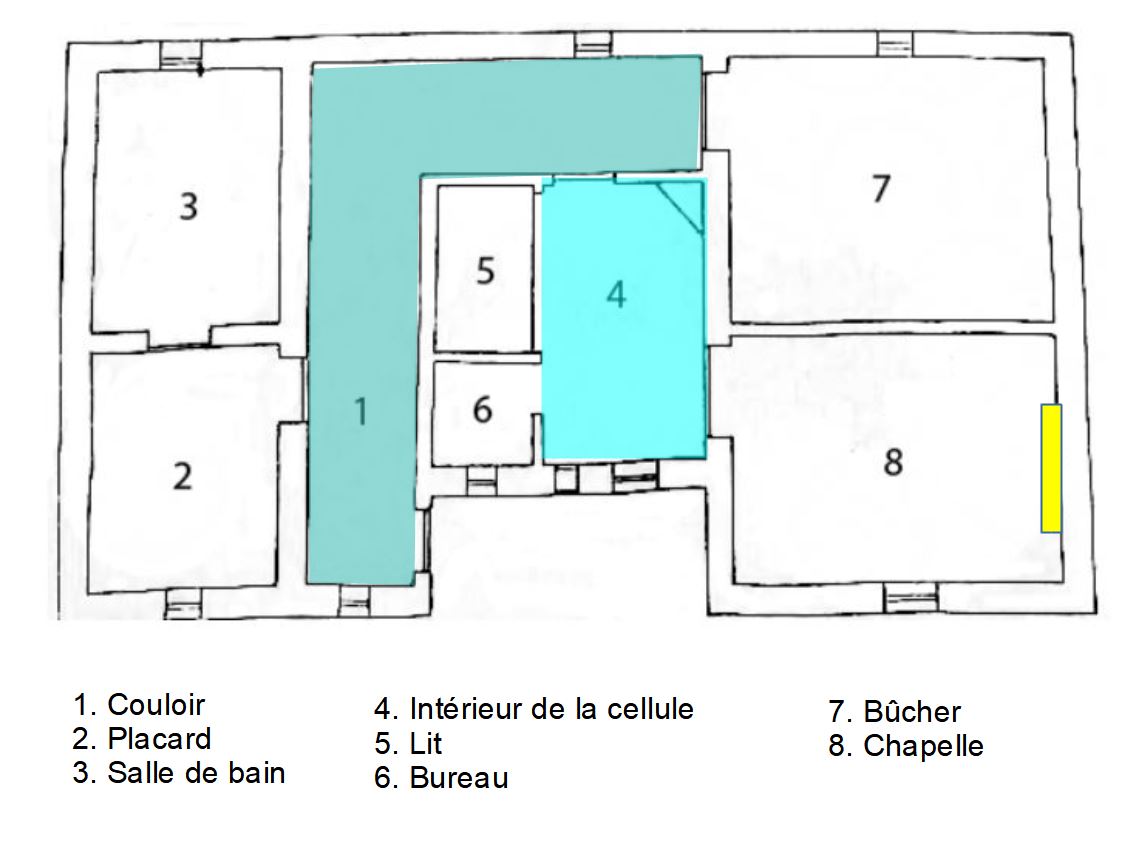


 Reconstitution P.Bousquet (cellule dite de Saint Romuald, eremo di Camaldoli)
Reconstitution P.Bousquet (cellule dite de Saint Romuald, eremo di Camaldoli)