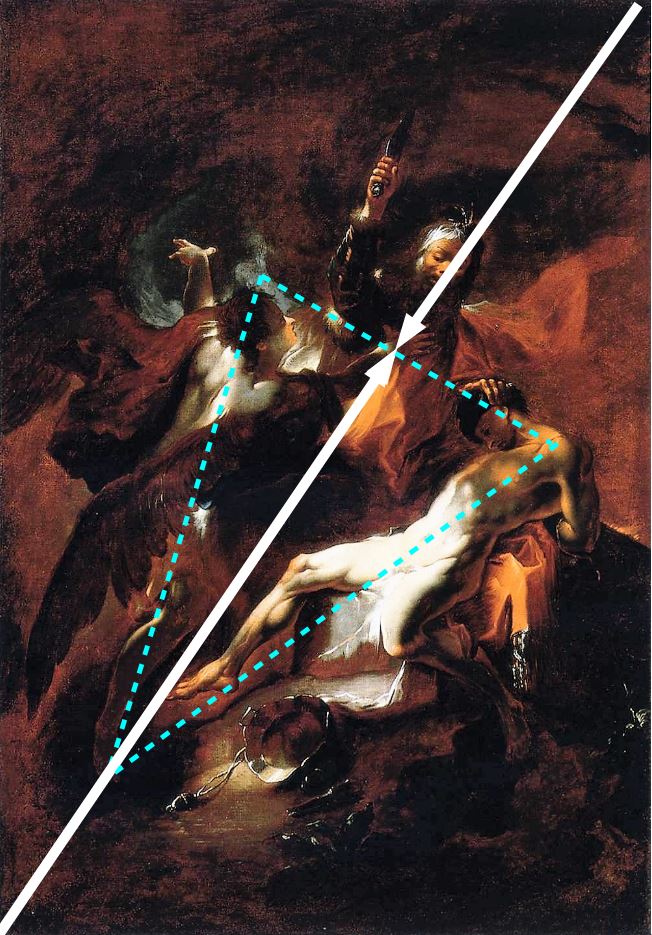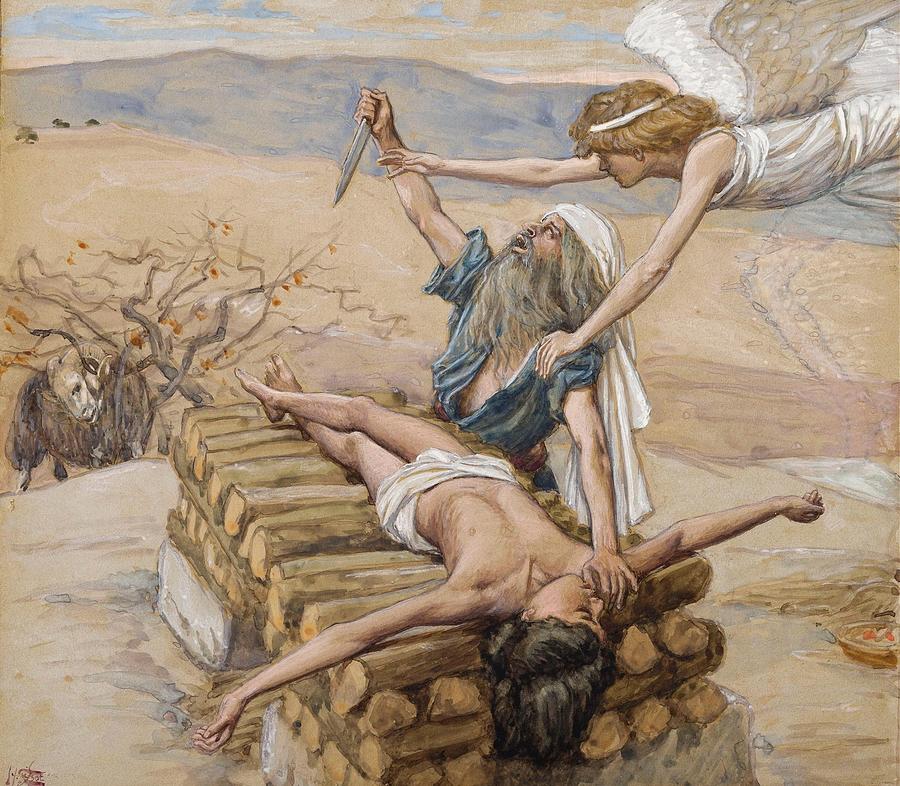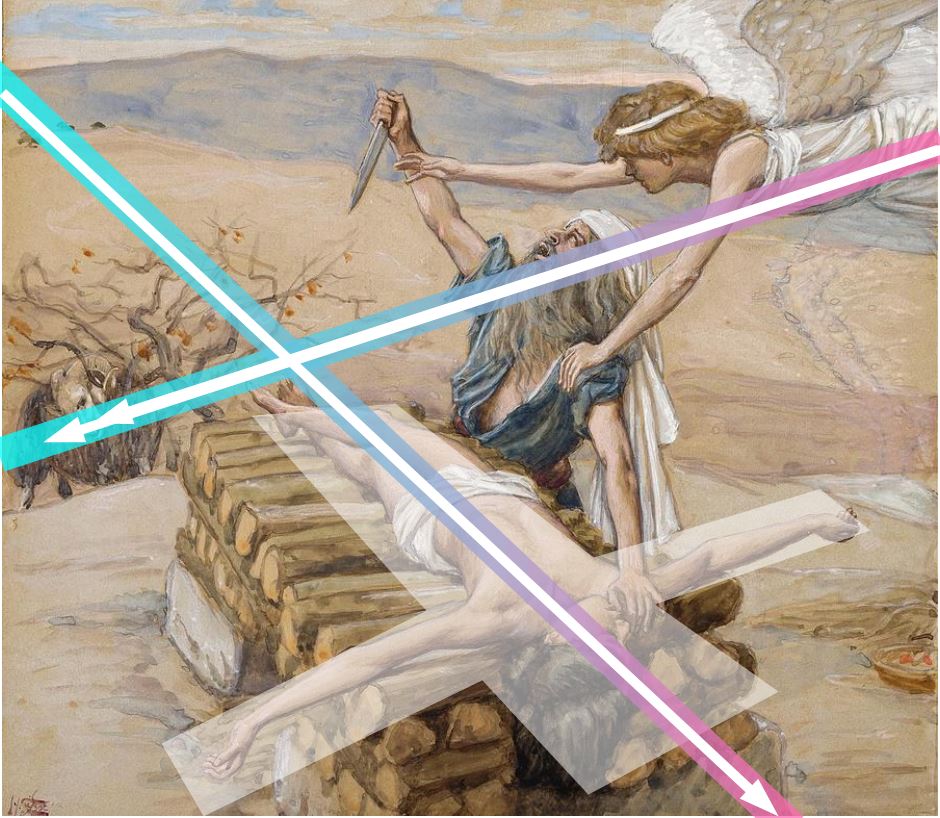Le lapin et les volatiles 2
La symbolique phallique des volatiles, notamment à long cou, est bien connue (voir [13] et L’oiseau licencieux). On se demande ici dans quelle mesure le « cuniculus » pouvait être compris comme le symbole du sexe opposé.
Article précédent : Le lapin et les volatiles 1
![]()
Les volaillers
Les scènes de marché sont un décor de choix pour la cohabitation entre volatiles et lapins.
 Les volaillers (Pollivendola), Campi, vers 1580, Brera
Les volaillers (Pollivendola), Campi, vers 1580, Brera
Comme beaucoup de tableaux du même genre, celui-ci propose une surenchère dans la diversité : oiseaux sauvages et domestiques, plumées ou pas, tête en haut ou tête en bas, accouplés ou solitaires. On peut y voir simplement la jouissance naïve de l’abondance : mais la multiplication des postures laisse une impression équivoque, celle d’une pré-pornographie se dissimulant dans les volailles.
La symbolique aviaire joue ici à plein dans la figure du jeune homme :
« Il exerce du haut vers le bas un geste de resserrement du cou du volatile qu’il tient entre ses cuisses. Le bec entrouvert du canard, orienté vers le haut, prend place à la hauteur du sexe du garçon. L’idée d’érection n’est pas improbable lorsque l’on sait que Vincenzo Campi semble proposer des détails plastiques équivoques dans bon nombre de ses peintures. Il répond en cela au goût très prononcé de ses contemporains pour l’équivoque, qu’elle soit plastique ou littéraire. » [14]

S’exténuant en bas à cette occupation, le jeune homme a en haut le cou étouffé entre les pattes fourrées d’un fort lapin, image probable d’un sexe féminin exigeant : ainsi s’explique le regard amusé de la marchande qui regarde le garçon faire ses premiers pas, tandis qu’elle même s’occupe à cajoler une grosse volaille au cou tendu.
 Scène de marché
Scène de marché
Beuckelaer (atelier), vers 1573, collection particulière
La même symbolique aviaire et lapinière est ici clairement à l’oeuvre, entre l’homme brandissant une volaille au dessus de ses oeufs, et la femme un lapin aux cuisses vulvaires. Le jeune homme qui se retourne au centre du tableau nous signale qu’il y a bien là quelque chose à deviner.
 Nature morte avec une jeune femme
Nature morte avec une jeune femme
Michele Pace Del Campidoglio, 1650-70, collection particulière
Ce tableau pourrait être considéré comme un précurseur de l’esthétique pin-up : deux friandises particulièrement suggestives (le melon fracturé et la grenade explosée) encadrent un intrus, le minuscule lapin blanc, d’où l’oeil monte vers la gorge dénudée de la jeune fille qui nous propose ses bons fruits.
Les cas où la symbolique sexuelle du lapin est aussi appuyée sont rares. La plupart du temps; l’allusion est si discrète qu’elle passe inaperçue.
Les lapins de Metsu (SCOOP !)
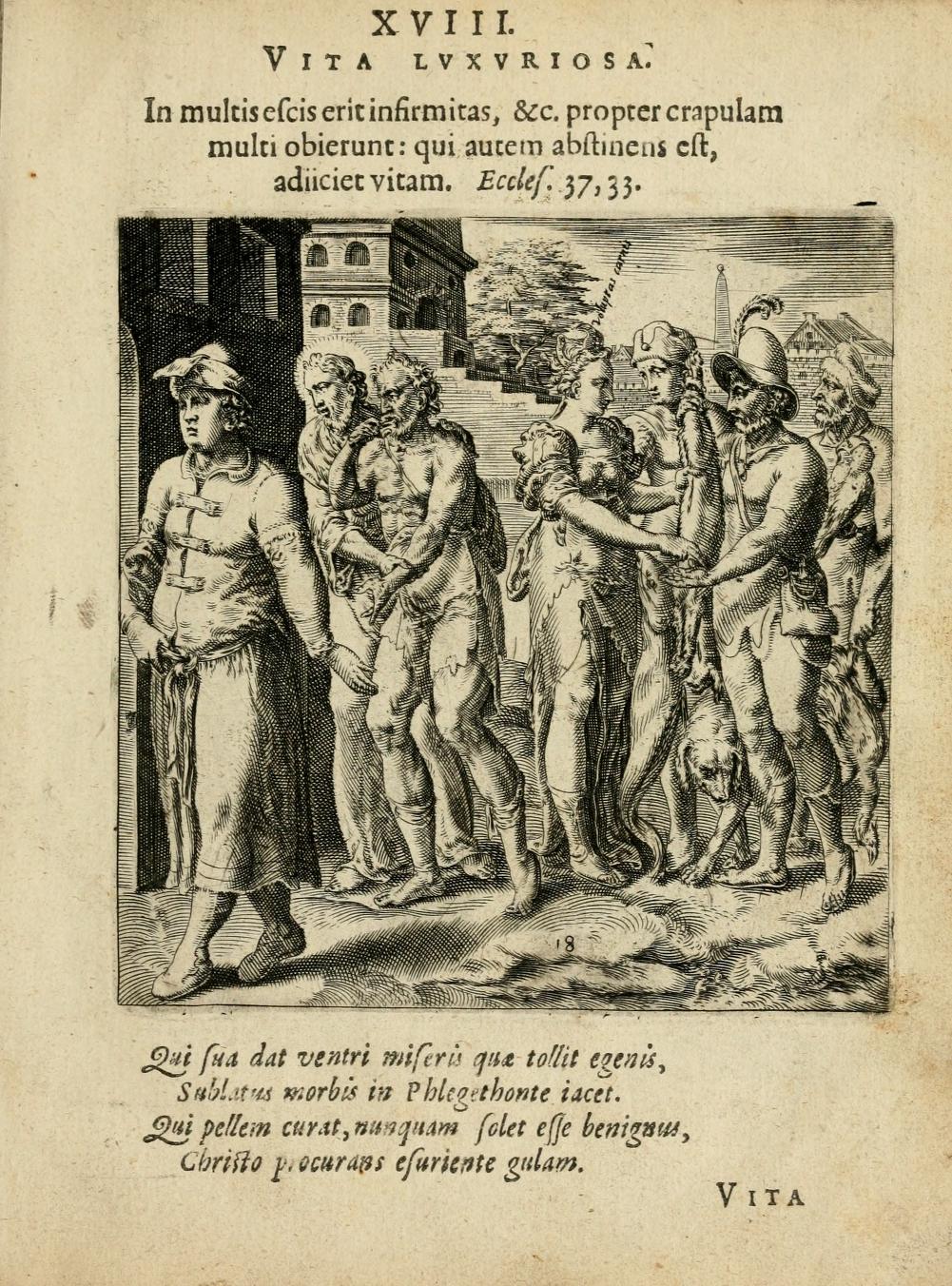
Vita luxuriosa, illustration de Weenix pour « Recht ghebruyck ende misbruyck, van tydlycke have : van rijckdom, nodruft en ghebreck ick beluyck t’onzaligh misbruyck, mettet zaligh ghebruyck », Anvers, 1585
|
Qui donne à son ventre ce qu’il a pris aux pauvres |
Qui sua dat ventri miseris quae tollit egenis, |
Le lapin dont le ventre bée illustre :
- littéralement les mots du texte (ventre, peau) ;
- allusivement, l’idée d’appétit (gorge) ;
- précisément, l’appétit sexuel féminin, comme l’indique l’inscription « voluptas carnis » (plaisir de la chair) juste à côté de la femme.
 Femme vendant du gibier à un étal, Metsu, 1653-54, Leiden collection
Femme vendant du gibier à un étal, Metsu, 1653-54, Leiden collection
Ce tableau est exceptionnel :
- par sa très grande taille ;
- parce qu’elle est la première des quinze scènes de marché connues de Metsu ;
- parce que c’est sa première nature morte animalière, sans doute pour rivaliser avec celles d’un spécialiste tel que Weenix.
« Depuis le milieu du XVIe siècle, avec des peintures d’Aertsen et de Beuckelaer, les artistes dépeignent généralement les femmes du marché comme des séductrices, les aliments qu’elles vendent soulignant leur sexualité. Les manches à crevés du corsage rouge de la femme ont sans doute une fonction similaire. Ils ne sont pas conformes à la mode contemporaine, mais ils apparaissent dans des costumes fantastiques portés par les représentations de prostituées et de bouffons de Metsu » [15]
Tandis que l’acheteuse arrive du côté des volailles de petite taille, la marchande plantureuse surplombe une oie au cou proéminent. Ce qu’elle propose à la jeune fille naïve, le lapin aux cuisses ouvertes, c’est la métaphore d’une sexualité épanouïe.
 |
 |
|---|
Jeune fille embrochant un poulet, Metsu, 1655-57, Alte Pinakothek, Münich
La jeune servante embroche en souriant un poulet éviscéré, plumé et tête en bas, caricature de masculinité ridicule. En contraste, son gros lapin dodu, fourré et cuisses ouvertes, attend d’être embroché par plus habile.
 Vieil homme vendant de la volaille Vieil homme vendant de la volaille |
 Jeune femme vendant de la volaille Jeune femme vendant de la volaille |
|---|
Metsu, 1662, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde
Sur ce pendant aux allusions sexuelles appuyées, voir Les pendants de Metsu. Ce qui nous intéresse ici est que Metsu a condensé les deux tableaux en un seul, autour d’une peau de lapin :

La vieille marchande
Metsu, vers 1662, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde (photo JL Mezières)
Le gamin à l’arrière-plan nous indique, comme souvent, qu’il y a un sous-entendu comique. Il faut comprendre que la jeune fille demande à la vieille femme, habile à plumer un pigeon sur son ventre, un conseil pour s’occuper de son lapin.
![]()
Natures mortes à poil et à plume
Au retour de la chasse ou à la cuisine, le lièvre ou le lapin, apparié avec des oiseaux, constitue un contraste de textures idéal pour le peintre de nature morte.
Lapin et oiseaux dans les bodegons
En Espagne, les cadavres sont de préférence suspendus verticalement, dans des compositions étranges où la géométrie se mêle avec la crudité anatomique.
 Hiepes, 1643, Prado
Hiepes, 1643, Prado
La forte symétrie centrale tend à faire du quadrupède un oiseau parmi les autres. d’autant que, par une sorte d’ironie macabre, il est placé nez à nez avec deux oeufs. Seul tête en bas parmi tous ces cous en extension, sa plaie vulvaire attire l’oeil de manière délibérement malsaine.
 Mariano Nani, 18ème siècle, Prado Mariano Nani, 18ème siècle, Prado |
 Bartolome Montalvo, début 19ème, collection privée Bartolome Montalvo, début 19ème, collection privée |
|---|
Cette tradition très géométrique se maintient les siècles suivant. Le mode de suspension inversé, par le cou pour les volatiles et par les cuisses pour le lapin, met en évidence ce que chacun offre en matière de métaphore, et crée un effet bizarre de copulation sublimée.
Lapin et oiseaux dans les natures mortes
 Gabriele Salci, 1719, Musée des Beaux Arts, Budapest
Gabriele Salci, 1719, Musée des Beaux Arts, Budapest
Certains tableaux de chasse procurent un effet de monde à l’envers comme si, grâce à l’alibi de la mort et de l’animalité, ils se complaisaient à disposer les corps dans des poses interdites aux humains. Le ventre sanglant du lièvre est ici exhibé d’une manière particulièrement obscène, en regard du canon qui l’a défloré.
Il serait néanmoins outrancier de prétendre que tous les trophées de chasse avaient des sous-entendus sexuels. Les natures mortes avec volatiles et lapins sont innombrables, et cette cohabitation est avant tout justifiée par le contraste des matière. Parmi les gibiers à fourrure, la petite taille du lièvre facilite également son adoption. Par ailleurs, la chasse aux lièvres était une activité universelle, prisée aussi bien des nobles que des bourgeois.
J’ai ressemblé ci-après quelques échantillons de peintres spécialisés dans ce sous-genre particulier, la nature morte au lapin/lièvre et oiseaux.
Jan Fyt

Lièvre et perdreaux, Jan Fyt, 1642, Collection du prince de Lichstenstein, Vaduz
 Lièvre, perdrix, geai et autres oiseaux sur une corniche, Jan Fyt, Collection privée Lièvre, perdrix, geai et autres oiseaux sur une corniche, Jan Fyt, Collection privée |
 Lièvre et oiseaux sauvage, Jan Fyt, Collection privée Lièvre et oiseaux sauvage, Jan Fyt, Collection privée |
|---|
Les plumes et le poil se frôlent dans la promiscuité de la mort.
Adriaen van Utrecht

Nature morte avec un lièvre et des oiseaux sur une table, Adriaen van Utrecht ,1647, Johnny van Haeften Gallery
Un massacre à ambition encyclopédique : au mileu de ces brochettes d’oiseaux, le lièvre ouvre un oeil tout étonné d’avoir été classé dans ce genre zoologique.
Jan Weenix
 Lièvre et oiseaux, Jan Weenix, 1687, Städel Museum, Francfort Lièvre et oiseaux, Jan Weenix, 1687, Städel Museum, Francfort |
 Lièvre et perdreaux, Jan Weenix, collection particulière Lièvre et perdreaux, Jan Weenix, collection particulière |
 Lièvre, perdreaux et autres oiseaux sans une niche, Jan Weenix, Museum of Fine Arts, Houston Lièvre, perdreaux et autres oiseaux sans une niche, Jan Weenix, Museum of Fine Arts, Houston |
|---|
Jan Weenix satisfait sa production en série en positionnant différemment toujours les mêmes éléments. Il est donc difficile de trouver un sous-entendu dans l’oiseau qui pique du bec, plus ou moins près de l’entrejambe écartelée du lièvre. Les deux objets hémisphériques pendus au dessus sont un chaperon de faucon, l’ennemi commun de l’un et de l’autre.
Chardin
Contrairement aux hollandais du siècle précédent, Chardin ne cherche pas à composer des trophées tape à l’oeil, artistement disposés. Il place toujours le gibier dans la cuisine, posé sur une étagère de manière naturelle, comme au retour de la chasse ou du marché.
 1728, Musée de la chasse et de la nature, Paris 1728, Musée de la chasse et de la nature, Paris |
 1728-30, MET 1728-30, MET |
|---|
Au début de sa carrière, le thème l’intéresse surtout pour ses effets de texture, en contraste avec les couleurs vives des fruits .
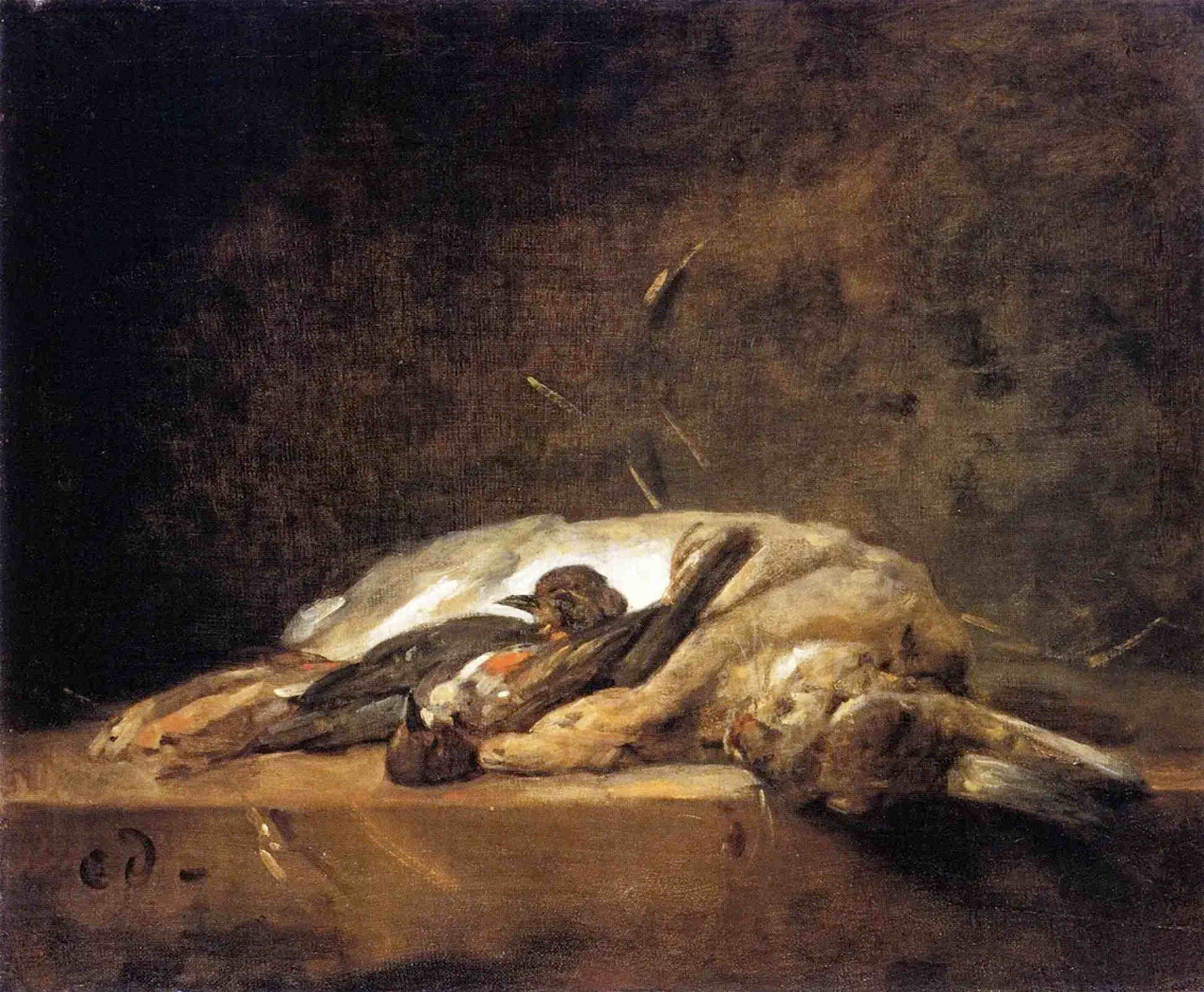 1755, Musée de la chasse et de la nature, Paris 1755, Musée de la chasse et de la nature, Paris |
 1760-65, NGA, Washington 1760-65, NGA, Washington |
|---|
Lorsqu’il y revient à la maturité, seuls ou à côté de l’orange à l’éclatante vitalité, les petits cadavres avachis font ressentir toute la cruauté de la mort.
Oudry
 Gibier mort et pêches dans un paysage
Gibier mort et pêches dans un paysage
Oudry, 1727, Birmingham Museum of Art
Oudry suit un peu la même évolution : au départ, un trophée de chasse imité des hollandais.
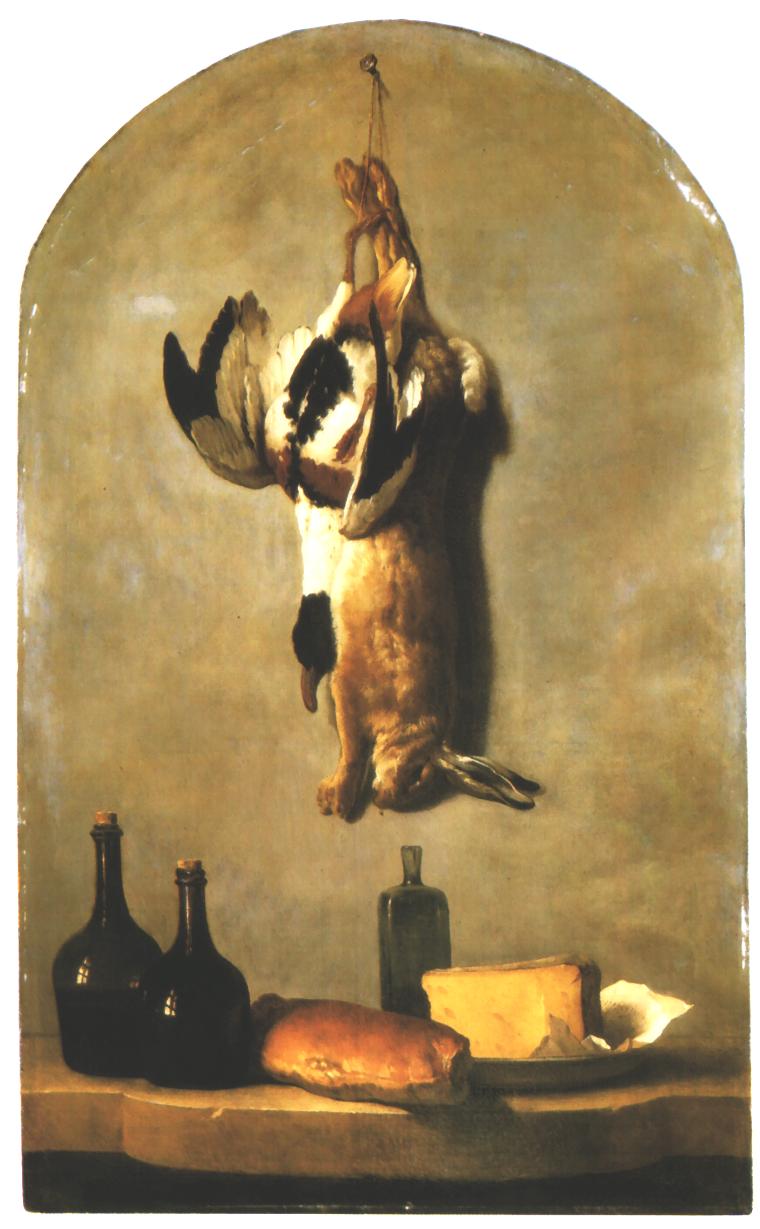 Lièvre, canard, bouteilles, pain et fromage, Oudry (école), 1742, Louvre Lièvre, canard, bouteilles, pain et fromage, Oudry (école), 1742, Louvre |
 Perdrix rouge, lapin, citrons, oranges et bouilloire, Oudry, 1746, Louvre Perdrix rouge, lapin, citrons, oranges et bouilloire, Oudry, 1746, Louvre |
 Faisan, lièvre et perdrix rouge, 1753, Louvre Faisan, lièvre et perdrix rouge, 1753, Louvre |
|---|
Dans un second temps, il met au point cette étrange chimère : un lièvre aux ailes déployées, suspendu à un piton.
 Nature morte avec vue sur la ville
Nature morte avec vue sur la ville
Hugo Salmson 1863-94, Nationalmuseum, Stockholm
Au XIXème siècle, on peut citer cette composition très inventive : le couple contre-nature du gibier, pendu à l’envers devant un décor citadin, fait un premier ricochet dans le couple de moineaux sur le garde-corps, et un second dans le couple humain à sa fenêtre : comme si les animaux des champs amenaient l’amour à la ville.
 Lièvre et faisan, Lovis Corinth, 1910, collection privée Lièvre et faisan, Lovis Corinth, 1910, collection privée |
 Lapin et perdrix, Suzanne Valadon, 1930, Ermitage Lapin et perdrix, Suzanne Valadon, 1930, Ermitage |
|---|
Au XXème siècle, le genre subsiste chez quelques artistes respectueux des traditions, mais les sous-entendus éventuels se sont perdus.
![]()
Diane et son gibier
La figure de Diane permet de combiner les charmes opulents de la chasse et de la chair.
 Diane et ses nymphes épiées par des satyres
Diane et ses nymphes épiées par des satyres
Peter Paul Rubens (pour les figures) et Frans Snyders (pour la nature morte), 1616, Royal Collection, Hampton Court
Rubens n’a pas représenté explicitement l’attribut de la déesse, mais l’a évoqué par la forme en croissant du corps de la femme de gauche : le lévrier fidèle qui dort à ses pieds l’identifie comme étant Diane.
Par rapport aux représentations habituelles de la chaste déesse, ce tableau cumule deux énormes provocations :
- un satyre enjambe Diane tandis que l’autre la dénude ;
- le satyre voyeur érige entre ses pattes de bouc un gigantesque tronc noueux.
A côté de ces allusions massives, les deux lièvres et les oiseaux peints par Snyders n’ont pas besoin d’être sexualisés.
 Diane et ses nymphes après la chasse
Diane et ses nymphes après la chasse
Jan Brueghel le jeune, 1630-39, Walters Art Museum Baltimore
Ce tableau sur le même thème, en moins scandaleux , est également à quatre mains : les figures sont d’un artiste non identifié du cercle de Peter Paul Rubens, le paysage et les animaux de Jan Brueghel le jeune.
Ici la meute de chien et l’amoncellement des proies font rempart entre la sexualité de louve, côté nymphe et satyre, et la sexualité des biches, dans le coin opposé. Perdus dans la masse, les lièvres et les oiseaux ne manifestent pas d’intention particulière.
 Diane avec ses chiens et ses trophées de chasse dans un paysage
Diane avec ses chiens et ses trophées de chasse dans un paysage
Jan Fyt et Erasmus Quellinus II, 1630 – 1661, Gemäldegalerie, Berlin
Toujours à quatre mains, cette composition juxtapose les deux genres sur la même toile : nature morte à gauche, scène mythologique à droite.
Pour une fois, Jan Fyt a eu une intention grivoise, en posant le long cou de cygne sur l’entrecuisse d’un lapin. Et les deux moitiés du tableau sont moins indépendantes qu’il ne semble : tandis qu’à droite un chien lève sa truffe vers sa maîtresse adorée, à gauche un autre chien lève la sienne vers l’objet de son appétit : ce qui crée une équivalence visuelle entre les points culminants des deux triangles, le lièvre au poitrail offert et la déesse au sein dénudé.
![]()
Diane et son gibier, chez Boucher
En focalisant le trophée de Diane sur un lièvre et un ou deux oiseaux, Boucher rend à ces animaux toute leur vigueur symbolique.
 Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre
Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre
Dans ce tableau très commenté [16], on passe en général à côté de l’essentiel.
Le collier de perles

Un premier détail qui devrait intriguer est le collier de perles que Diane manipule ostensiblement : car cette chasseresse n’est pas réputée coquette. En forçant, on pourrait justifier la présence des perles par leur parenté avec la Lune (blanche et changeante) ou comme symbole de pureté : mais ceci ne vaut guère que pour la Vierge, et dans un contexte chrétien (Margarita regni pretiosissima).
 La Toilette de Vénus
La Toilette de Vénus
Boucher, 1746, National Museum, Stockholm
En fait le collier de perles que tripote Diane est un double contresens :
- mythologique : c’est l’attribut naturel de Vénus, née de la mer dans une coquille ;
- narratif : si le collier était destiné à Diane, il devrait lui être présenté par la nymphe ; de plus elle en porte déjà un dans ses cheveux.
Les pieds de la déesse
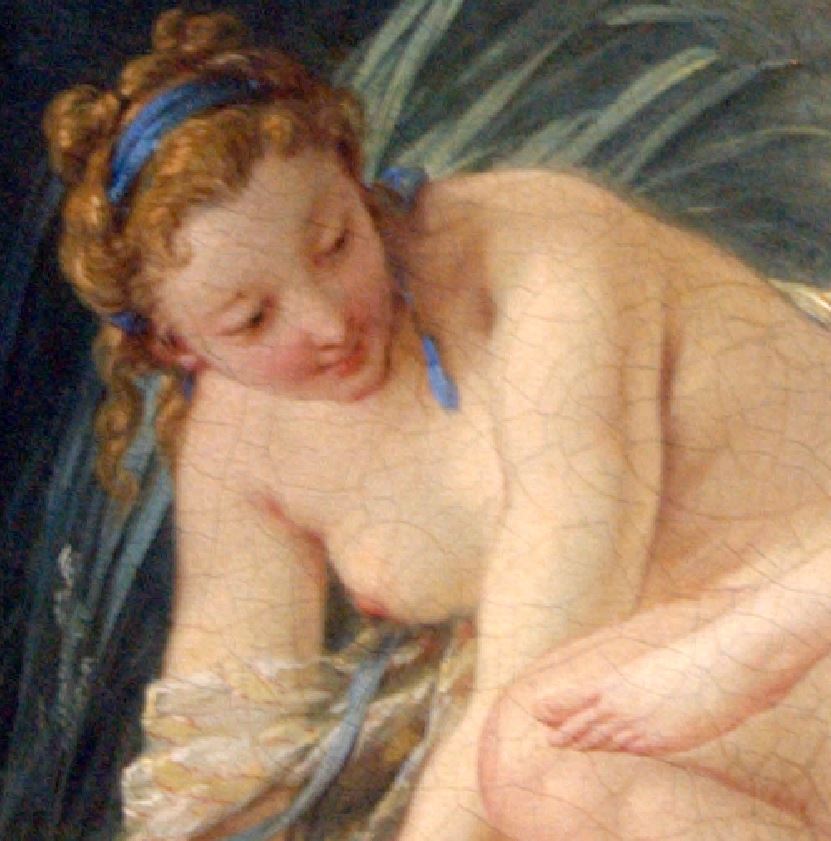
On voit bien que son pied droit frôle l’eau claire du premier plan. Mais que fait exactement son pied gauche, en suspens devant le genou de la nymphe ? Le frôle-t-il ou ne le frôle-t-il pas ?
Le regard à la fois étonné de la nymphe nous répond : Diane est tout simplement en train de lui faire du pied. Et le collier est le présent qui accompagne ses avances.
Le centre du tableau est donc un hommage discret aux amours féminines.
Le lièvre et les deux perdreaux

Tout le monde a bien vu les attributs de Diane :
- à gauche le carquois à côté des deux chiens,
- à droite l’arc à côté du gibier : un lièvre et deux perdreaux.
 Le Repos des nymphes au retour de la chasse, dit Le Retour de chasse de Diane
Le Repos des nymphes au retour de la chasse, dit Le Retour de chasse de Diane
Boucher, 1745, Musée Cognacq-Jay, Paris
Trois ans plus tard, Boucher distribuera ces éléments de manière différente : deux carquois, pas d’arc, un lapin et un perdreau à gauche, l’autre au centre. La chasseresse frôle toujours de son pied nu l’eau cristalline. Si on cherche la sandale qu’elle vient d’ôter, on trouvera son ruban bleu posé à gauche et frôlant, par une ironie discrète, la patte fourrée de sa victime.

La nymphe fait subir au second perdreau un écartèlement très étrange : tout comme sa maîtresse pince le ruban bleu, d’une main elle lui pince une patte et de l’autre elle lui pince la tête, le pouce bien enfoncé dans l’orbite.
Au XVIIIème siècle , et notamment chez Boucher, un volatile est une métaphore du soupirant en général (voir L’oiseau chéri) et de l’organe viril en particulier (voir L’oiseau licencieux). Le jeu cruel de la nymphe avec le cadavre flasque est donc une image de dérision, celle des compagnes de Diane envers l’orgueil masculin.

Dans la version de 1742, l’allusion sexuelle est plus discrète : un des perdreaux porte à la patte un ruban rouge dénoué, tandis que la patte du lièvre est encore attachée à l’arc par un autre ruban rouge. Cette idée bizarre de se servir d’un arc pour transporter des trophées n’a de sens que métaphorique : Diane sait se montrer impitoyable envers ses soupirants (les deux perdreaux) mais aussi envers celles qui lui sont attachées mais la trahissent (le lièvre). On se rappelle ici l’histoire de la nymphe Callisto, engrossée par Jupiter et punie par Diane, qui la transformera en ourse.
 Jupiter et Callisto
Jupiter et Callisto
Boucher, 1744, Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou
Boucher représentera plusieurs fois cette histoire, alibi commode pour une scène émoustillante entre filles. L’aigle caché à l’arrière-plan nous fait comprendre que celle qui caresse la nymphe au collier de perles n’est pas Diane, mais Jupiter ayant changé de sexe. Au premier plan, le cadavre du perdreau couché sur celui du lièvre rappelle l’hostilité de la déesse envers les amours ordinaires.
Deux siècles après Cosimo et un siècle après Cecco, Boucher exploite à nouveau, à plein, la symbolique sexuelle de l’animal à poils confronté à l’animal à plumes.

Les compagnes de Diane
Boucher, 1745, Fine Arts Museums, San Francisco
Ici Boucher ne s’embarrasse plus d’alibi mythologique : il nous montre deux filles à demi nues dans la campagne, celle avec un arc (la tireuse) lutinant celle avec un carquois (la receveuse). Perdus à côté dans le gris, le lapin et les pigeons symbolisent le manque de peps de la sexualité ordinaire.
 La Nymphe Callisto, séduite par Jupiter sous les traits de Diane
La Nymphe Callisto, séduite par Jupiter sous les traits de Diane
Boucher, 1759, Musée d’art Nelson-Atkins, Kansas City
Boucher restera fidèle à sa rhétorique dans cette version tardive, où seul subsiste le perdreau mort, mais où cohabitent cinq types de flèches qu’il n’est pas trop difficile d’interpréter.
Les zones liminaires
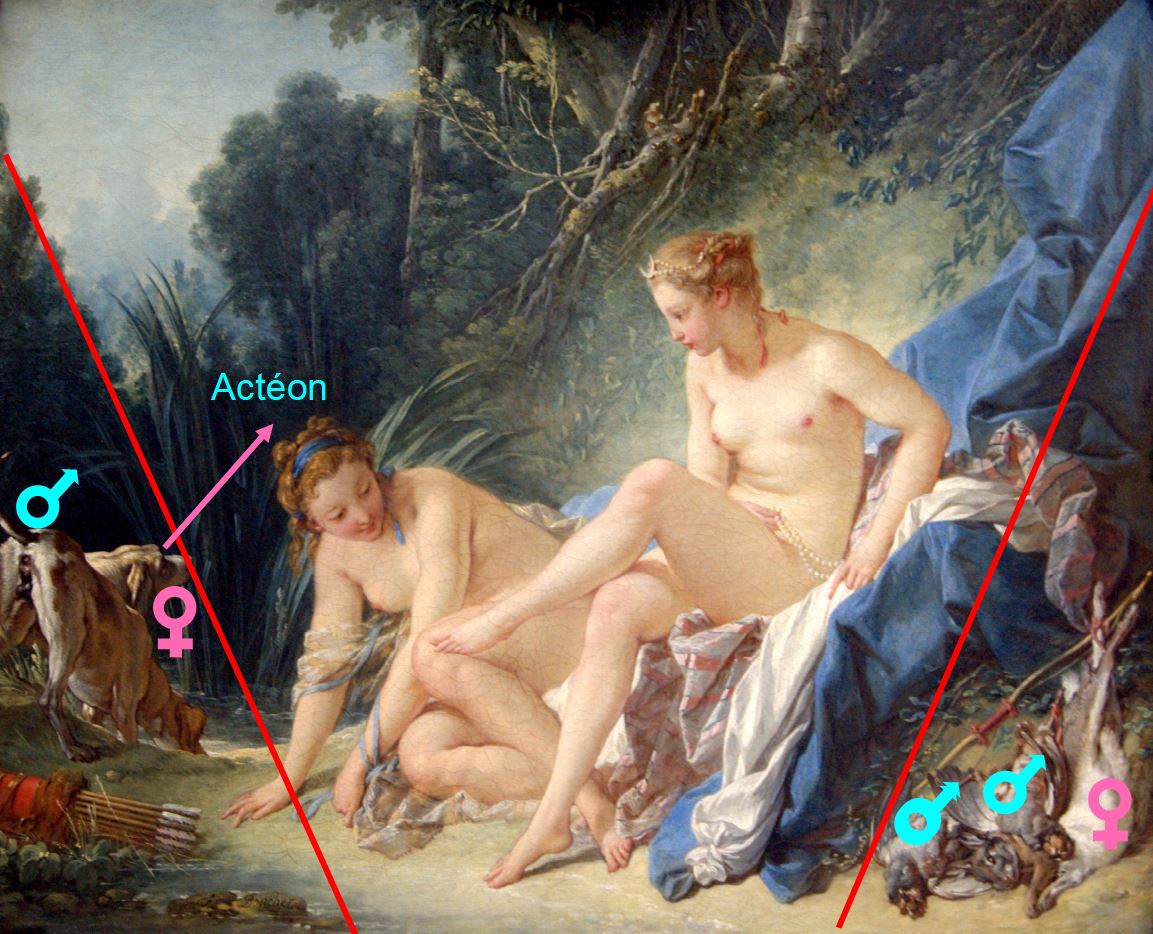 Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre
Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre
Pour en revenir au tout premier tableau sur le thème de la nymphe énamourée, Boucher n’aborde pas encore le thème égrillard de Jupiter travesti. Il se contente d’expurger sur les bords tous les symboles de la sexualité ordinaire :
- à droite les proies de Diane, tout gibier à poil ou à plume ;
- à gauche ses chiens, seuls animaux sexués qu’elle tolère, dont l’un arbore ostensiblement ses génitoires.
Tandis que ce chien s’abreuve dans l’étang sombre à l’arrière, la nymphe à quatre pattes, en situation de domesticité animale, se penche à l’avant vers l’eau claire du bain de Diane.
L’autre chien – qui devrait donc logiquement être une chienne – lève son museau vers l’arrière-plan, comme alerté par une présence importune. Il s’agit très certainement [17] d’une allusion à un autre mythe lié à Diane, celui du chasseur Actéon qui s’était dissimulé pour l’épier durant son bain. L’allusion est d’autant plus judicieuse, qu’Actéon, transformé en cerf pour sa punition, sera finalement dévoré par les chiens.
 |
 |
|---|---|
| Vers 1750, gravure de Pierre – François Tardieu d’après Boucher, MET (inversée) | 1761, Gravure d’après un dessin de Boucher, Les métamorphoses d’Ovide, trad. par M. l’abbé Banier, Volume I p 200 Gallica |
Diane et Actéon
Boucher ne semble pas avoir traité le thème en peinture : on connaît seulement ces deux gravures assez conventionnelles, où c’est Diane qui désigne aux nymphes effarouchées le péril masculin imminent.
Post-scriptum
![]()
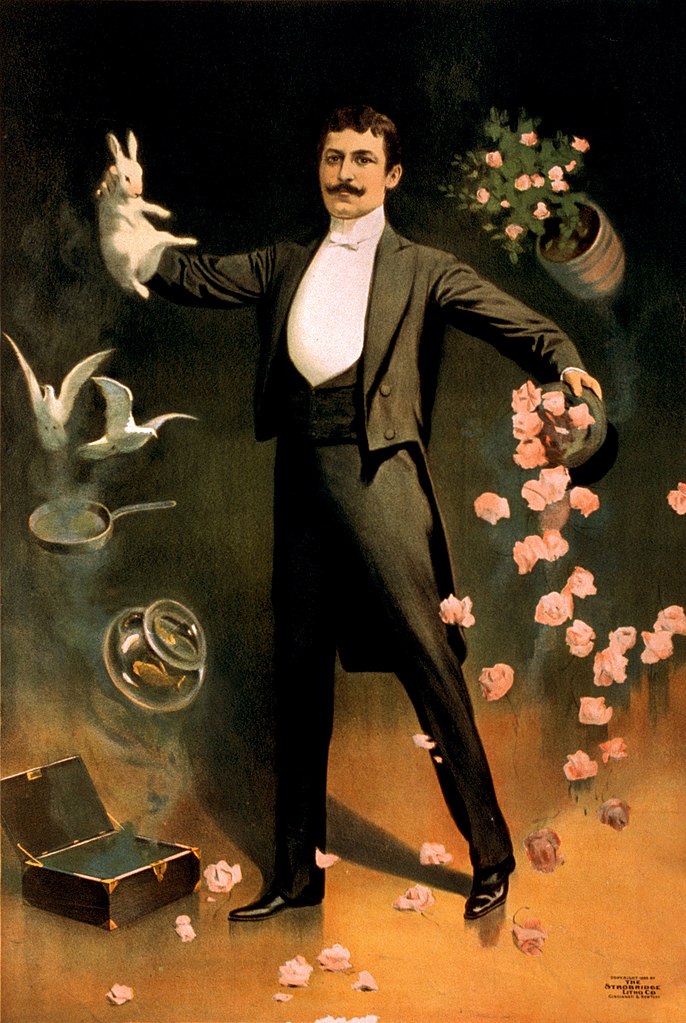 Le magicien Zan Zig, 1899
Le magicien Zan Zig, 1899
Une dernière coïncidence, en guise de coup de chapeau.
![]()

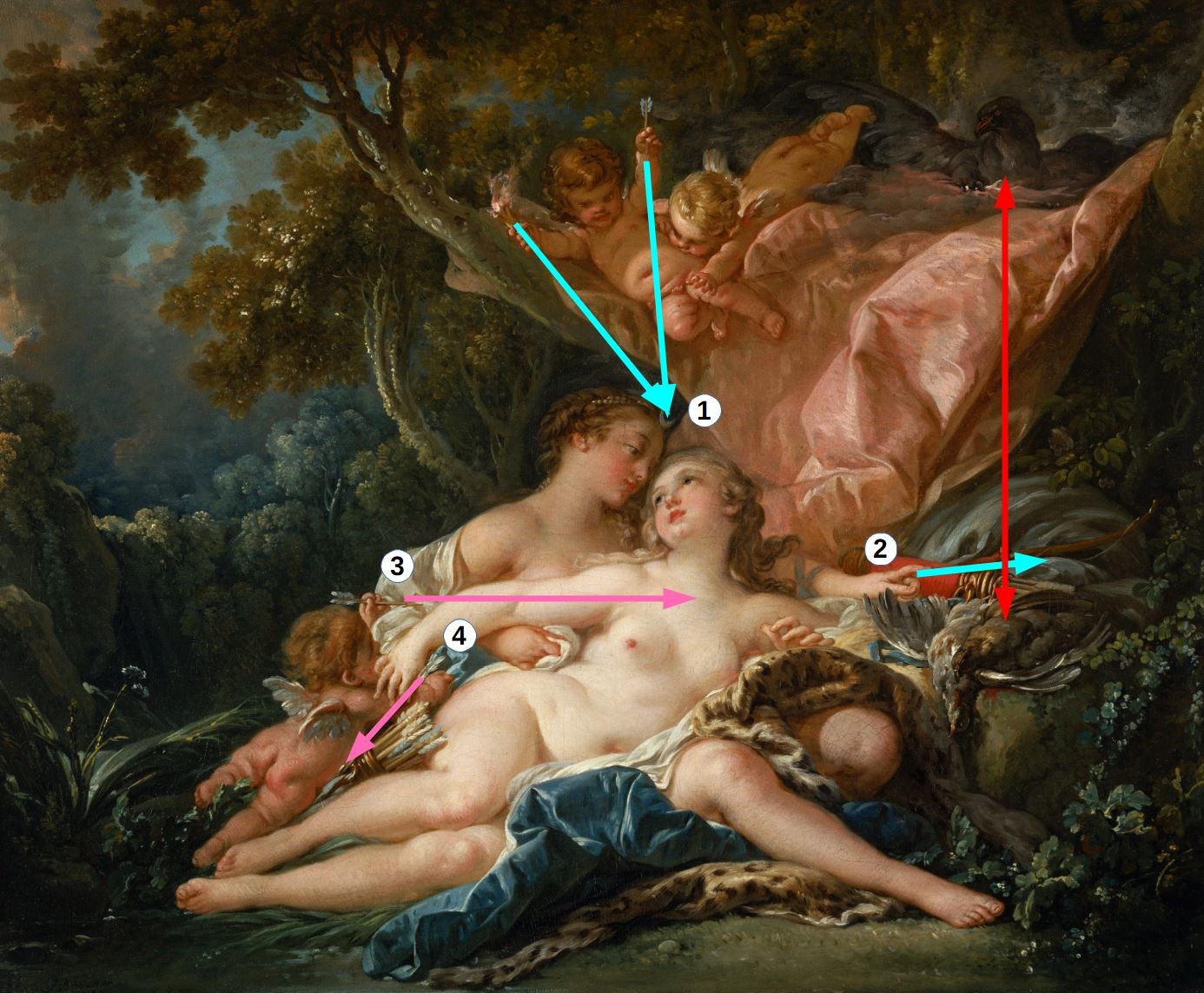
 Johannes Hevelius, 1687, Les trois constellations Lepus, Columba et Canis Major
Johannes Hevelius, 1687, Les trois constellations Lepus, Columba et Canis Major Allégorie de la Luxure, Pisanello, vers 1426, Albertina, Vienne
Allégorie de la Luxure, Pisanello, vers 1426, Albertina, Vienne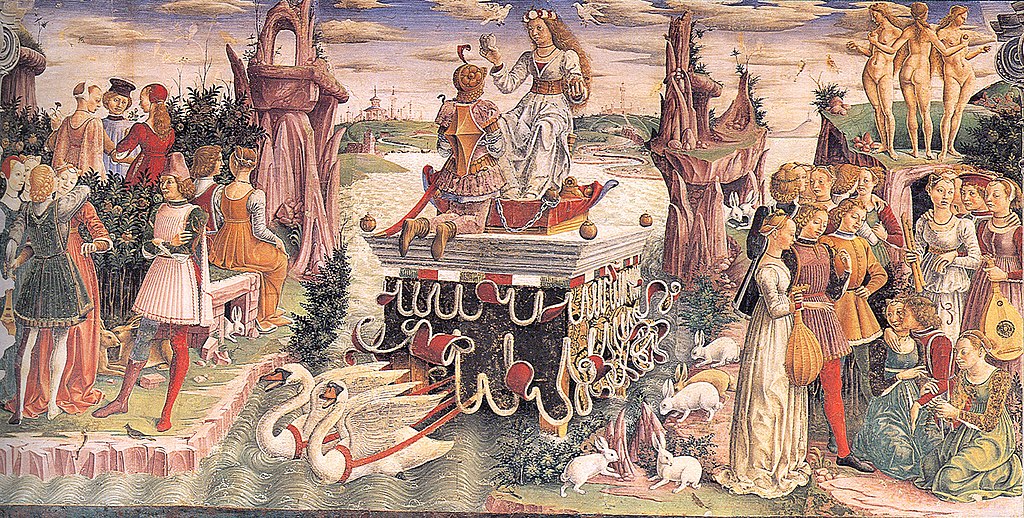 Avril et les Enfants de Vénus (vers 1470), Francesco del Cossa, Pallazo Schifanoia, Ferrare
Avril et les Enfants de Vénus (vers 1470), Francesco del Cossa, Pallazo Schifanoia, Ferrare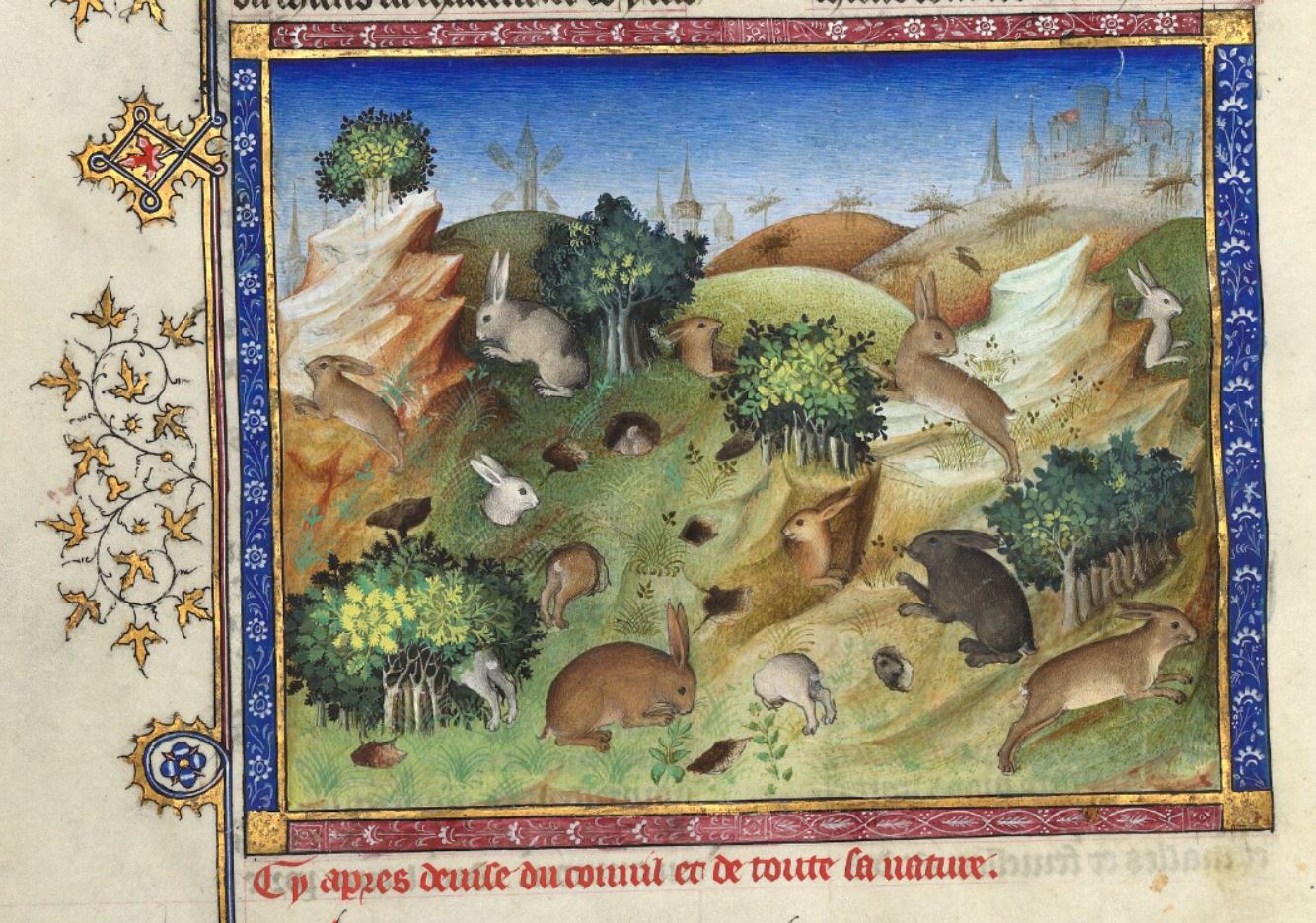 Cy après devise du connil et de toute la nature
Cy après devise du connil et de toute la nature


 Hans Baldung Grien, 1516, Maître-autel du monastère de Freiburg
Hans Baldung Grien, 1516, Maître-autel du monastère de Freiburg Hans Jakob Strueb, 1505, panneau de retable, musée Thyssen, Madrid
Hans Jakob Strueb, 1505, panneau de retable, musée Thyssen, Madrid Triptyque en forme de coeur (Colditzer Altar), revers
Triptyque en forme de coeur (Colditzer Altar), revers Livre d’Heures
Livre d’Heures La Vierge au Lapin, Titien, 1530, Louvre
La Vierge au Lapin, Titien, 1530, Louvre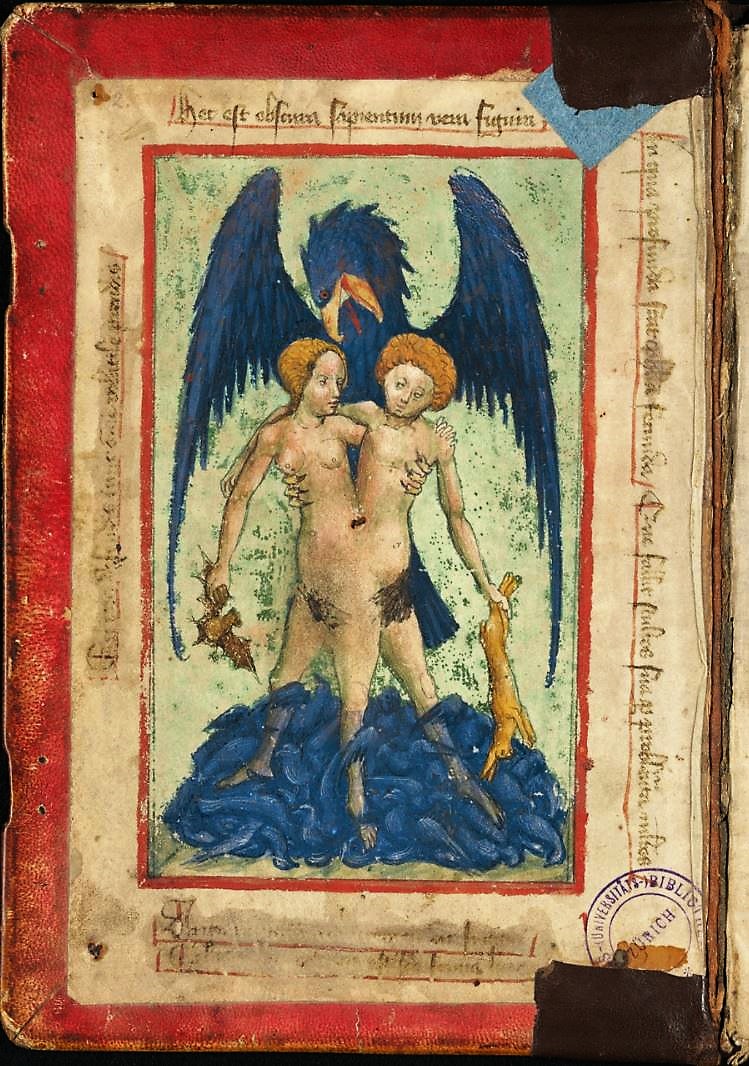 Hermaphrodite alchimique
Hermaphrodite alchimique  La crèche aux lapins
La crèche aux lapins 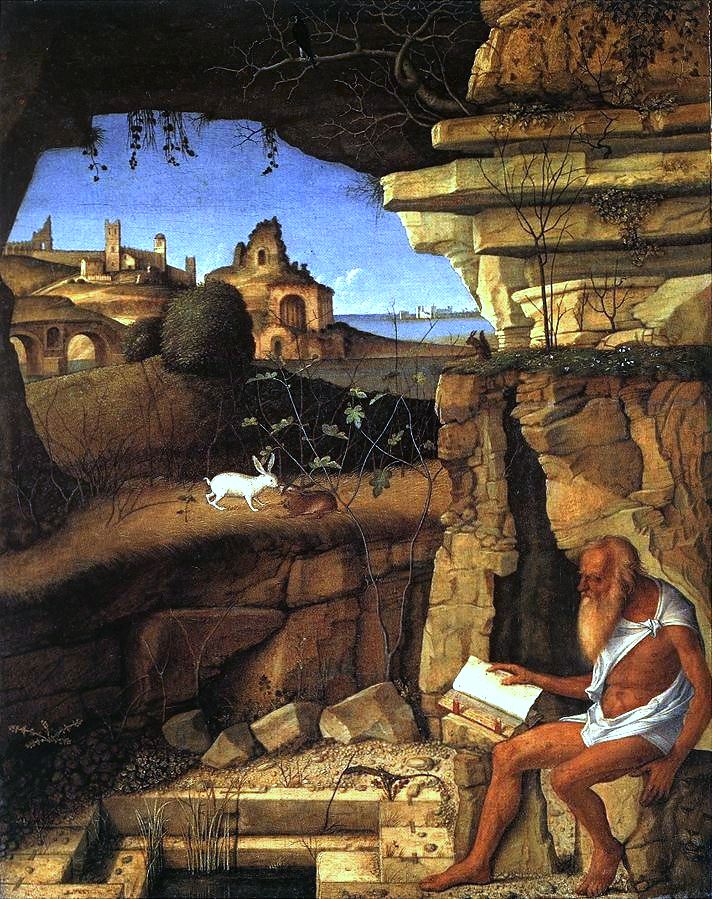

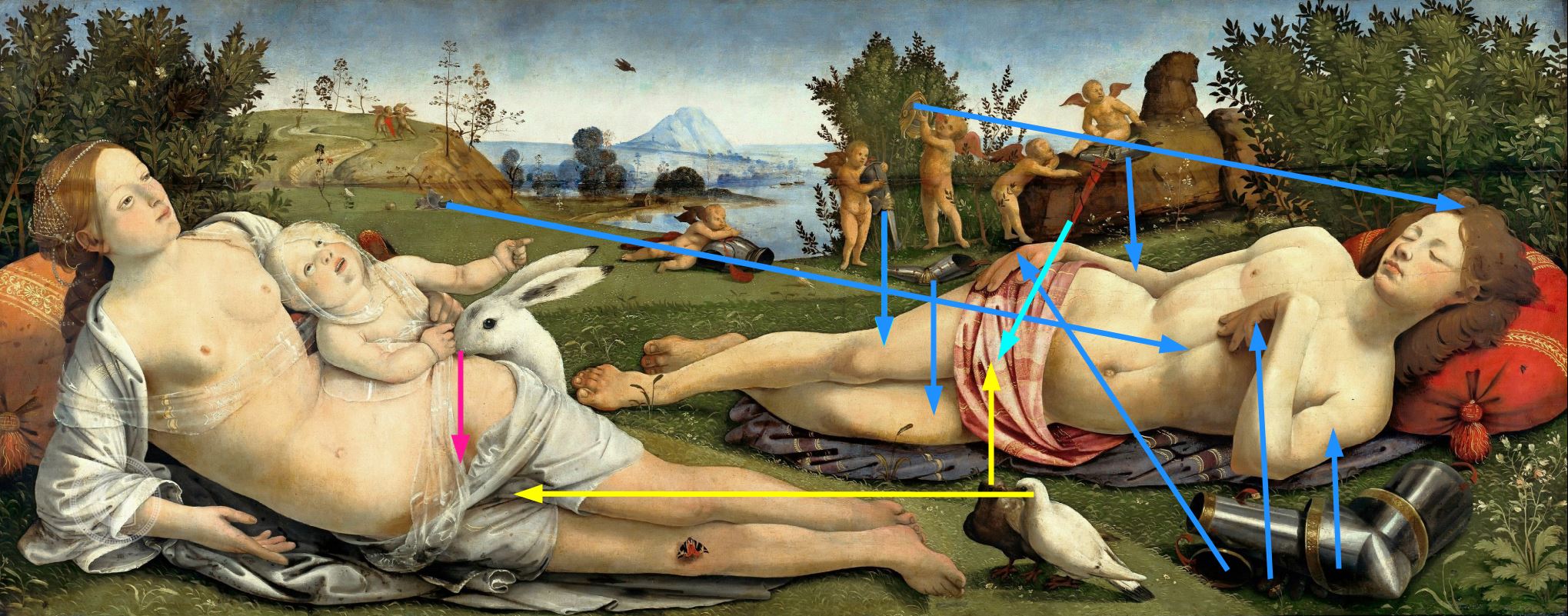




 Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)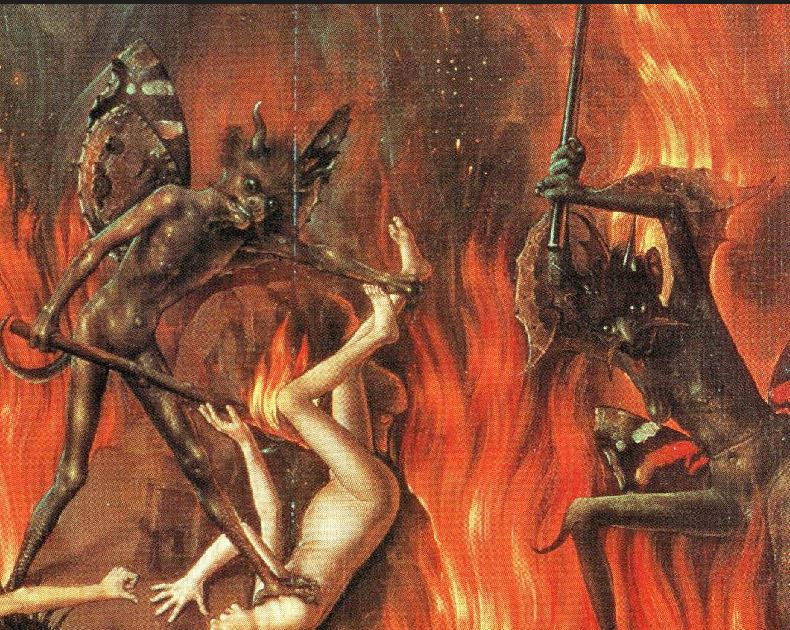 Vulcain (Vanessa atalanta)
Vulcain (Vanessa atalanta)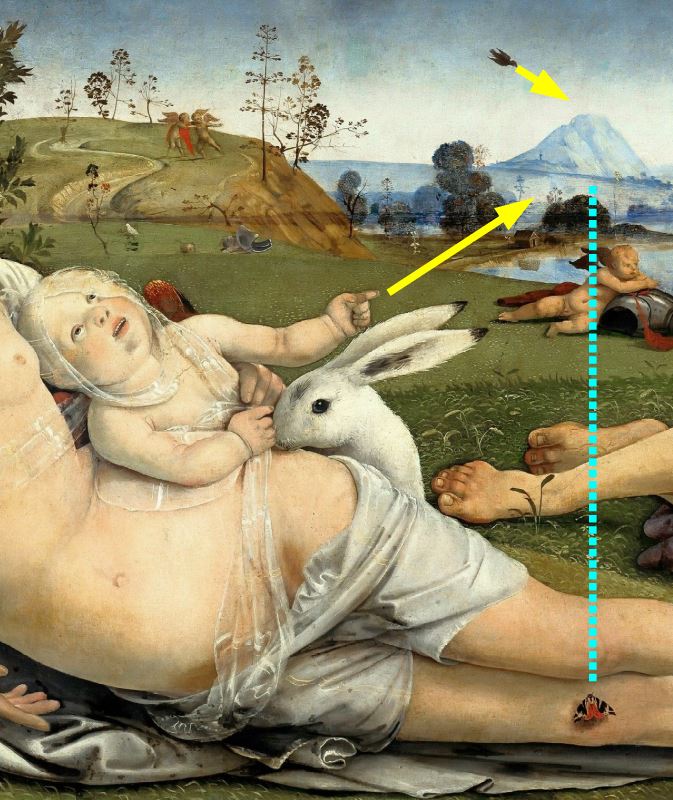
 Femme avec deux colombes, Prado, Madrid
Femme avec deux colombes, Prado, Madrid Homme avec un lapin, Palazzo Reale, Madrid
Homme avec un lapin, Palazzo Reale, Madrid Le Christ chassant les marchands du Temple (détail)
Le Christ chassant les marchands du Temple (détail) Le martyre de Saint Sébastien
Le martyre de Saint Sébastien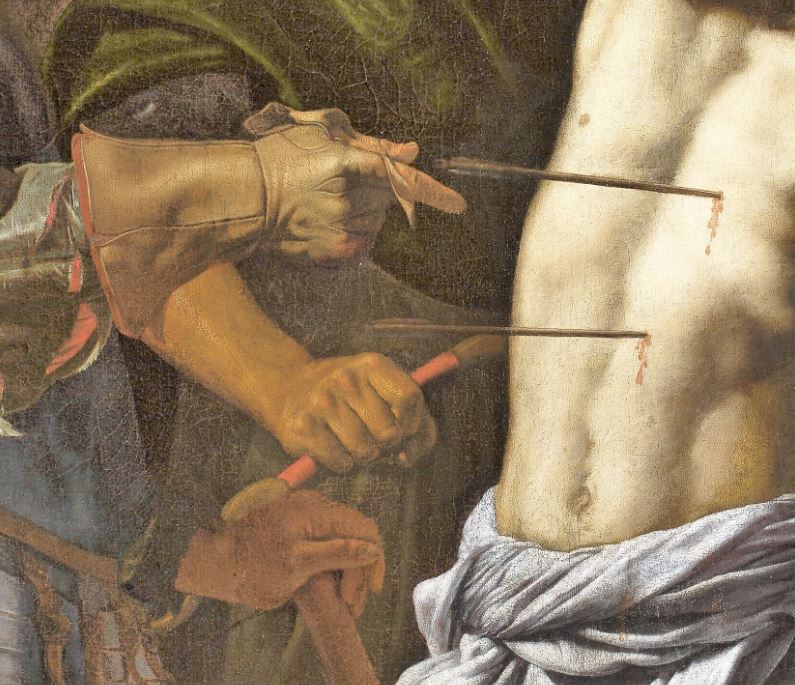

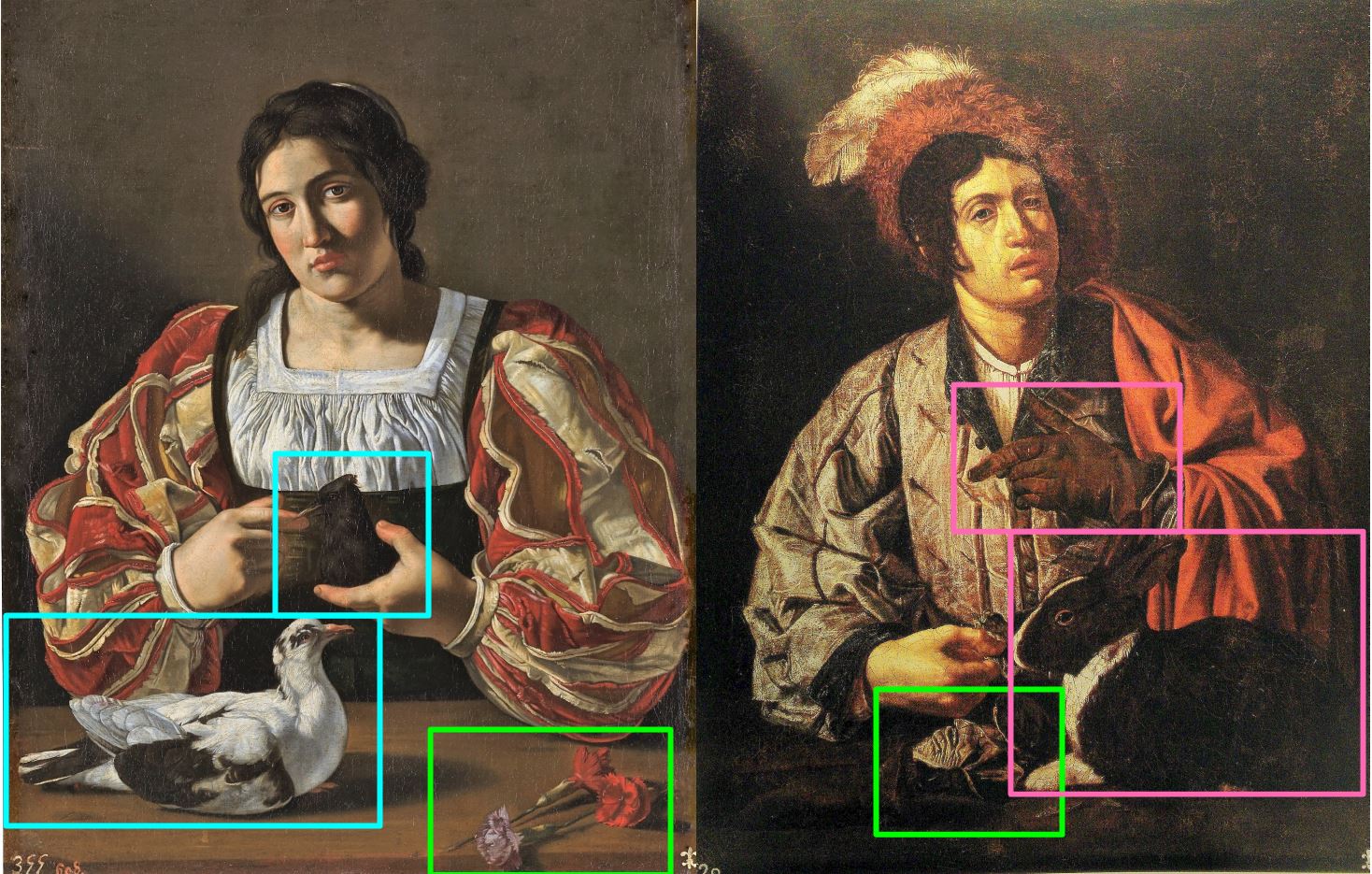


 Portrait d’un petit garçon avec une colombe et un lapin (probablement Ferigo, né en 1758), collection particulière
Portrait d’un petit garçon avec une colombe et un lapin (probablement Ferigo, né en 1758), collection particulière Portrait d’un jeune garçon en uniforme (probablement Gerolamo, né en 1754), Museum of Fine Arts,Springfield
Portrait d’un jeune garçon en uniforme (probablement Gerolamo, né en 1754), Museum of Fine Arts,Springfield Portrait d’une jeune fille avec une colombe et un chien
Portrait d’une jeune fille avec une colombe et un chien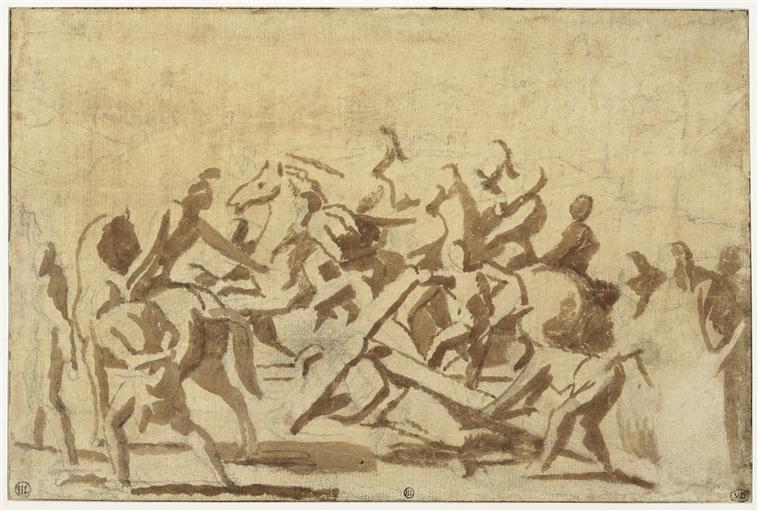 Le Portement de Croix, dessin, Musée de Dijon
Le Portement de Croix, dessin, Musée de Dijon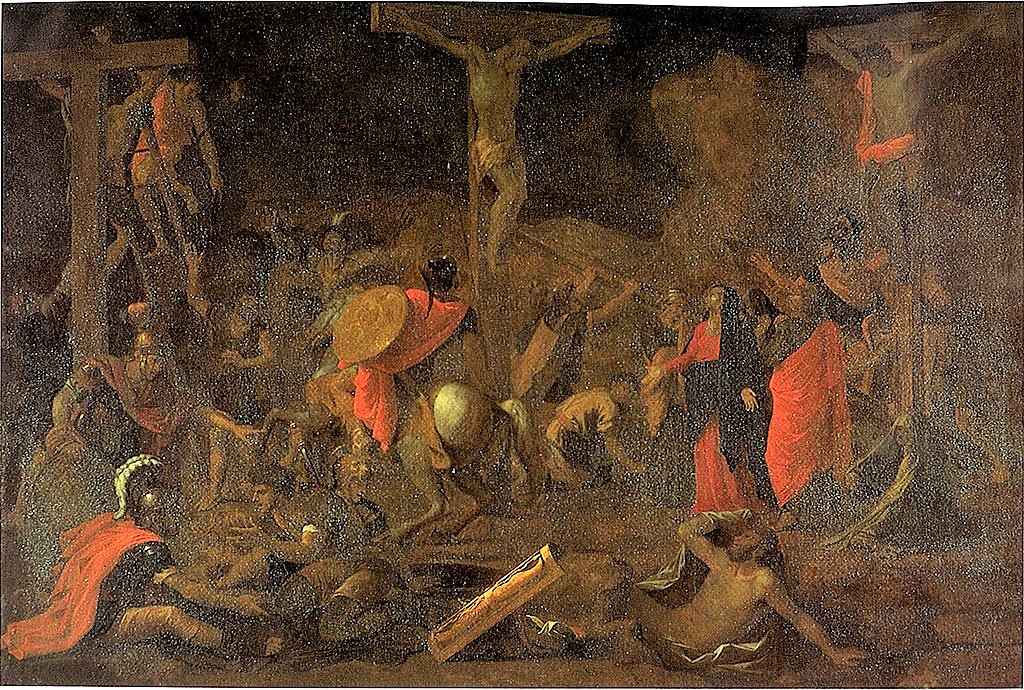 Crucifixion, Wadsworth Atheneum, Hartford
Crucifixion, Wadsworth Atheneum, Hartford Crucifixion, attribué à Poussin, 1647, Louvre (c) RMN
Crucifixion, attribué à Poussin, 1647, Louvre (c) RMN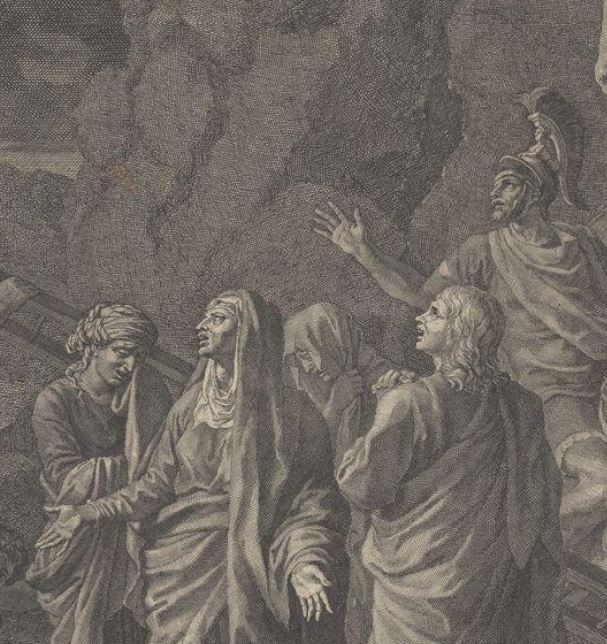

 Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon
Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon Moïse changeant en serpent la verge d’Aaron
Moïse changeant en serpent la verge d’Aaron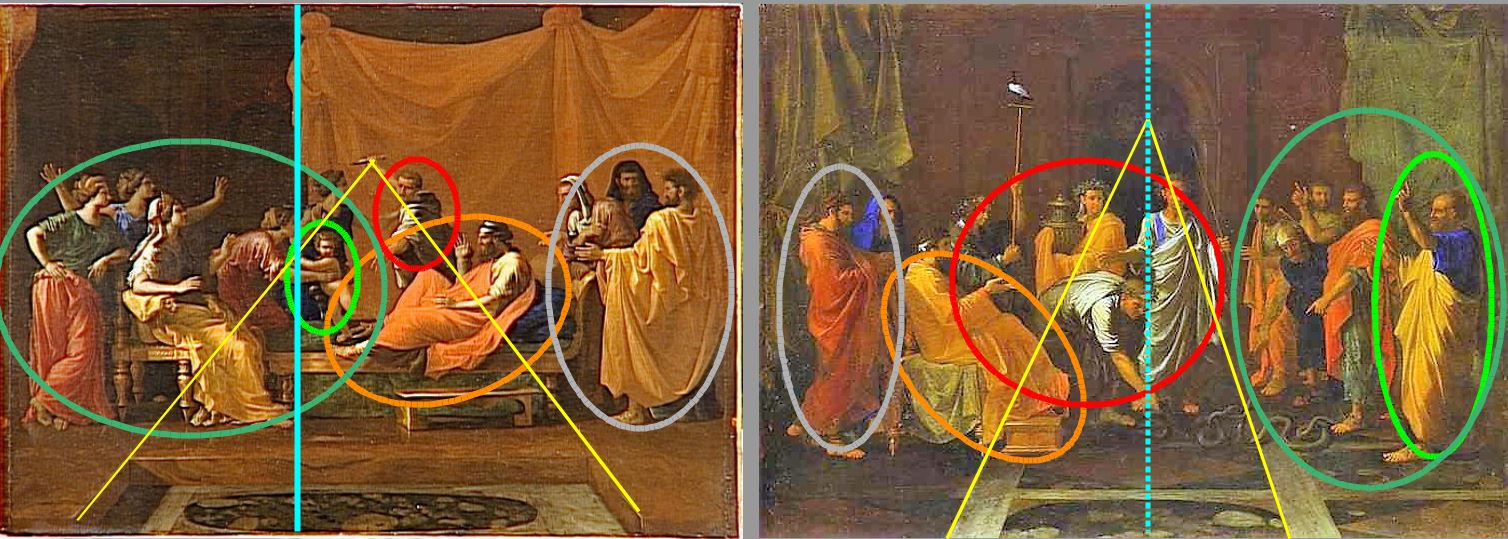
 Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon, 1645, Woburn Abbey
Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon, 1645, Woburn Abbey Le Jugement de Salomon, 1649, Louvre
Le Jugement de Salomon, 1649, Louvre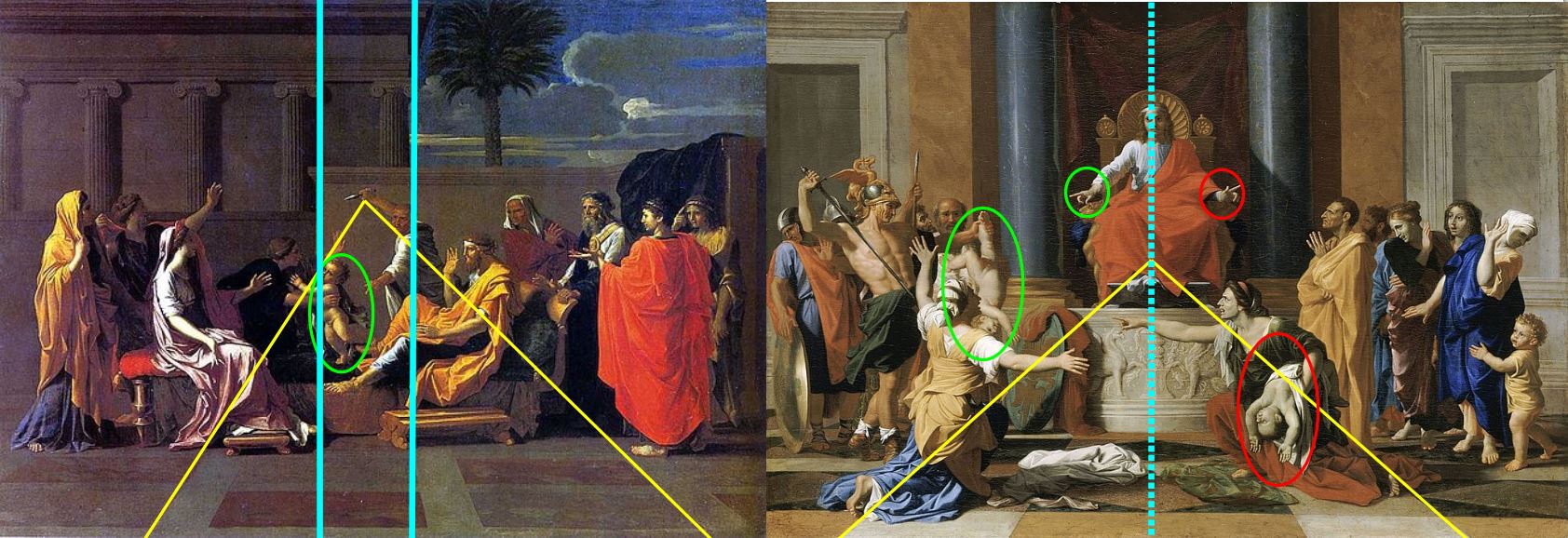







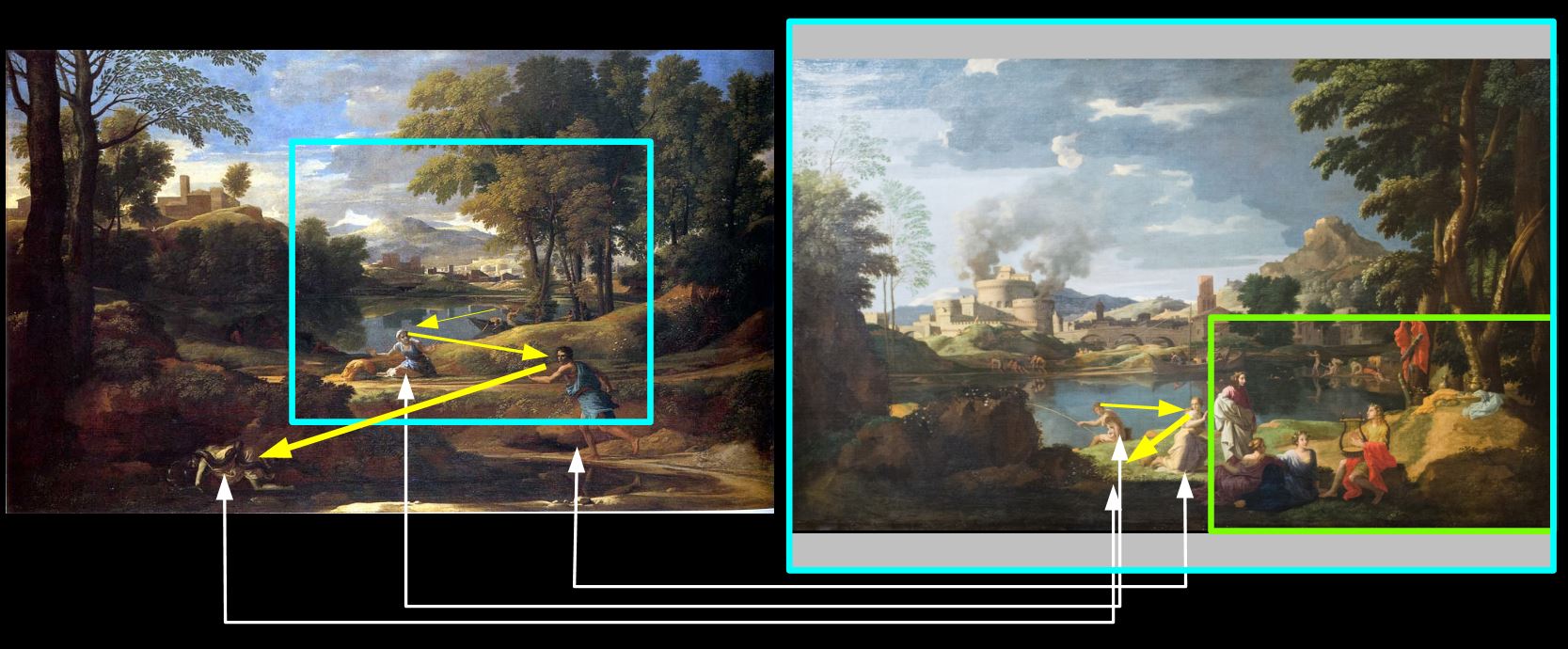
 Paysage avec un homme effrayé par un serpent, 1637-39, Musée des Beaux Arts, Montréal
Paysage avec un homme effrayé par un serpent, 1637-39, Musée des Beaux Arts, Montréal Paysage avec Polyphème, 1649, Ermitage
Paysage avec Polyphème, 1649, Ermitage Paysage avec Hercule et Cacus, 1659, Musée Pouchkine, Moscou
Paysage avec Hercule et Cacus, 1659, Musée Pouchkine, Moscou
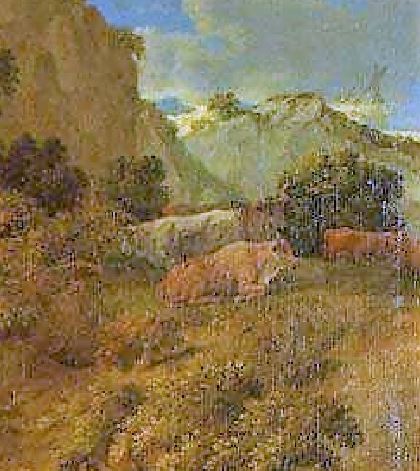
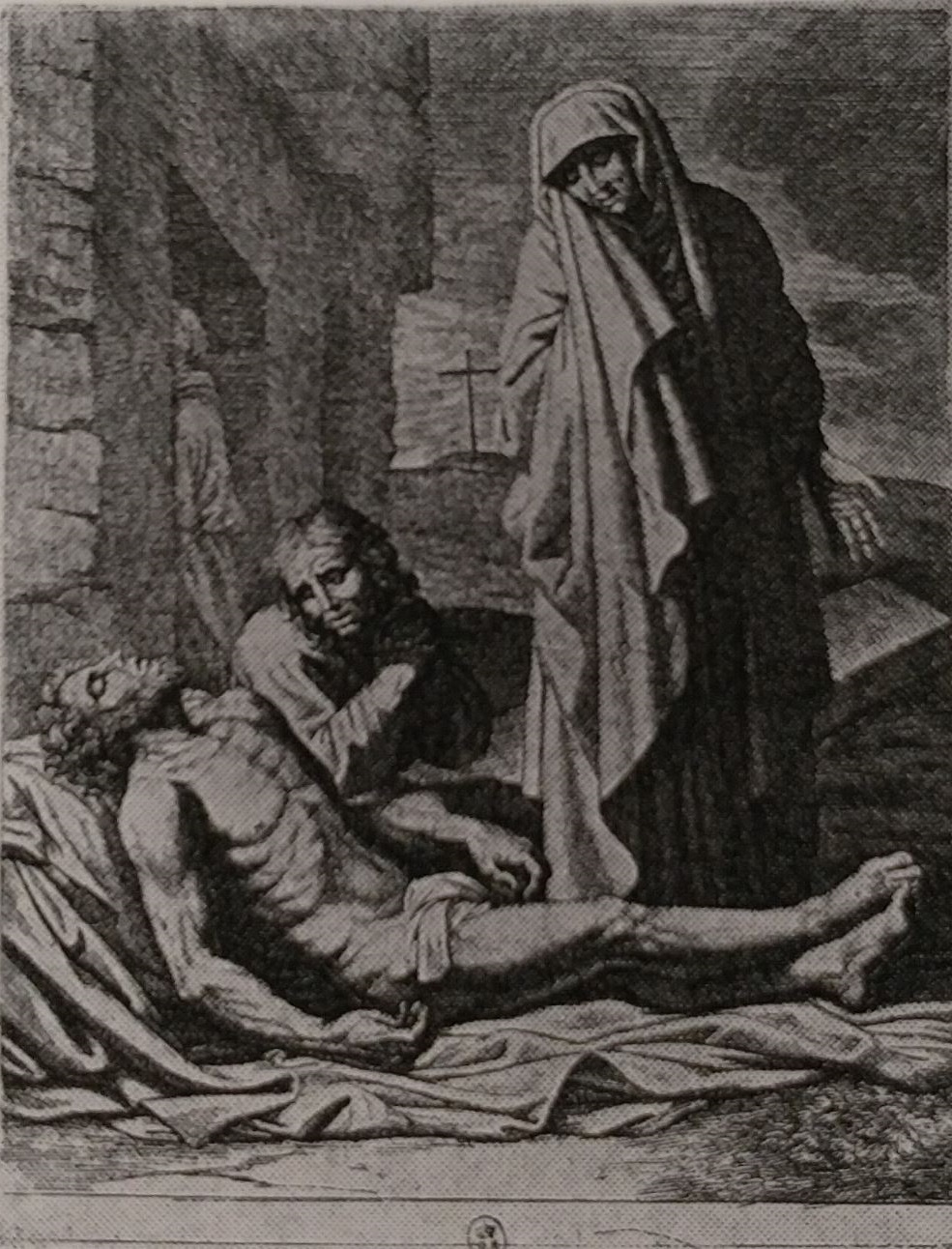 Lamentation sur le Christ Mort gravure de Pietro del Po (inversée)
Lamentation sur le Christ Mort gravure de Pietro del Po (inversée) Noli me tangere, Prado, Madrid
Noli me tangere, Prado, Madrid Paysage avec les funérailles de Phocion
Paysage avec les funérailles de Phocion Paysage avec les cendres de Phocion
Paysage avec les cendres de Phocion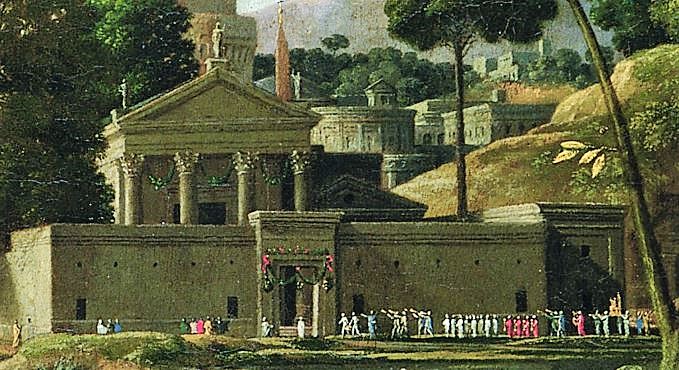




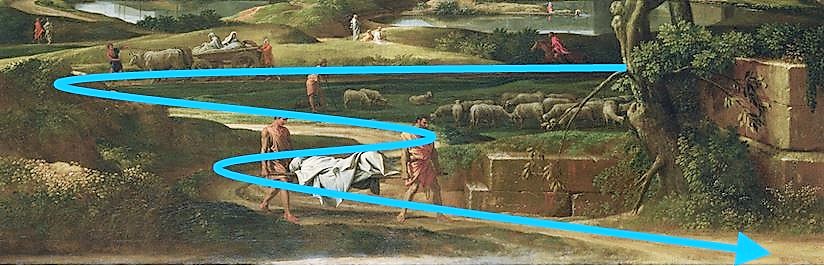
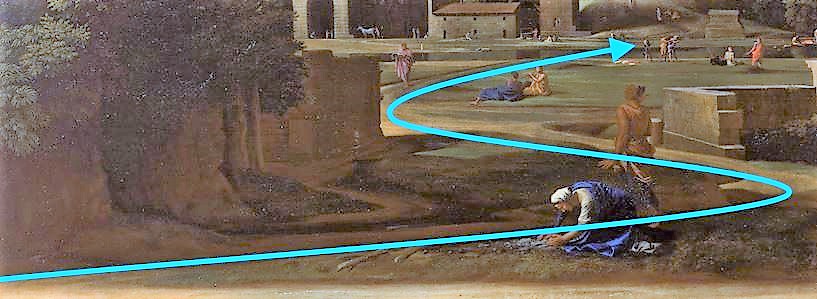
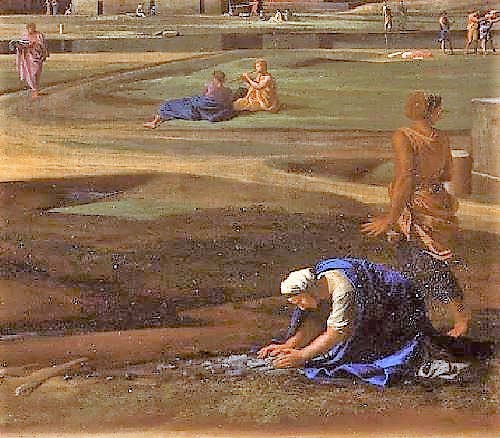
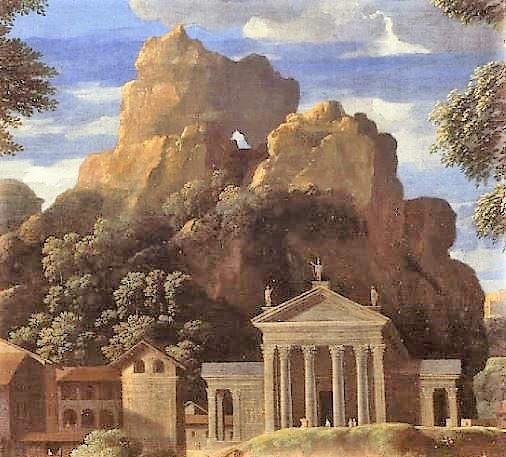
 Paysage par temps calme
Paysage par temps calme L’orage
L’orage Annonciation
Annonciation Nativité
Nativité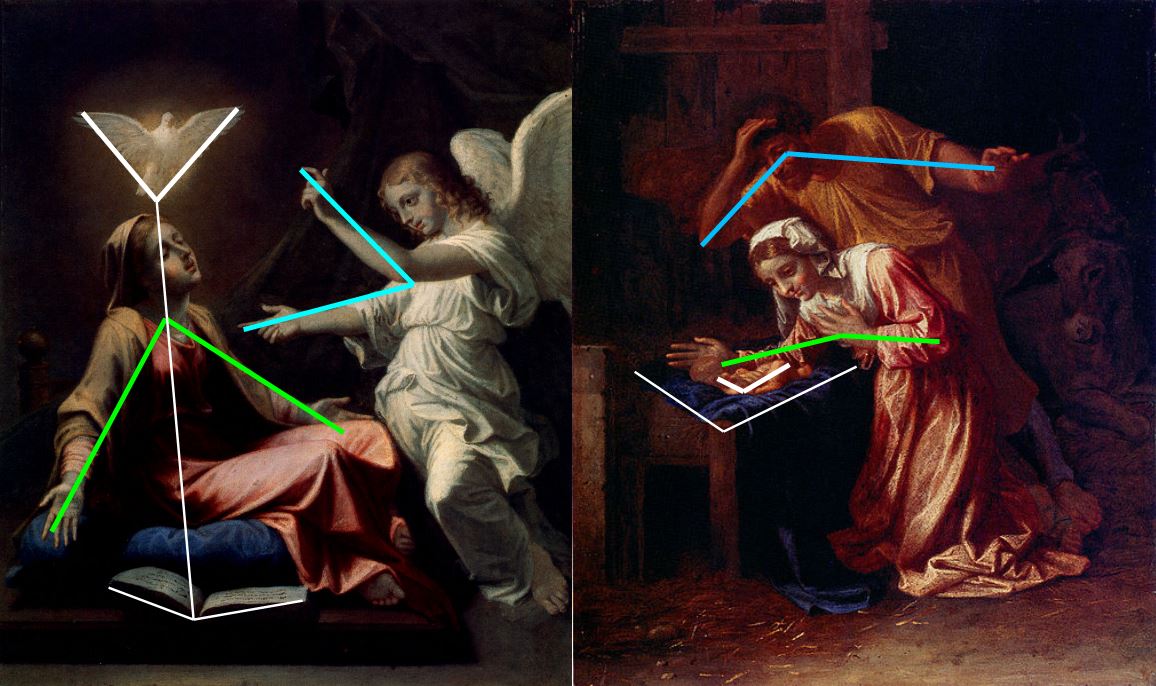
 L’enlèvement par Hercule de Déjanire , vers 1637, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe
L’enlèvement par Hercule de Déjanire , vers 1637, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe L’enlèvement par Armide de Renaud mourant, vers 1637, Windsor castle.
L’enlèvement par Armide de Renaud mourant, vers 1637, Windsor castle.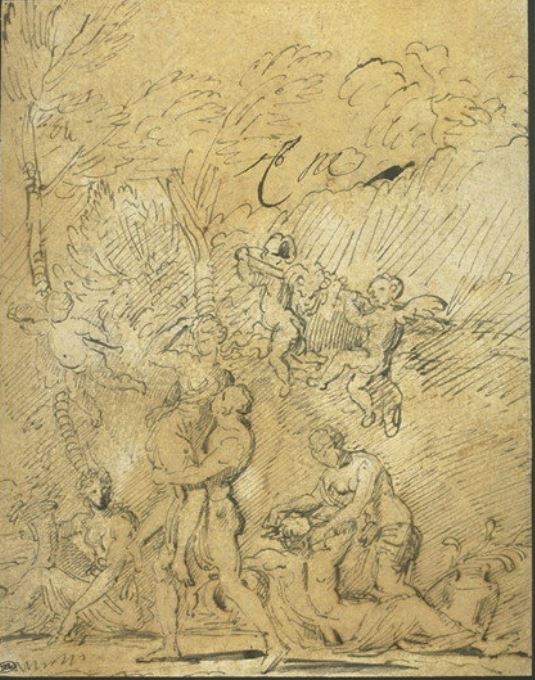 Dessin attribué à Poussin, RMN-Grand Palais, photo Jean-Gilles Berizzi
Dessin attribué à Poussin, RMN-Grand Palais, photo Jean-Gilles Berizzi Hercule et Déjanire, gravure d’Audran, 1692
Hercule et Déjanire, gravure d’Audran, 1692
 Paysage avec un homme lavant ses pieds à une fontaine (Paysage avec un chemin de terre), Poussin, National Gallery, Londres
Paysage avec un homme lavant ses pieds à une fontaine (Paysage avec un chemin de terre), Poussin, National Gallery, Londres Paysage avec voyageurs au repos (la route romaine), D’après Poussin, vers 1648, Dulwich Gallery
Paysage avec voyageurs au repos (la route romaine), D’après Poussin, vers 1648, Dulwich Gallery
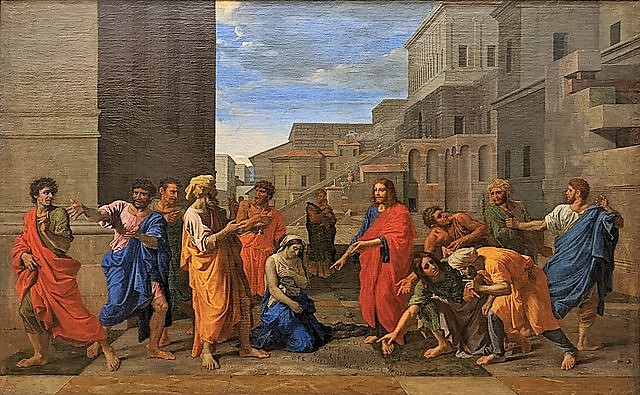 Le Christ et la femme adultère
Le Christ et la femme adultère La mort de Saphire
La mort de Saphire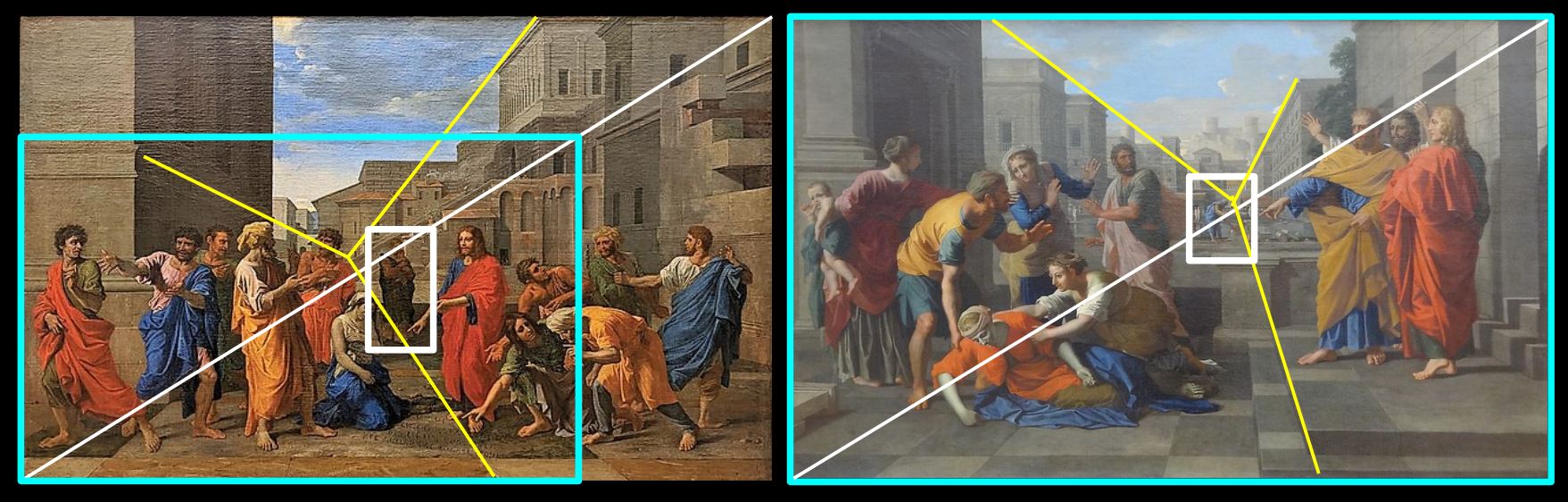
 Brunelleschi
Brunelleschi Ghiberti
Ghiberti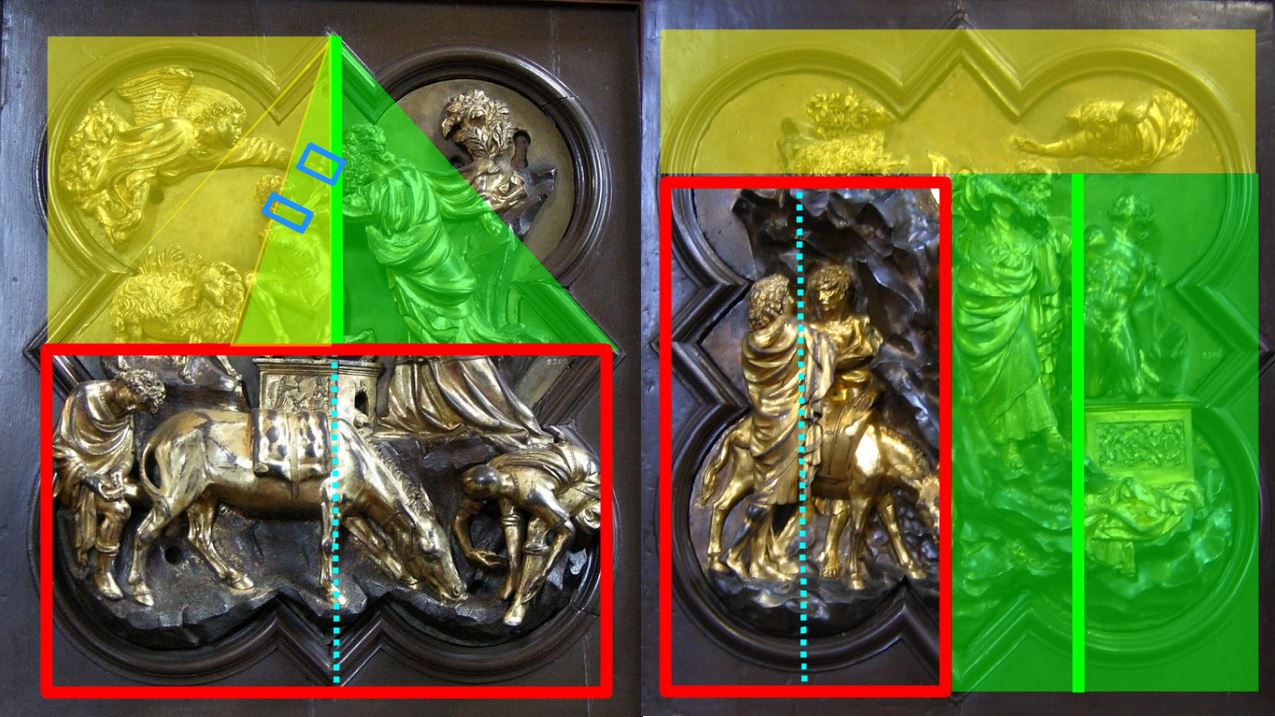
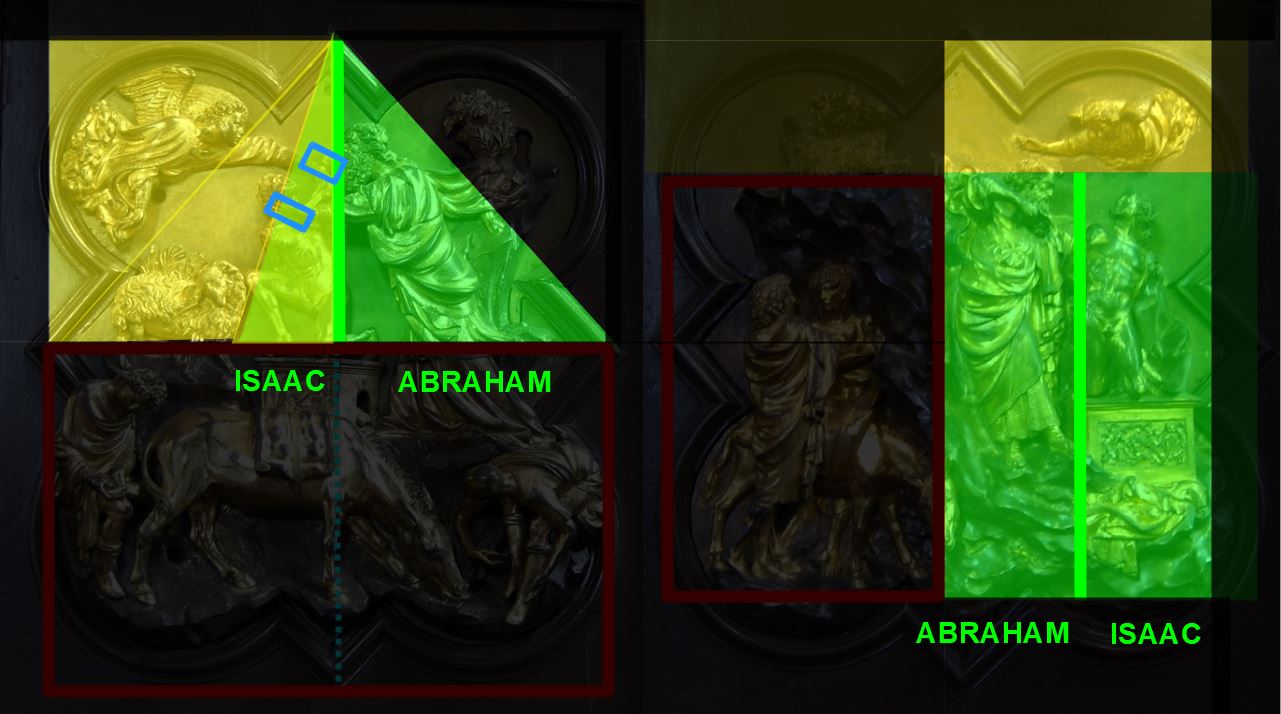
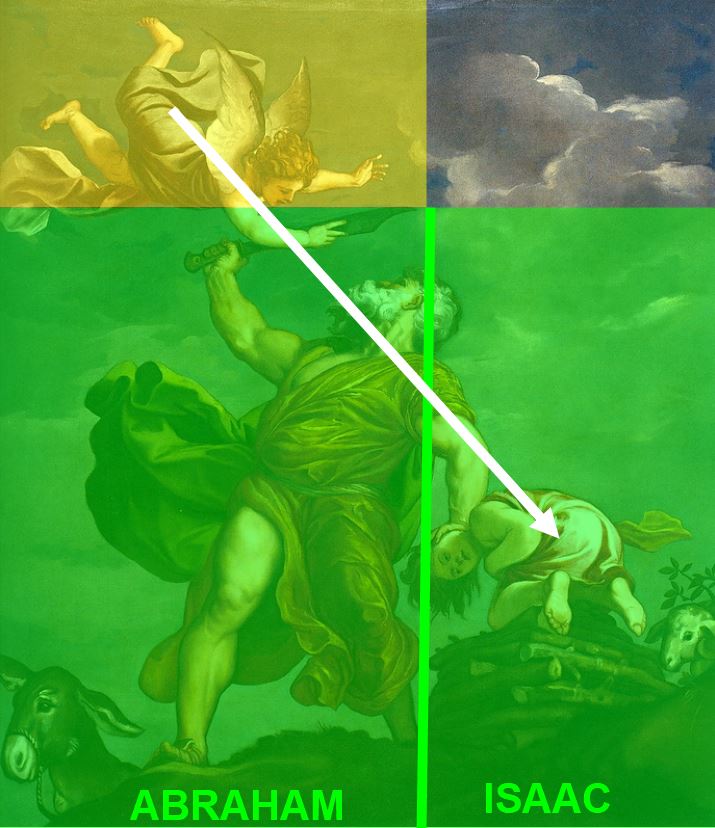
 Nicolas de Verdun, 1194, Klosterneuburg Altar
Nicolas de Verdun, 1194, Klosterneuburg Altar Master Bertram de Minden, 1383, Grabower Altar, St. Peter, Hambourg
Master Bertram de Minden, 1383, Grabower Altar, St. Peter, Hambourg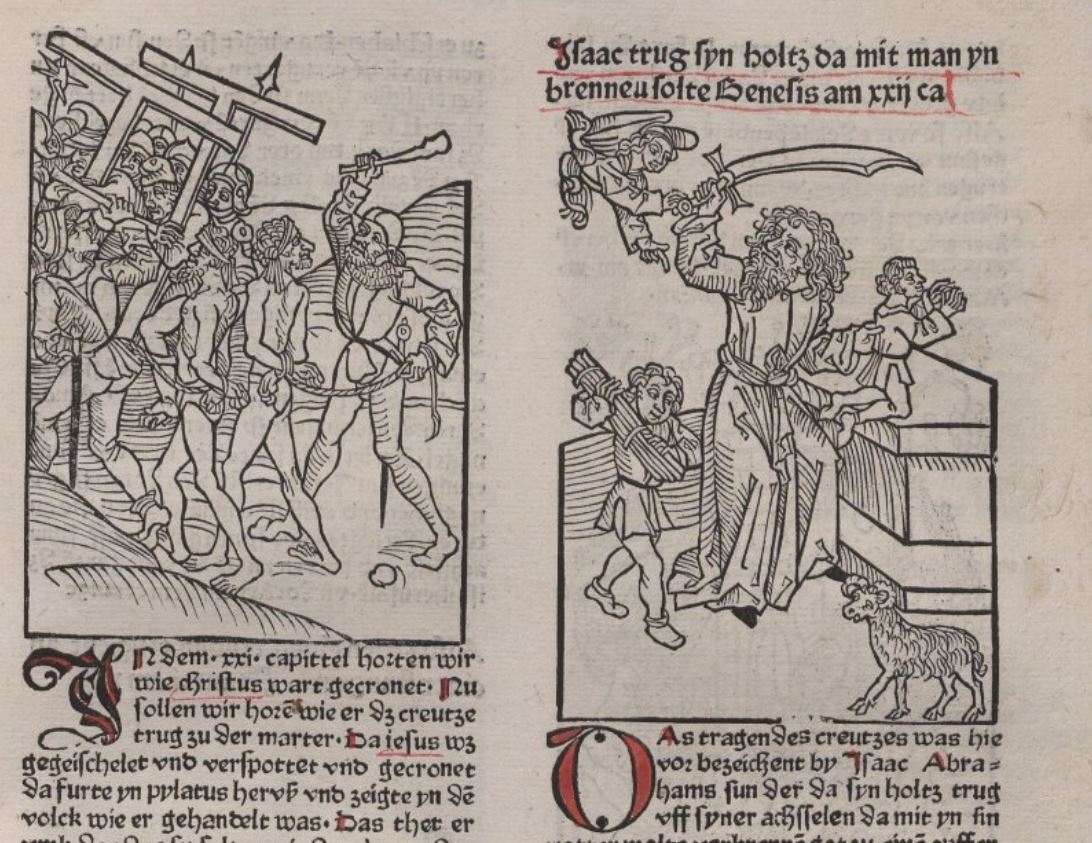 Spire, vers 1480, BSB-Ink S-512 p 102
Spire, vers 1480, BSB-Ink S-512 p 102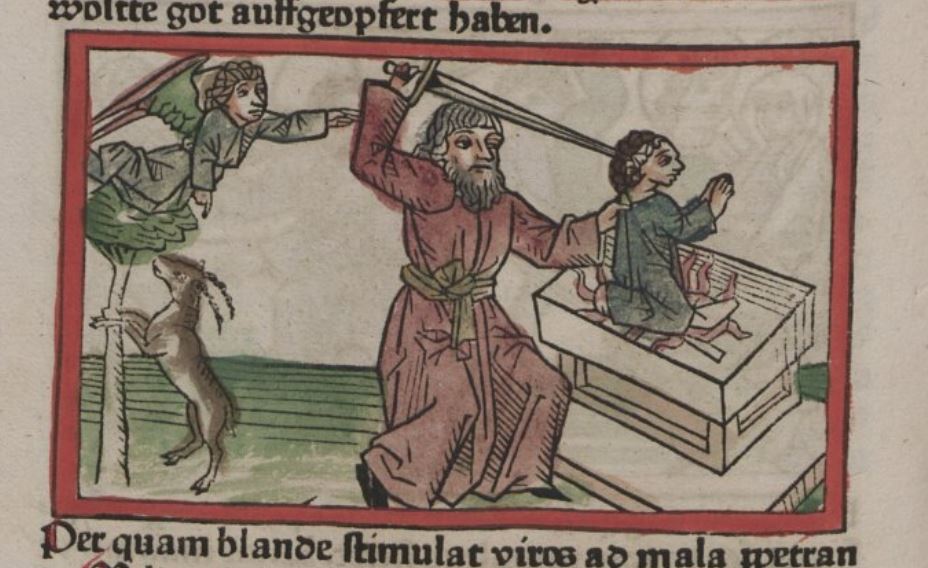 Augsbourg, avant 1473, BSB-Ink S-509 p 234
Augsbourg, avant 1473, BSB-Ink S-509 p 234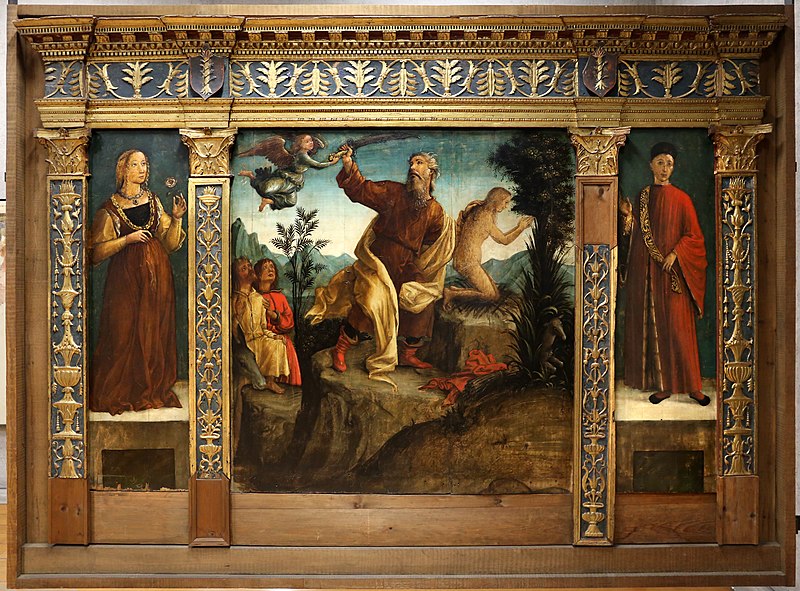
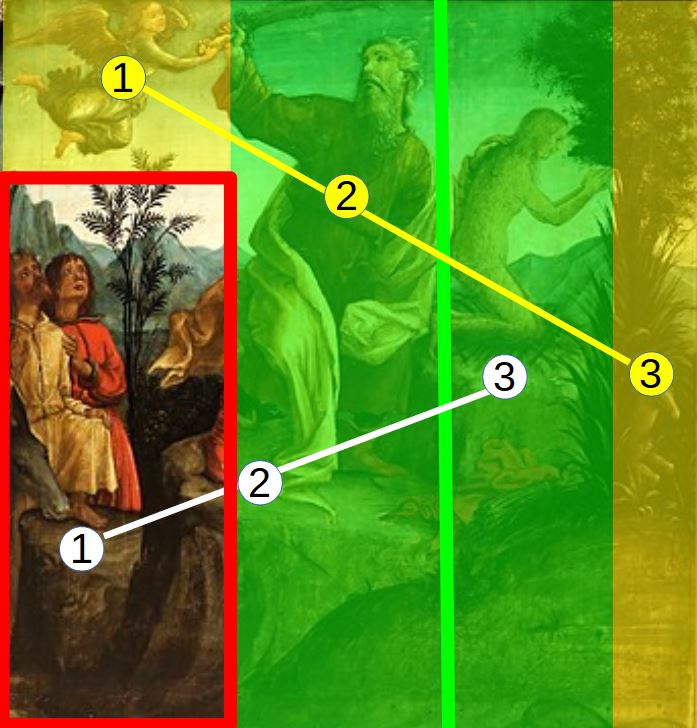
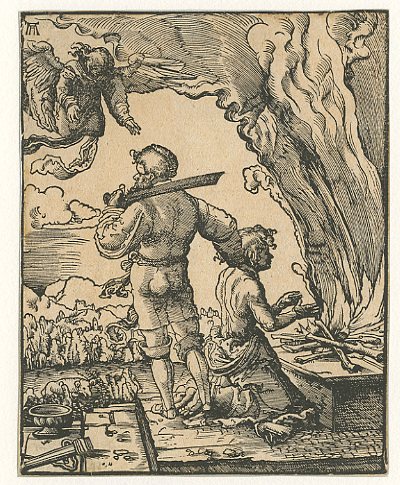 Altdorfer, vers 1520, Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg
Altdorfer, vers 1520, Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg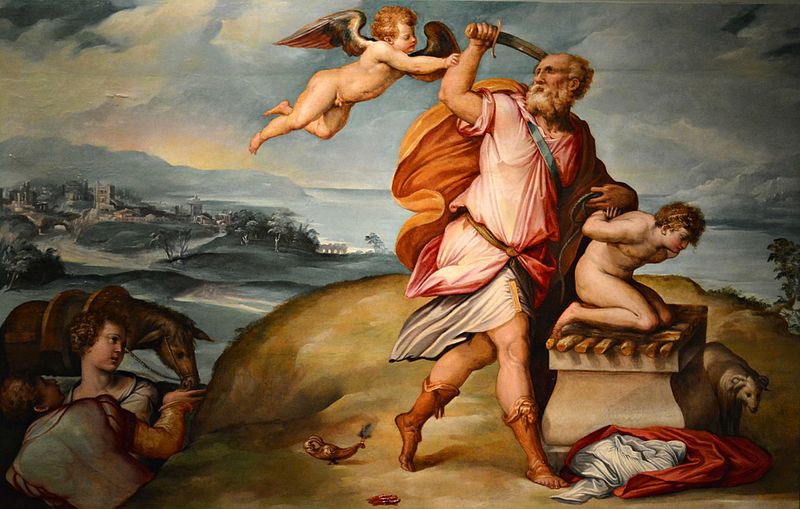 Giorgio Vasari, 1550-70, Capodimonte
Giorgio Vasari, 1550-70, Capodimonte Lelio Orsi, après 1555, Capodimonte
Lelio Orsi, après 1555, Capodimonte Titien, 1542-44, plafond de la sacristie, Santa Maria della Salute, Venise
Titien, 1542-44, plafond de la sacristie, Santa Maria della Salute, Venise Tintoret et atelier, 1550-55, Offices
Tintoret et atelier, 1550-55, Offices Tintoret, 1577-78, Scuola Grande di San Rocco
Tintoret, 1577-78, Scuola Grande di San Rocco Cristofano Allori, 1600-25, Musée Thomas Henry, Cherbourg-Octeville
Cristofano Allori, 1600-25, Musée Thomas Henry, Cherbourg-Octeville Domenico Fetti, 1613-23, Credito Bergamasco, Bergamo
Domenico Fetti, 1613-23, Credito Bergamasco, Bergamo Jacopo (da Empoli) Chimenti, 1615-20, Cappella Serragli, Chiesa di San Marco, Florence
Jacopo (da Empoli) Chimenti, 1615-20, Cappella Serragli, Chiesa di San Marco, Florence Guerchin, 1615-20, Collection Prince du Liechtenstein, Vienne
Guerchin, 1615-20, Collection Prince du Liechtenstein, Vienne Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City
Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City Matthys Voet, 1617-18, collection particulière
Matthys Voet, 1617-18, collection particulière Tanzio da Varallo, 1627, Chapelle de l’Ange gardien, Basilica San Gaudenzio, Novare
Tanzio da Varallo, 1627, Chapelle de l’Ange gardien, Basilica San Gaudenzio, Novare Astolfo Petrazzi, 1630-53, Pinacoteca di Siena
Astolfo Petrazzi, 1630-53, Pinacoteca di Siena Jeronimo Jacinto de Espinosa, vers 1640, Real Parroquia de San Andres, Valence
Jeronimo Jacinto de Espinosa, vers 1640, Real Parroquia de San Andres, Valence Matteo Rosselli, vers 1640, collection particulière
Matteo Rosselli, vers 1640, collection particulière Everard Quirinsz. van der Maes, avant 1640, Musée Sainte-Croix de Poitiers (photo Alienor.org)
Everard Quirinsz. van der Maes, avant 1640, Musée Sainte-Croix de Poitiers (photo Alienor.org) François Perrier, vers 1640, collection particulière, en dépôt à Saint-Cloud, musée du Grand Siècle
François Perrier, vers 1640, collection particulière, en dépôt à Saint-Cloud, musée du Grand Siècle Guillaume Courtois, 1660-69, National Trust
Guillaume Courtois, 1660-69, National Trust Gilles Garcin, 1682, église Saint-Nicolas, Pertuis (photo Atelier Gaillandre)
Gilles Garcin, 1682, église Saint-Nicolas, Pertuis (photo Atelier Gaillandre)
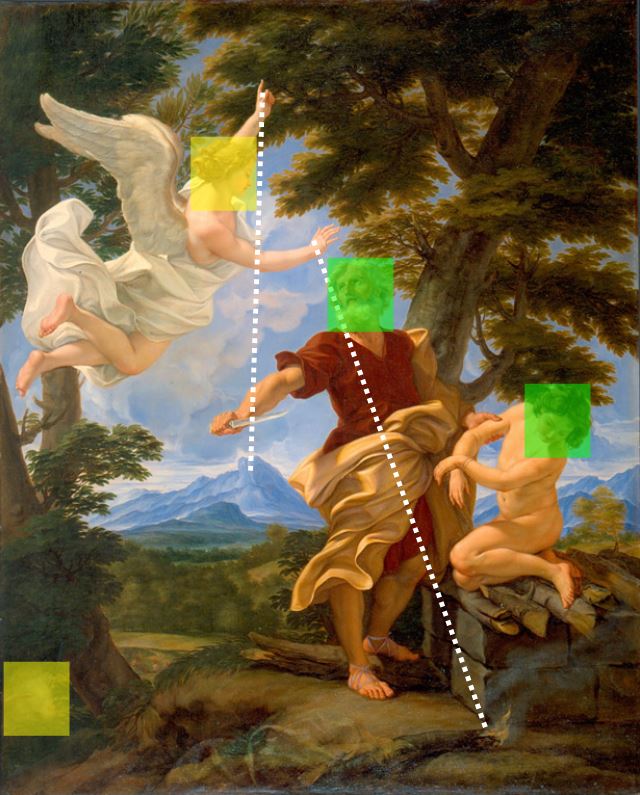
 Donato Creti (école), 1700-20, collection particulère
Donato Creti (école), 1700-20, collection particulère Giambattista Lama, vers 1717, Kunsthistorisches Museum, Vienne
Giambattista Lama, vers 1717, Kunsthistorisches Museum, Vienne Le Sacrifice d’Isaac
Le Sacrifice d’Isaac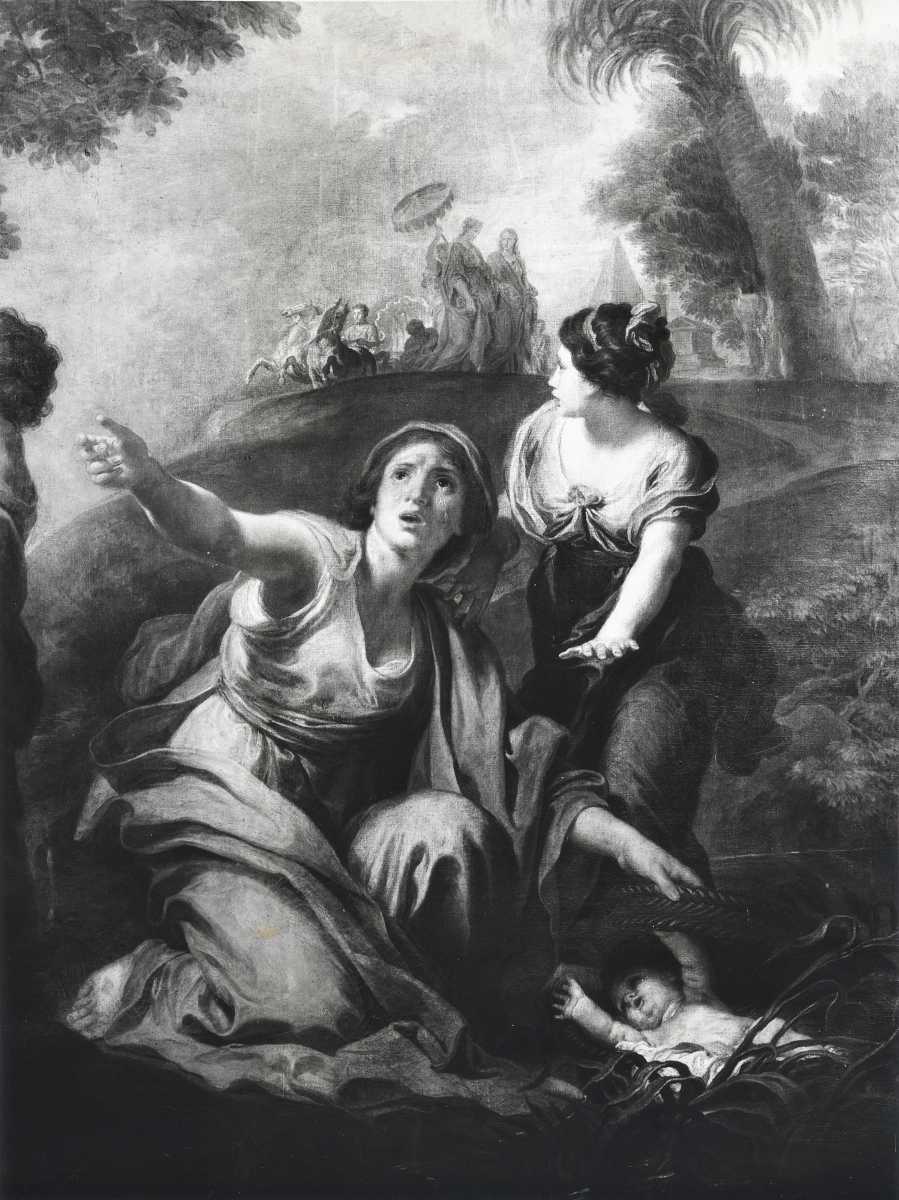 Moïse sauvé des eaux (fototeca Zeri)
Moïse sauvé des eaux (fototeca Zeri)
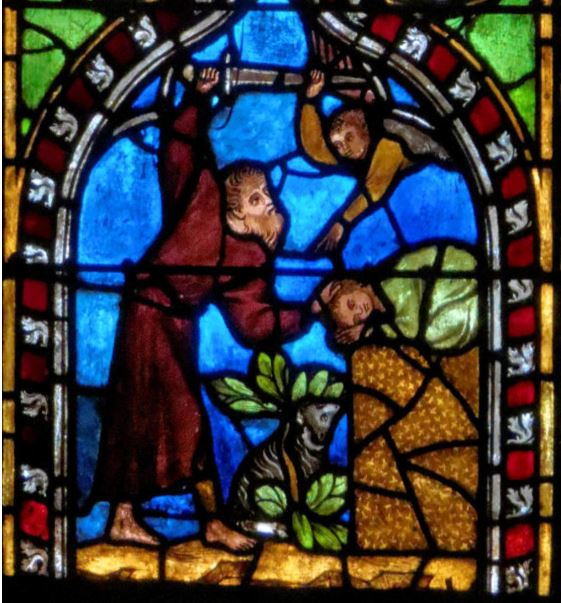 Vers 1350, église Saint Martin, Colmar
Vers 1350, église Saint Martin, Colmar Speculum humanae salvationis, 1432 Madrid, Biblioteca Nacional de Espana → Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 21v
Speculum humanae salvationis, 1432 Madrid, Biblioteca Nacional de Espana → Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 21v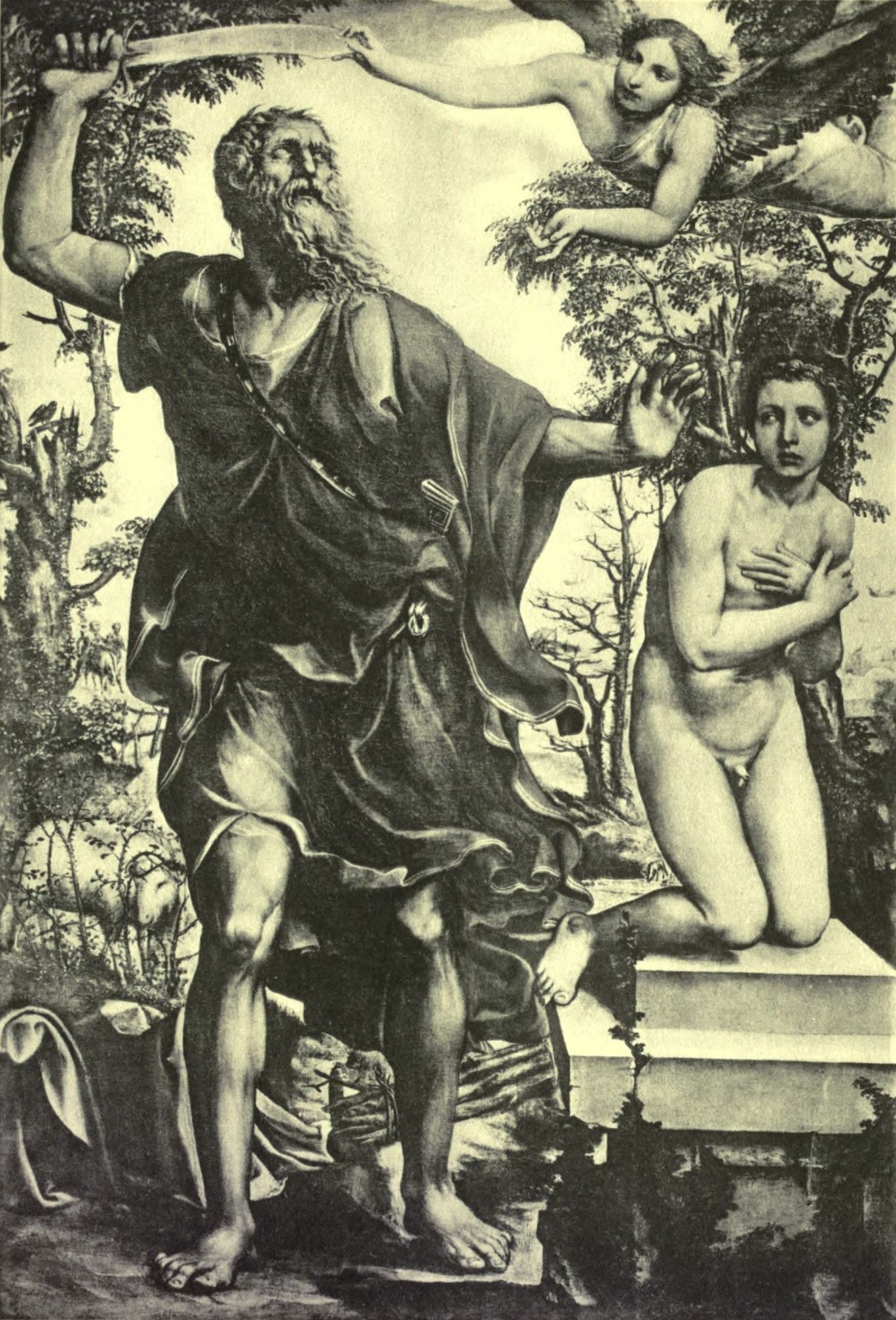 Sodoma, 1540-42, Cattedrale di S. Maria Assunta, Pise
Sodoma, 1540-42, Cattedrale di S. Maria Assunta, Pise Alessandro Allori, 1583, Diocese de Florence
Alessandro Allori, 1583, Diocese de Florence Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani
Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani Camillo Procaccini, vers 1600, Residenzgalerie, Salzburg
Camillo Procaccini, vers 1600, Residenzgalerie, Salzburg 1626, collection particulière
1626, collection particulière 1650, Detroit_Institute_of_Arts
1650, Detroit_Institute_of_Arts Carlo-Francesco et Giuseppe Nuvolone, 1648-52, Santuario del rosario, Vimercate
Carlo-Francesco et Giuseppe Nuvolone, 1648-52, Santuario del rosario, Vimercate Antoine Coypel, 1721, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing
Antoine Coypel, 1721, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing

 Antonio Vassilacchi, dit l’Aliense, vers 1590, San Zaccaria, Venise
Antonio Vassilacchi, dit l’Aliense, vers 1590, San Zaccaria, Venise Giovan Battista Vanni, 1620-60, Musée des Beaux Arts, Chambéry
Giovan Battista Vanni, 1620-60, Musée des Beaux Arts, Chambéry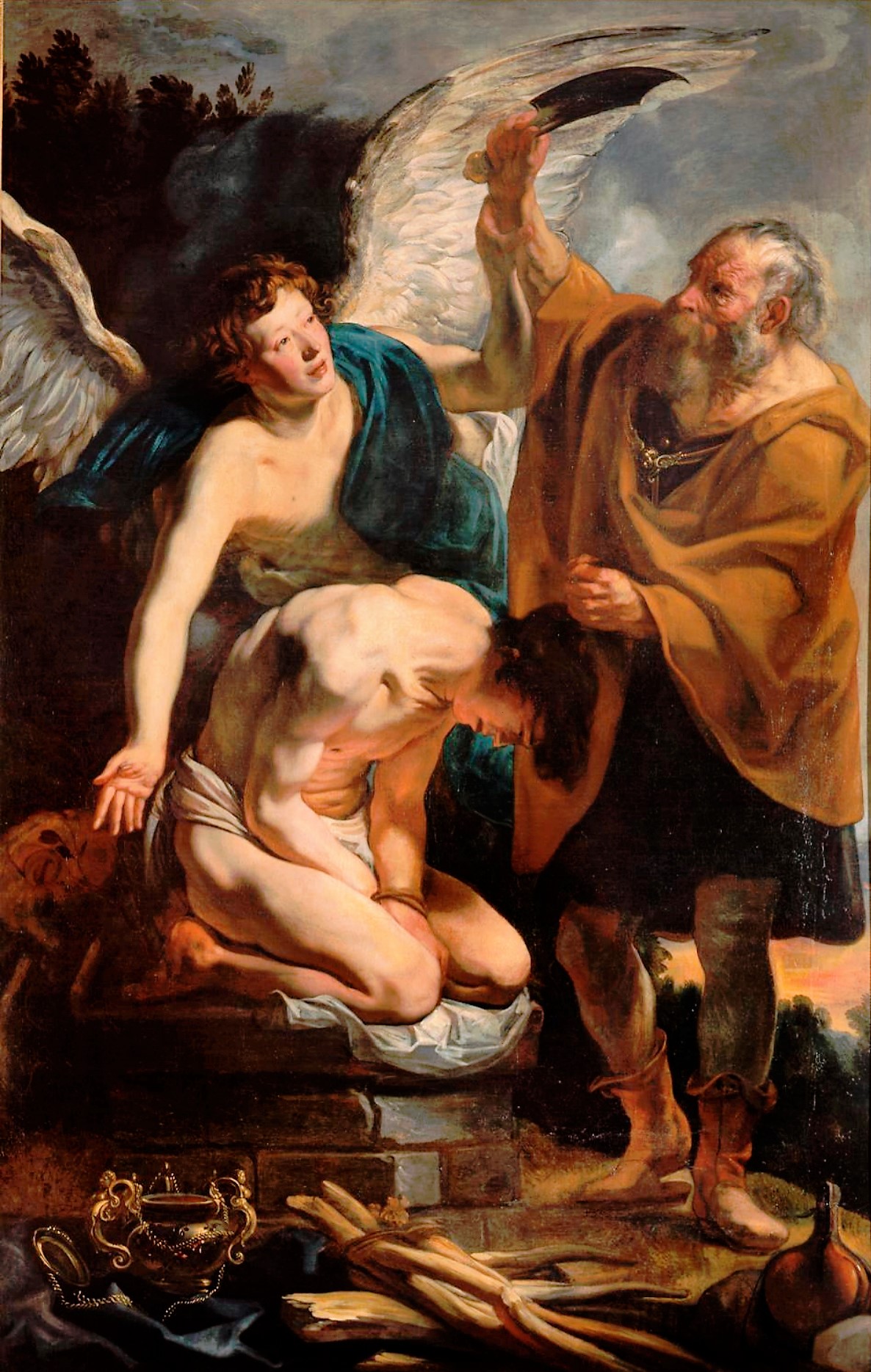
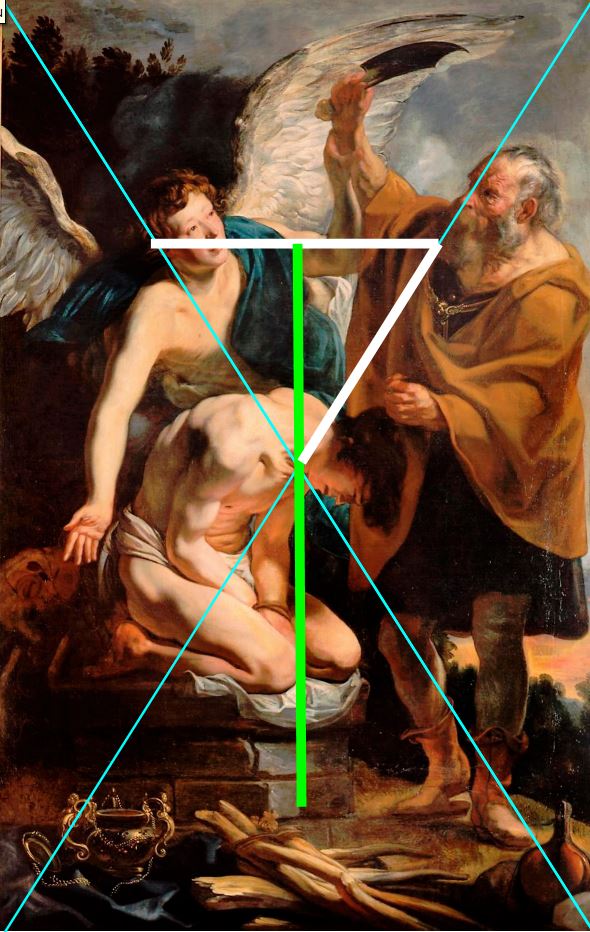

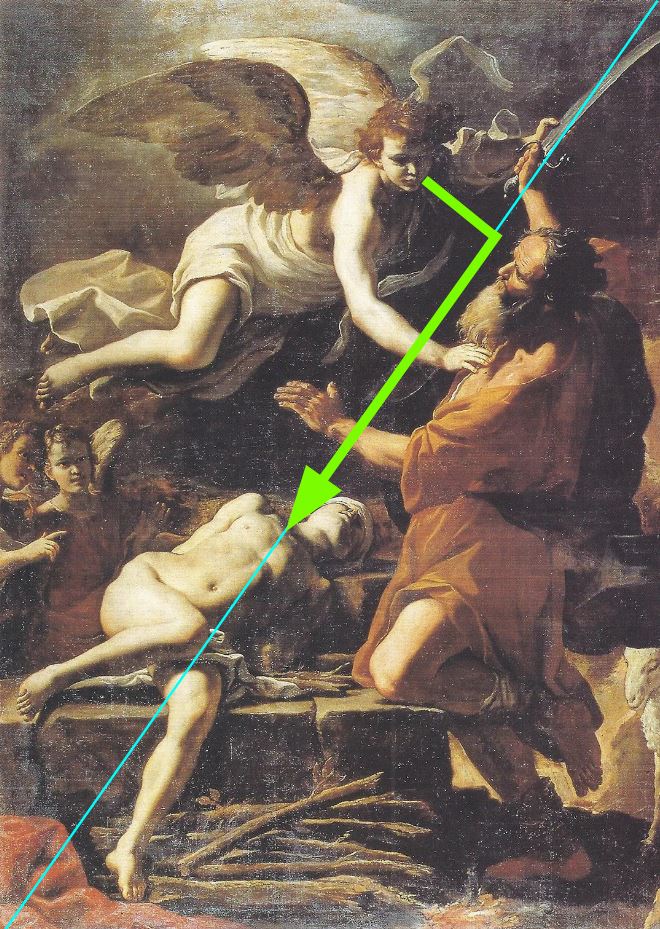
 Anton Losenko, 1765, Musée Russe, Saint Pétersbourg
Anton Losenko, 1765, Musée Russe, Saint Pétersbourg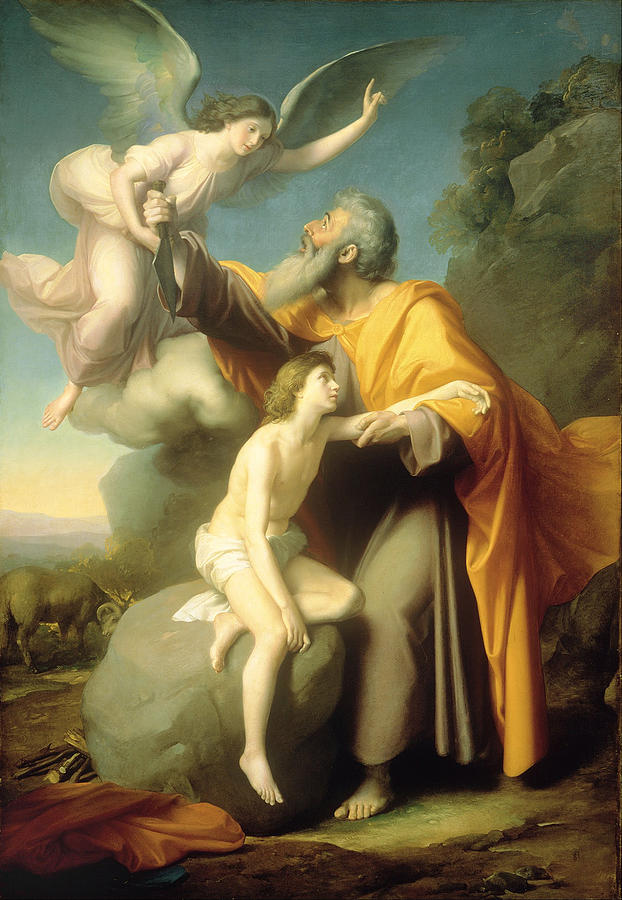 Santiago Rebull, 1857, Museo Nacional de Arte Mexico
Santiago Rebull, 1857, Museo Nacional de Arte Mexico Fred Appleyard, 1913, « Lay Not Thy Hand Upon the Lad », collection particulière
Fred Appleyard, 1913, « Lay Not Thy Hand Upon the Lad », collection particulière Pompeo Batoni, vers 1750, Strahov Monastery Prague.
Pompeo Batoni, vers 1750, Strahov Monastery Prague.
 Donatello, 1419-21, Museo dell’Opera del Duomo, Florence
Donatello, 1419-21, Museo dell’Opera del Duomo, Florence La tentation d’Adam et Eve
La tentation d’Adam et Eve Le sacrifice d’Isaac
Le sacrifice d’Isaac Raphaël, 1514, Chambre d’Héliodore, Vatican
Raphaël, 1514, Chambre d’Héliodore, Vatican Agostino Veneziano d’après Jules Romain, 1516–18, MET
Agostino Veneziano d’après Jules Romain, 1516–18, MET Cornelis Galle l’Ancien, vers 1630, British Museum, 1891,0414.546
Cornelis Galle l’Ancien, vers 1630, British Museum, 1891,0414.546 Le Dominicain, 1627-28, Prado
Le Dominicain, 1627-28, Prado Antonio Gonzalez Velazquez, 1743-1793, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid
Antonio Gonzalez Velazquez, 1743-1793, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid Andrea del Sarto, 1529, Prado
Andrea del Sarto, 1529, Prado Battista Franco (attr), 1540–60, MET
Battista Franco (attr), 1540–60, MET

 Ludovico Cardi , 1605-07, Palazzo Pitti
Ludovico Cardi , 1605-07, Palazzo Pitti Le Sacrifice d’Isaac
Le Sacrifice d’Isaac Agar et l’ange
Agar et l’ange

 Daniele Crespi, 1620-30, collection particulière
Daniele Crespi, 1620-30, collection particulière Giovanni Battista Benaschi, 1656-88, Musée des Beaux Arts, Brest
Giovanni Battista Benaschi, 1656-88, Musée des Beaux Arts, Brest Daniel Saiter (Seiter), 1662-1705, collection particulière
Daniel Saiter (Seiter), 1662-1705, collection particulière




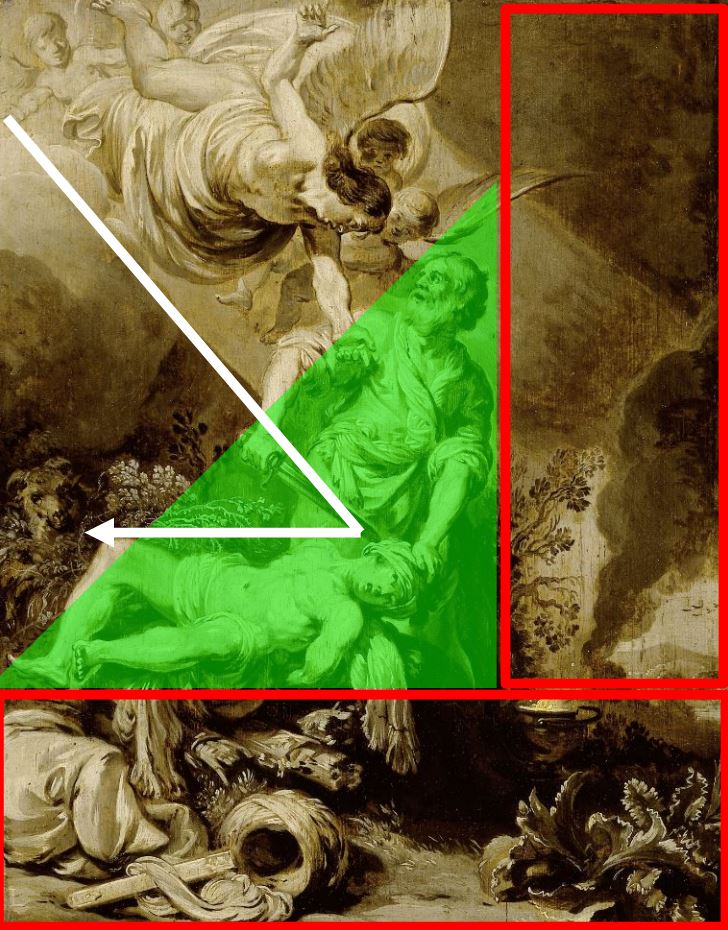
 Pieter Lastman, 1616, Louvre
Pieter Lastman, 1616, Louvre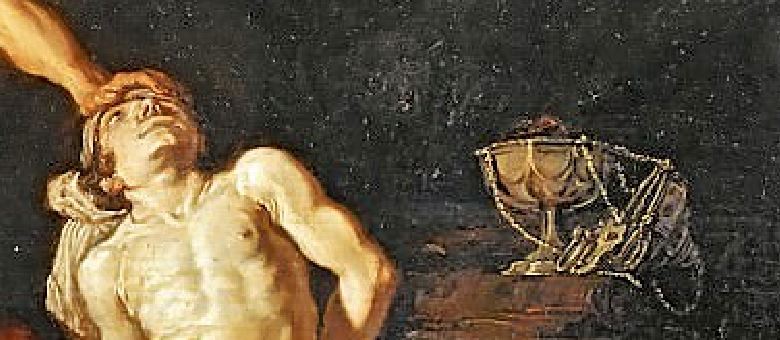
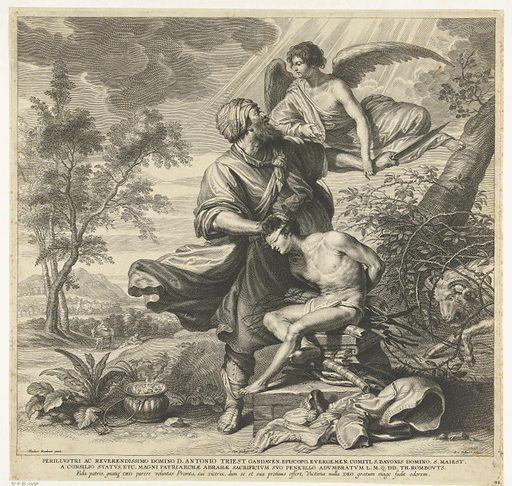 Schelte (Adamsz Bolswer) d’après Theodoor Rombouts, Rijksmuseum
Schelte (Adamsz Bolswer) d’après Theodoor Rombouts, Rijksmuseum Ecole anglaise, 1674, National Trust
Ecole anglaise, 1674, National Trust Rembrandt, 1635, Ermitage
Rembrandt, 1635, Ermitage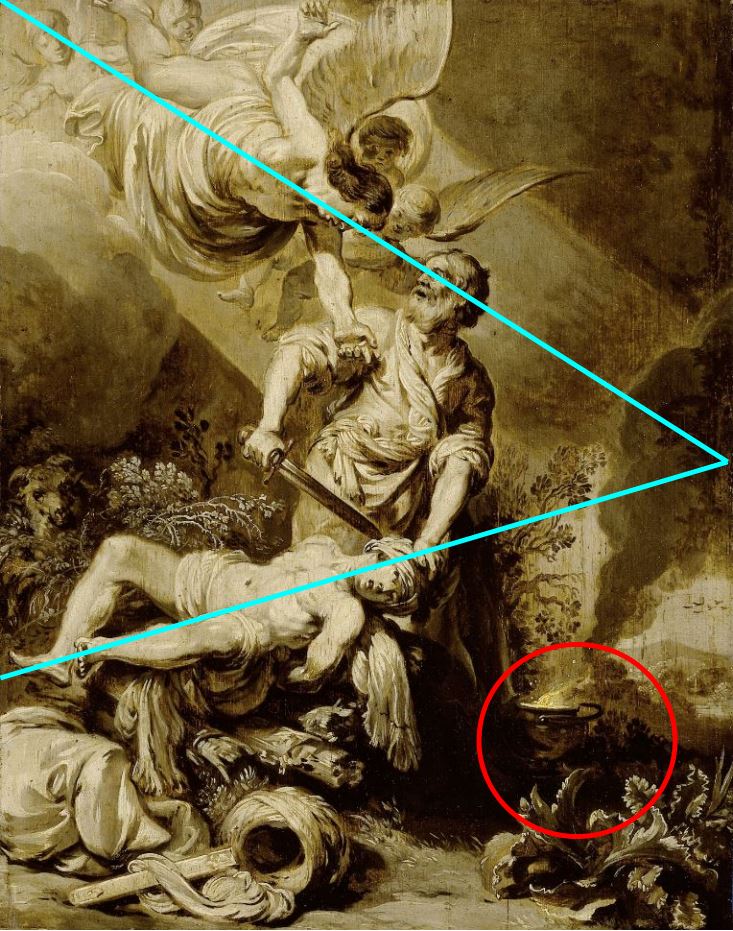
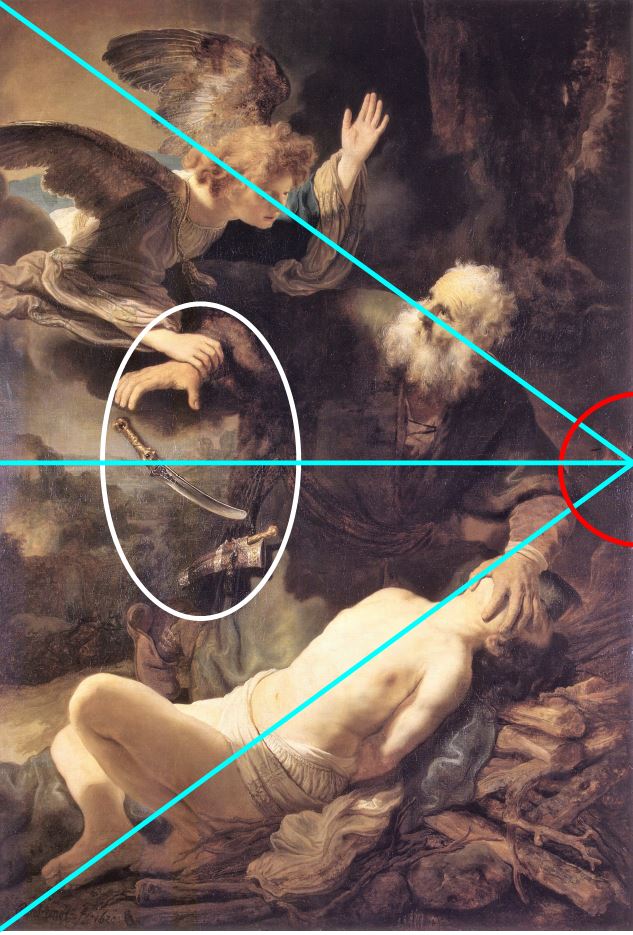

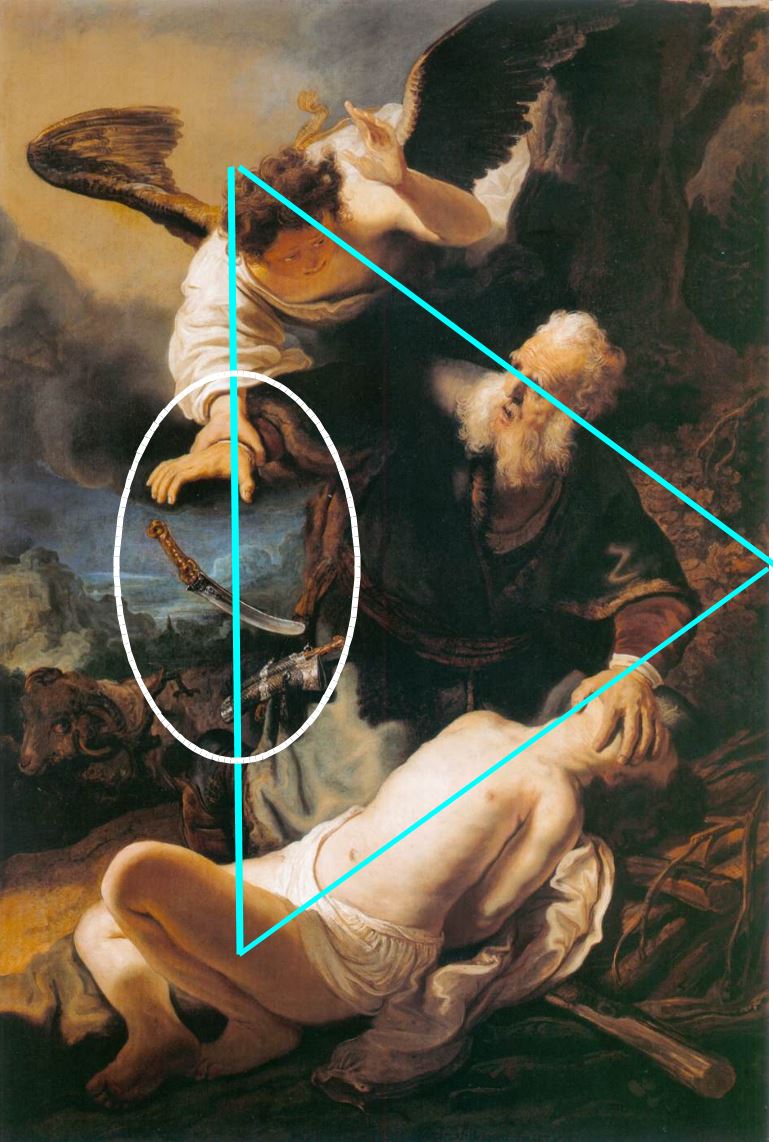
 Ferdinand Bol, 1646, Museo di Palazzo Mansi, Lucca
Ferdinand Bol, 1646, Museo di Palazzo Mansi, Lucca
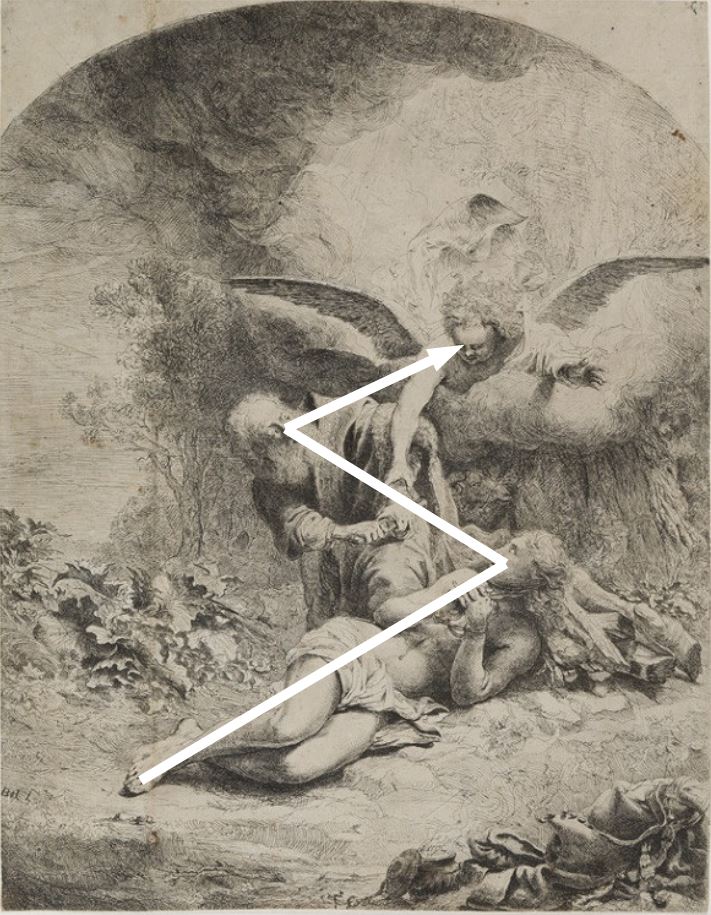
 Jan Lievens, 1643, musée des Beaux-Arts, Tel Aviv
Jan Lievens, 1643, musée des Beaux-Arts, Tel Aviv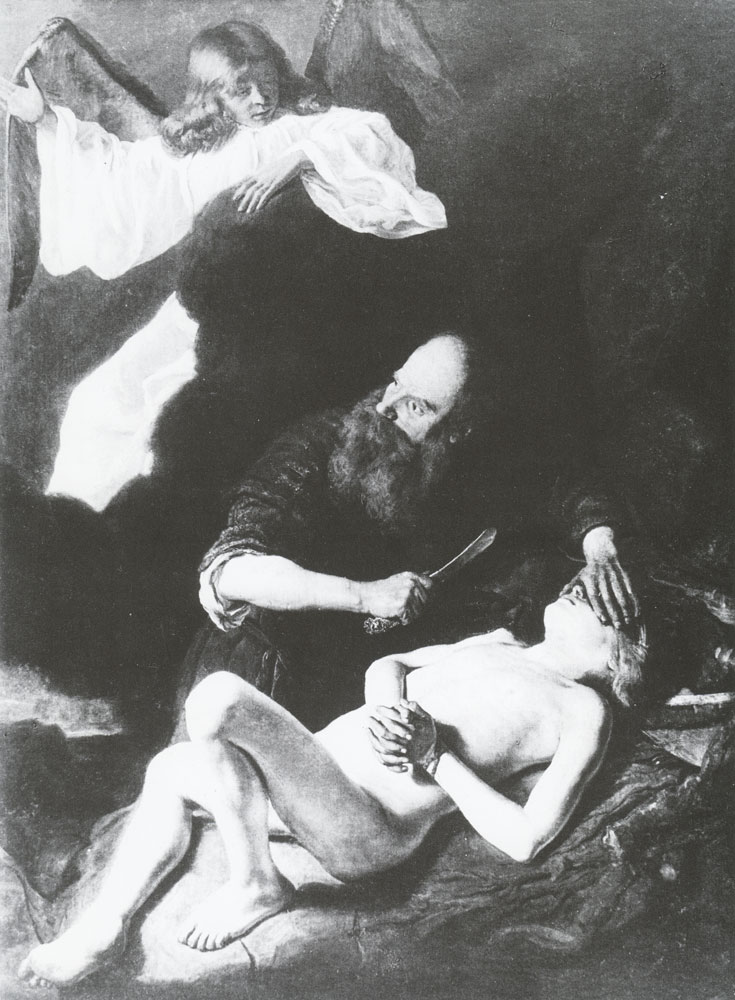 Anonyme rembranesque, collection particulière
Anonyme rembranesque, collection particulière Govert Flinck, 1649, collection particulière
Govert Flinck, 1649, collection particulière Gravure, 1655 (inversée)
Gravure, 1655 (inversée) 1659, Hedingham castle
1659, Hedingham castle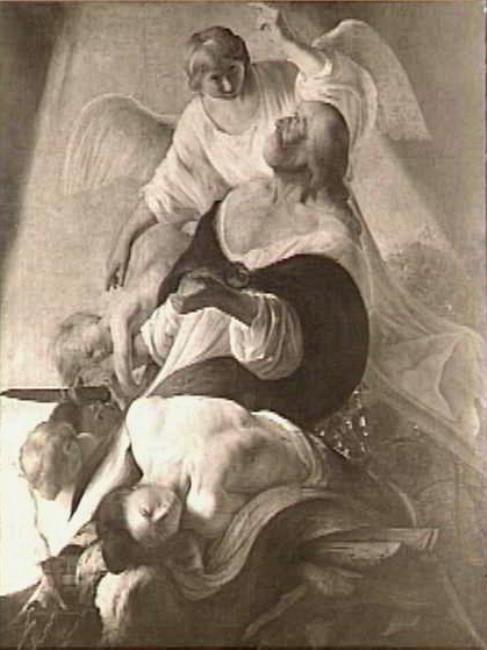 Paulus Bor (attr) 1616-69, collection particulière (photo rkd)
Paulus Bor (attr) 1616-69, collection particulière (photo rkd)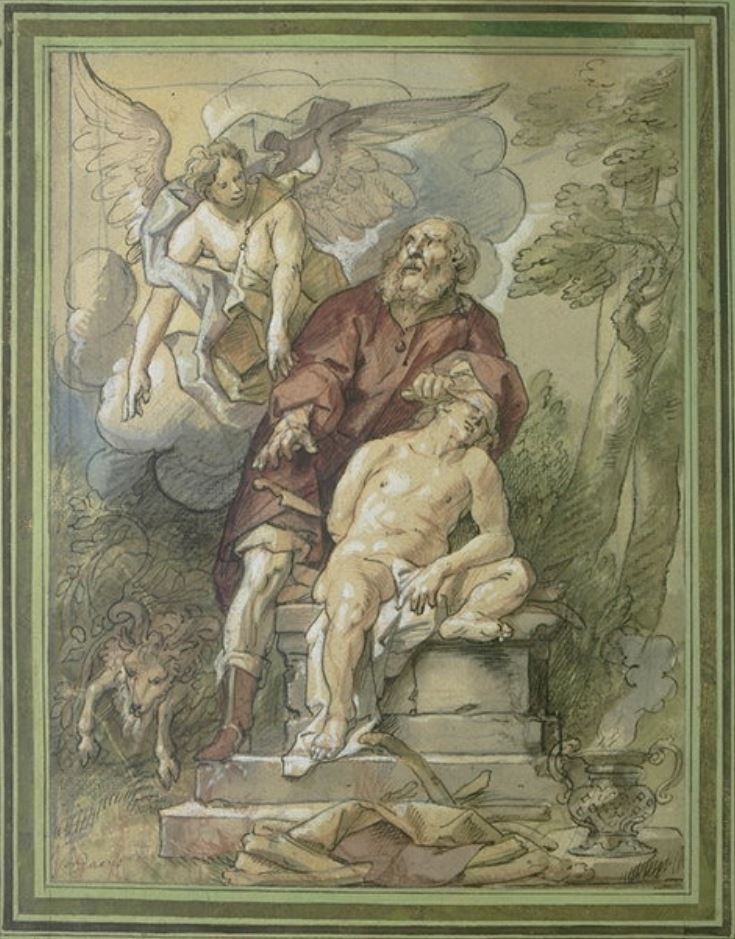 Dessin, Louvre
Dessin, Louvre St Lorenz, Lübeck
St Lorenz, Lübeck Philippe de Champaigne, 1633-35, collection particulière
Philippe de Champaigne, 1633-35, collection particulière Charles Le Brun, vers 1650, collection particulière
Charles Le Brun, vers 1650, collection particulière Hilaire Pader, vers 1660, Cathédrale St Etienne de Toulouse (Photo Christian Attard)
Hilaire Pader, vers 1660, Cathédrale St Etienne de Toulouse (Photo Christian Attard) Alessandro Magnasco, 1687-1749, collection particulière
Alessandro Magnasco, 1687-1749, collection particulière Anonyme, 18ème, Propriété municipale, Reggio di Calabria
Anonyme, 18ème, Propriété municipale, Reggio di Calabria Livio Retti, 1736-38, Schwäbisch Hall, Mairie, Mur de la Salle du Conseil
Livio Retti, 1736-38, Schwäbisch Hall, Mairie, Mur de la Salle du Conseil



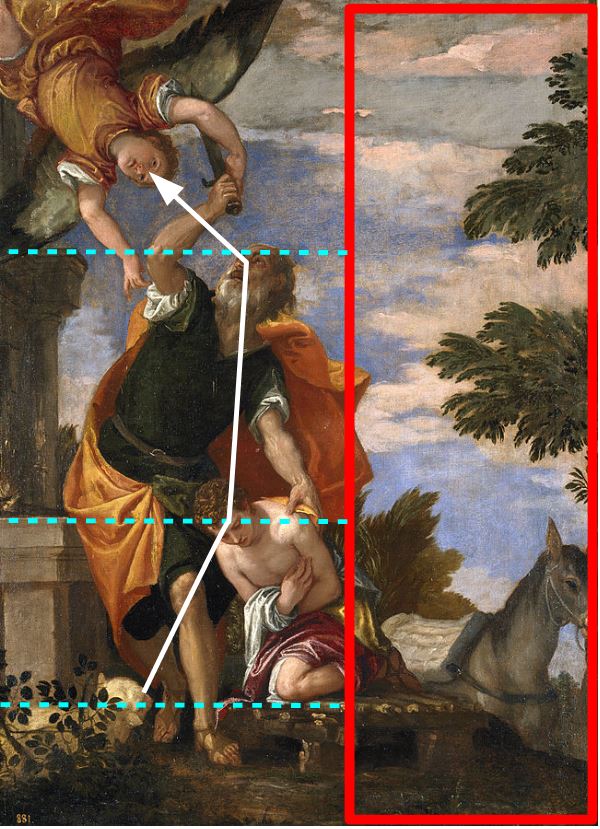
 Véronèse, 1580-86, Kunsthistorisches Museum, Vienne
Véronèse, 1580-86, Kunsthistorisches Museum, Vienne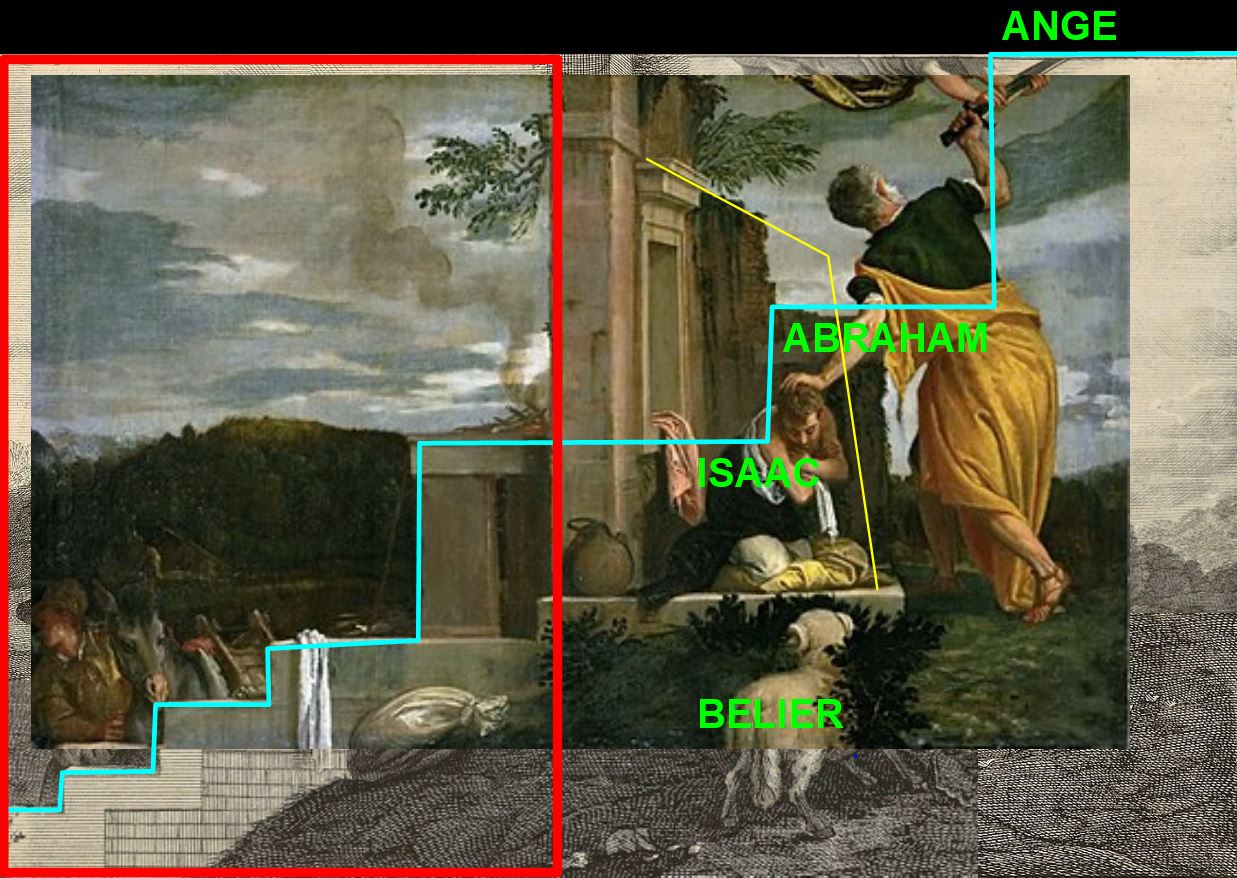
 Suiveur de Jacob de Backer, vers 1600, collection particulière
Suiveur de Jacob de Backer, vers 1600, collection particulière Paolo de Matteis, 1682-1728, collection particulière
Paolo de Matteis, 1682-1728, collection particulière Johann Christoph Storer (attr), 1782, Bavarian State Painting Collections
Johann Christoph Storer (attr), 1782, Bavarian State Painting Collections Battistello da Caracciolo, 1615-20, Musée Pouchkine, Moscou.
Battistello da Caracciolo, 1615-20, Musée Pouchkine, Moscou.
 Battistello da Caracciolo, vers 1620, Dundee Art Gallery and Museum
Battistello da Caracciolo, vers 1620, Dundee Art Gallery and Museum Gérard Seghers (attr), 1610-50, collection particulière
Gérard Seghers (attr), 1610-50, collection particulière Peter Thijs (attr), 1639-77, collection particulière
Peter Thijs (attr), 1639-77, collection particulière Simon Vouet et Pierre Patel, vers 1642, Milwaukee Art Museum
Simon Vouet et Pierre Patel, vers 1642, Milwaukee Art Museum 1640-50, Museum Catharijneconvent, Utrecht
1640-50, Museum Catharijneconvent, Utrecht 1647, National Museum Stockholm
1647, National Museum Stockholm
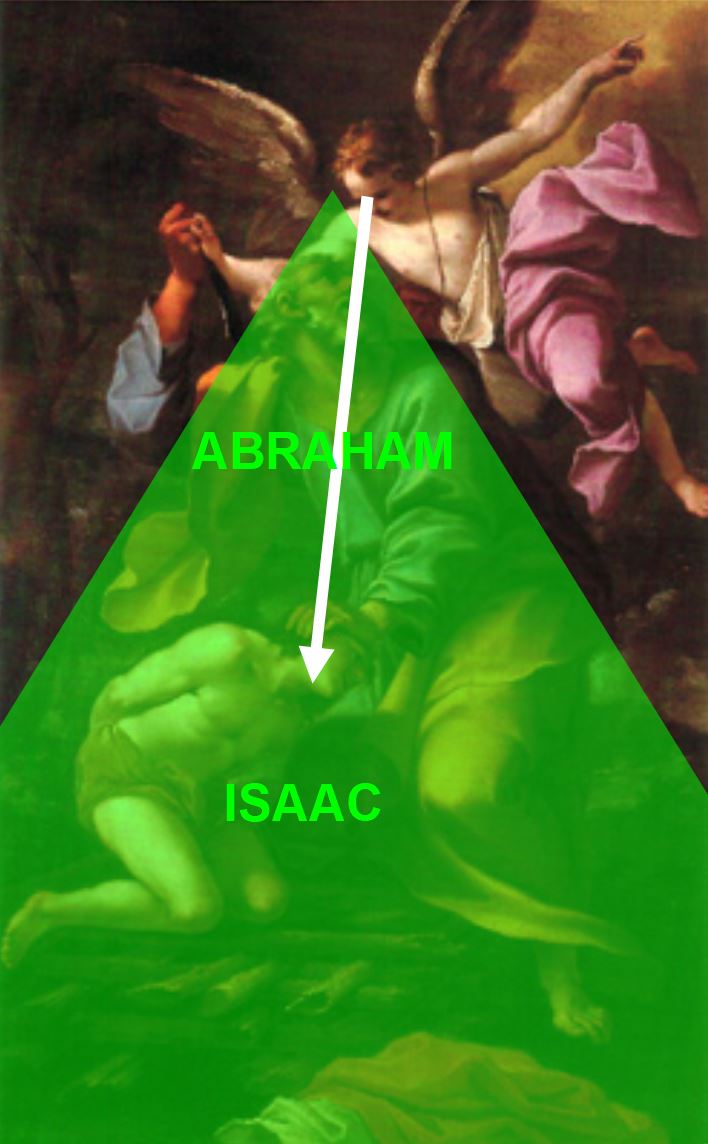
 Caravage, 1597-1603, Offices
Caravage, 1597-1603, Offices Judith décapitant Holopherne (inversé), Caravage, 1598–99, Galerie nationale d’art ancien, Rome
Judith décapitant Holopherne (inversé), Caravage, 1598–99, Galerie nationale d’art ancien, Rome
 Il expédie à la va-vite cette échappée, sans doute une exigence du commanditaire. Et par goût de l’énigme, il réduit à la taille d’un point les deux serviteurs exigés par la narration, et évoque l’âne par deux feuilles perdues dans l’ombre.
Il expédie à la va-vite cette échappée, sans doute une exigence du commanditaire. Et par goût de l’énigme, il réduit à la taille d’un point les deux serviteurs exigés par la narration, et évoque l’âne par deux feuilles perdues dans l’ombre. Un détail du paysage lui permet néanmoins de servir la dramaturgie : la branche coupée, en écho au couteau.
Un détail du paysage lui permet néanmoins de servir la dramaturgie : la branche coupée, en écho au couteau.
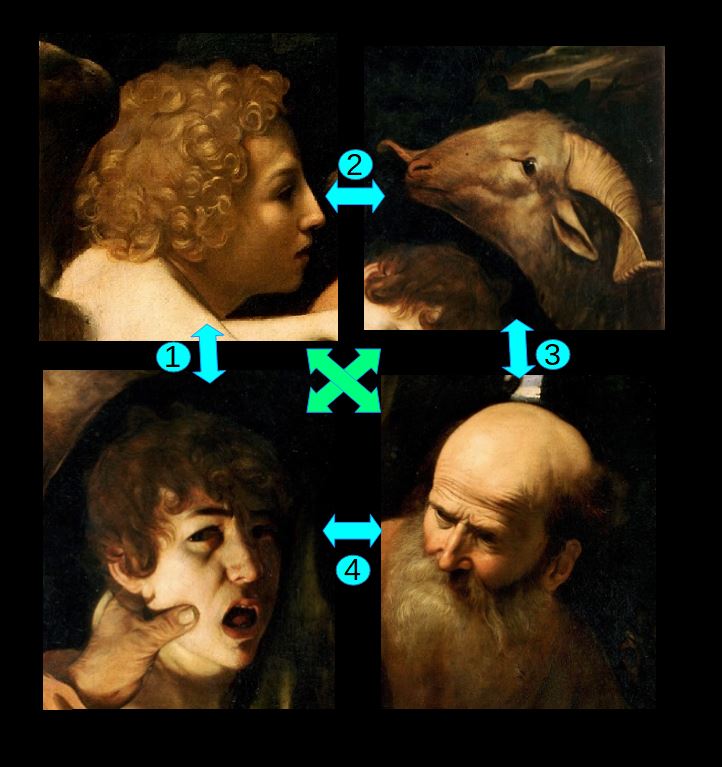
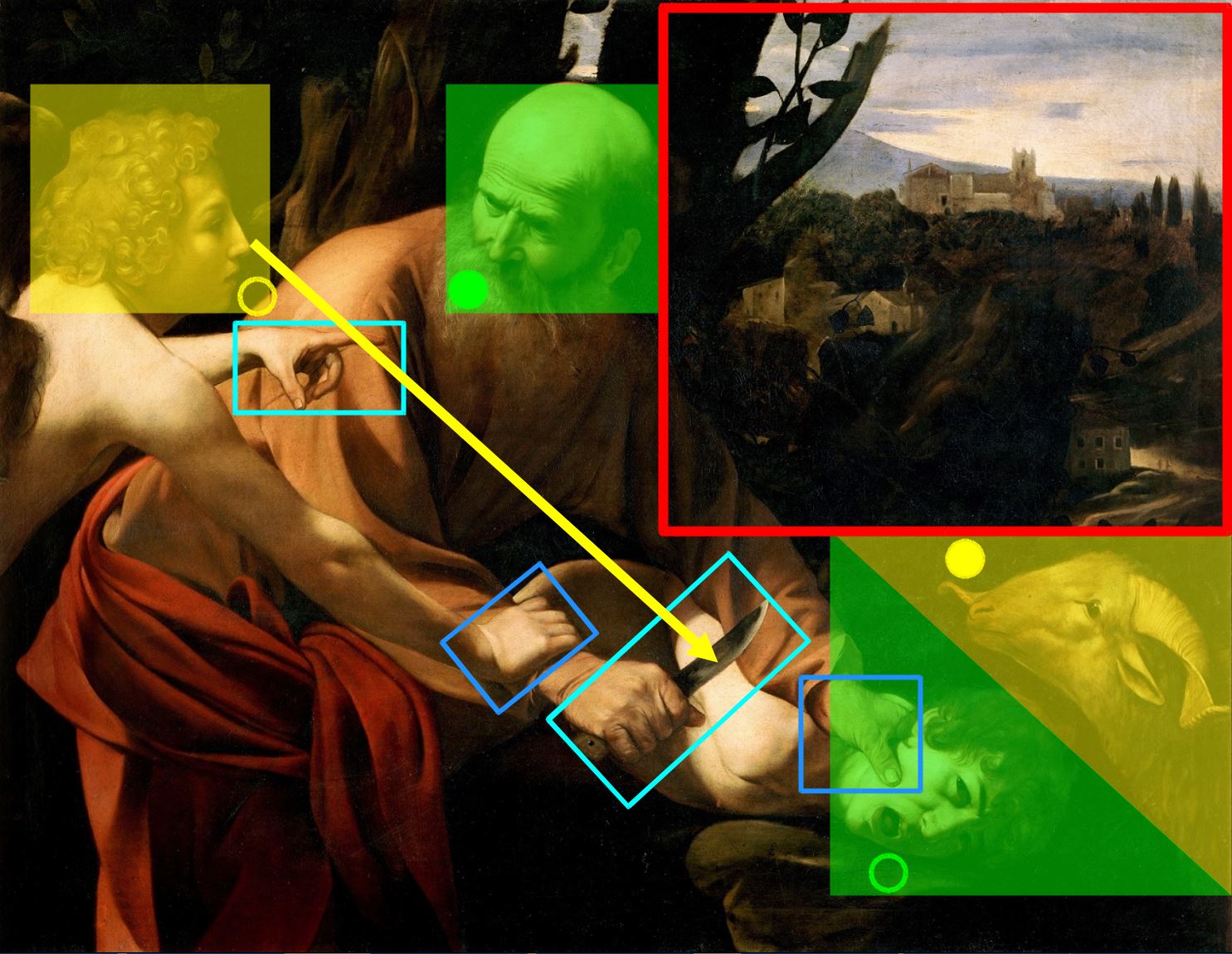
 Orazio Gentileschi, vers 1612, Genova, Palazzo Spinola, Gênes
Orazio Gentileschi, vers 1612, Genova, Palazzo Spinola, Gênes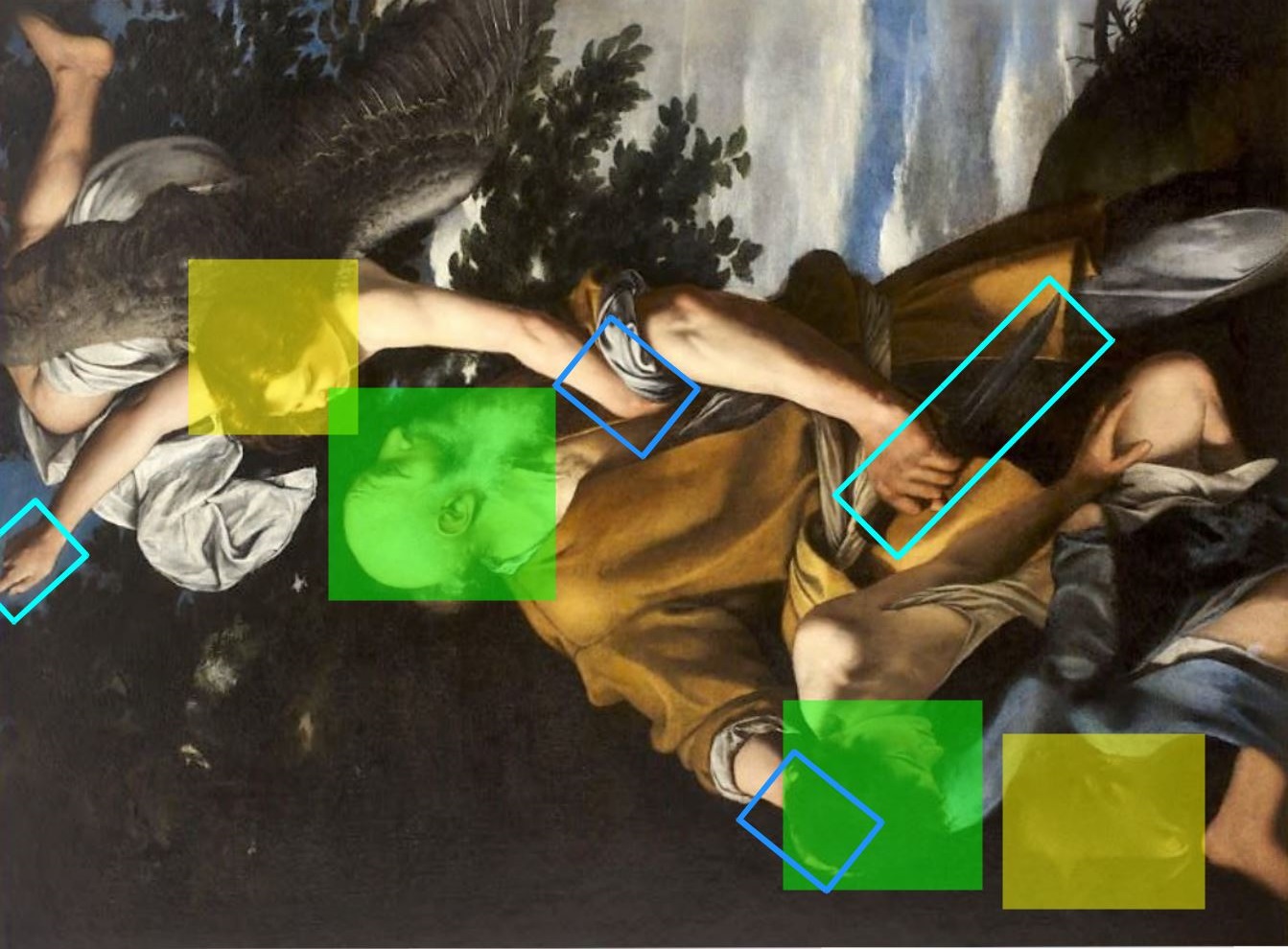 Il suffit de faire pivoter le tableau pour constater tout ce que la composition doit à Caravage, notamment dans l’alternance de mains. La seule différence est qu’ici l’ange pointe le ciel, alors que ches Caravage il pointait le bélier.
Il suffit de faire pivoter le tableau pour constater tout ce que la composition doit à Caravage, notamment dans l’alternance de mains. La seule différence est qu’ici l’ange pointe le ciel, alors que ches Caravage il pointait le bélier.
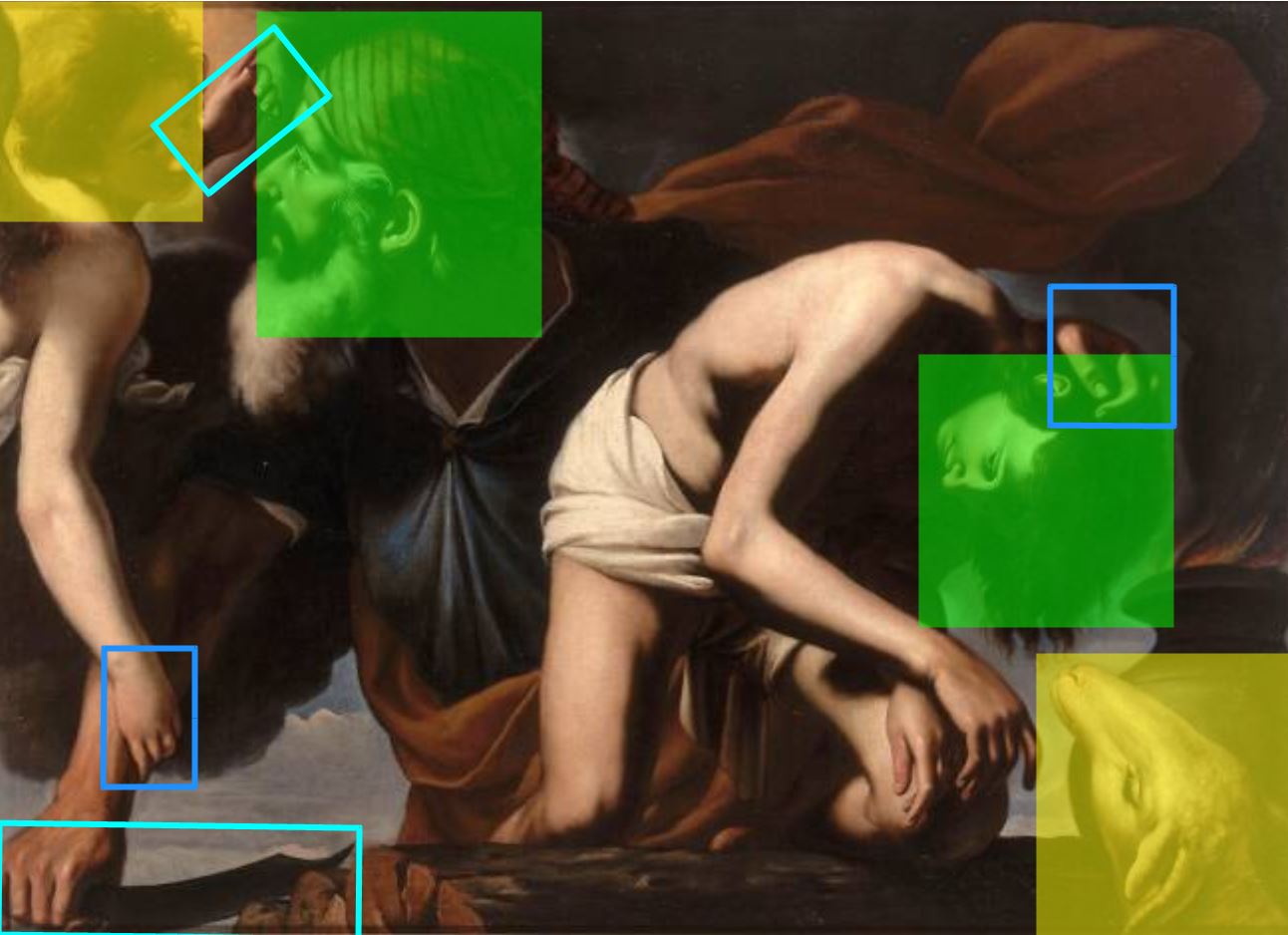

 D. Bernardus, vers 1630, Musée d’Art et d’Histoire, Genève
D. Bernardus, vers 1630, Musée d’Art et d’Histoire, Genève Giovanni Antonio Galli (Lo Spadarino), vers 1650, Museo Collezione Gianfranco Luzzetti
Giovanni Antonio Galli (Lo Spadarino), vers 1650, Museo Collezione Gianfranco Luzzetti


 Sans entrer dans la querelle, on peut verser au dossier le détail extrêmement rare du reflet dans le couteau, qui montre ici le museau du bélier tirant la langue par derrière. Si le tableau n’est pas de Caravage, il est clair que Cavarozzi avait observé de très près la version Florence, et en avait saisi les intentions, même les plus discrètes.
Sans entrer dans la querelle, on peut verser au dossier le détail extrêmement rare du reflet dans le couteau, qui montre ici le museau du bélier tirant la langue par derrière. Si le tableau n’est pas de Caravage, il est clair que Cavarozzi avait observé de très près la version Florence, et en avait saisi les intentions, même les plus discrètes.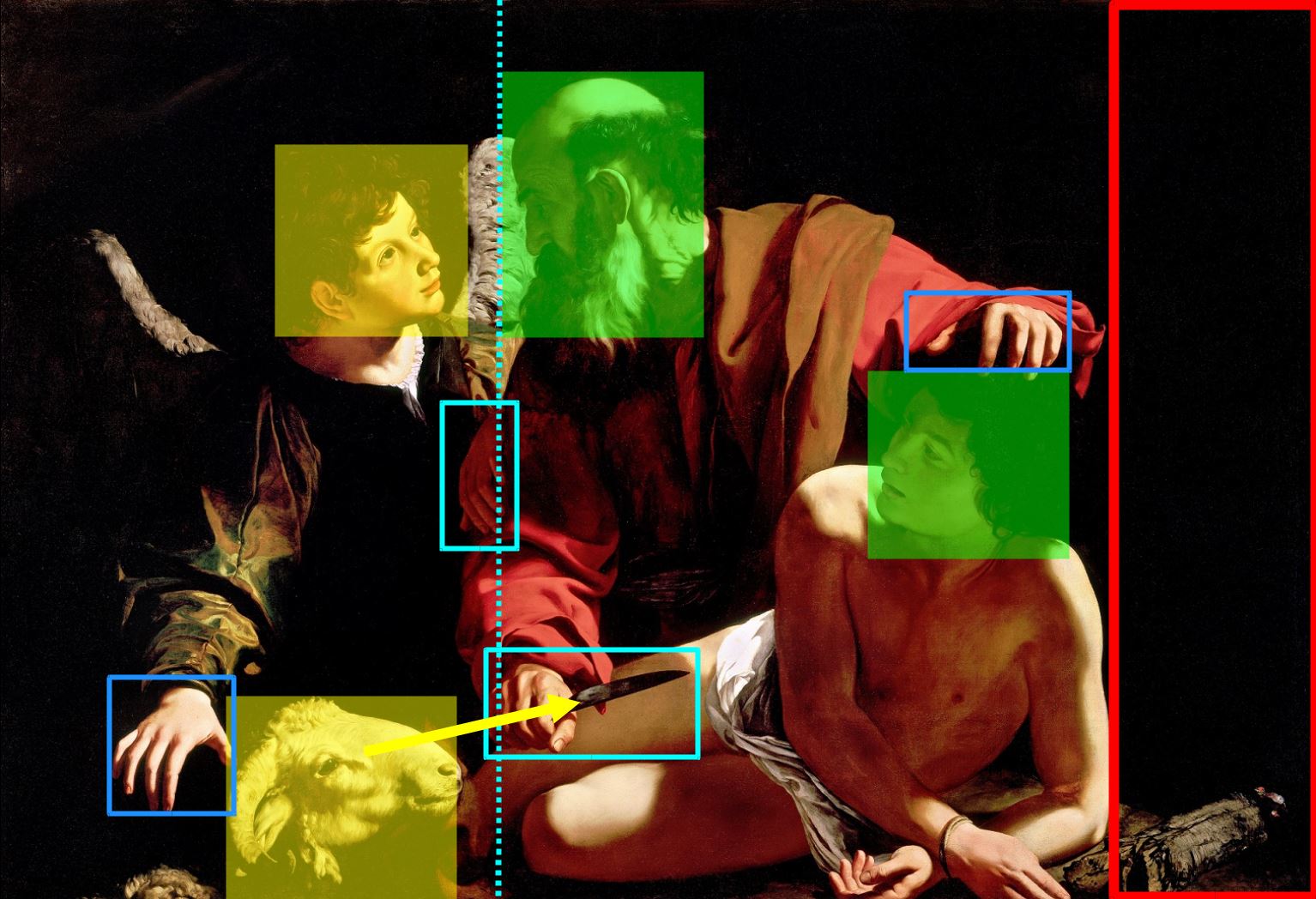


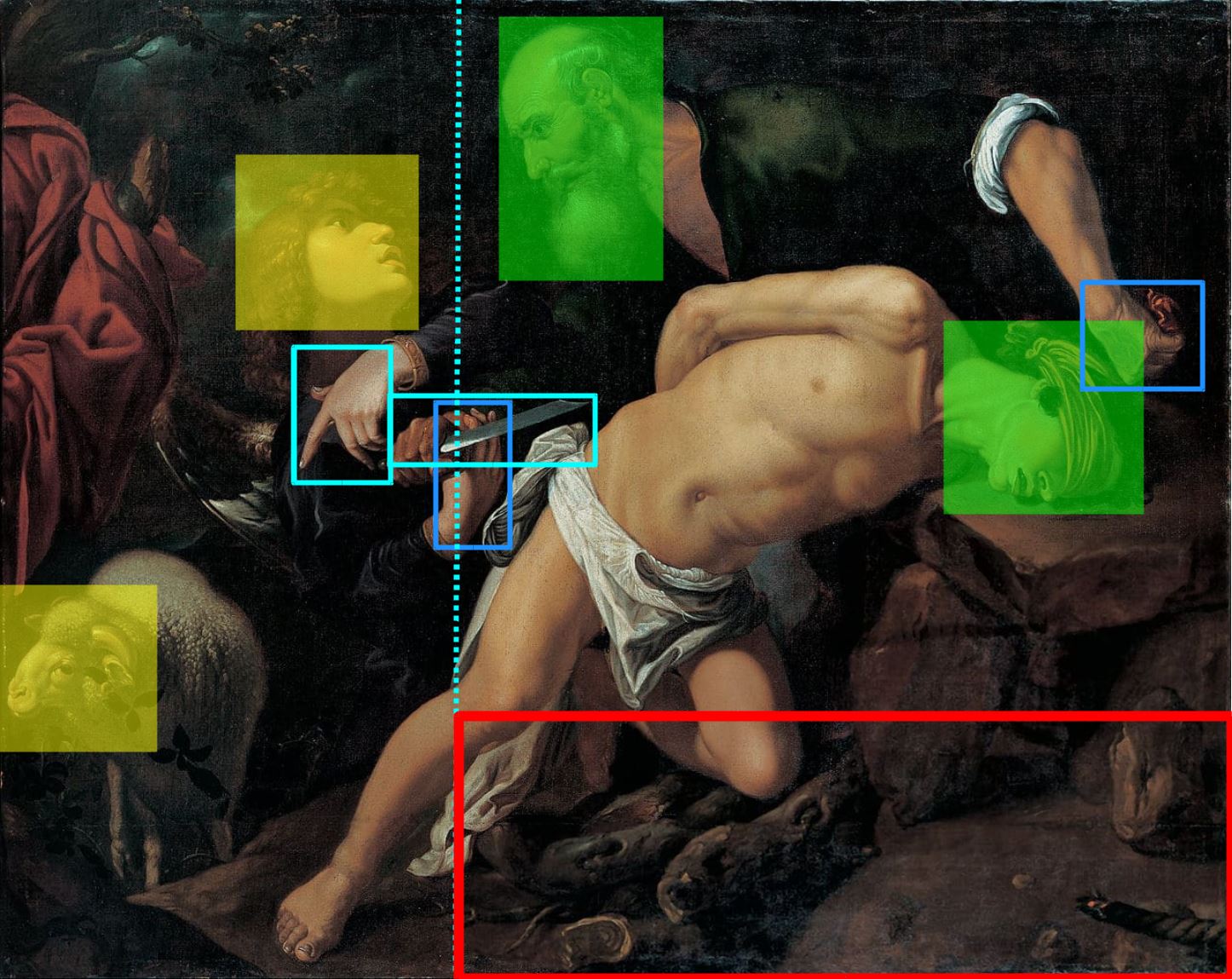
 Filippo Vitale, 1615-20, Capodimonte
Filippo Vitale, 1615-20, Capodimonte Valentin de Boulogne, 1630-32, Musée des Beaux Arts, Montréal
Valentin de Boulogne, 1630-32, Musée des Beaux Arts, Montréal
 Carlone Giovanni Battista (attr), 1649-97, Musée de Picardie (Photo Marc Jeanneteau).
Carlone Giovanni Battista (attr), 1649-97, Musée de Picardie (Photo Marc Jeanneteau). Bernhard Keil (Monsu Bernardo), 1636-87, collection particulière
Bernhard Keil (Monsu Bernardo), 1636-87, collection particulière Ecole italienne, 1650-1700, collection particulière
Ecole italienne, 1650-1700, collection particulière Giambattista Mengardi, 18ème siècle, église paroissiale de Lupia
Giambattista Mengardi, 18ème siècle, église paroissiale de Lupia
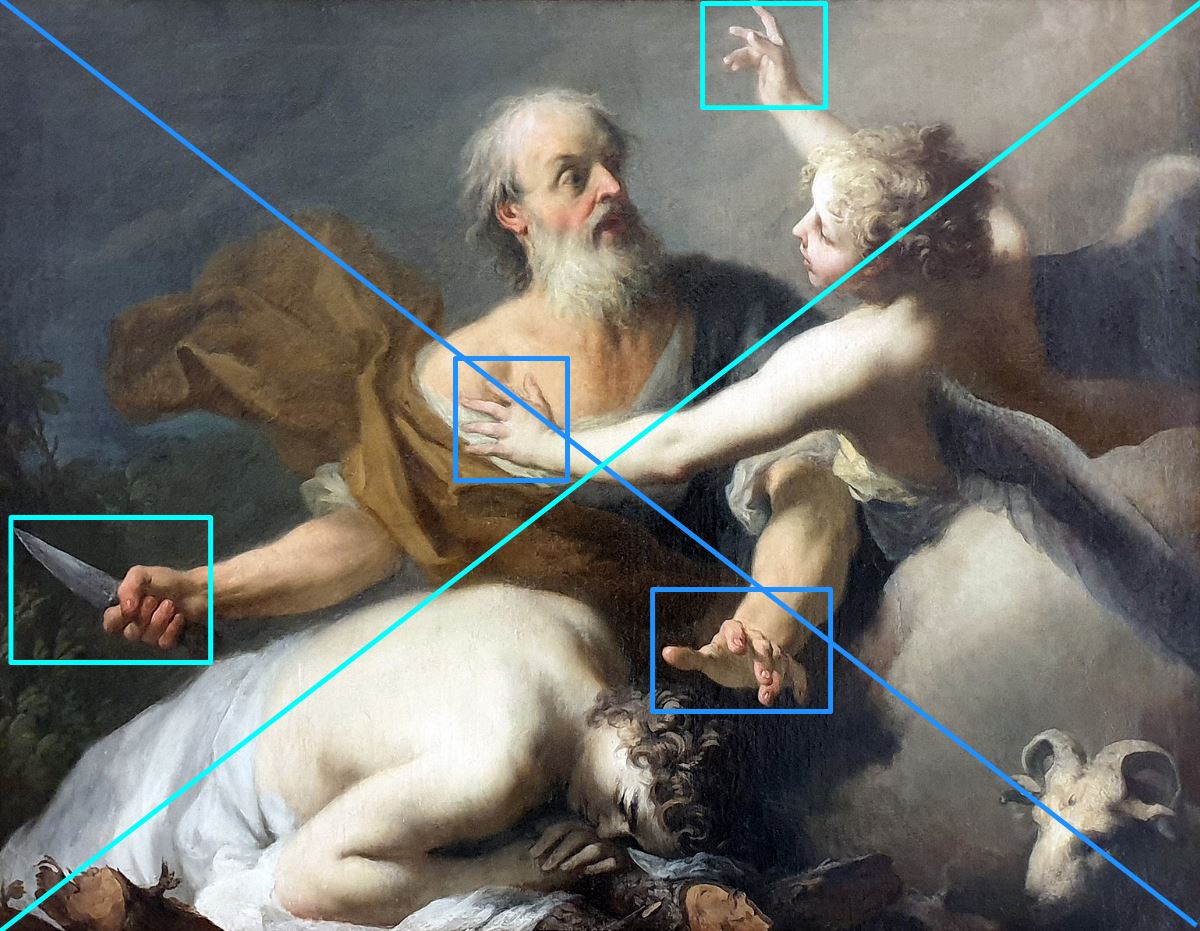

 Collection particulière
Collection particulière






 Collection Colnaghi, Londres
Collection Colnaghi, Londres Collection particulière
Collection particulière
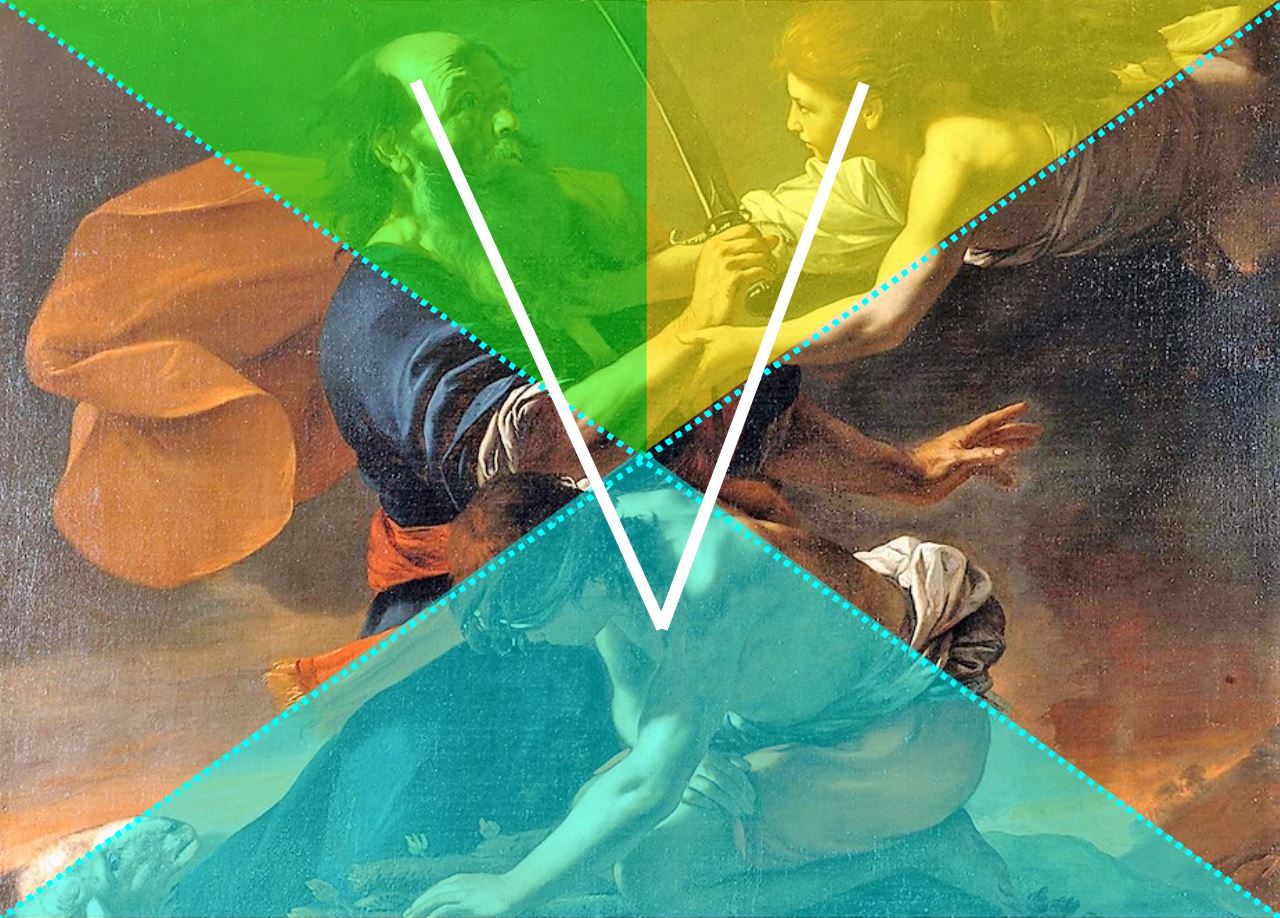
 Ecole espagnole, XVIIème siècle, Musée de Saintes
Ecole espagnole, XVIIème siècle, Musée de Saintes
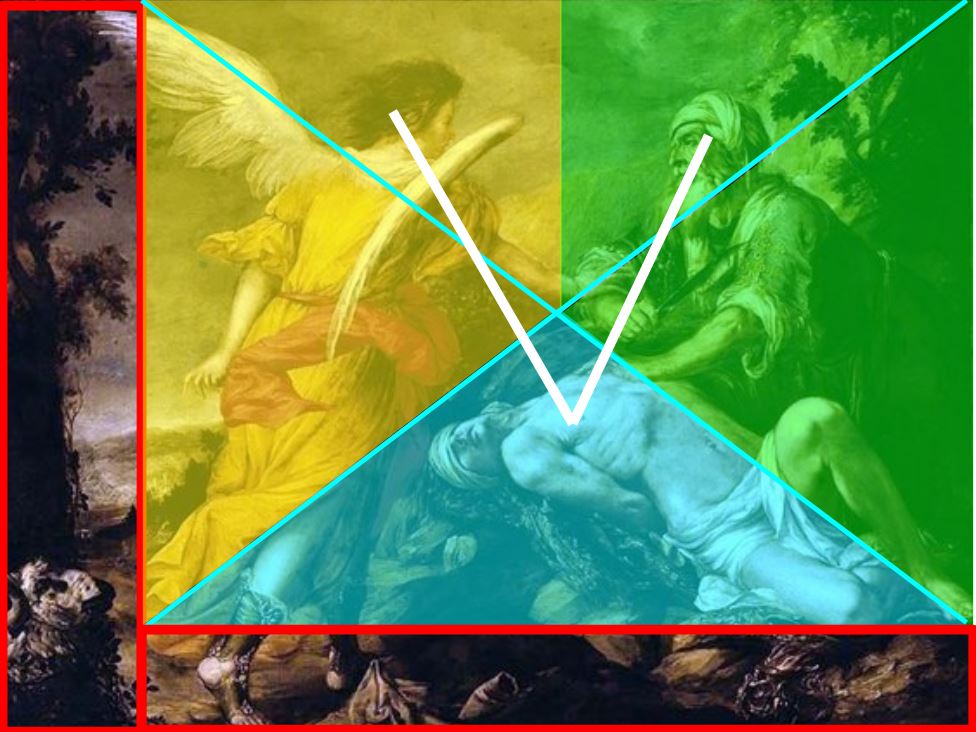
 Antonio Bellucci, après 1675, collection particulière
Antonio Bellucci, après 1675, collection particulière Anonyme vénitien, XVIIème siècle, collection particulière
Anonyme vénitien, XVIIème siècle, collection particulière Antonio Filocamo, 1712, Pinacoteca Zelantea, Acireale
Antonio Filocamo, 1712, Pinacoteca Zelantea, Acireale Angelo Trevisani, 1720-30, collection particulière
Angelo Trevisani, 1720-30, collection particulière Anonyme caravagesque, XVIIème siècle, collection privée
Anonyme caravagesque, XVIIème siècle, collection privée Anonyme vénitien, 1720-30, collection privée
Anonyme vénitien, 1720-30, collection privée
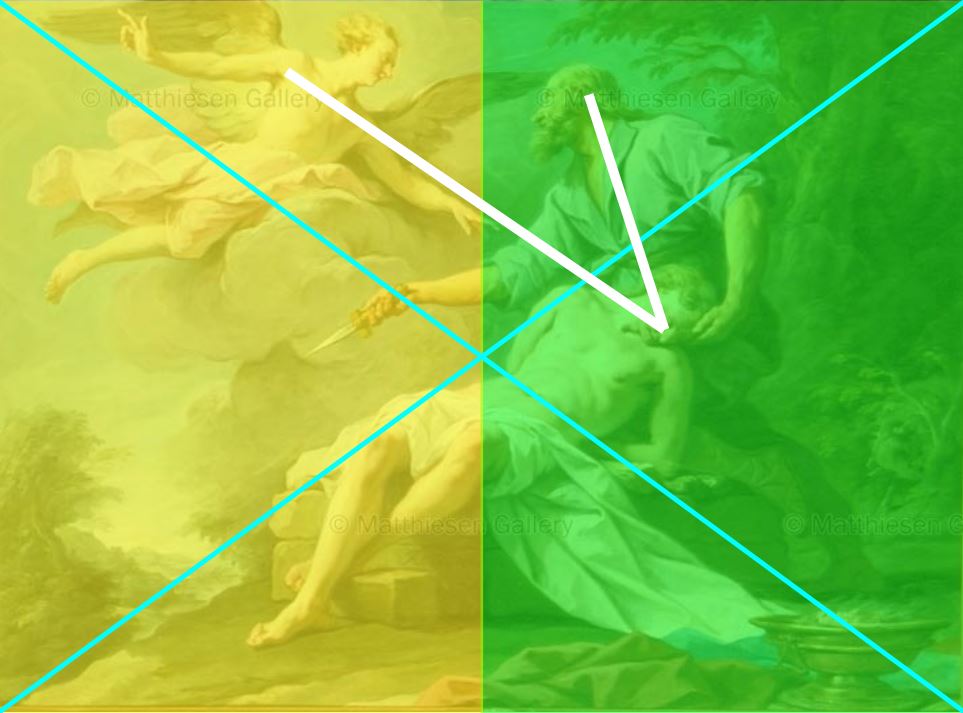 H3 dissymétrique
H3 dissymétrique V3 comprimé
V3 comprimé Agar, Ismaël et l’ange, Schloss Weißenstein, Pommersfelden
Agar, Ismaël et l’ange, Schloss Weißenstein, Pommersfelden Sacrifice d’Isaac, Strossmayer Gallery, Zagreb
Sacrifice d’Isaac, Strossmayer Gallery, Zagreb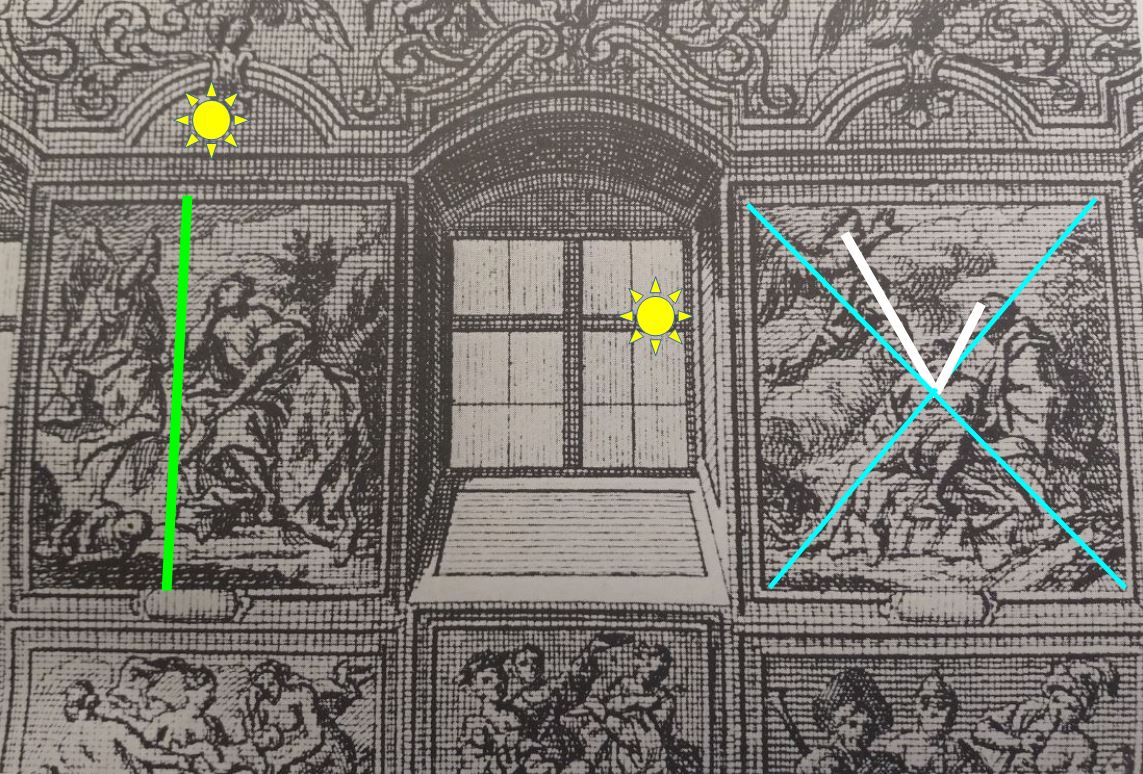

 1715, collection Thyssen Bornemisza, en dépôt au Museu Nacional d’Art de Catalunya
1715, collection Thyssen Bornemisza, en dépôt au Museu Nacional d’Art de Catalunya 1730-35, Gemäldegalerie, Dresde
1730-35, Gemäldegalerie, Dresde 1736-40, National Gallery, Londres
1736-40, National Gallery, Londres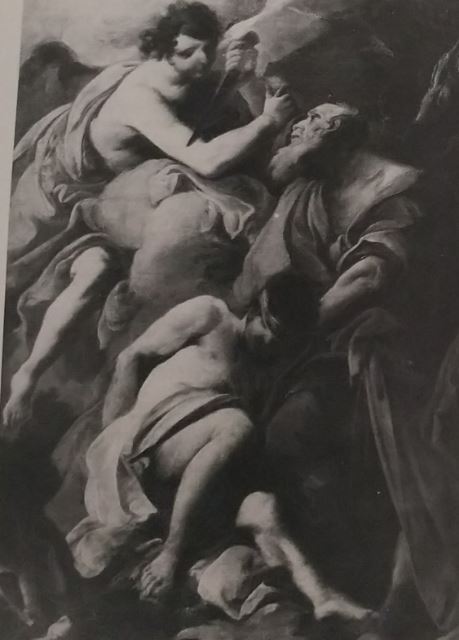 Giambattista Mariotti (vénitien), 1710-50, Musée national, Belgrade fig 55 [14]
Giambattista Mariotti (vénitien), 1710-50, Musée national, Belgrade fig 55 [14] Vénitien, XVIIIème siècle, collection particulière, fig 53 [14]
Vénitien, XVIIIème siècle, collection particulière, fig 53 [14] Vincenzo Damini (vénitien), 1720, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel
Vincenzo Damini (vénitien), 1720, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel Francesco Migliori (vénitien) , 1704-38, anciennement Gemäldegalerie, Dresde, fig 54 [14]
Francesco Migliori (vénitien) , 1704-38, anciennement Gemäldegalerie, Dresde, fig 54 [14] Francesco Guardi, vers 1750, Cleveland museum of arts
Francesco Guardi, vers 1750, Cleveland museum of arts Franz Sigritz, 1760-70, PBA Lille
Franz Sigritz, 1760-70, PBA Lille Bernardino Luini , 1524, Chiesa di S. Maria Nascente, Paderno Dugnano
Bernardino Luini , 1524, Chiesa di S. Maria Nascente, Paderno Dugnano Michael Rottmayr, 1692, Alte Galerie, Schloss Eggenberg, Graz
Michael Rottmayr, 1692, Alte Galerie, Schloss Eggenberg, Graz Rubens, 1620-21, esquisse pour le plafond de l’église des Jésuites, Anvers
Rubens, 1620-21, esquisse pour le plafond de l’église des Jésuites, Anvers
 Collection particulière (autrefois Nils Rapp)
Collection particulière (autrefois Nils Rapp) Cassa di Risparmio di Cesena
Cassa di Risparmio di Cesena Collection particulière
Collection particulière Giuseppe Vermiglio, Collection particulière
Giuseppe Vermiglio, Collection particulière


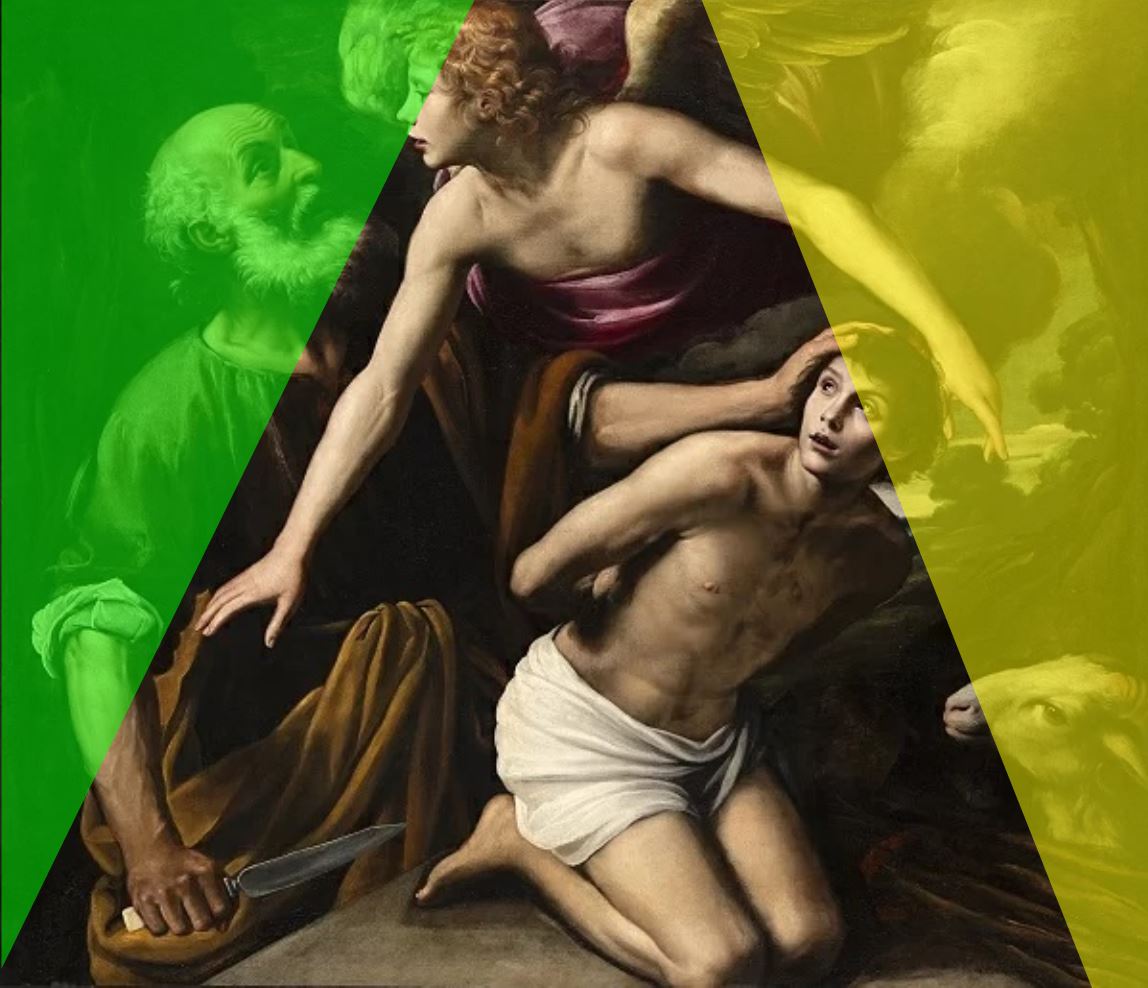
 Collection particulière
Collection particulière Collection particulière
Collection particulière Gregorio Lazzarini, 1705, provenant du monastère SS.Giovanni e Paolo, Accademia, Venise
Gregorio Lazzarini, 1705, provenant du monastère SS.Giovanni e Paolo, Accademia, Venise

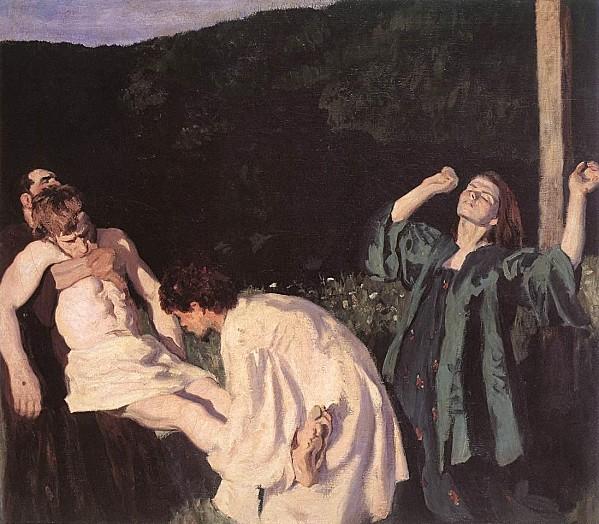 Déposition, Karoly Ferenczy, 1903, Kultúrpalota, Marosvásárhely
Déposition, Karoly Ferenczy, 1903, Kultúrpalota, Marosvásárhely Johan Liss, 1625-26, Collection particulière
Johan Liss, 1625-26, Collection particulière La déploration d’Abel
La déploration d’Abel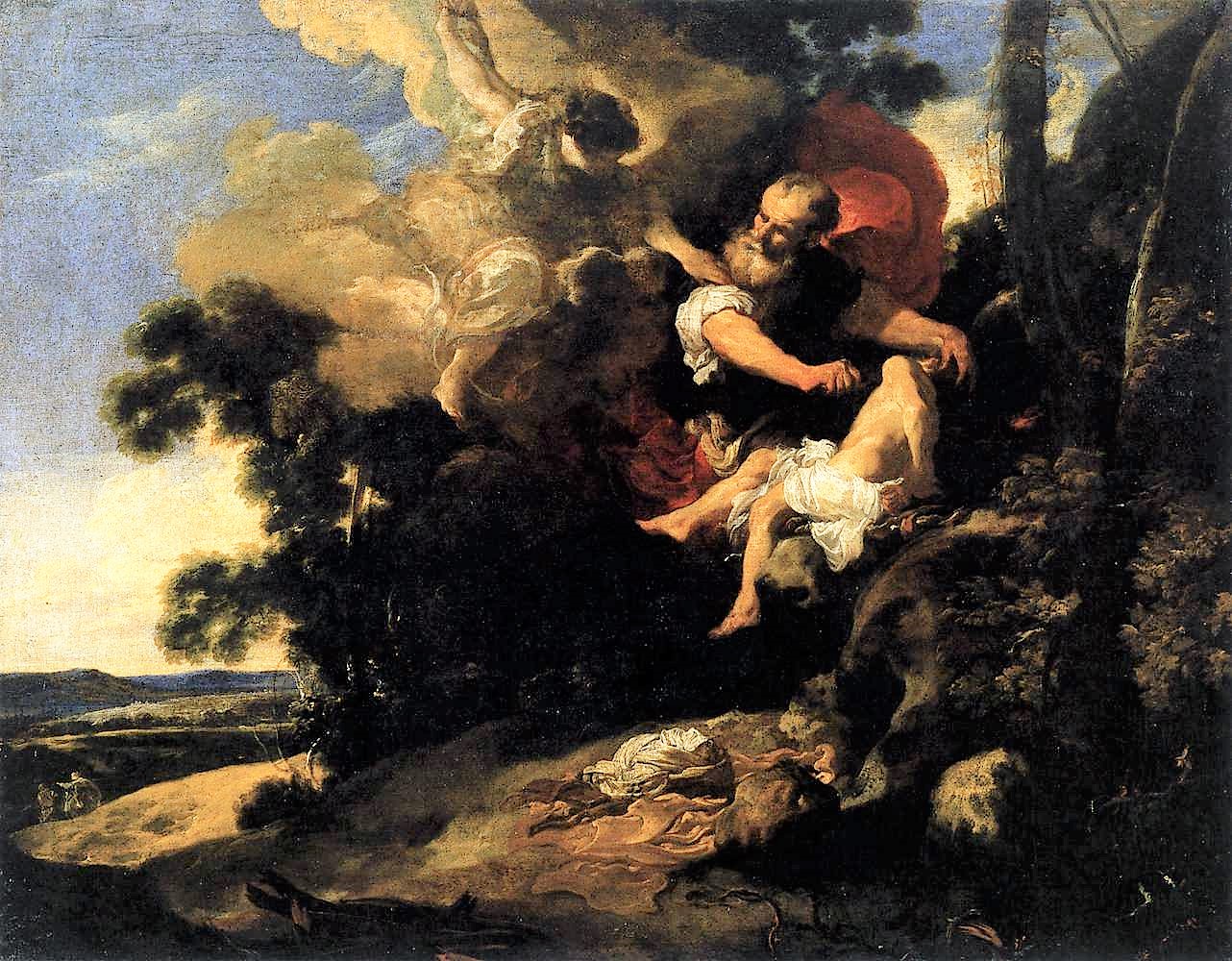 Le sacrifice d’Isaac
Le sacrifice d’Isaac
 Collection particulière
Collection particulière 1631, Staedel Museum
1631, Staedel Museum
 Collection particulière
Collection particulière Palazzo Barberini, Roma
Palazzo Barberini, Roma Collection particulière
Collection particulière Après 1625, Pinacoteca di Savona
Après 1625, Pinacoteca di Savona 1650-57, Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica di Palazzo dell’Arengo
1650-57, Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica di Palazzo dell’Arengo Capodimonte
Capodimonte Tower Hamlets Local History Library and Archives
Tower Hamlets Local History Library and Archives Collection particulière, Montecatini Terme
Collection particulière, Montecatini Terme Collection Baldeschi, Modène
Collection Baldeschi, Modène Gemäldegalerie, Dresde
Gemäldegalerie, Dresde 1639, Residenzgalerie, Salzburg
1639, Residenzgalerie, Salzburg Palazzo Pinto, Salerne
Palazzo Pinto, Salerne Collection particulière
Collection particulière Abraham et Isaac
Abraham et Isaac  Agar au désert
Agar au désert Collection particulière
Collection particulière Agar et l’Ange
Agar et l’Ange Sacrifice d’Isaac
Sacrifice d’Isaac
 1685-88, Ermitage, Saint Petersbourg
1685-88, Ermitage, Saint Petersbourg Sacrifice d’Isaac, 1685-90, Museo Casa Paolo Pagani, Valsolda
Sacrifice d’Isaac, 1685-90, Museo Casa Paolo Pagani, Valsolda Rapt d’Helène, vers 1700, Collection privée
Rapt d’Helène, vers 1700, Collection privée 1680-89, Ermitage
1680-89, Ermitage Collection particulière
Collection particulière
 Sacrifice d’Abel et Caïn
Sacrifice d’Abel et Caïn Sacrifice d’Isaac
Sacrifice d’Isaac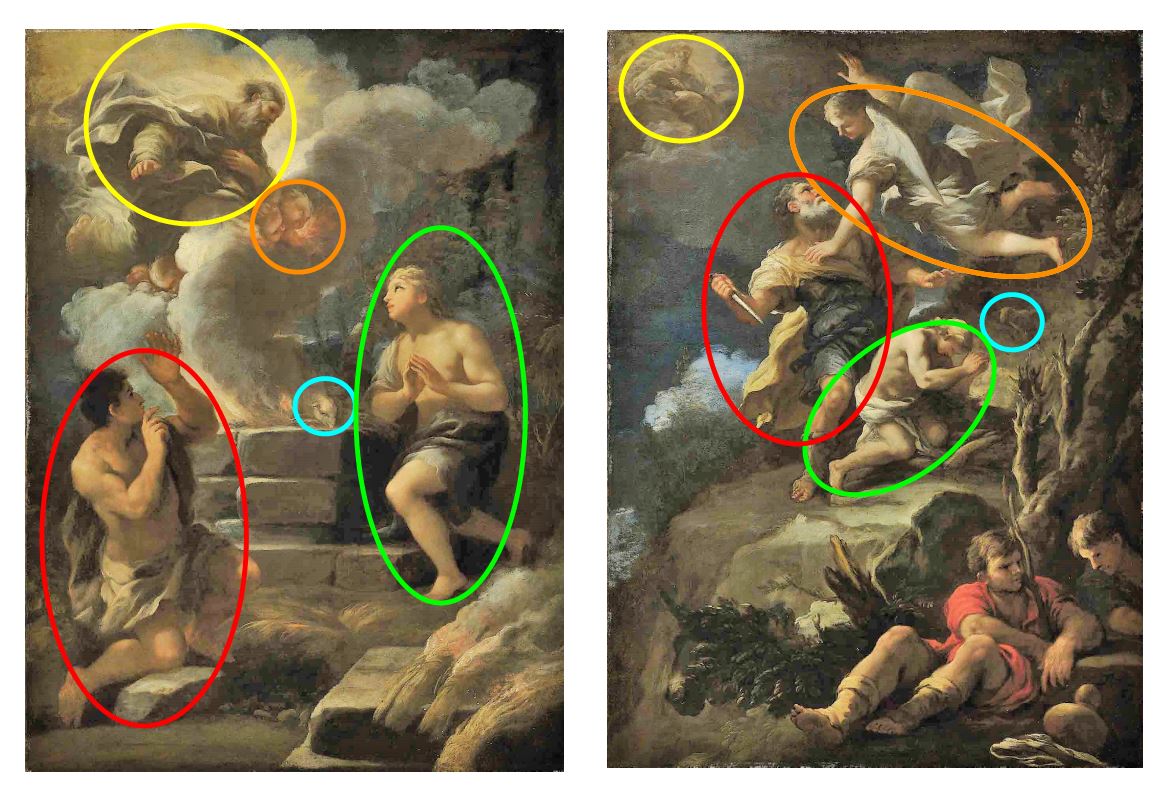

 Michael Rottmayr, 1700-30, National Museum, Varsovie
Michael Rottmayr, 1700-30, National Museum, Varsovie 1713-14, Speed Art Museum, Louisville
1713-14, Speed Art Museum, Louisville Collection particulière
Collection particulière Musée de Picardie
Musée de Picardie PIttoni, 1720, Chiesa di San Francesco della Vigna, Venise.
PIttoni, 1720, Chiesa di San Francesco della Vigna, Venise. 1750, Museum of Fine Arts, Boston
1750, Museum of Fine Arts, Boston Gianbattista Tiepolo, 1720-25, pennacchi dell’Ospedaletto, Venise
Gianbattista Tiepolo, 1720-25, pennacchi dell’Ospedaletto, Venise Gianbattista Tiepolo, 1727-28, Plafond de la Galleria degli ospiti, Palazzo Patriarcale, Udine
Gianbattista Tiepolo, 1727-28, Plafond de la Galleria degli ospiti, Palazzo Patriarcale, Udine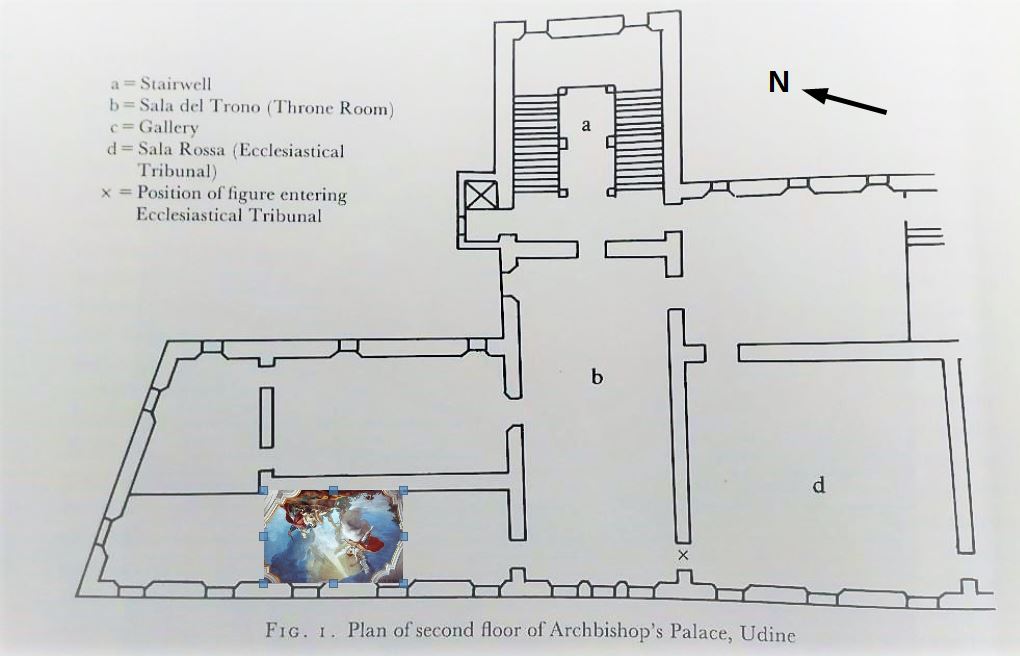

 Gianbattista et Dominico Tiepolo, 1750, MET
Gianbattista et Dominico Tiepolo, 1750, MET Vers 1755 (G09), Suermondt-Ludwig Museum, Aachen
Vers 1755 (G09), Suermondt-Ludwig Museum, Aachen Vers 1755 (G10, abb 138), Alte Pinakothek Munich
Vers 1755 (G10, abb 138), Alte Pinakothek Munich Vers 1775, collection particulière, photographie rkd
Vers 1775, collection particulière, photographie rkd Sacrifice d’Isaac (G12, abb 141)
Sacrifice d’Isaac (G12, abb 141) Abraham et les trois anges (G12, abb 140)
Abraham et les trois anges (G12, abb 140) Avant 1762 (G11), perdu
Avant 1762 (G11), perdu 1780-90 (G16, abb 139), collection particulière
1780-90 (G16, abb 139), collection particulière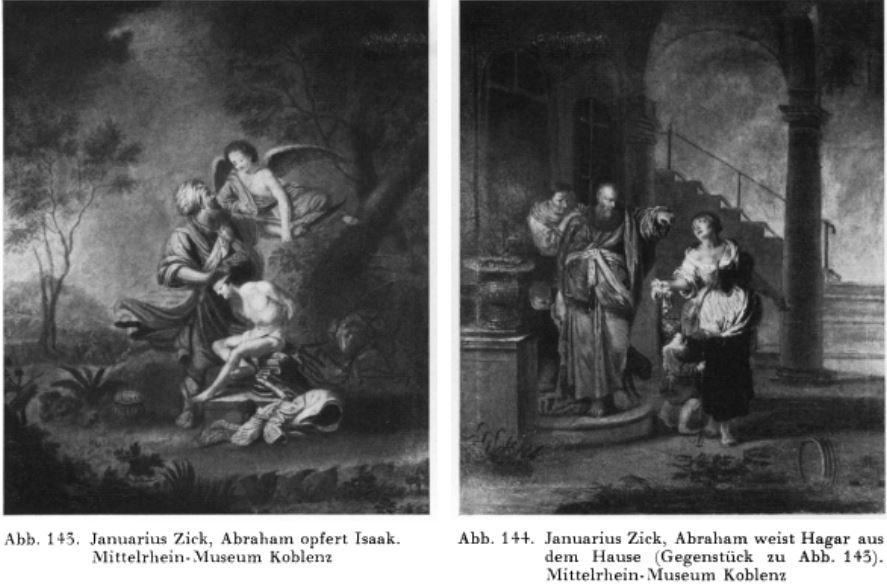
 Vers 1755 (G08), collection particulière
Vers 1755 (G08), collection particulière Vers 1765 (G15, abb 135), Wallraf Richartz Museum, Cologne
Vers 1765 (G15, abb 135), Wallraf Richartz Museum, Cologne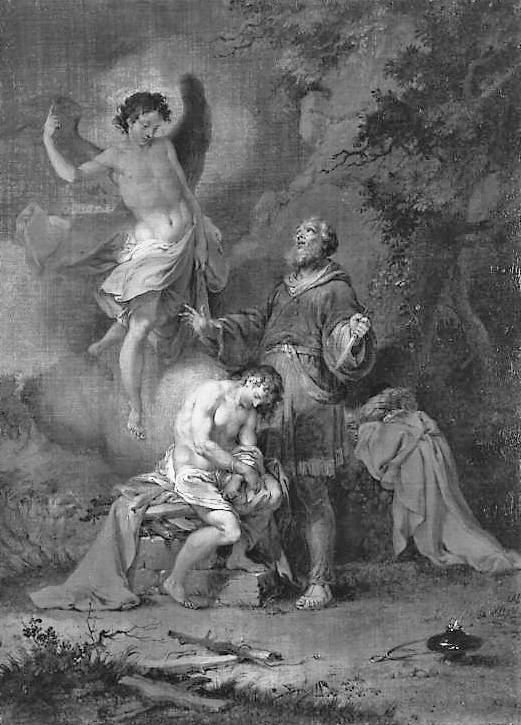 1760-65 (G13, abb 142), Alte Pinakothek, Münich
1760-65 (G13, abb 142), Alte Pinakothek, Münich Vers 1780 (G14), collection particulière
Vers 1780 (G14), collection particulière

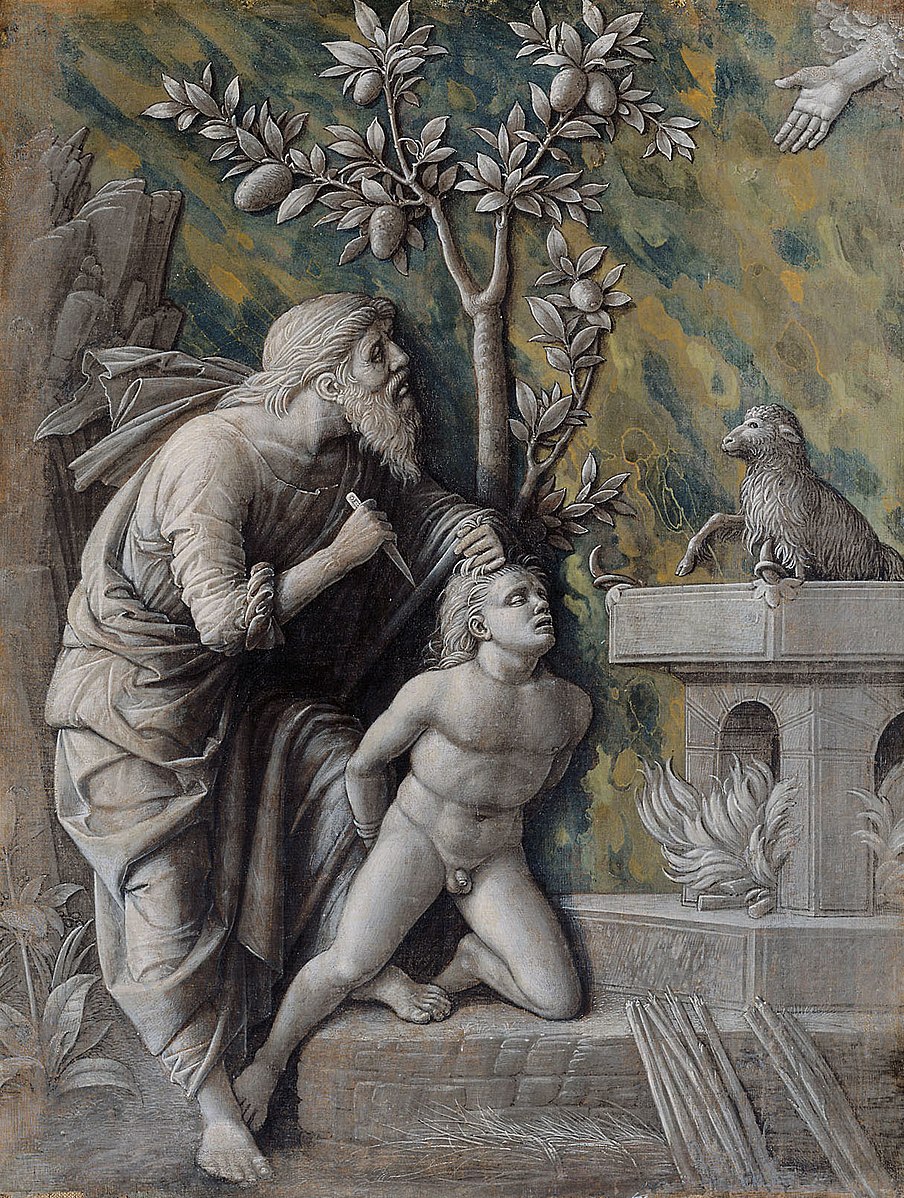 Le sacrifice d’Isaac
Le sacrifice d’Isaac David et Goliath
David et Goliath Cristofano Gherardi, 1555, Musée diocésain, Cortone
Cristofano Gherardi, 1555, Musée diocésain, Cortone Alessandro Tiarini, 1620-30, collection particulière (fototeca Zeri)
Alessandro Tiarini, 1620-30, collection particulière (fototeca Zeri) Nicolaes Maes, 1655-58, Collection of Alfred and Isabel Bader, Milwaukee [22]
Nicolaes Maes, 1655-58, Collection of Alfred and Isabel Bader, Milwaukee [22] Sacrifice d’Isaac
Sacrifice d’Isaac Moïse et le buisson ardent
Moïse et le buisson ardent
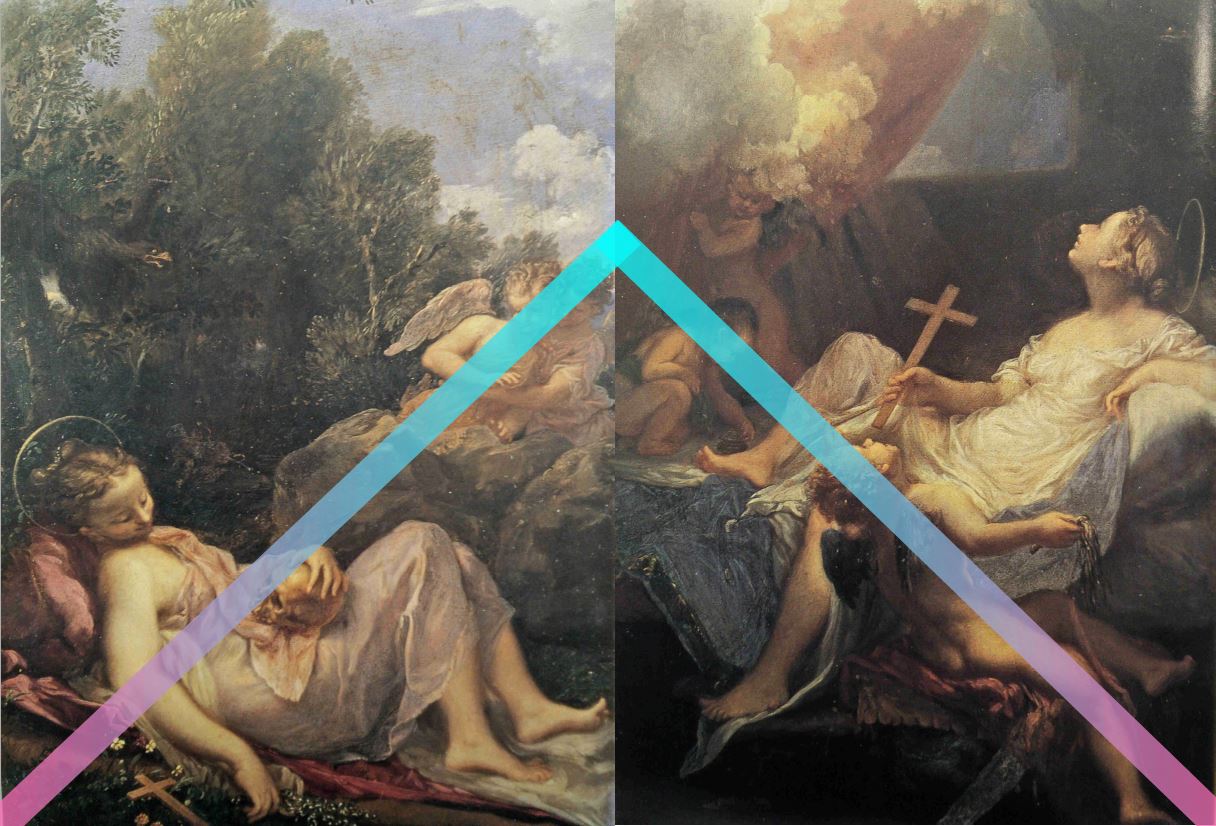 Madeleine pénitente, Madeleine en extase
Madeleine pénitente, Madeleine en extase Alessandro Gherardini, 1675-1726, collection particulière (fototeca Zeri)
Alessandro Gherardini, 1675-1726, collection particulière (fototeca Zeri) Pieter de Grebber, 1630-40, Galerie nationale slovaque, Bratislava
Pieter de Grebber, 1630-40, Galerie nationale slovaque, Bratislava Jan Lievens, 1638, Herzog Anton Ulrich museum, Braunschweig
Jan Lievens, 1638, Herzog Anton Ulrich museum, Braunschweig Jan Lievens, 1659, Dallas Museum of Art
Jan Lievens, 1659, Dallas Museum of Art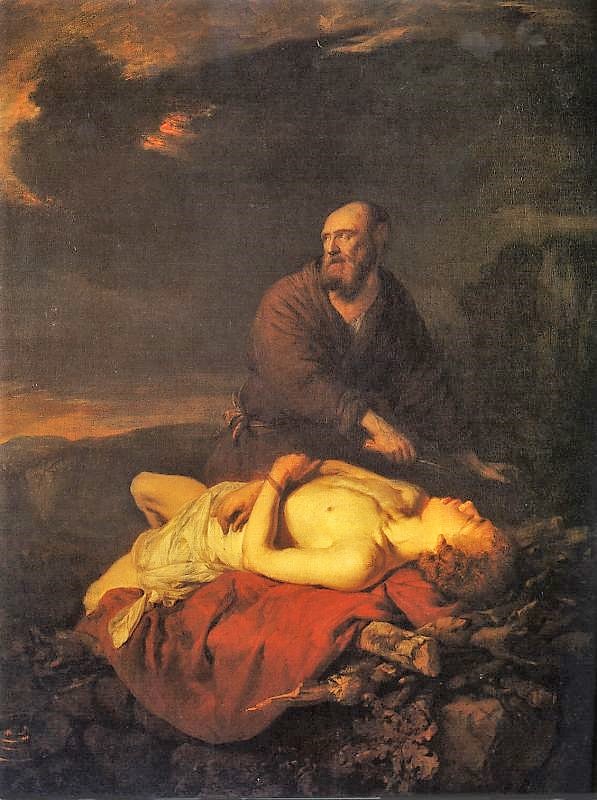 Metsu, vers 1660, The Israel Museum, Jérusalem
Metsu, vers 1660, The Israel Museum, Jérusalem Aert de Gelder, 1665-1727, collection particulière
Aert de Gelder, 1665-1727, collection particulière Abraham et Isaac sur le chemin
Abraham et Isaac sur le chemin Le Sacrifice d’Isaac
Le Sacrifice d’Isaac