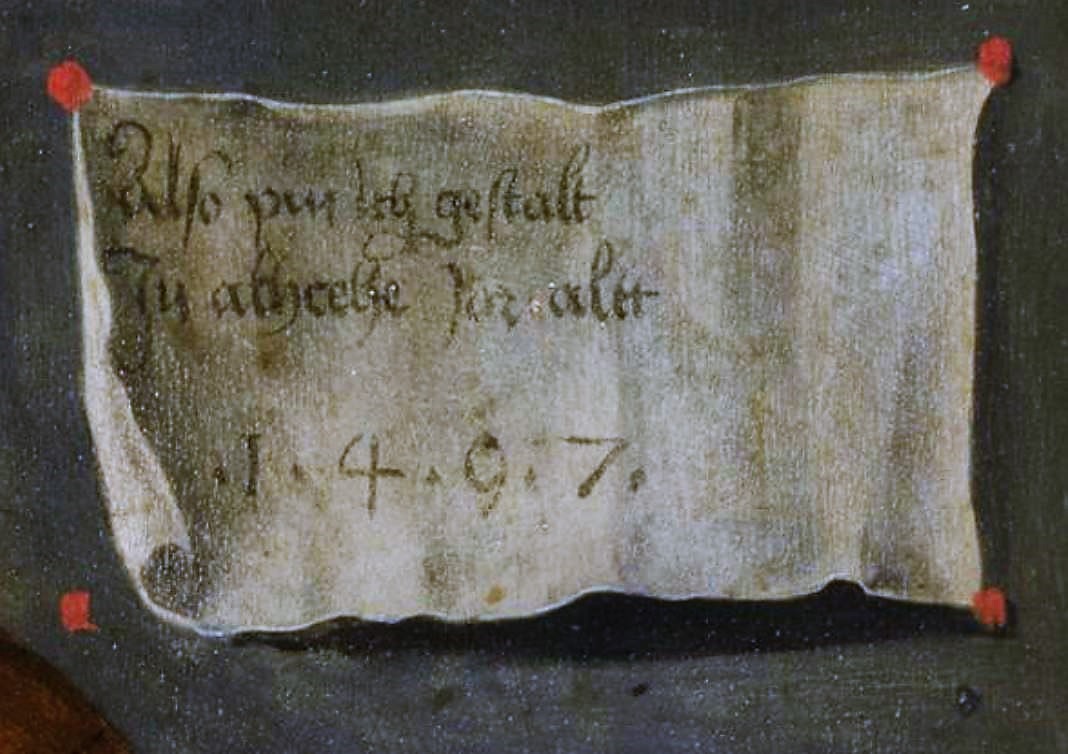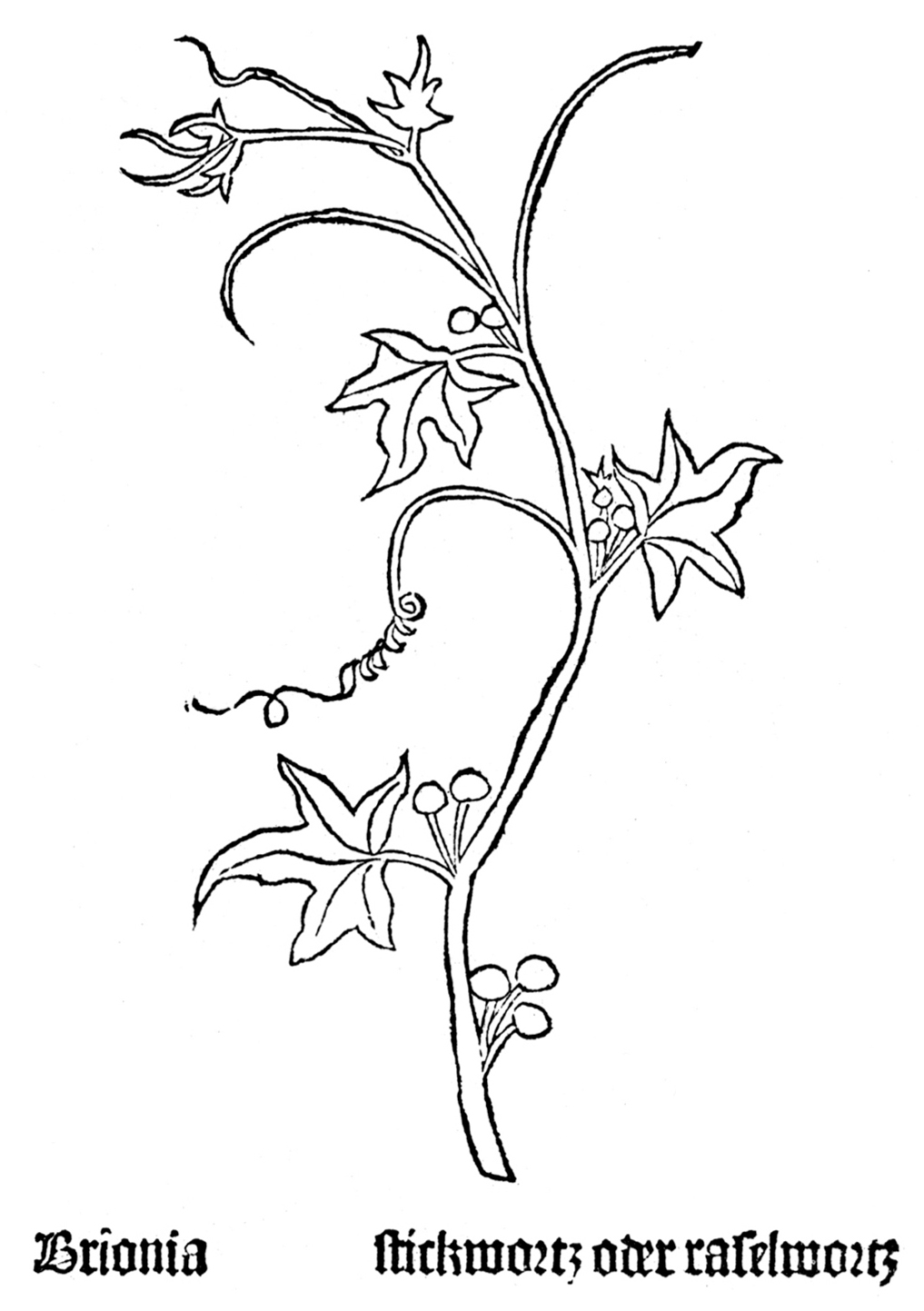Imaginons qu’un peintre inconnu, à la recherche de nouveauté, ait eu l’idée que l’index tendu de la servante, dans le Reniement de Pierre, rappelait un autre index caravagesque très célèbre, celui du Christ dans la Vocation de Mathieu : deux histoires finalement assez semblables de désignation d’un anonyme dans la foule.


Article précédent : 3 Reniement de Pierre : Les renversements du prototype

L’introduction d’un nouveau thème (1610-1620)

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Attribué à Ribera, 1615-16, Galleria Corsini, Rome
Il se trouve que, sur le papier du moins, une oeuvre répond au problème de cet artiste.
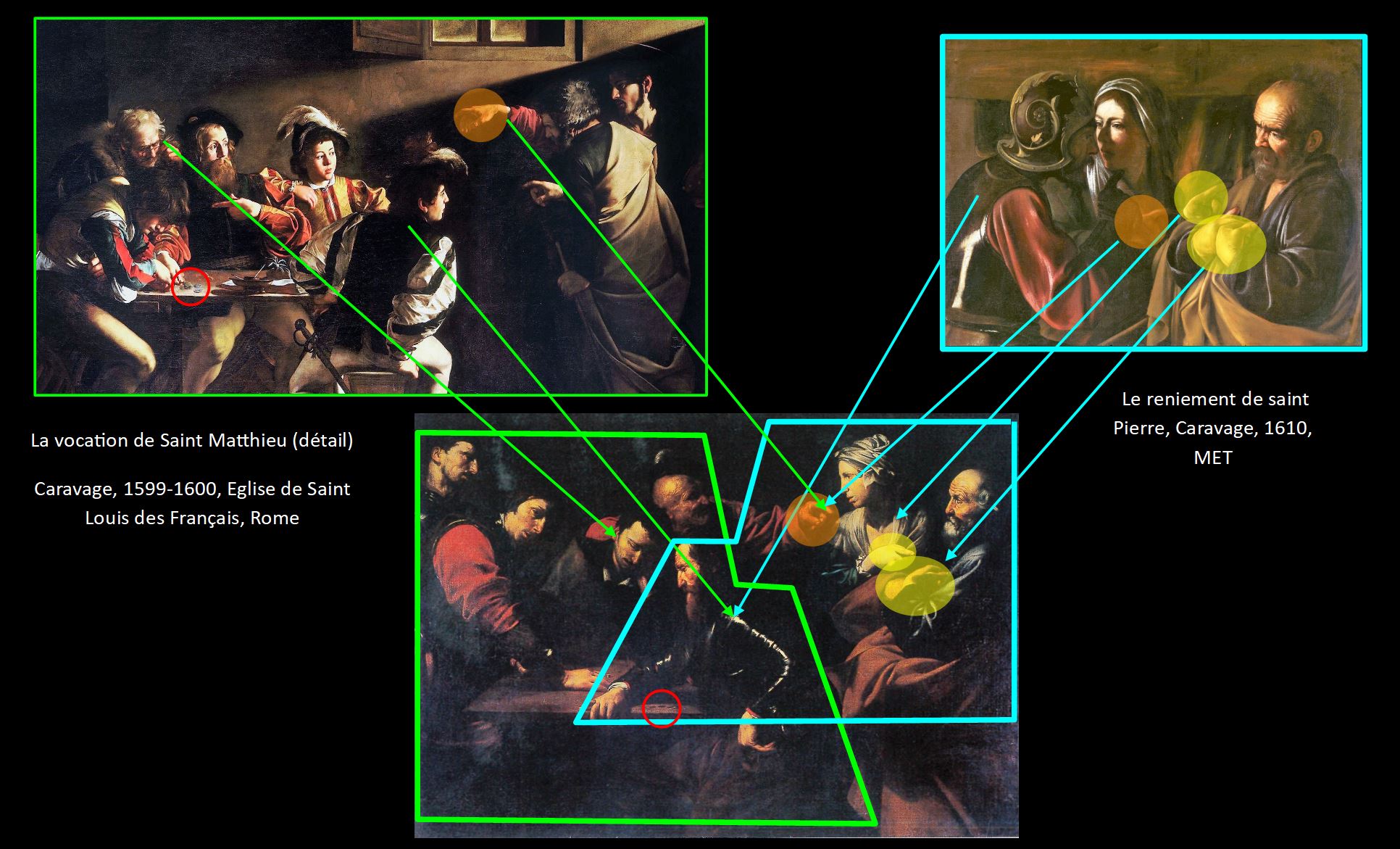
Le soldat en cuirasse du Reniement vient s’asseoir sur un banc, formant le même repoussoir que le soldat en pourpoint devant la table de la Vocation ; et les pièces du collecteur d’impôt se retrouvent sous forme d’enjeu d’un jeu de dés (cercle rouge).
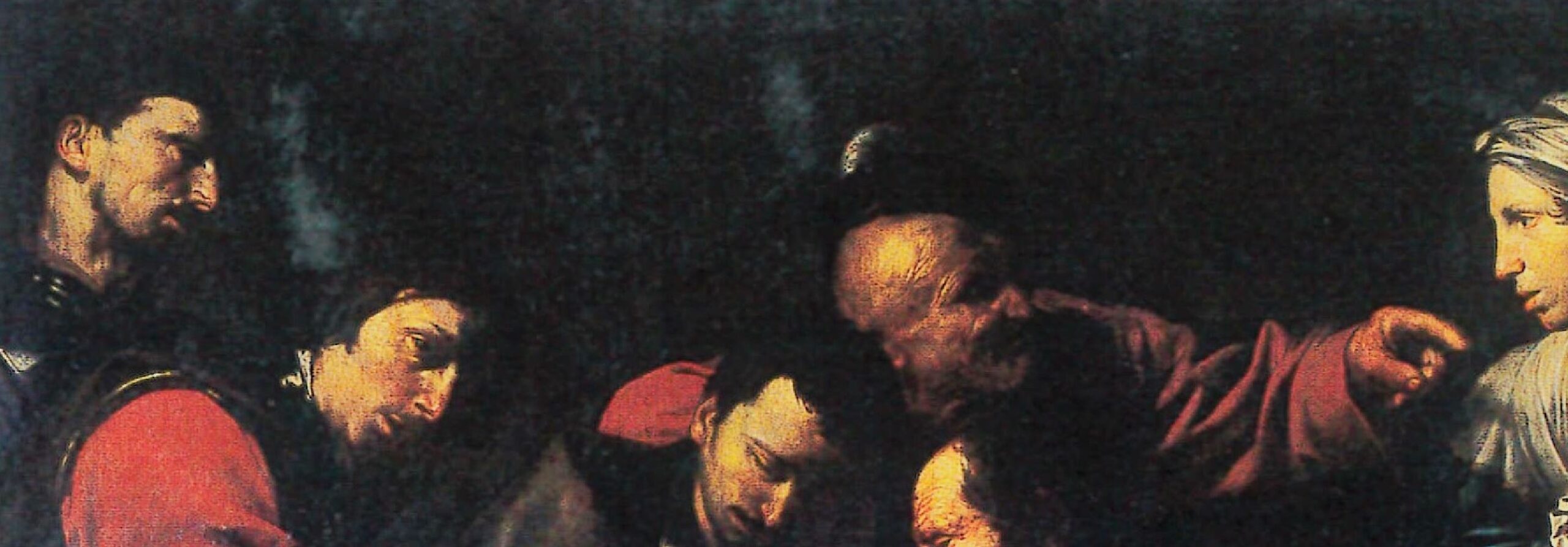 Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement.
Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement.
 A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction.
A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction.

Ainsi l’ajout du thème des joueurs est plus qu’une variation graphique : il a aussi un enjeu narratif, en permettant de préciser de quel Reniement il s’agit. Tous les « Reniements avec joueurs » qui suivront reprendrons l’idée de Ribera, celui du Deuxième Reniement.
Il existe cependant une exception, dans laquelle aucun des soldats n’est conscient de ce qui se passe…

Une oeuvre-clé : le tableau de la Certosa
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Caravagesque nordique inconnu, Certosa di San Martino, Naples
Anciennement admirée comme un authentique Caravage, cette oeuvre a été l’objet d’une longue querelle d’attribution dans laquelle nous n’entrerons pas [1]. Assombrie et desservie par un accrochage ingrat, la composition, de tout premier ordre, révèle une grande profondeur de conception.
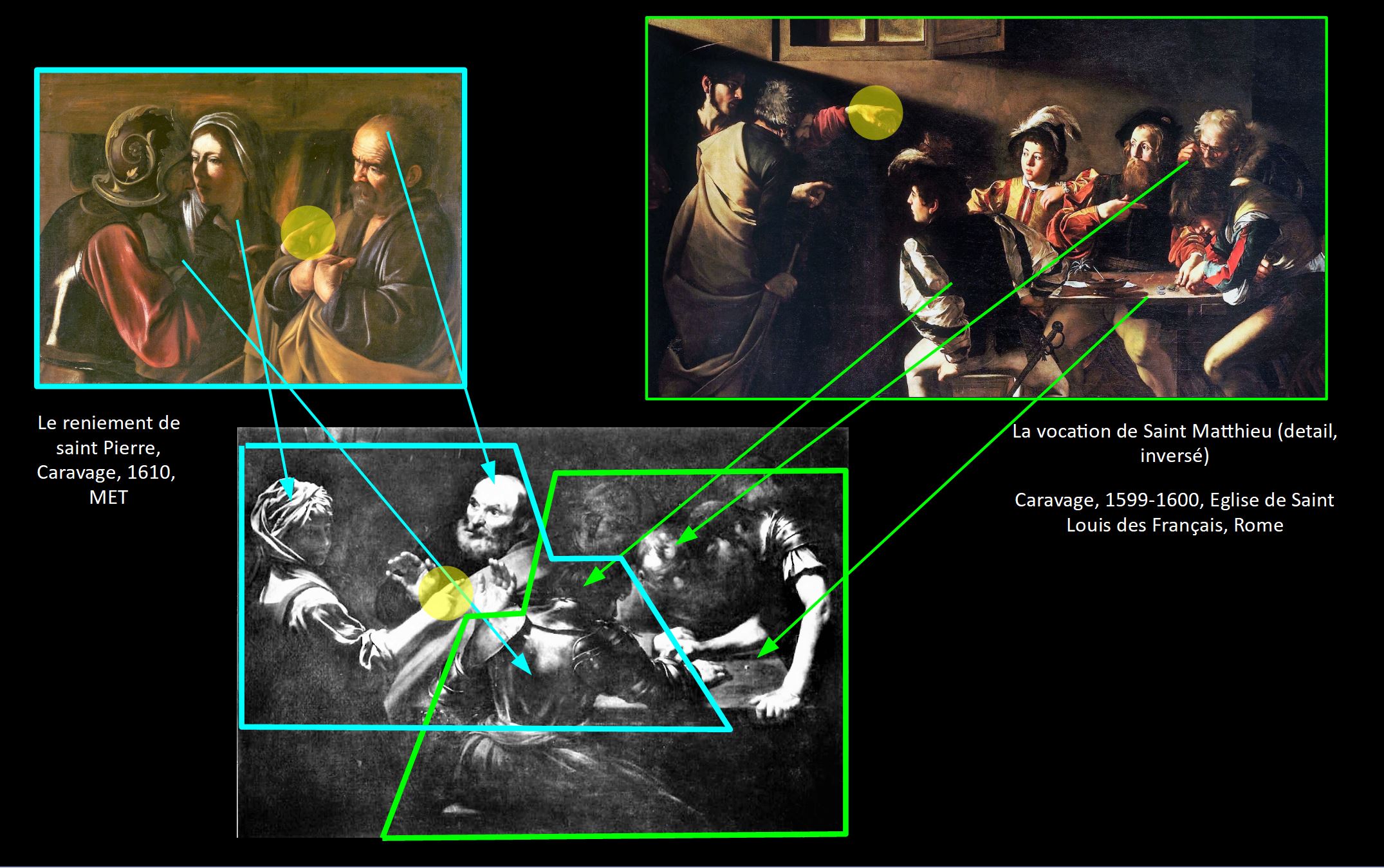 Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.
Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.
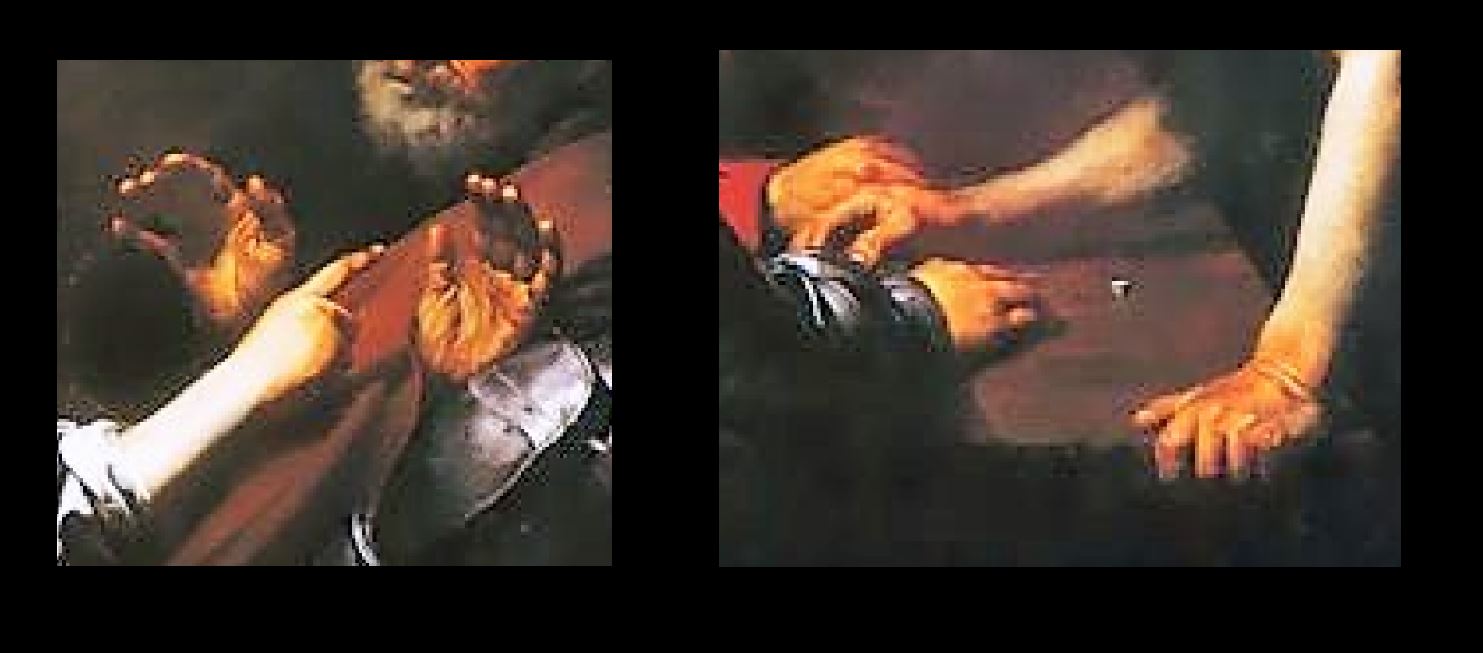
Les gestes ont subi une élaboration particulière, qui les éloigne des modèles de Caravage : entre les mains ouvertes de Saint Pierre, l’index de la servante désigne moins l’apôtre lui-même que son manteau rouge, tandis que les mains fermées des trois joueurs s’abattent sur la table, laissant visible un seul dé.
Le motif du Jeu de Dés
 Crucifixion (détail)
Crucifixion (détail)
Maître de Giovanni Barrile, vers 1350, Louvre
Or durant toute l’époque médiévale et jusqu’au Moyen-Age, le jeu de dés est un détail très courant des Calvaires, avec la scène des soldats jouant au sort le manteau rouge de Jésus : bien pratique pour illustrer la condamnation des jeux de hasard par l’Eglise [2].
 Soldats jouant aux dès la tunique du Christ Soldats jouant aux dès la tunique du Christ
Valentin de Boulogne (attribué), 1615-16 , collection particulière |
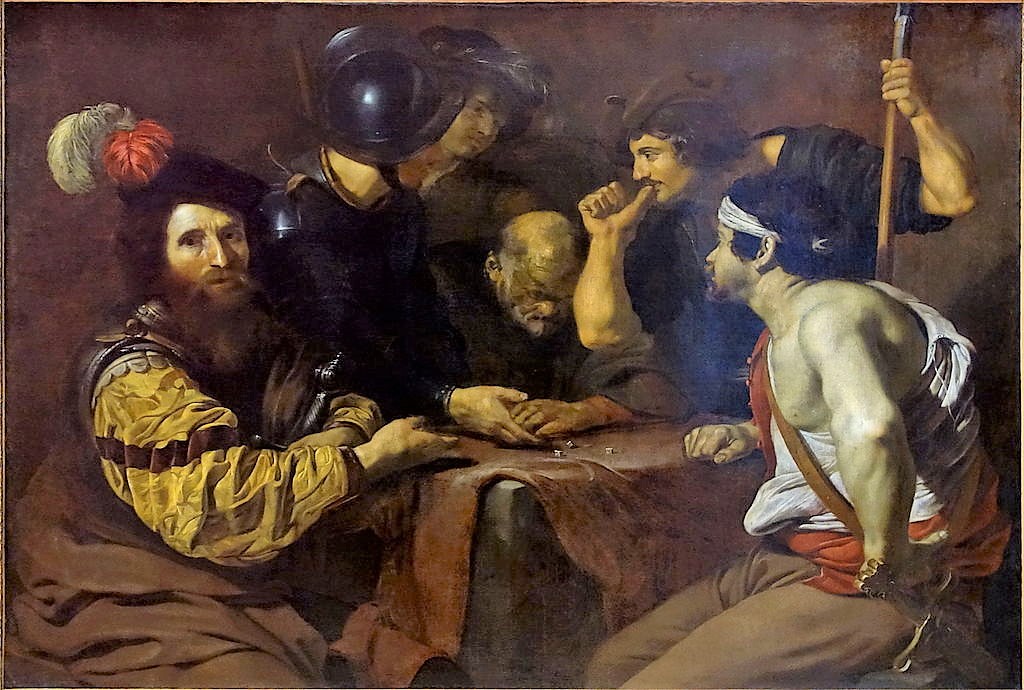 Soldats jouant aux dés la tunique du Christ Soldats jouant aux dés la tunique du Christ
Nicolas Régnier, vers 1650, Musée des Beaux-Arts, Lille. |
Malgré son intérêt chromatique, le thème de la tunique rouge du Christ est quasiment absent chez les Caravagesques, mis à part ces deux tableaux, l’un très précoce, l’autre très tardif. Comme si durant toute la période, il avait été admis que le traitement oblique, au travers du Reniement de Saint Pierre, était plus intéressant que le traitement direct. Et que le jeu de dés conférait un caractère sacré à leur grand fonds de commerce : les scènes de tripot et de triche.
 Joueurs de Dés
Joueurs de Dés
Nicolas Tournier, 1619-27, Speed Art Museum, Louisville
L’idée de dissimuler une allusion christique dans une scène de dés n’est pas venue qu’au seul Maître de la Certosa : je vous laisse chercher le manteau rouge.
Un prototype de Ribera ?
G.Pappi [3] considère le Reniement de la Certosa comme une oeuvre du jeune Ribera, vers 1611-1612, qui serait le prototype de son Reniement de la galerie Corsini.
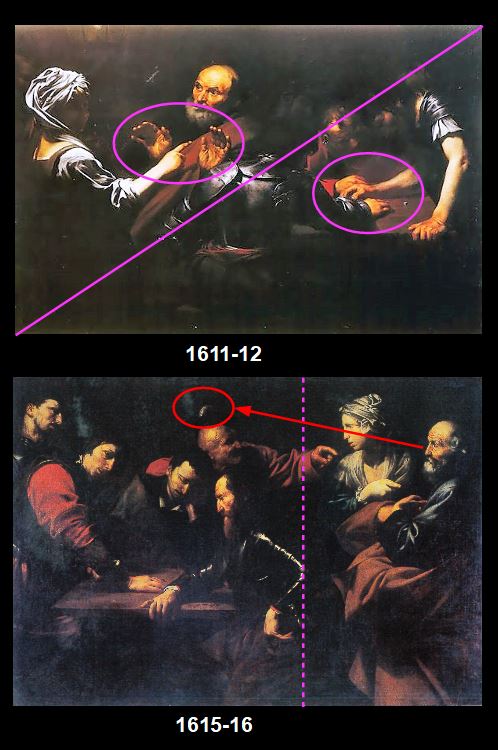
Notre analyse est cohérente avec cette généalogie :
- la composition de la Certosa invente l’expansion du Reniement par le Jeu de Dés : les deux scènes restent indépendantes, et la position similaire des mains invite l’oeil à rapprocher le manteau de l’Apôtre d’une part, le jeu de dés de l’autre, comme si le premier était l’enjeu du second :
comme si le Reniement anticipait le Calvaire ;
- la composition de la Corsini surenchérit avec une nouvelle innovation iconographique, l’homme au chapeau de coq qui joint les deux scènes spatialement, mais aussi temporellement :
- Passé de la Prédiction,
- Présent du Reniement,
- futur de la Crucifixion.

Manfredi
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Bartolomeo Manfredi, avant 1618 (c ) Herzog Anton Ulrich Museum, Brunswick
D’un strict point de vue structural, la composition de Manfredi pourrait bien être postérieure : comme si, le nouveau sujet du « Reniement au jeu de dés » étant acquis, il s’agissait maintenant de le réélaborer, non plus par collage et dérivation à partir des deux oeuvres de Caravage, mais selon une logique propre.
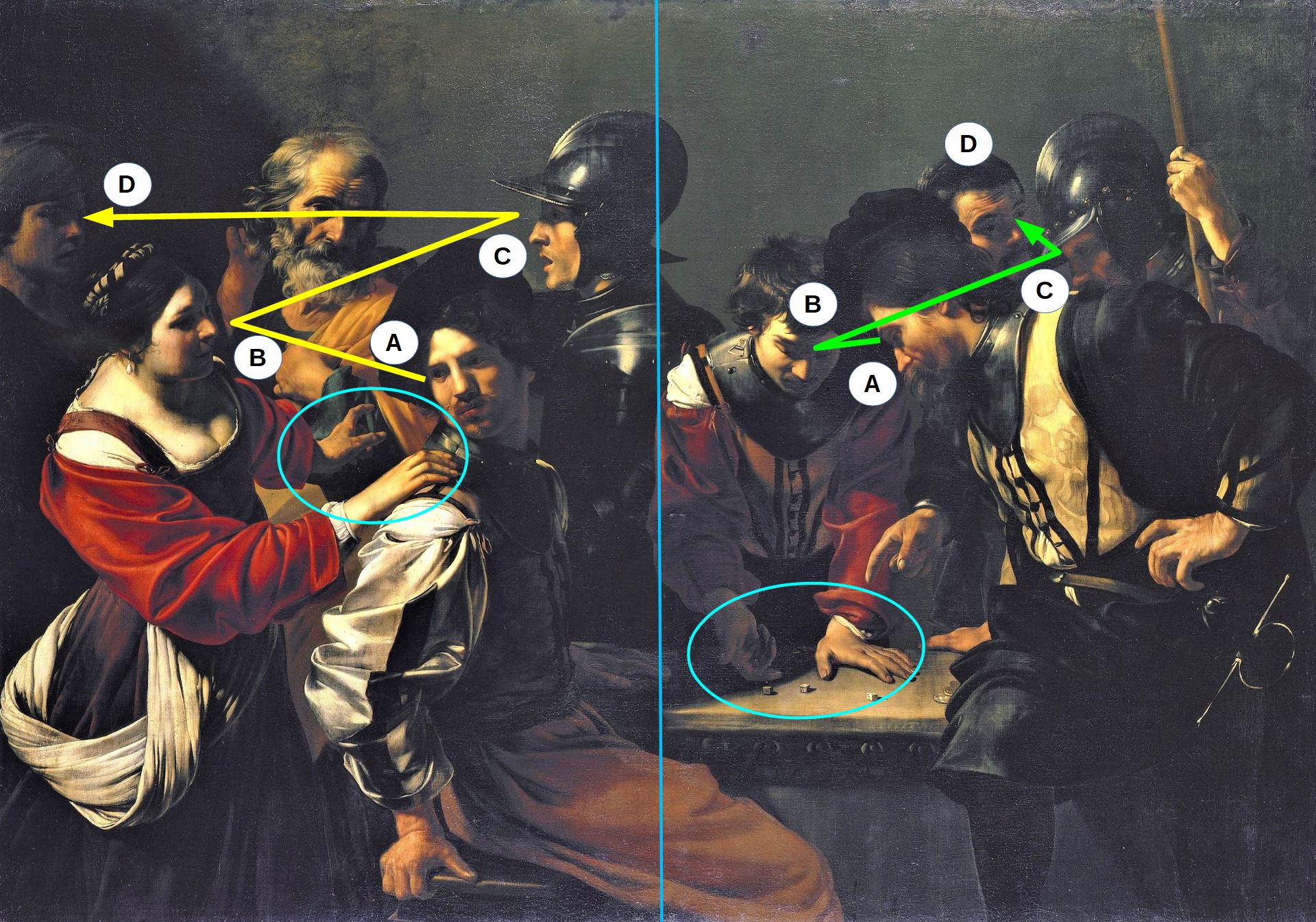 Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :
Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :
- A : deux soldats assis avec béret, pourpoint, et collier cuirassé ;
- B : deux personnages penchés, en rouge et blanc, dont les mains se font écho (cercles bleus) ;
- C : deux soldats debout, casqués et vus de profil ;
- D : deux têtes vues de trois quart, à l’arrière-plan.
Les dés interdits
Il est possible que la scène représente une partie clandestine, bien dans l’esprit « punky » des caravagesques. Tous les jeux de hasard n’étaient pas prohibés, à Rome, mais on sait que le peintre Jean Ducamps fut arrêté en 1625 pour avoir joué à la riffa, un jeu interdit dont la spécificité était de nécessiter trois dés ([4], p 19).
Une trouvaille iconographique
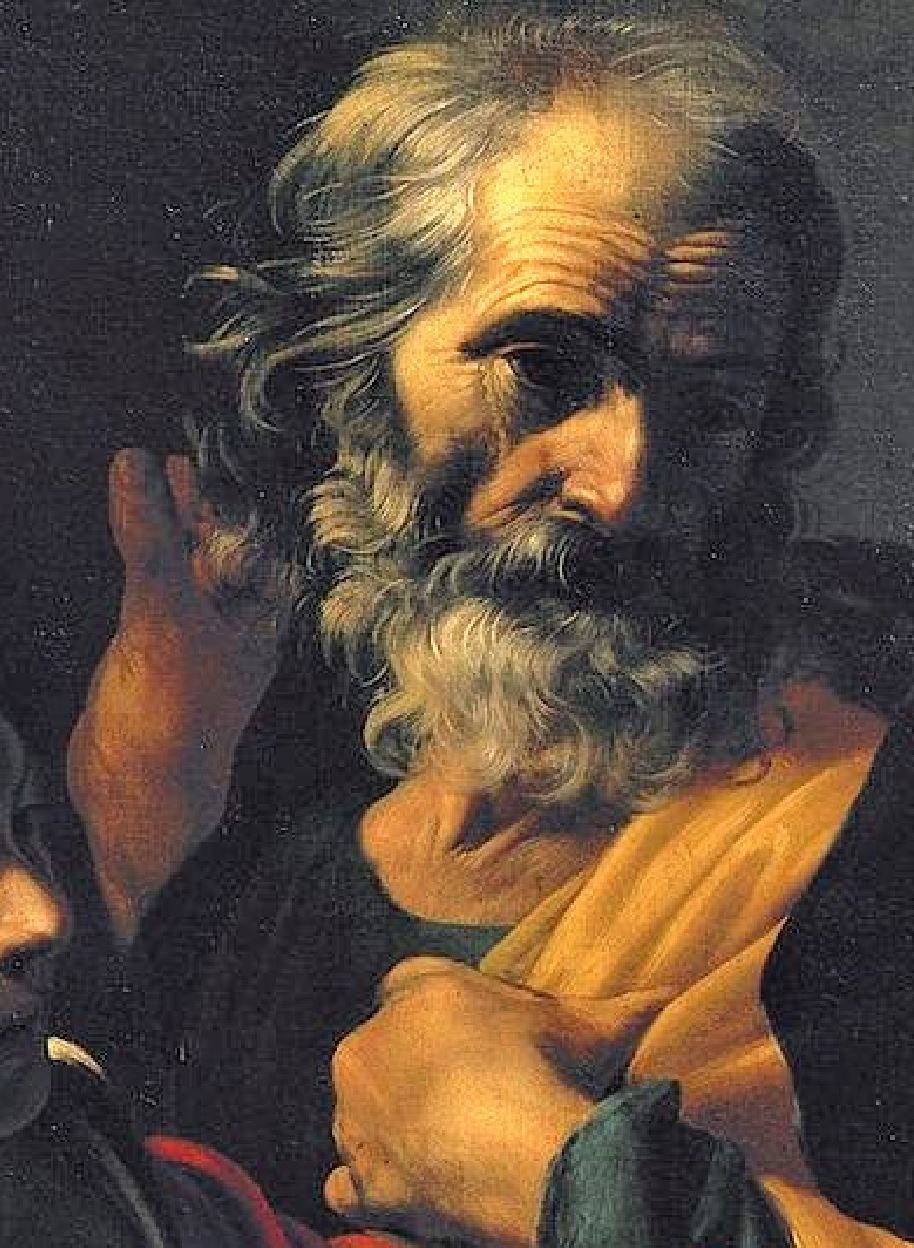 La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés.
La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés.

Les deux Reniements de Valentin
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Valentin de Boulogne, 1615-1617, Fondazione di studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, Florence
Cette oeuvre très ambitieuse constitue une autre restructuration majeure du sujet.
Un instant de suspens
 Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail) Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail) |
 Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre |
Dans son autre tableau de jeu de dés de la même période, Valentin avait montré l’instant où les jeux sont faits, celui où le dernier dé se pose sur la table. Ici il améliore le suspense en nous montrant le dé juste lâché par la main de chair, tandis que la main d’ombre posée sur la table nous dit que le destin a déjà joué, même si nous ne connaissons pas encore le résultat.
Ce jeu avec l’avenir inéluctable explicite le thème même du tableau : la prédiction de Jésus qui va se réaliser.
Le bas-relief
Le quart du tableau est occupé par un bas-relief antique, dont beaucoup de commentateurs suspectent qu’il devrait donner une clé de lecture de l’ensemble, mais qui est resté mystérieuse.
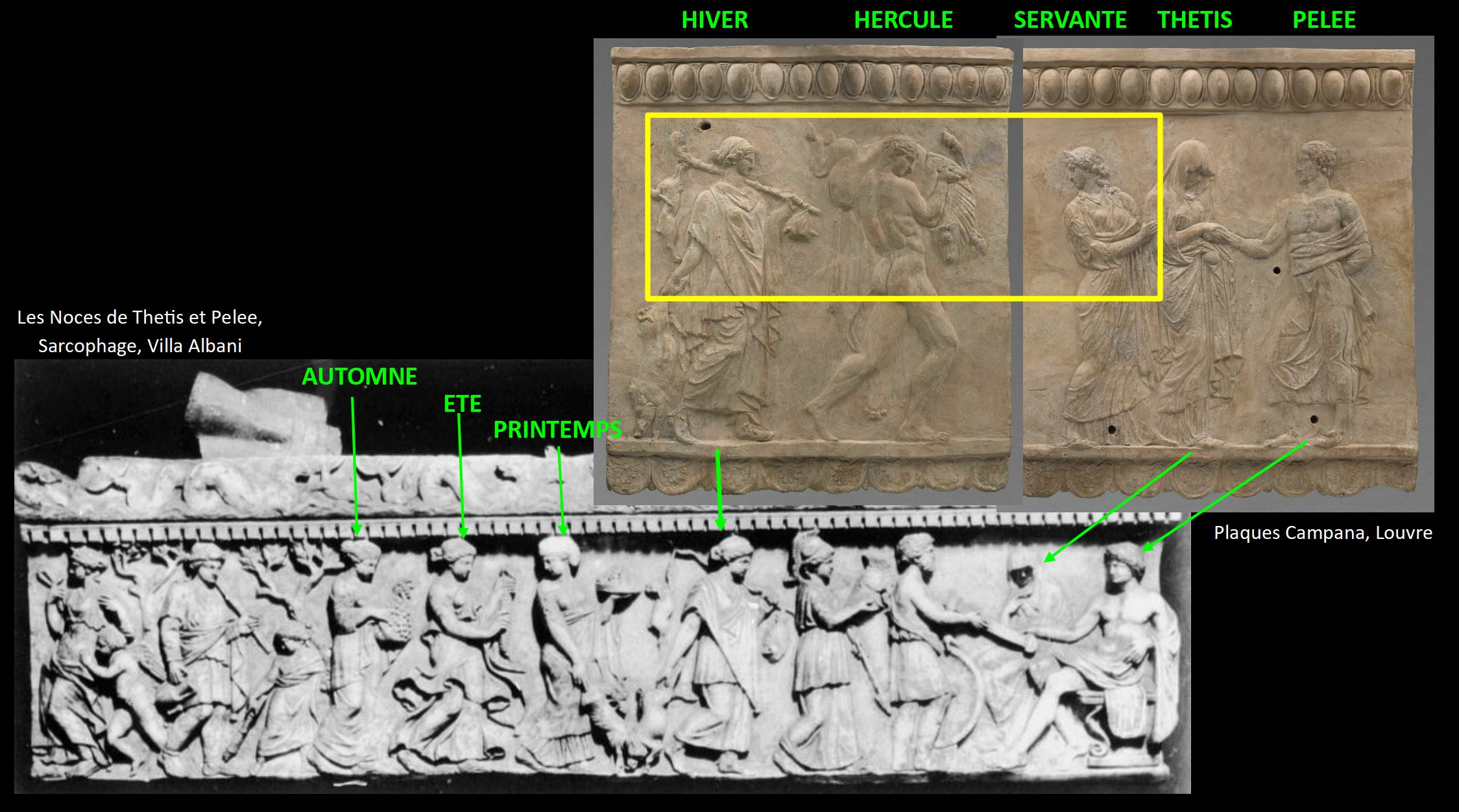
Valentin a recopié deux des plaques de terre-cuite de la collection Borghese, bien connues à l’époque ([4], p 130) La femme de gauche est une représentation classique de l’Hiver, telle qu’elle apparaît, en compagnie des autres saisons, dans un autre sarcophage bien connu à l’époque, les Noces de Thétis et Pelée de la villa Albani.
Valentin a donc procédé à la fois :
- par collage, en raboutant les deux plaques isolées, dans une démonstration d’érudition archéologique ;
- par caviardage, en supprimant la partie « mariage » de la seconde plaque, ce qui rend inintelligible la figure féminine de droite (une servante ou « pronuba ») , sauf comme pendant de la femme de gauche.
Il ne faut donc pas surinterpréter la portée symbolique de ce cortège. Ce type de bas-relief se retrouve d’ailleurs dans d’autres oeuvres caravagesques comme marqueur typiquement romain et comme hommage au goût antiquaire du commanditaire.
Notons que Valentin s’est amusé à placer l’Hiver juste à côté du brasero, et a peut être choisi la scène simplement parce que la femme de gauche porte différents gibiers, et Hercule porte un boeuf de Géryon : scènes de capture à l’antique, formant un contrepoint païen à la capture qui menace Pierre.
Une composition tripartite
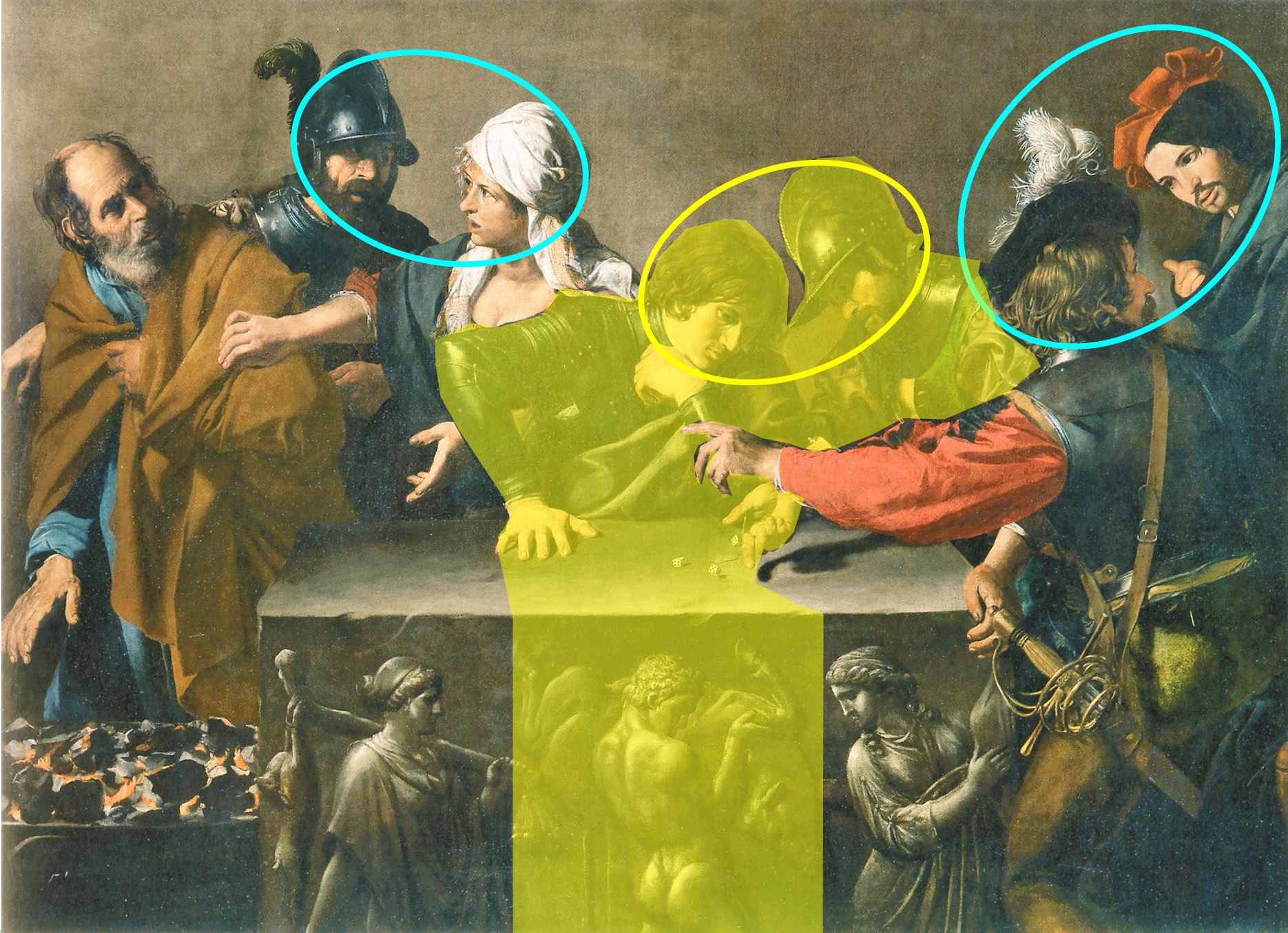
Reste que le bas-relief nous donne bien une indication de lecture, en nous incitant à décomposer en trois couples le « cortège » des poursuivants de Pierre :
- le soldat qui écoute la servante ;
- les deux soldats qui attendent le résultat du coup de dés ;
- le soldat vu de dos, qui écoute l’homme qui sort son pouce de sa cape.

La symétrie de la frise nous fait comprendre que ce troisième couple doit être lu en pendant du premier, comme une autre dénonciation : cet homme à la cape, qui a tout d’un traître de comédie, est en train de dénoncer Pierre au chef de l’escouade : nous en sommes donc au Deuxième Reniement.
 La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.
La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.
Le cube organisateur chez Valentin (SCOOP !)

Le concert au bas-relief
Valentin de Boulogne, 1624-26, Louvre
Dix ans plus tard, Valentin réutilisera la plaque Borghese dans cette oeuvre célèbre, dont la profondeur allégorique est peu à peu redécouverte : ainsi le soldat assis au premier plan, qui masque la Mariée du bas-relief et verse du vin dans une carafe d’eau mise au rafraîchissoir est maintenant reconnu comme une figure de la Tempérance ; à l’inverse, l’enfant qui boit goulûment à l’arrière-plan représente l’antithèse, l’Excès ([4], p 153) .
Se pourrait-il que la table cubique, vue ici par la pointe, joue le rôle ici encore d’une sorte de guide de lecture de la composition ?
 Les Quatre Ages de la vie
Les Quatre Ages de la vie
Valentin de Boulogne, vers 1626, National Gallery, Londres
Dans cette autre toile allégorique de la même période, Valentin organise les quatre âges de la vie selon les quatre arêtes du cube :
- l’enfant qui rêve de capture ;
- le jeune musicien qui rêve d’amour ;
- le guerrier d’âge mûr, qui a lu les livres et connu la victoire ;
- le vieillard riche qui se console avec du vin.
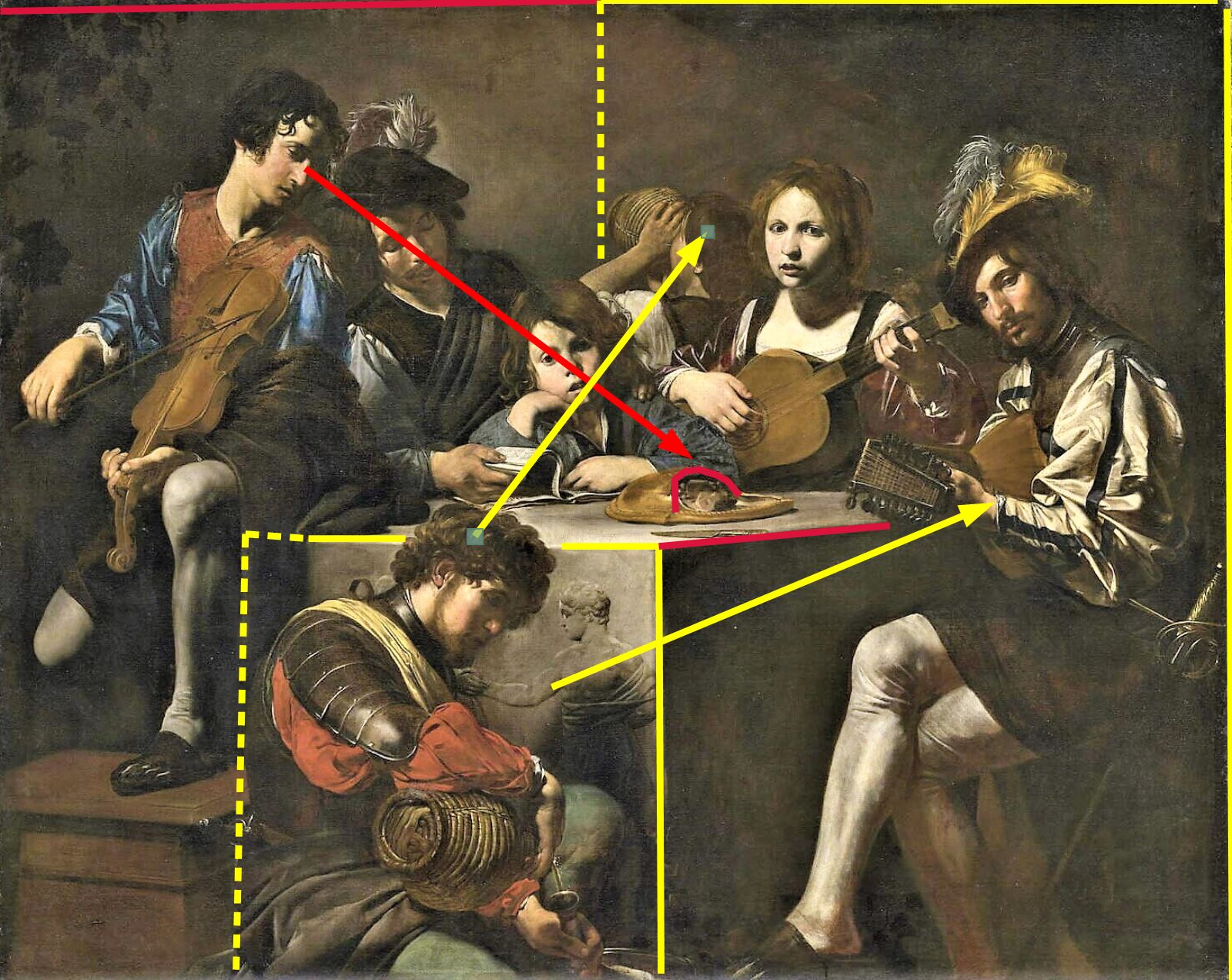
Ici, l’organisation de l’ensemble est moins évidente, même s’il est clair que la face éclairée du cube (la Tempérance, devant le couple antique) se projette dans la moitié droite (l’Excès, derrière le couple moderne).
En poursuivant cette logique, à la face obscure du cube correspondent les personnages de la moitié gauche : le violoniste, le chanteur, et le jeune garçon mélancolique qui, de sa main posée sur la partition, empêche de tourner la page.

Je pense que ce jeune garçon n’est autre que l’allégorie de la Finitude : il interrompt le concert comme le couteau tranche le pâté, et comme l’arête terminale de la frise Borghese clôture son cortège.
Suspens et révélation
 C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :
C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :
- l’un déjà posé,
- le deuxième touchant par l’arête,
- le troisième encore en vol.
Nous en sommes bien au Deuxième Reniement, et cette main qui lance les dés symbolise très exactement la réalisation en trois temps de la prédiction du Christ.

Notre regard monte alors sur ce dialogue entre un plumet blanc et une crète rouge, qui clôt la composition en haut à droite : il nous annonce, visuellement, que le coq chantera bientôt.
 La Diseuse de Bonne Aventure (détail)
La Diseuse de Bonne Aventure (détail)
Valentin de Boulogne, vers 1620, Toledo Museum of Art
L’association d’idée entre béret rouge et crète de coq n’est pas pure spéculation : elle reviendra sous une forme plus explicite dans ce tableau, qui montre le voleur de la gitane à son tour volé par un enfant (sur ce thème, voir 5.5 Vol simple, vol en réunion )


Le reniement de saint Pierre
Valentin de Boulogne, 1623-25, Pushkin Museum, Moscou
Cette version à six personnages revient à l’exercice de style consistant à combiner les deux sujets de Caravage.
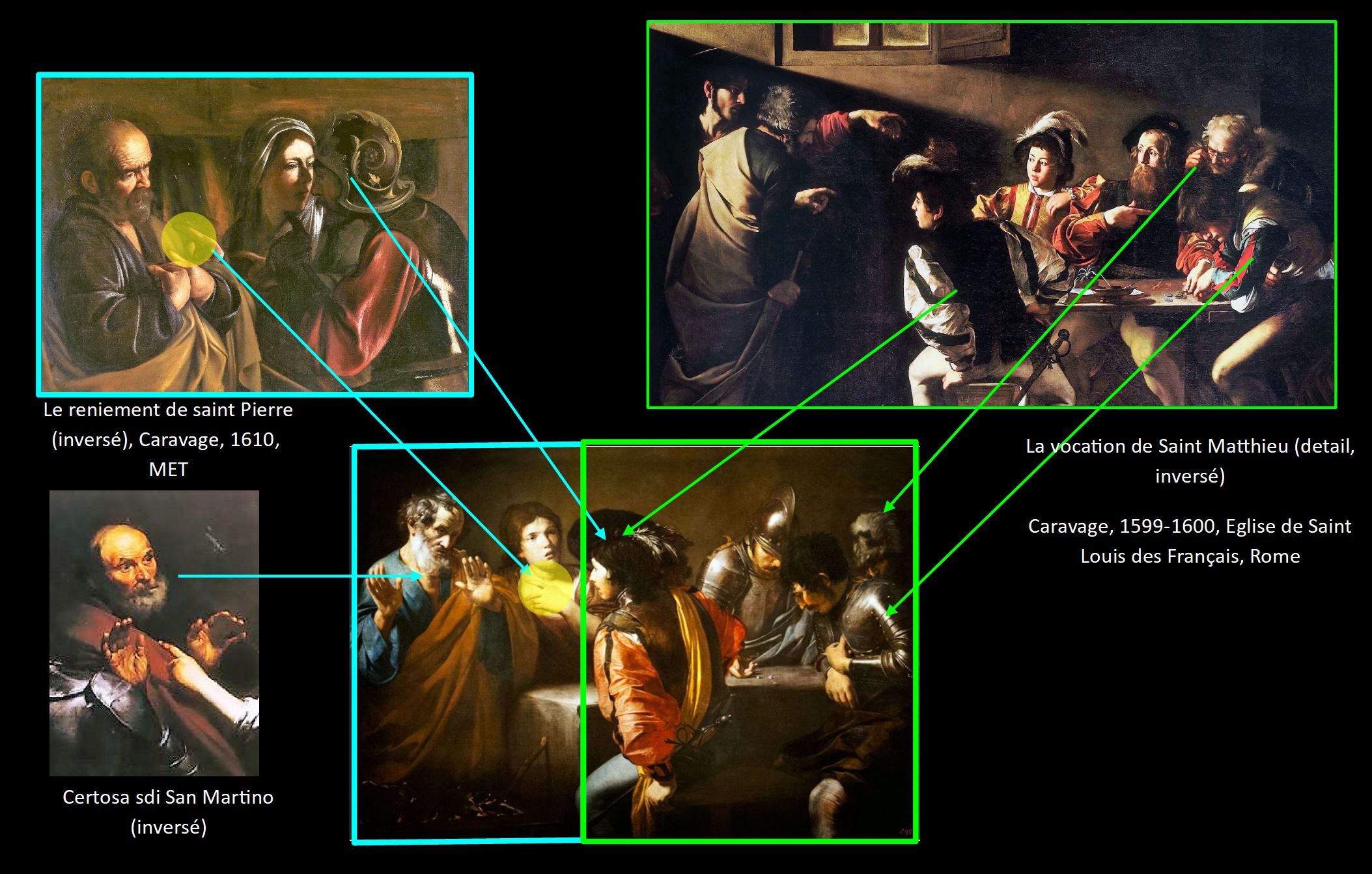
La combinaison est ici franche et assumée :
- la jonction entre les deux sujets est nette, marquée par l’arête du sarcophage ;
- la moitié droite pastiche ouvertement la Vocation de Saint Mathieu :
- la figure pivot (le soldat qui se retourne pour unifier les deux narrations) est une copie presque à l’identique ;
- le soldat de droite scrute les dés comme le percepteur compte les pièces ;
- juste derrière lui, la toque en fourrure est un clin d’oeil au col en fourrure du vieillard aux bésicles ;
- la moitié gauche reprend la structure du Reniement, en modifiant néanmoins Saint Pierre (le geste rare des paumes en avant est peut être une référence au Maître de la Certosa).
Ce tableau ambigu apparaît stylistiquement comme une concession au goût nouveau impulsé par Guerchin (plus rhétorique et moins brutal dans les transitions ombre-lumière), et iconographiquement comme l‘affirmation renouvelée de la filiation caravagesque ([4], p 158).

Les développements en Italie (1620-1630)

Les Reniements de Nicolas Tournier
La datation des oeuvres attribuées à Tournier est entièrement spéculative, basée sur l’influence supposée de Manfredi au départ, puis de Valentin par la suite. Nous resterons donc, pour ses quatre Reniements, sur une datation entre 1620 et 1625, durant la période romaine. L’importance particulière, chez lui, du thème du Reniement est peut être liée à l’obligation d’abjurer sa foi protestante au profit du catholicisme (L.Vertova).
 Collection privée (anciennement Colnaghi) Collection privée (anciennement Colnaghi) |
 Gemäldegalerie, Dresde Gemäldegalerie, Dresde |
Le reniement de saint Pierre, Nicolas Tournier, 1620-25
Ces deux compositions à cinq personnages montrent Pierre au centre, assis ou debout, se chauffant au dessus du brasero et se couvrant de la main droite. Le thème du jeu, supposé connu, n’est évoqué que de manière allusive par la position du soldat de droite, affalé ou endormi sur la table. Ces ingrédients très semblables sont néanmoins combinés de manière très différente.
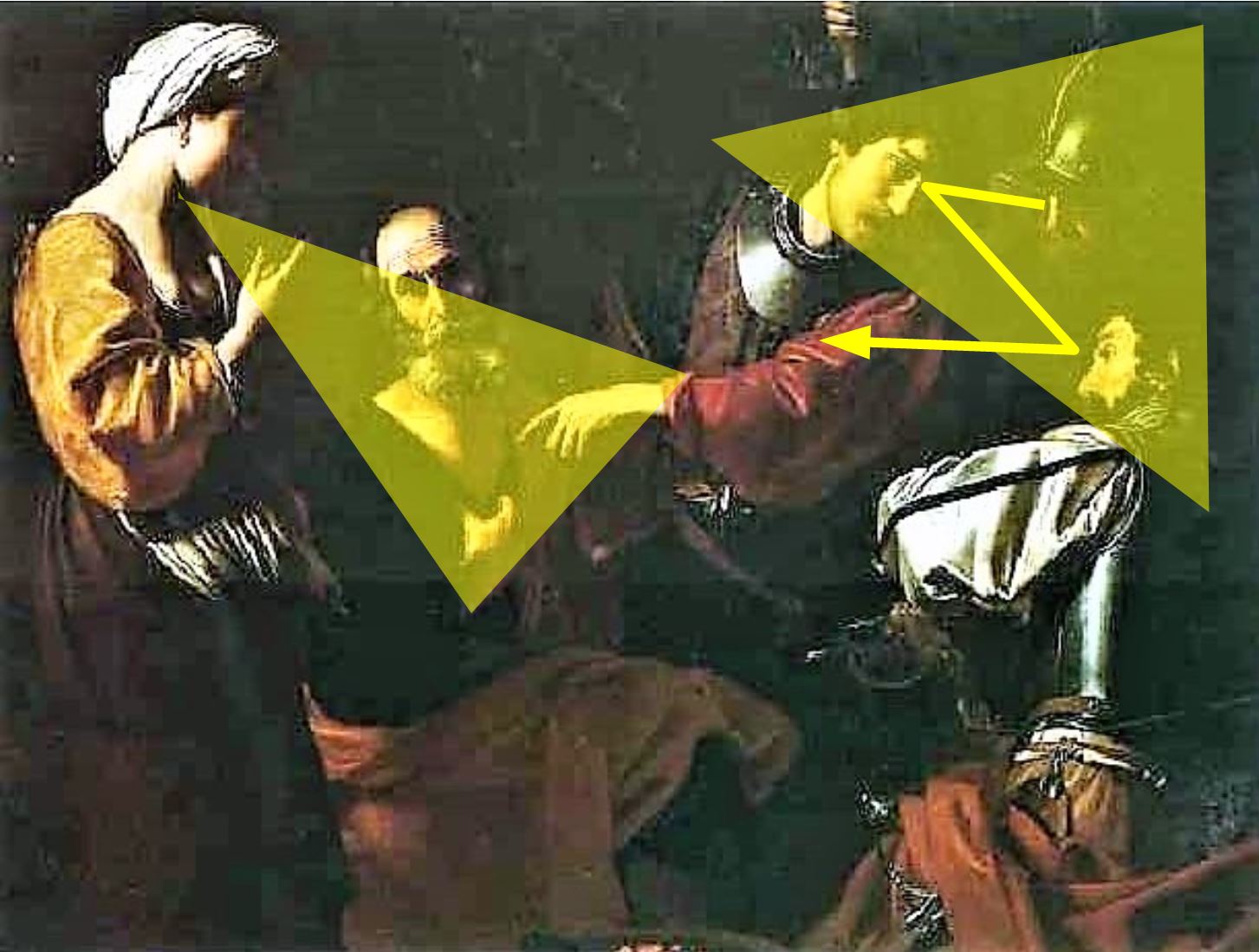
Dans le Reniement Colnaghi, le soldat debout fait pivot entre les deux thèmes, répartis équitablement dans les deux moitiés. Il participe à la fois :
- à un triangle de mains (index qui énonce, index qui dénonce, main qui serre le vêtement) ;
- à un triangle de visages, sorte de prisme d’où le regard finit par s’échapper vers la gauche.
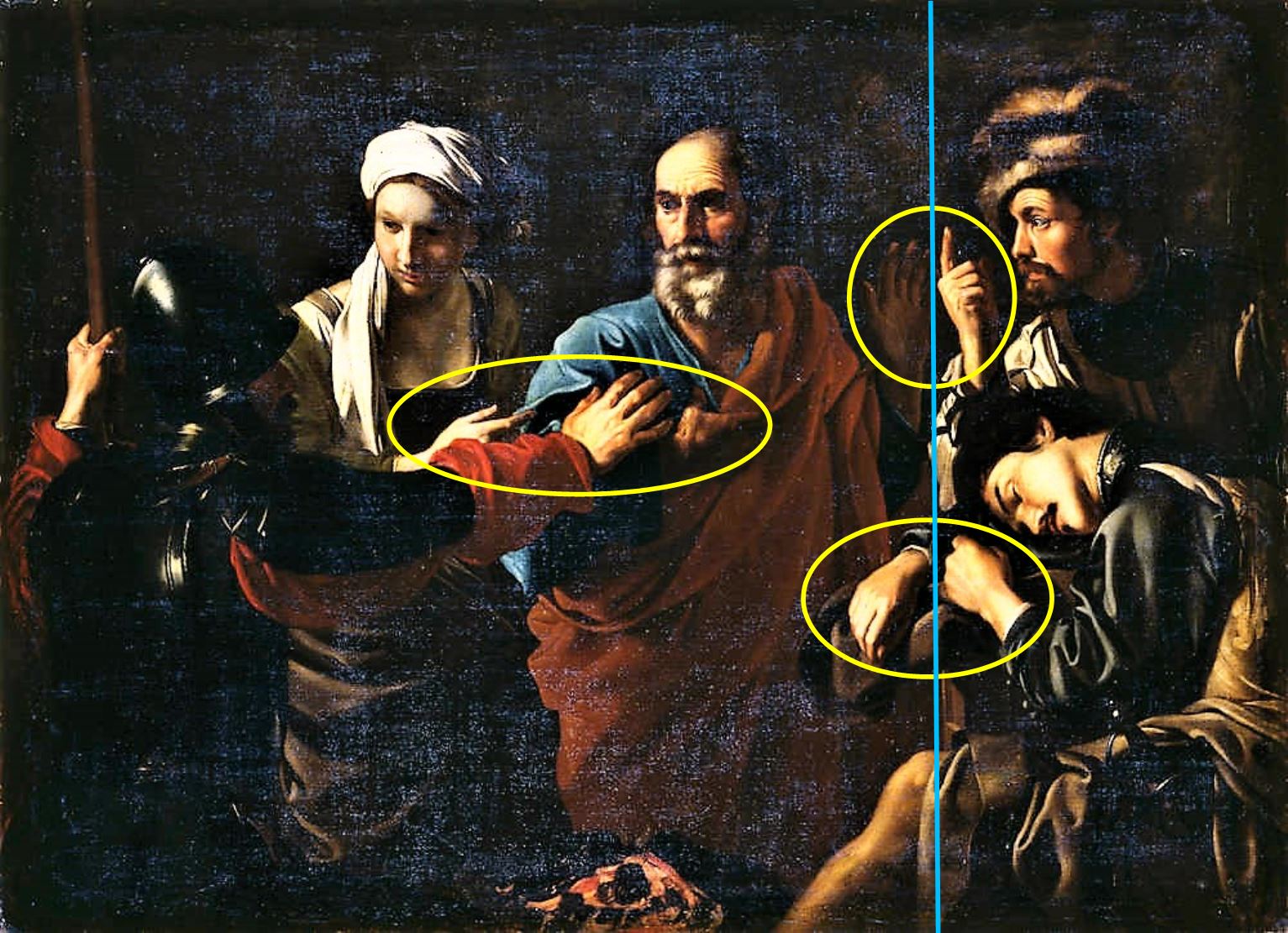
Dans le Reniement de Dresde, les deux sujets sont disjoints et d’importance inégale :
- la partie Dénonciation se condense, au centre, en une chaîne horizontale de mains ;
- la partie Tripot se confine à une bande étroite sur la droite, délimitée verticalement par deux groupes de mains jointives.
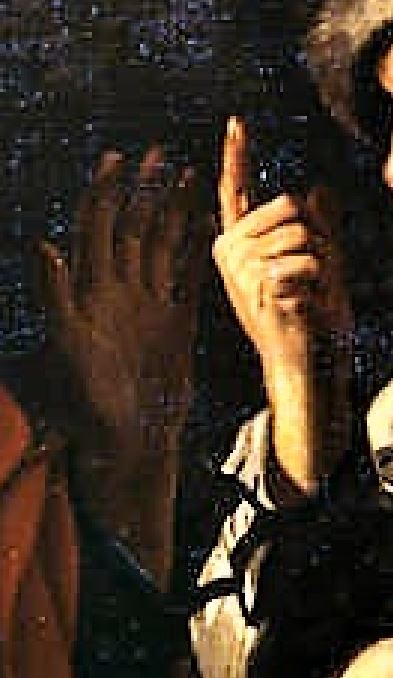
Cette limite fortement marquée attire l’oeil sur la trouvaille graphique majeure des deux mains qui prennent le ciel à témoin :
- en pleine lumière, l’index levé qui confirme la dénonciation ;
- dans la pénombre, la paume levée du faux serment.
Ce jeu de lumière, à lui seul, résume toute l’affaire : le recul de l’apôtre devant la menace du soldat.

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Nicolas Tournier, 1620-25, High Museum of Art, Atlanta
On retrouve le même geste du serment dans la pénombre au centre de cette vaste composition à huit personnages, qui constitue une double citation, de Tournier lui-même et de Valentin.
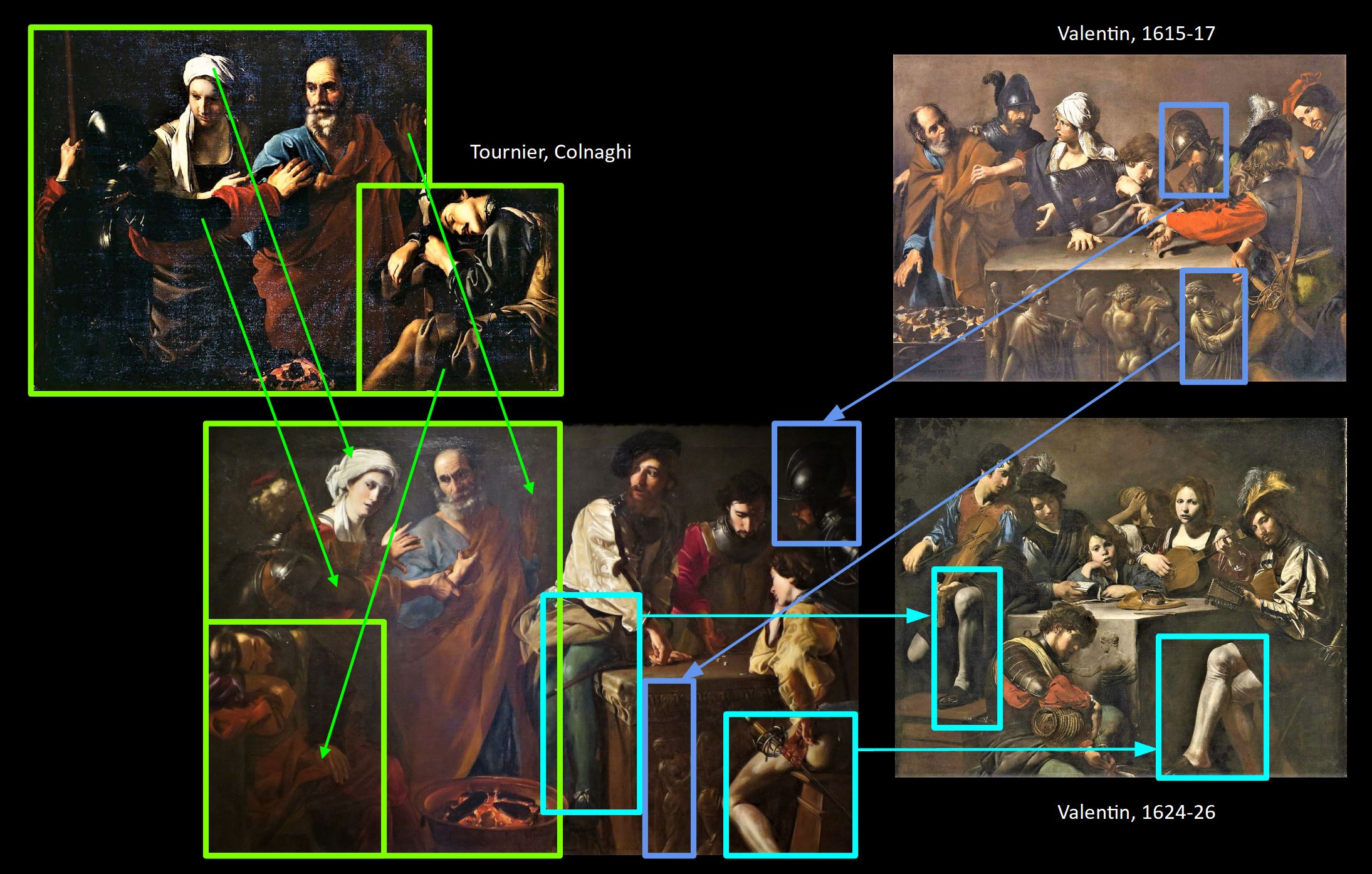
Le principe des deux sujets disjoints est celui du Reniement Colnaghi, que la moitié gauche reprend directement.
La moitié droite est un citation du Reniement de Valentin de 1615-17 : Tournier réutilise le même décor (le sarcophage à droite du brasero) et le personnage du soldat casqué. Dans le bas-relief, il dévoile un personnage supplémentaire de la plaque Campana : la Mariée à droite de la servante. D’une certaine manière, les quatre jeunes et séduisants joueurs répartis autour de cette scène nuptiale tronquée, sont comme les substituts modernes de l’époux antique, masqué par une jambe satinée.
L’idée de ce soldat assis à droite en repoussoir, ainsi que celle du soldat assis sur le coin du sarcophage, pourraient bien être des innovations de Tournier, que Valentin aurait reprises ensuite dans son Concert au bas-relief de 1624-26 : enfin apparaît le Mari, concluant ce fascinant jeu de ping-pong artistique autour de la plaque Campana !
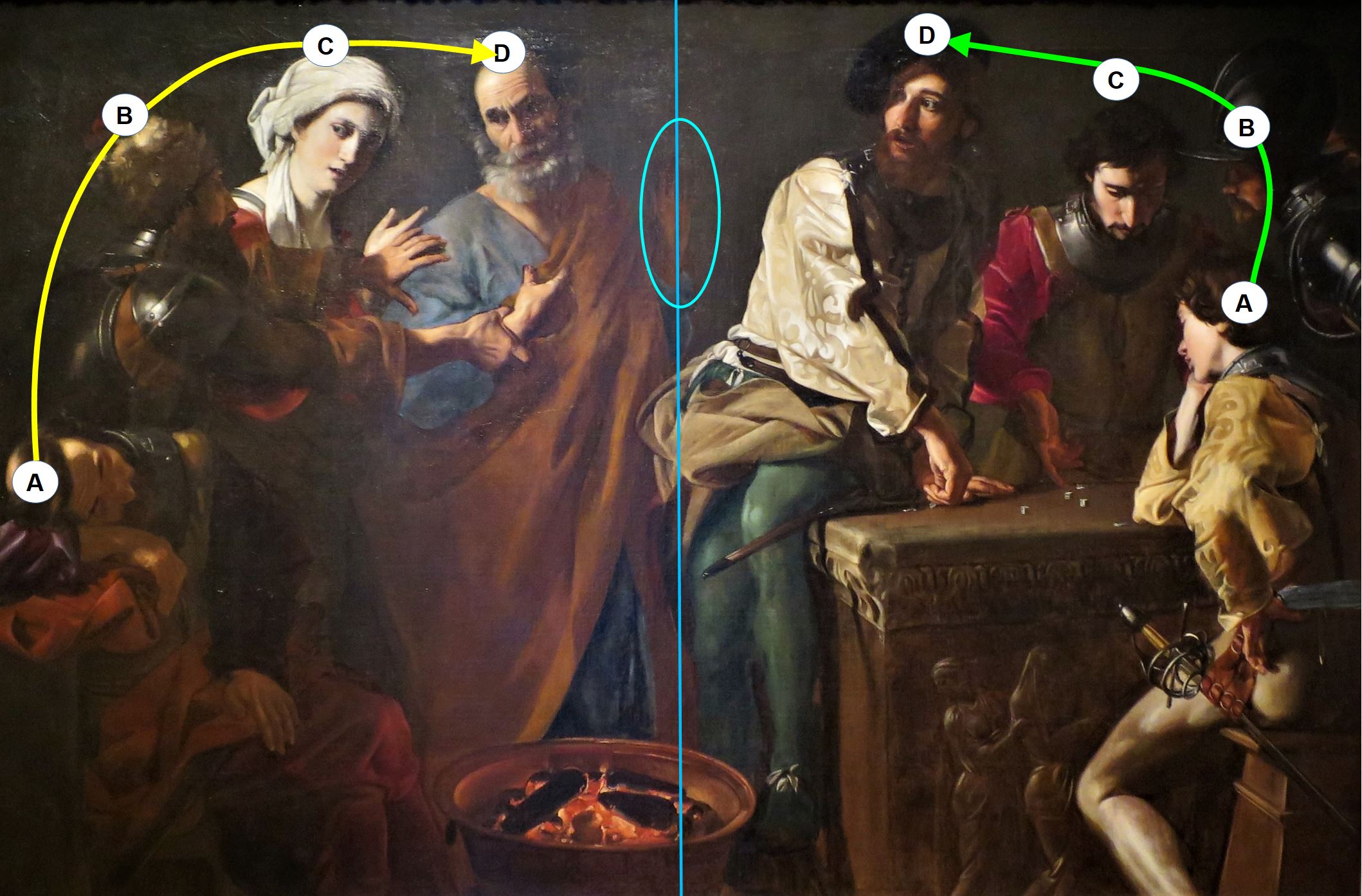
Quoiqu’il en soit, l’oeuvre ne se limite pas à un collage de morceaux antérieurs : elle développe une scansion interne, à la Manfredi, entre les quatre personnages de part et d’autre, conduisant l’oeil vers la « lettre volée » du tableau : le faux serment en plein milieu.

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Nicolas Tournier, 1620-25, Prado
Le Reniement le plus sophistiqué de Tournier vient probablement, en apothéose, à la suite des précédents, vers la fin de la période romaine.
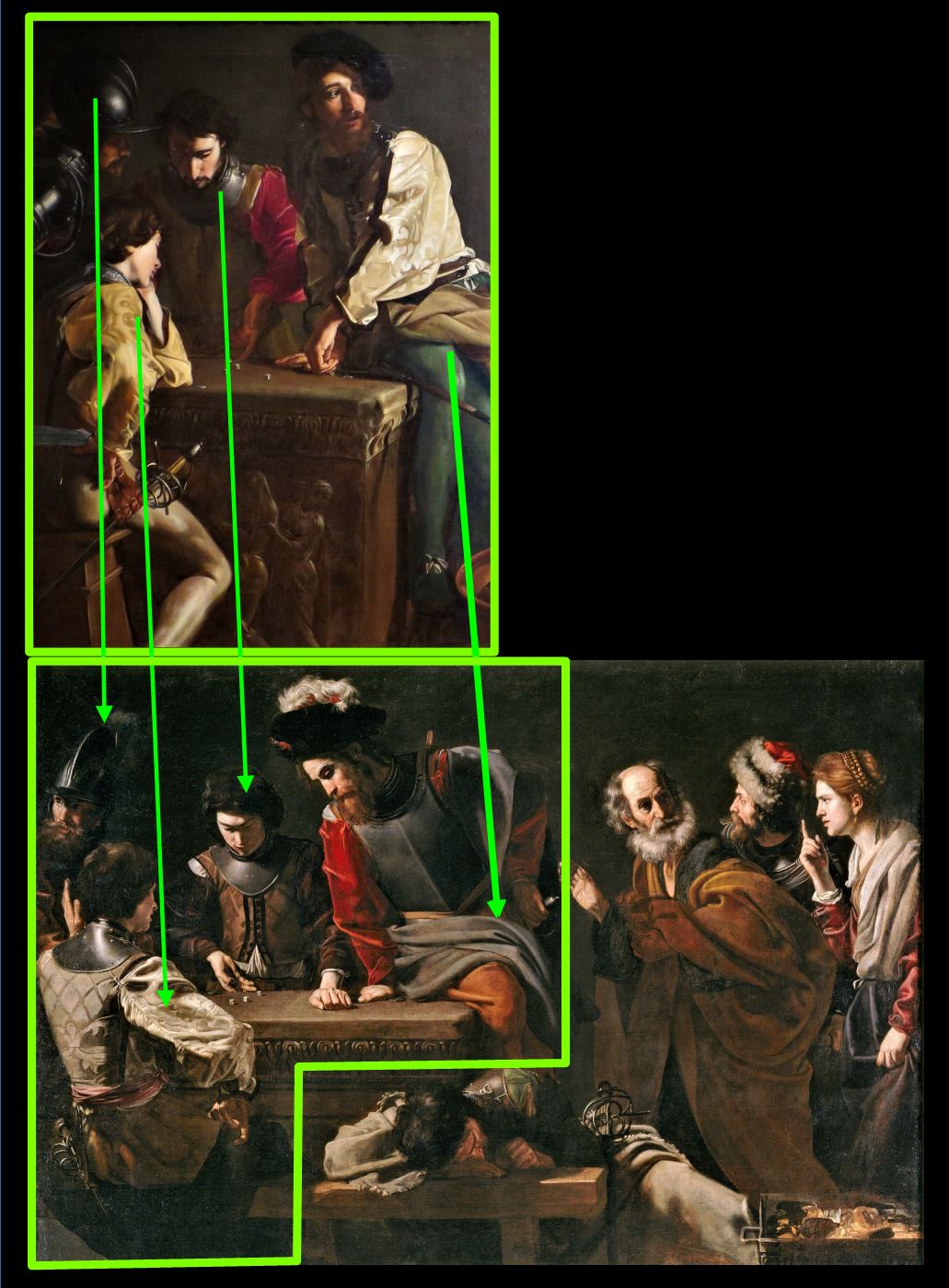
Techniquement, la composition revient à la composition originelle de la Vocation de Saint Mathieu : le thème des Joueurs passe à gauche, et inverse littéralement la moitié « Joueurs » du Reniement d’Atlanta. Les deux thèmes sont maintenant totalement déconnectés puisque la figure pivot, celle du Joueur assis sur la pierre, ne se retourne même pas vers la scène du Reniement.

Celle-ci ne ressemble à rien de connu : un Saint Pierre dont le faux serment s’effectue maintenant en pleine lumière, et de la main droite, est mis en fuite par un soldat sévère, qui le retient de la main gauche par sa robe, et par la servante menaçante, qui tient de la main gauche sa propre robe.
Cette belle femme à la coiffure soignée ne pouvait manquer de convoquer, dans l’imaginaire du spectateur, une autre rousse flamboyante…
 Le Christ et la femme adultère (détail)
Le Christ et la femme adultère (détail)
Valentin de Boulogne, 1620-25, Getty Museum
…cette Pècheresse que Valentin nous montre environnée de soldats : comme si l’accusée, autrefois libérée par Jésus, revenait en accusatrice pour venger la trahison de l’Apôtre.

Voilà qui jette un éclairage nouveau sur la grand scène centrale : l’autre personnage roux du tableau, assis sur la pierre au dessus d’un soldat endormi près d’un brasero, convoque à son tour une autre image forte : celle du Christ sorti du tombeau qui tournerait le dos à Pierre.
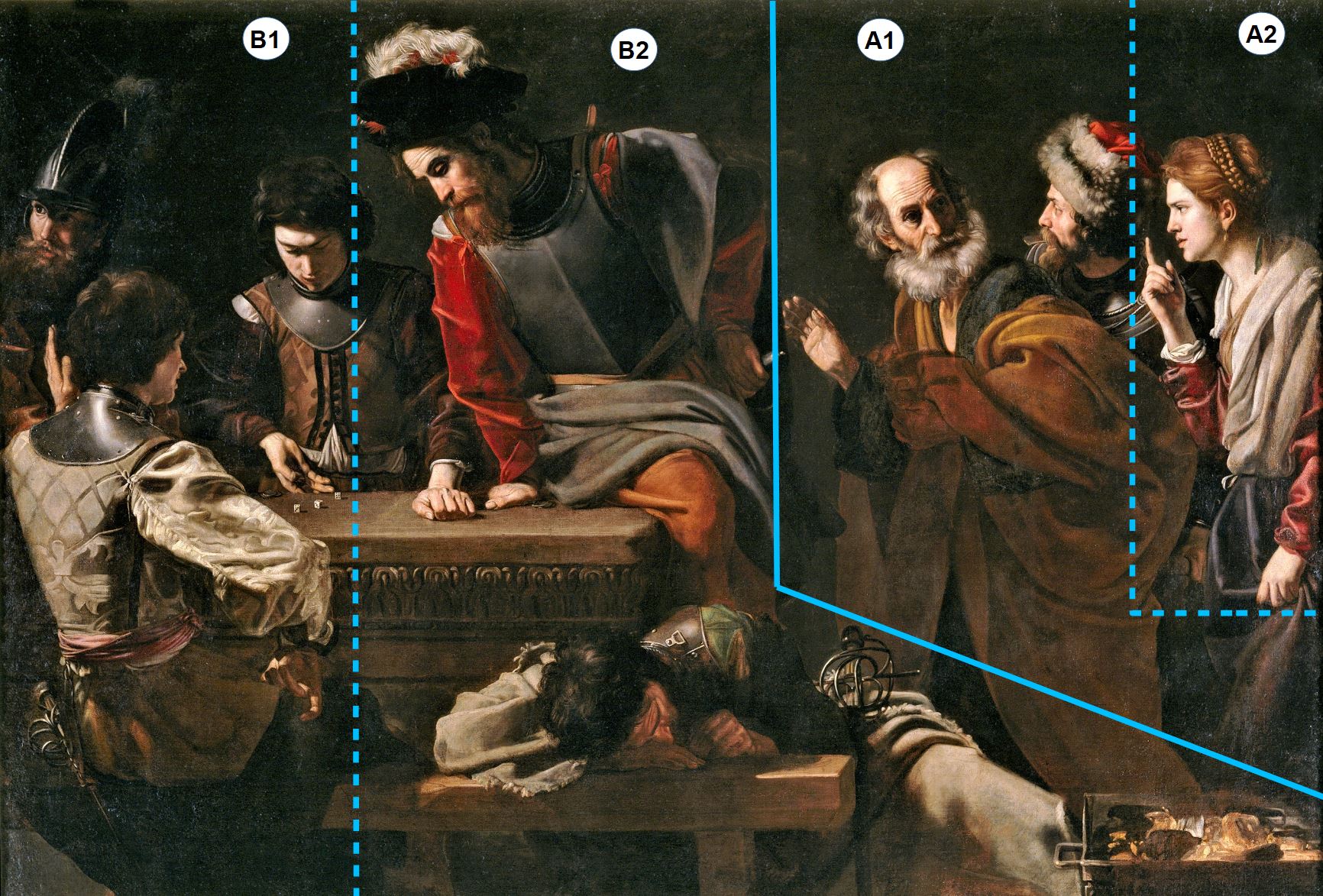
Plutôt qu’un collage de figures empruntées ici ou là, cette composition procède d’une manière totalement innovante, en suggérant deux sous-thèmes imaginaires à l’intérieur des précédents :
- la « Vengeance de la Femme adultère » (A2) vient se superposer au Reniement de Pierre (A1) ;
- le « Dédain du Christ ressuscité » (B2) vient se superposer aux Joueurs de dés (eux-même évoquant lointainement le Calvaire).

Autres Reniements italiens
Deux reniements attribués à Jean Ducamps
 Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples |
 Museo civico, Macerata Museo civico, Macerata |
Le reniement de saint Pierre, attribué à Jean Ducamps, 1624-27
Après des attributions variées, ces deux Reniements sont donnés aujourd’hui au même peintre, Jean Ducamps (Giovanni del Campo). Il est vrai que les deux compositions, qui fonctionnent en sens inverse, présentent des similitudes :
- brasero en position centrale à côté de la table à jouer ;
- soldat au béret de coq assis au premier plan, qui désigne Pierre par dessus la table.
 Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples |
 Nicolas Tournier, vers 1625, Gemäldegalerie, Dresde Nicolas Tournier, vers 1625, Gemäldegalerie, Dresde |
Dans la tableau de Naples, les quatre mains qui s’enchaînent au dessus du brasero semblent une surenchère par rapport à l’idée de Tournier dans son Reniement de Dresde.
Une oeuvre isolée

Le reniement de saint Pierre
Anonyme, 1620-25 , Kunsthistorisches Museum, Vienne
La présence de l’architecture invite à une lecture ternaire :
- un jeune officier planté statiquement à côté de Saint Pierre ;
- dans le rôle du pivot, la servante, ou plutôt la prostituée (à voir sa collègue qui enlace par derrière un des joueurs) ;
- une table où l’on boit et où l’on joue aux cartes (deux s’envolent).
Cette composition déconcertante et sur laquelle on ne sait rien tranche complètement avec les oeuvres que nous avons vues jusqu’ici, qui toutes s’inscrivaient dans la « méthode Manfredi » (personnages en cadrage serré, sans perspective, sans décor).

Les développements en Flandres ou en Hollande (1620-1630)
A partir de 1620, les artistes flamands ou hollandais se différencient par l’éclairage à la bougie et le jeu de cartes, qui remplace le jeu de dés.

Honthorst
 avant 1620, Musée de Rennes avant 1620, Musée de Rennes |
 1620-25, Collection particulière 1620-25, Collection particulière |
Le reniement de saint Pierre, Gerrit van Honthorst,
Réalisés l’un à Rome, l’autre après son retour à Utrecht, les deux Reniements au jeu de cartes de Honthorst se caractérisent par deux innovations :
- la scène devient nocturne, éclairée par deux sources de lumière,
- le soldat en repoussoir unifie les deux scènes, en étendant son bras pour agripper Saint Pierre.

On remarque dans la seconde toile le souvenir de la composition de Valentin, jusqu’à l’homme à la cape : c’est ici un complice qui, avec ses doigts, donne un indice au tricheur…

…ou au spectateur : nouvelle manière, encore plus discrète que les dés, d’évoquer les Trois reniements.
La substitution du jeu de cartes au jeu de dés ouvre un nouveau champ symbolique, qui remplace l’allusion à la Crucifixion par une métaphore plus immédiate : la trahison de Pierre est une sorte de tricherie.

Seghers
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Gerard Seghers, 1620-25, NCMA, Raleigh
Cette scène particulièrement mouvementée sera très célèbre, grâce à sa gravure.
 Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl
Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl
Cinquante ans plus tard, Immenraet la recopiera encore, en complétant le bas des corps.

Cette popularité tient probablement au caractère didactique et synthétique de la composition, ainsi qu’à ses devinettes :
- les escarbilles à peine visibles, à gauche au dessus de la servante, font deviner le brasero ;
- le joueur vu de dos profite de l’agitation pour mettre une main sur les pièces, et de l’autre pour changer ses cartes dans son dos ;
- l’index pointé de la servante évoque le Premier reniement (1);
- les mains posés sur Pierre du soldat au casque évoquent le Deuxième (2);
- la main qui saisit son poignet évoque le Troisième (3a), d’autant mieux que le béret et le plumet de l’homme, désignés par le geste appuyé d’un autre soldat (3b), font voir le Coq.
 Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle,
Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle,
Willem van Hacht, vers 1630, Mauritshuis, La Haye
Seghers a dû peindre un autre Reniement au jeu de cartes, cette fois avec des personnages en pieds, dont il nous reste seulement cette miniature.

Autres hollandais ou flamands
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Peter Wtewael, 1624-28, 1972.169, Cleveland Museum of Art
L’idée du soldat debout en repoussoir est venue aussi à Peter Wtewael, dans ce contrejour spectaculaire qui frise avec l’ambiance démoniaque d’une Tentation de Saint Antoine : Pierre se trouve non pas désigné, mais moqué par la servante qui lui a chipé ses clefs, et cerné par un groupe d’hommes ricanants, hérissés de plumes de coq.
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Théodore Rombouts, 1625–30 , Collection du prince de Liechtenstein, Vienne
On retrouve encore le « coq » en plein centre de ce reniement, réalisé à Anvers vers la fin de période où Seghers peignait les siens.
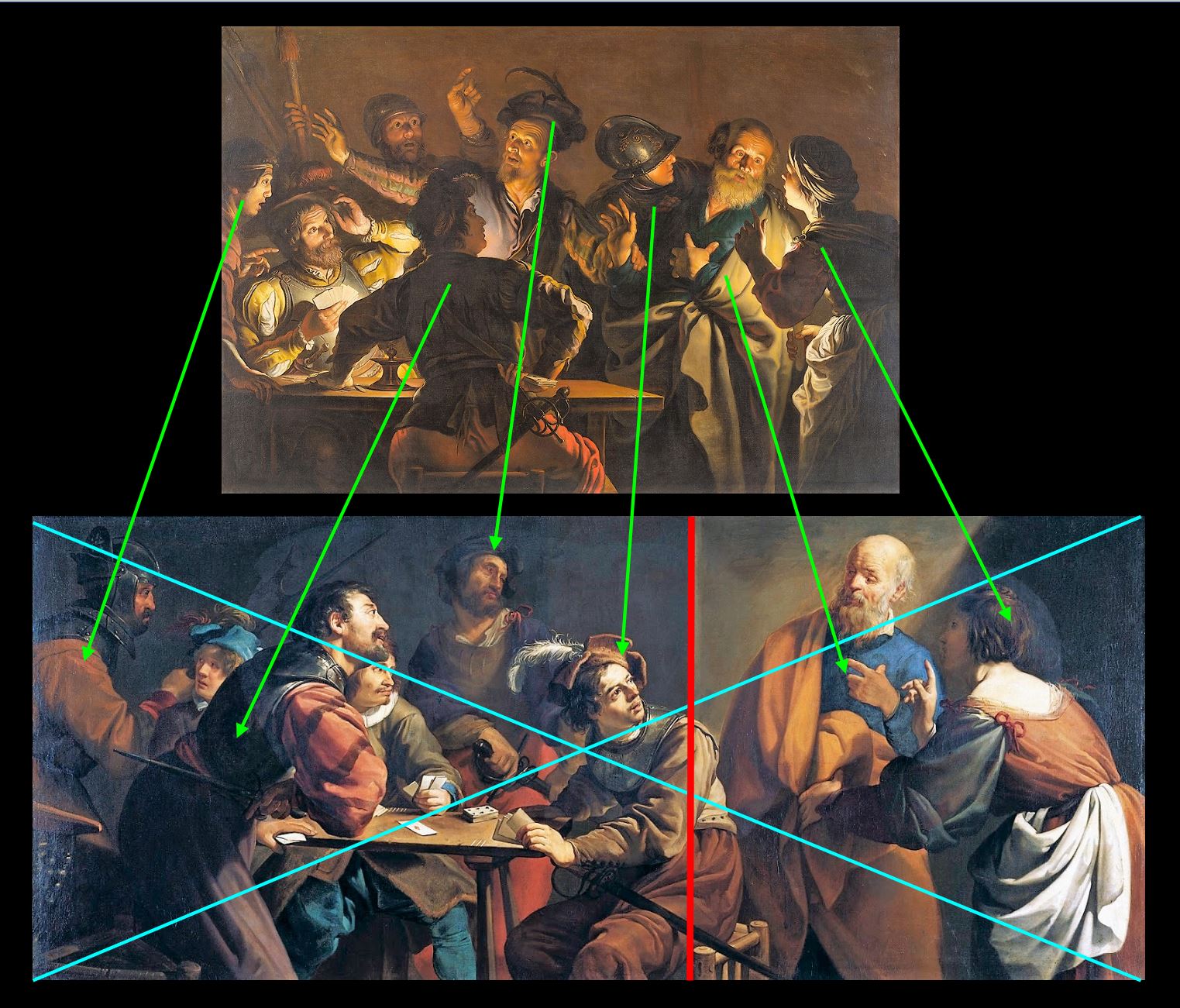
Rombouts s’inspire de la composition la plus célèbre de Seghers (six soldats jouant aux cartes, tous conscients de la dénonciation de Pierre), en l’inversant et en amplifiant son horizontalité, ce qui lui permet de séparer nettement les deux scènes (ligne rouge). Le remplacement des deux bougies par un rayon oblique tombant de la droite fait retour à l’ambiance lumineuse de la Vocation de Caravage.

Georges de La Tour
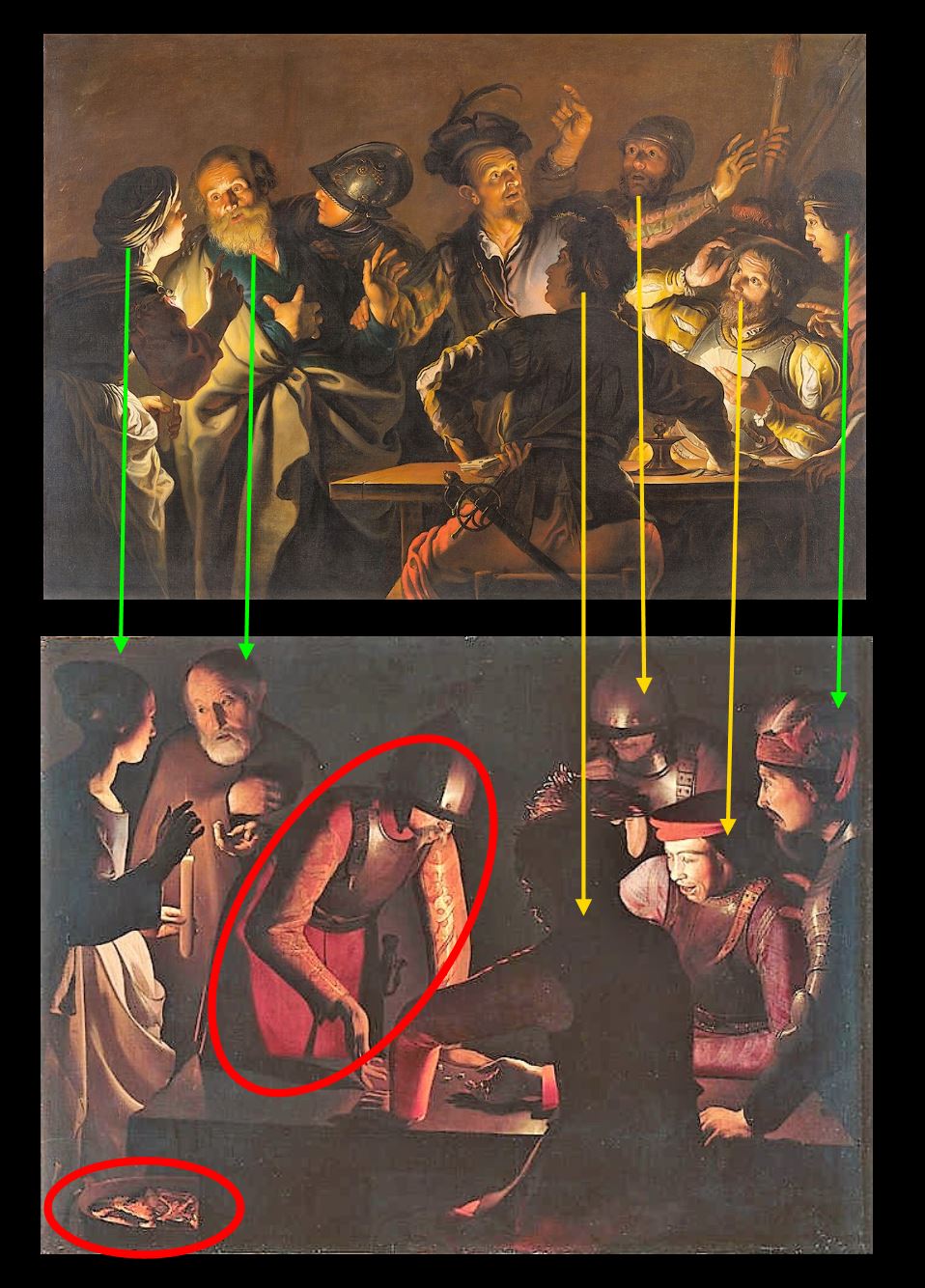 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Georges de La Tour, vers 1650, Musée de Nantes
Trente ans après Seghers, Georges de La Tour adapte à nouveau la célèbre composition :
- trois personnages sont repris pratiquement à l’identique (flèches vertes) ;
- trois sont fortement inspirés (flèches oranges) ;
- le jeu de cartes devient un jeu de dés.
La Tour a remplacé les deux soldats centraux par un soldat qui se penche vers la table (cercle rouge). Ainsi tous ont maintenant les yeux rivés sur le jeu (sauf le soldat debout à l’extrême droite) : en supprimant le soldat-coq et en déconnectant nettement les deux thèmes, La Tour a donc ramené la composition synthétique de Seghers (les Trois Reniements mélangés) à un sujet univoque : celui du Premier Reniement.
Ainsi recomposé, le tableau didactique devient moralisateur : il présente côte à côte, par le parjure ou par le jeu, deux manières de se perdre [6].

Les surenchères terminales (1620-1650)
La vue frontale s’épuisant, on en vient à des points de vue de plus en plus élaborés.

 Le Reniement de St Pierre
Le Reniement de St Pierre
Orazio di Ferrari, 1625-57, Capodimonte, Naples, photothèque Zeri.
Cette composition étage les plans diagonalement :
- en haut le bras de la servante masque Saint Pierre qui masque un soldat qui en masque deux autres ;
- en bas la ferronnerie à l’avant du brasero précède la ferronnerie à l’arrière, suivie par la main du Saint à l’avant de la table,
- puis par la main du soldat à l’arrière.

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Adam de Coster, vers 1630, collection particulière
Même progression diagonale, mais à rebours, depuis la table des gardes. On retrouve les deux bougies cachées, appréciées des peintres hollandais.

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Leonard Bramer, 1642, Rijksmuseum
Réalisé à Delft, ce tableau très original sonne comme un anachronisme, dans une Hollande où le caravagisme est terminé depuis 1630. Bramer abandonne d’ailleurs le cadrage étroit, passé de mode, pour montrer des figures en pied (le haut et le bas de la toile ont probablement été recoupés).
Dans un point de vue encore plus anticonformiste, Bramer relègue dans la pénombre et à l’arrière-plan la scène principale (la servante, un soldat et Pierre) tandis qu’au premier plan se déroule une scène énigmatique, un soldat qui semble examiner une tombe à la lumière d’une bougie
En fait, le sarcophage n’est qu’une table à jouer. En faisant mine de chercher quelque chose, le soldat en profite pour glisser un oeil sur le jeu de son partenaire.

Comme dans le Reniement de Terbrugghen, on devine en haut a gauche le départ du Christ, poussé par deux soldats.
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Leonard Bramer, 1625-26, collection privée
A noter que vingt ans plus tôt, à la fin de son séjour à Rome, Bramer avait déjà réalisé ce Reniement de Saint Pierre plus conforme au schéma caravagesque, mais transfiguré par le plan large et la mise en scène théâtrale qui caractérisent son style : à noter la symétrie entre la lampe à huile, côté cheminée, et le croissant de lune, côté coq.

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Bernardo Cavallino, vers 1640, Capodimonte, Naples
A la même époque en Italie, Cavallino exploite la même idée que Bramer (reléguer à l’arrière-plan le sujet principal) dans cette composition théâtrale, bordée à gauche par une sorte de maître de ballet au bâton; et à droite par un rideau rouge.

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
Rembrandt, 1660, Rijksmuseum, Amsterdam
Terminons par cette fusion spectaculaire des deux thèmes, non pas latéralement mais dans la profondeur de champ.
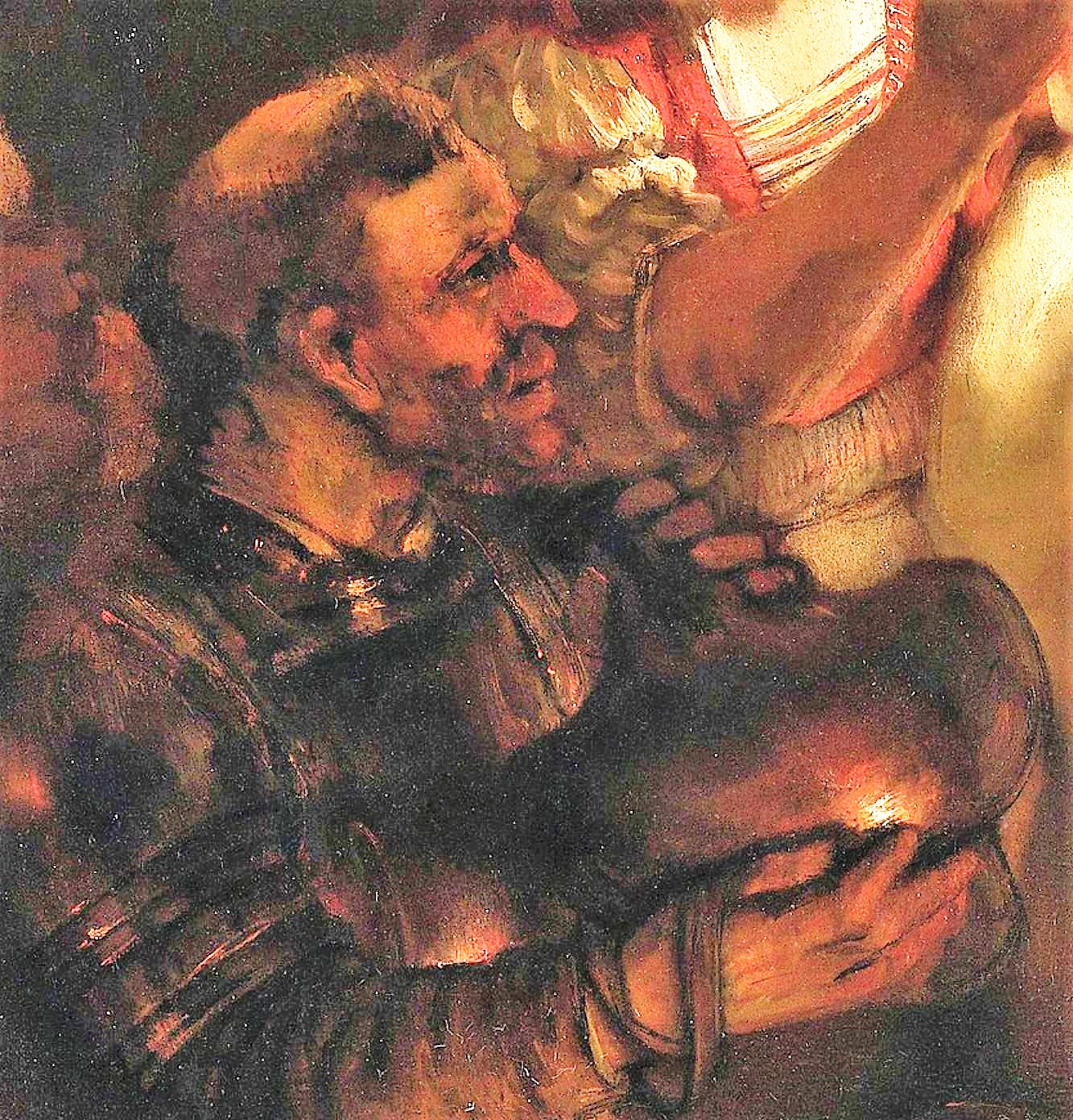
Au premier plan, dans la pénombre, la scène du tripot se résume à deux soldats, dont l’un boit dans une de ces gourdes métalliques que Rembrandt affectionnait pour ses reflets. Le thème négatif , le jeu, est remplacé par la boisson.

A l’arrière-plan, dans la pénombre également, on devine en contrepoids le héros positif : le Christ emmené au Sanhédrin, jetant un dernier regard à Saint Pierre.
Au plan médian, en pleine lumière, en équilibre entre le Mal et le Bien, celui-ci n’aurait qu’à se retourner pour répondre au regard du Maître. Mais il reste obnubilé par la Servante, inconscient du signe qu’au seul spectateur elle adresse avec ses doigts : le chiffre Trois de la prédiction.

Références :
[3] » Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli. 1608-1624″. Catalogo della mostra (Napoli, settembre 2011-gennaio 2012), p 150.
[4] Keith Christiansen, Annick Lemoine… « Valentin de Boulogne – Réinventer Caravage »
![]()
 Prédiction de Jésus
Prédiction de Jésus Reniement de Pierre devant la servante
Reniement de Pierre devant la servante![]()
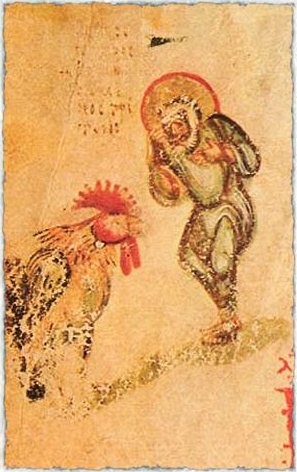 Psaultier Chludov, 9ème siècle, fol 38v.
Psaultier Chludov, 9ème siècle, fol 38v.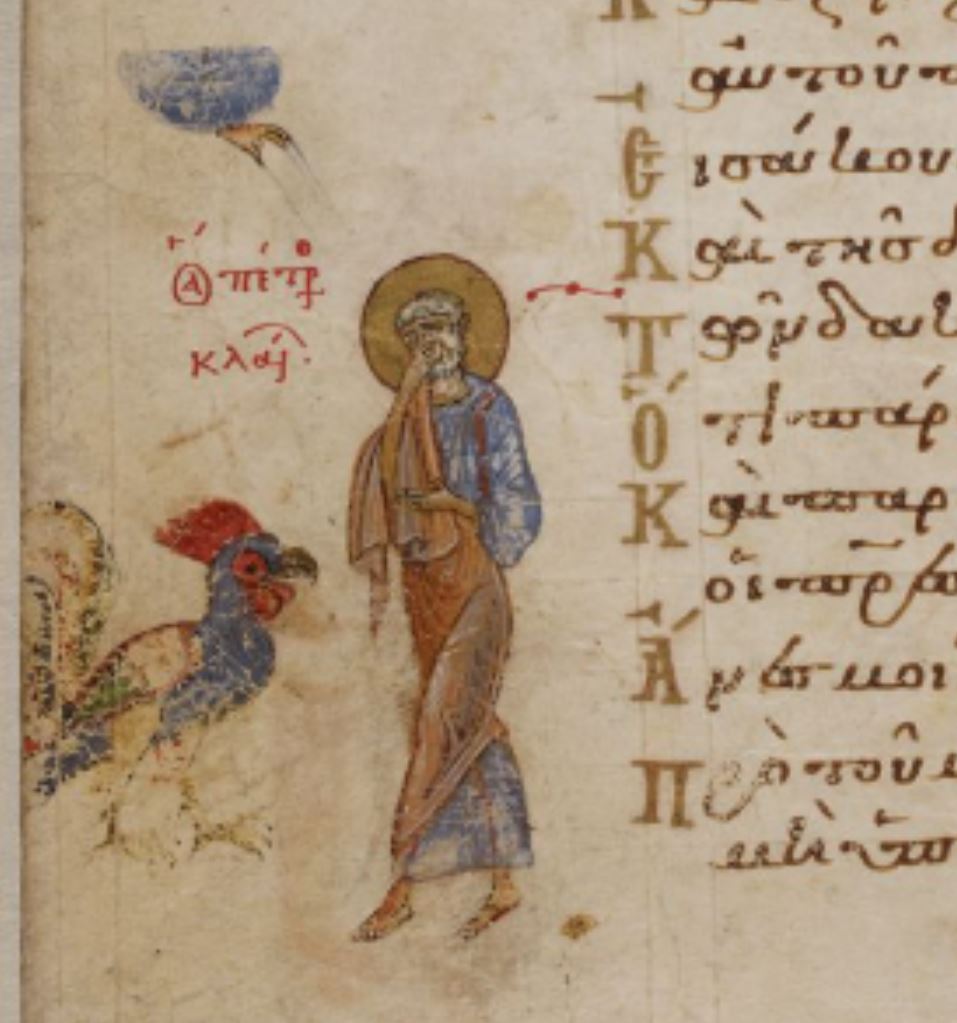 Psautier de Théodore, 1066, BL Add MS 19352 fol 47v (détail)
Psautier de Théodore, 1066, BL Add MS 19352 fol 47v (détail)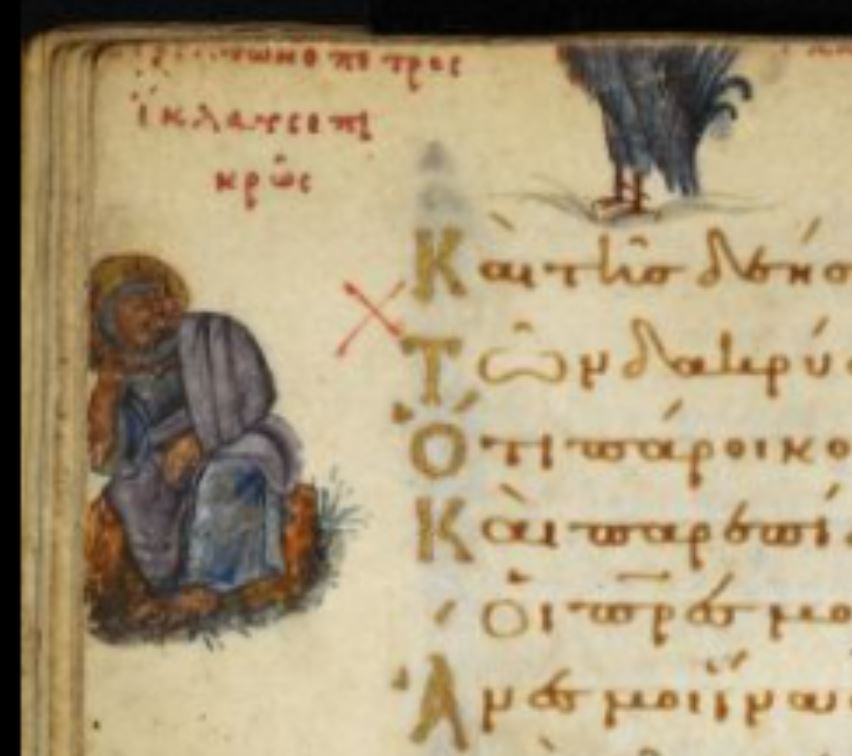 Psautier de Bristol, 11ème siècle, BL Add MS 40731 fol 65v (détail)
Psautier de Bristol, 11ème siècle, BL Add MS 40731 fol 65v (détail)![]()
 Psautier de Stuttgart, 800-50, Württembergische Landesbibliothek, Cod.bibl.fol. 23, fol. 49r
Psautier de Stuttgart, 800-50, Württembergische Landesbibliothek, Cod.bibl.fol. 23, fol. 49r![]()
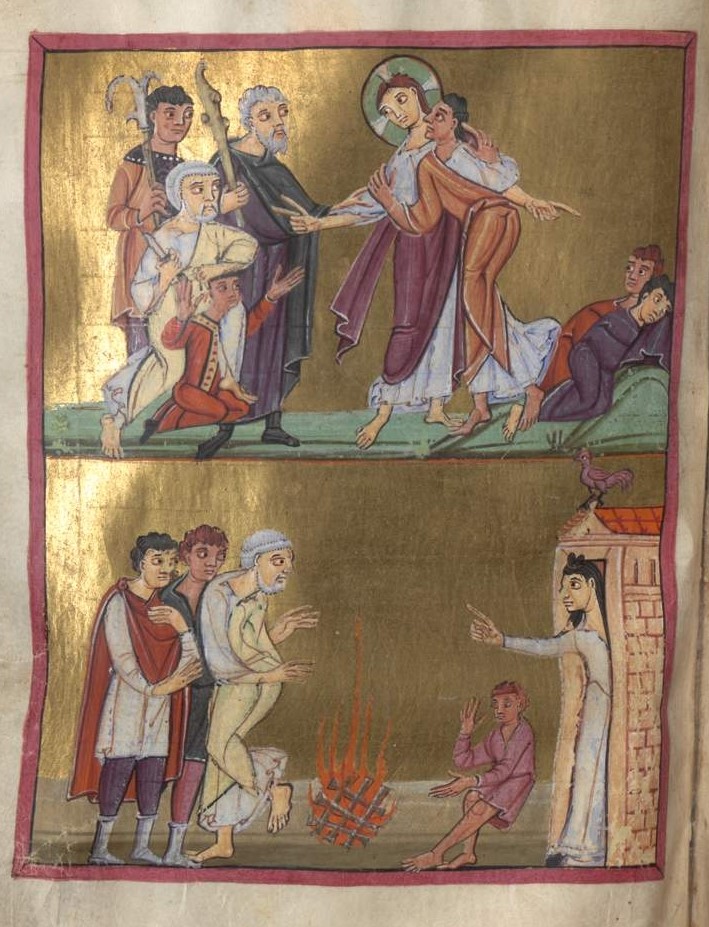 Evangéliaire de Reichenau, vers 1020, Clm 23338, fol. 81v, Bayerische Staatsbibliothek Münich
Evangéliaire de Reichenau, vers 1020, Clm 23338, fol. 81v, Bayerische Staatsbibliothek Münich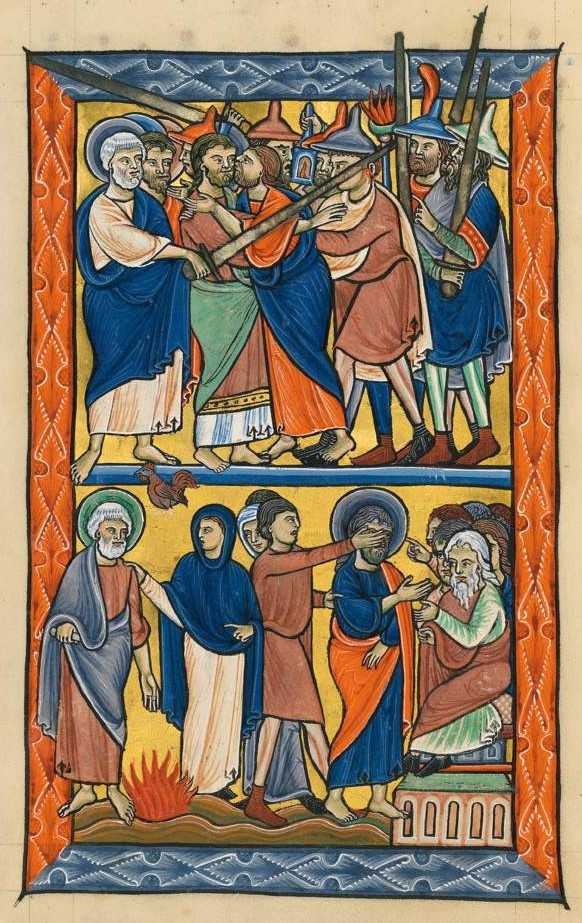 Psautier anglais, 1190-1210, Clm 835, fol. 25v, Bayerische Staatsbibliothek, Münich.
Psautier anglais, 1190-1210, Clm 835, fol. 25v, Bayerische Staatsbibliothek, Münich.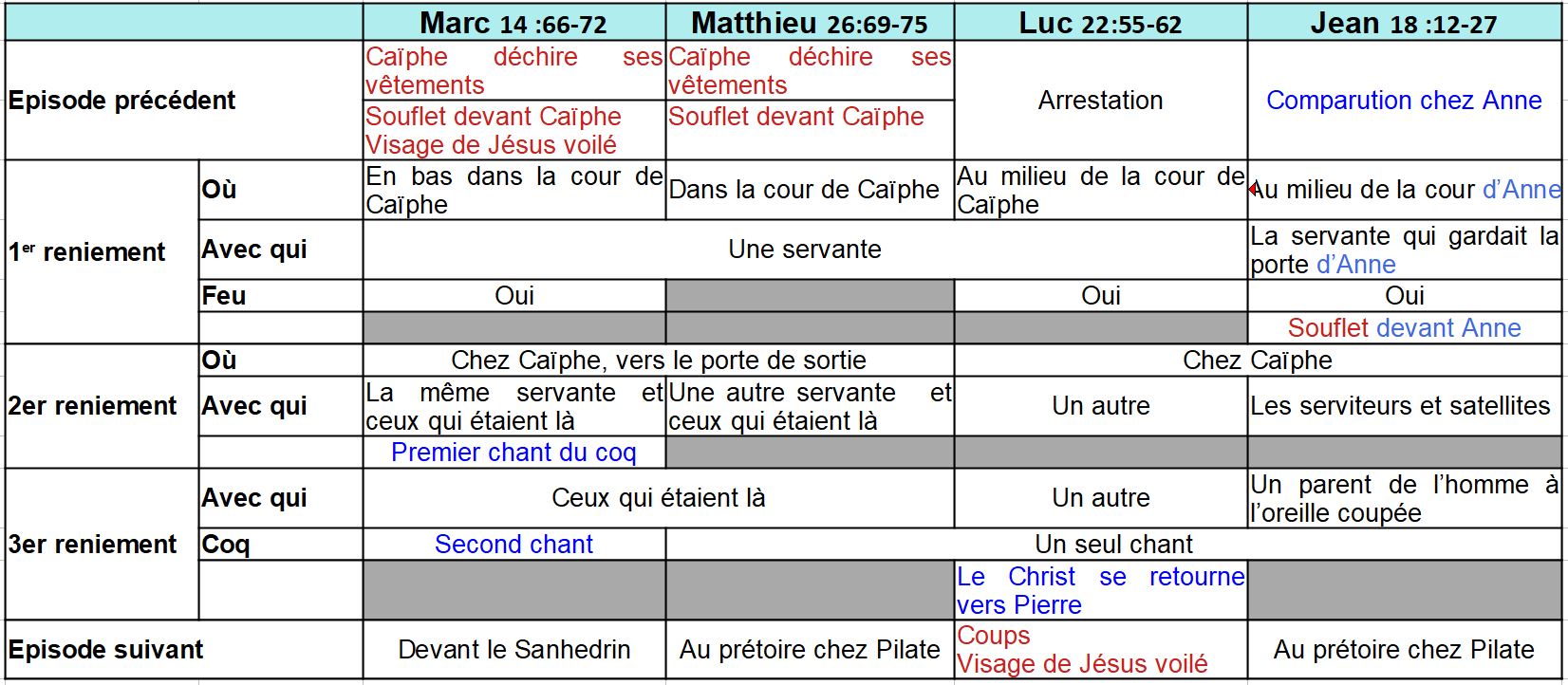 En bleu : détail présent dans un seul Evangéliste. [2]
En bleu : détail présent dans un seul Evangéliste. [2]

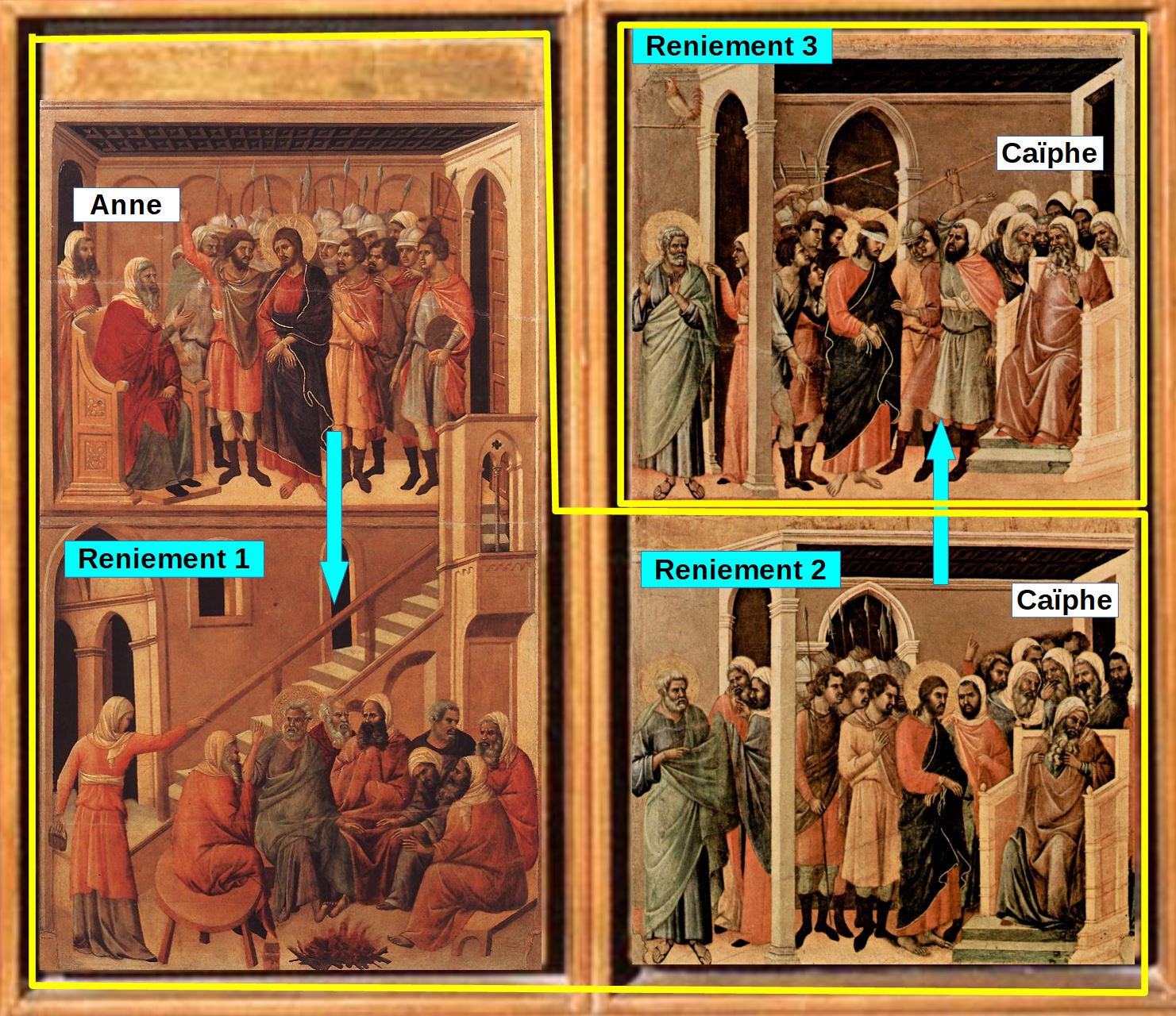
 …ce pourquoi Duccio a pris grand soin de souligner que l’escalier fait communiquer la cour avec la pièce d’Anne, mais ne donne pas accès à cette case terminale.
…ce pourquoi Duccio a pris grand soin de souligner que l’escalier fait communiquer la cour avec la pièce d’Anne, mais ne donne pas accès à cette case terminale. Premier Reniement
Premier Reniement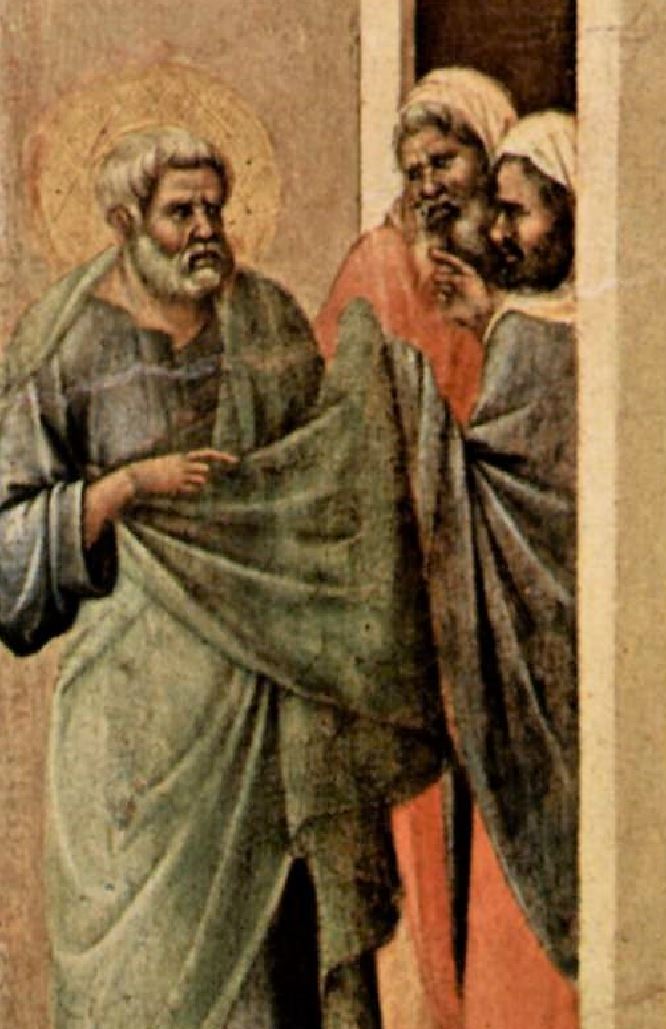 Deuxième Reniement
Deuxième Reniement Premier Reniement
Premier Reniement Troisième Reniement
Troisième Reniement Hamilton Lectionary, Constantinople, fin du XIème siècle, Morgan Library MS M.639 fol. 271v
Hamilton Lectionary, Constantinople, fin du XIème siècle, Morgan Library MS M.639 fol. 271v![]()

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre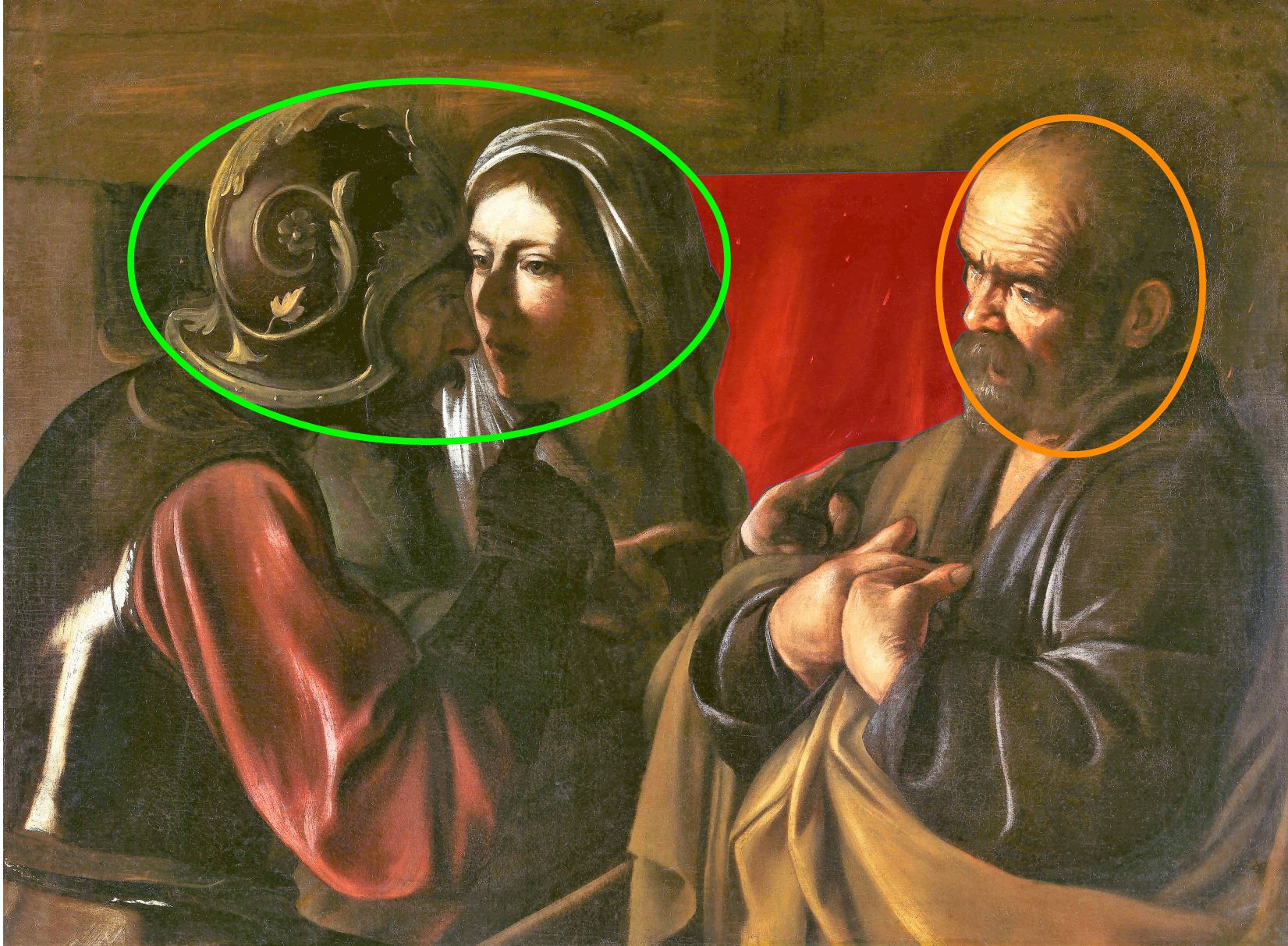
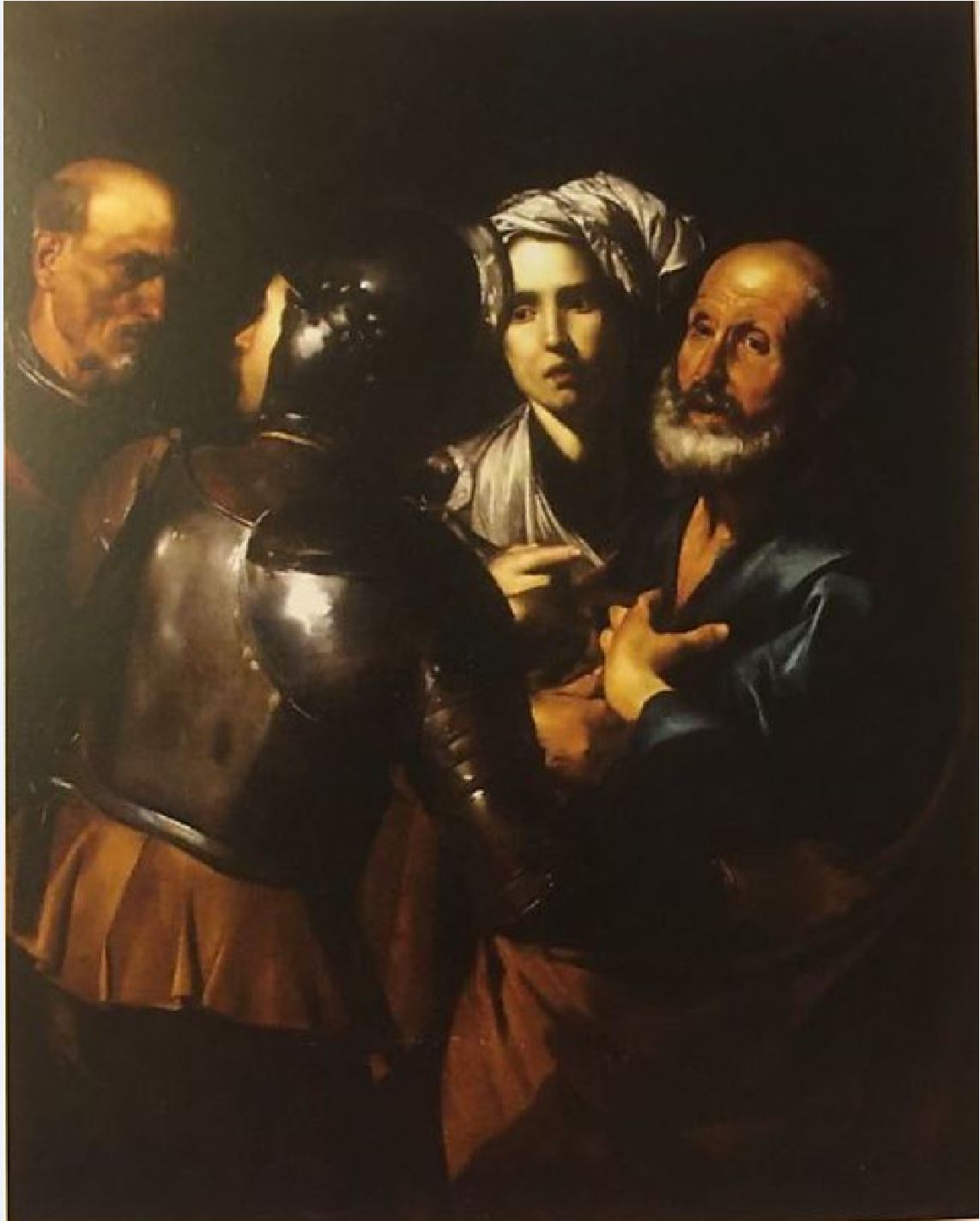 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre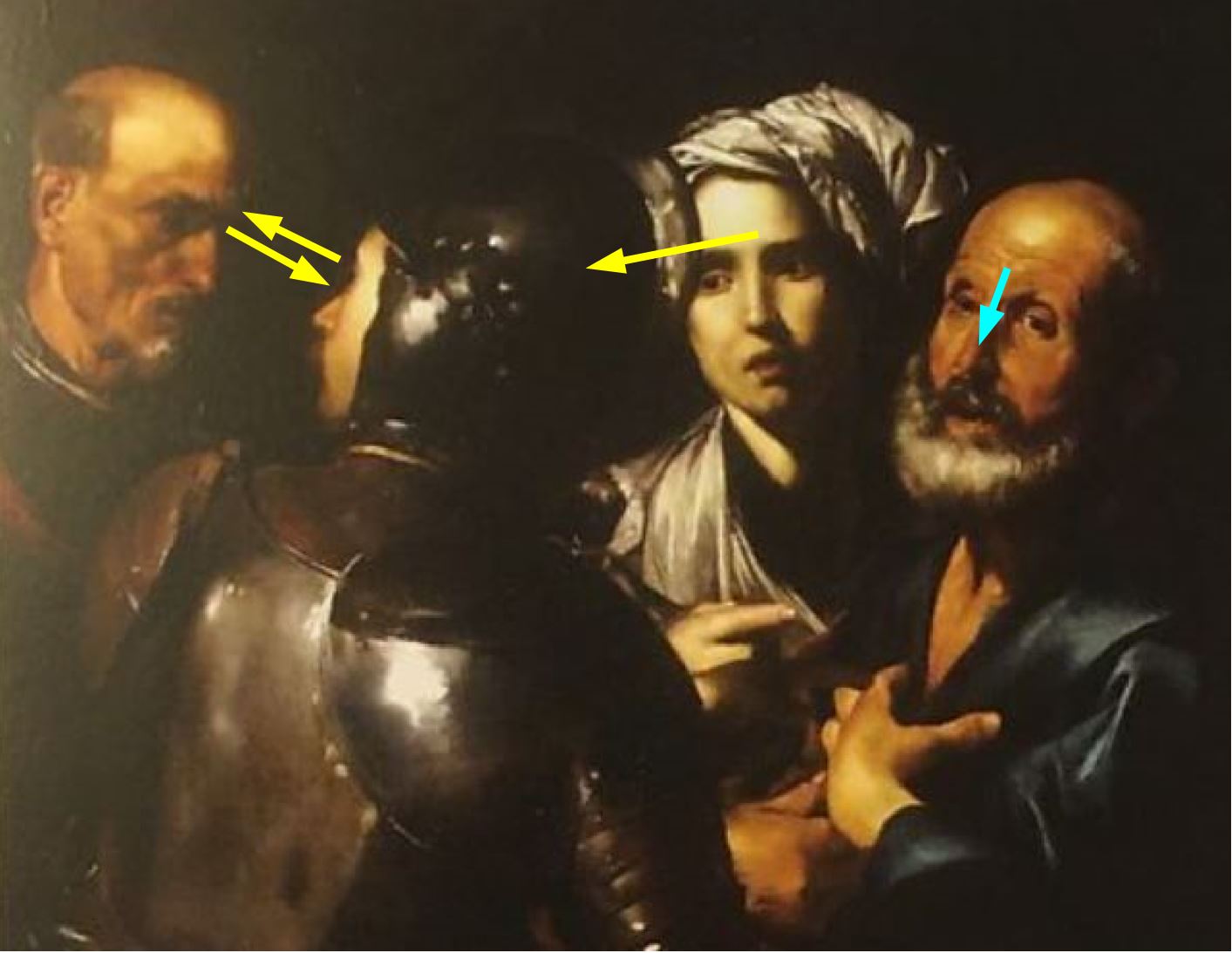
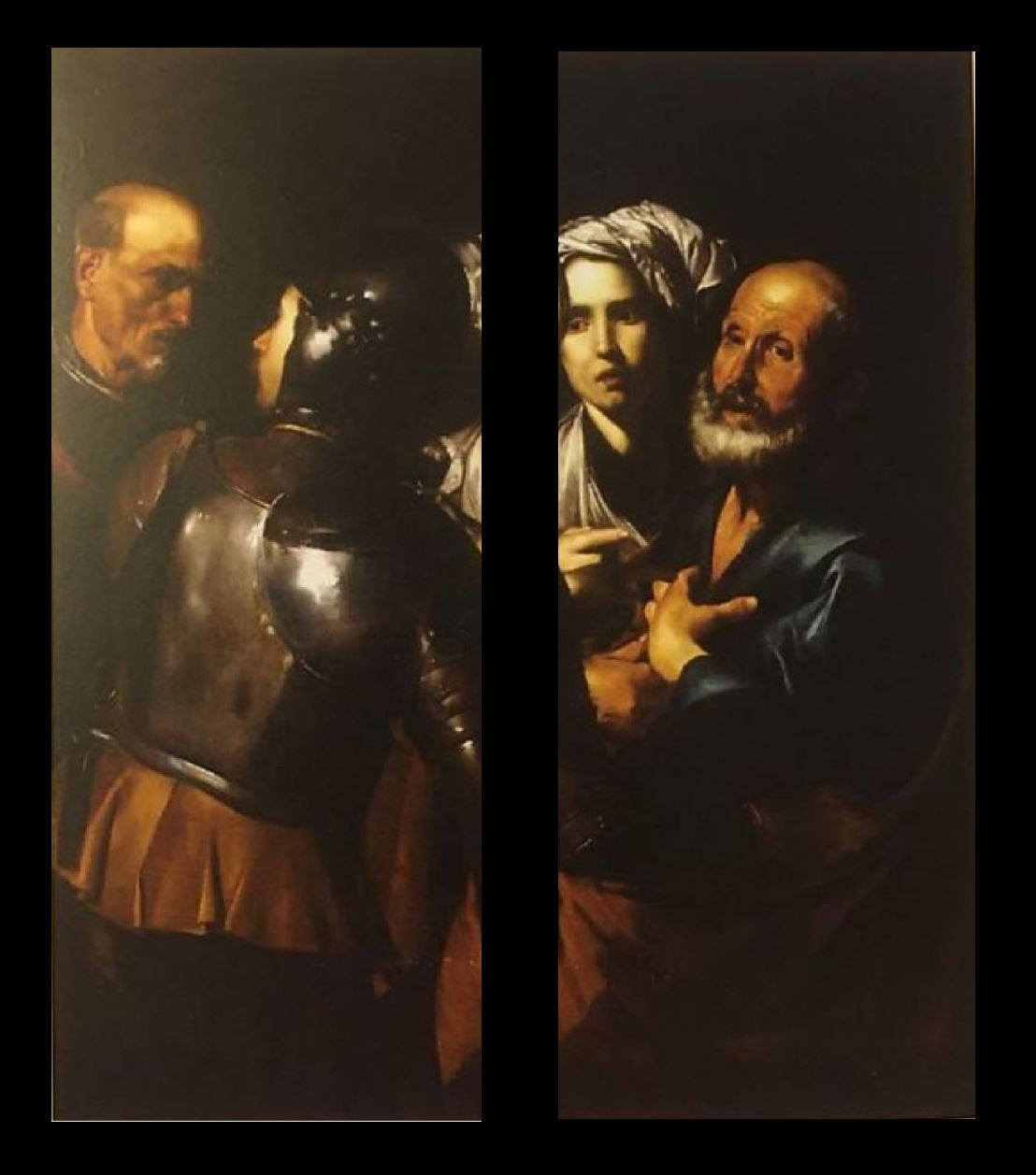
 La Charité (détail des Sept Œuvres de miséricorde) Caravage, 1607, Pio Monte della Misericordia, Naples
La Charité (détail des Sept Œuvres de miséricorde) Caravage, 1607, Pio Monte della Misericordia, Naples La Charité Romaine
La Charité Romaine Baburen, 1620-24, Musée National, Cracovie
Baburen, 1620-24, Musée National, Cracovie
 Seghers, vers 1620, Galerie nationale, Ljubljiana
Seghers, vers 1620, Galerie nationale, Ljubljiana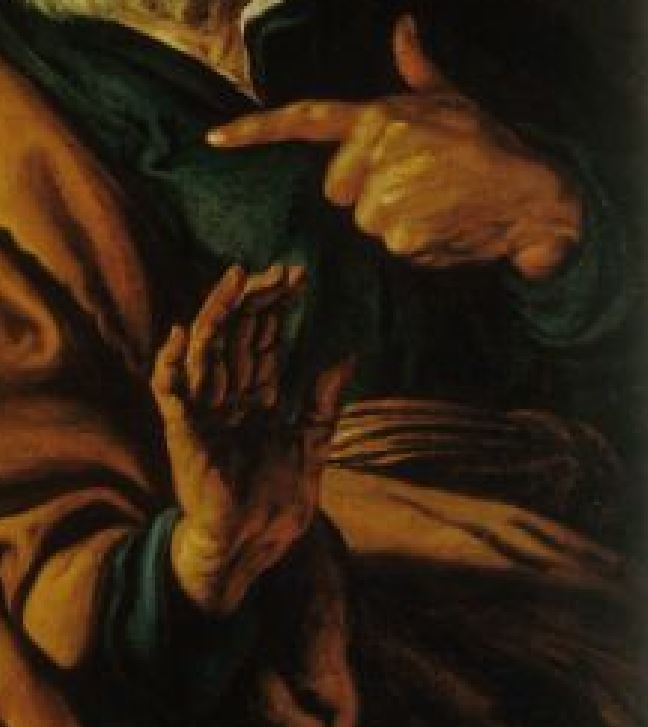
 Gerrit van Honthorst, vers 1623, Minneapolis Institute of Art
Gerrit van Honthorst, vers 1623, Minneapolis Institute of Art
 L’arrestation du Christ
L’arrestation du Christ Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre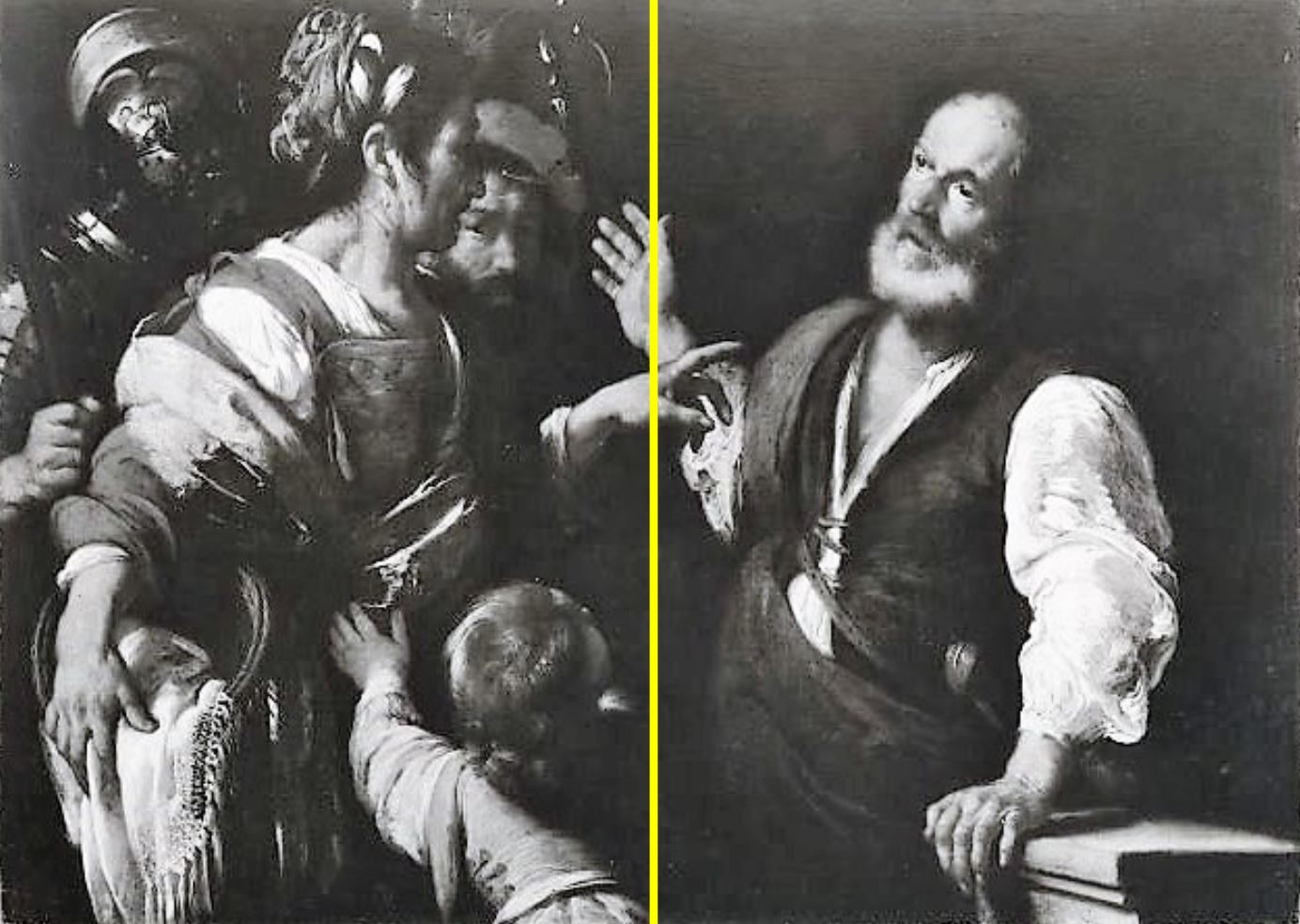 Strozzi, avant 1635, Wallraf Richartz Museum, photothèque Zeri
Strozzi, avant 1635, Wallraf Richartz Museum, photothèque Zeri Anonyme italien (Pietro Paolini ?), Musée des Beaux Arts, Rouen
Anonyme italien (Pietro Paolini ?), Musée des Beaux Arts, Rouen Preti, 1635-39, Galerie Doria Pamphilj
Preti, 1635-39, Galerie Doria Pamphilj Preti, vers 1660, Galleria Nazionale, Palazzo Arnone, Cosenza
Preti, vers 1660, Galleria Nazionale, Palazzo Arnone, Cosenza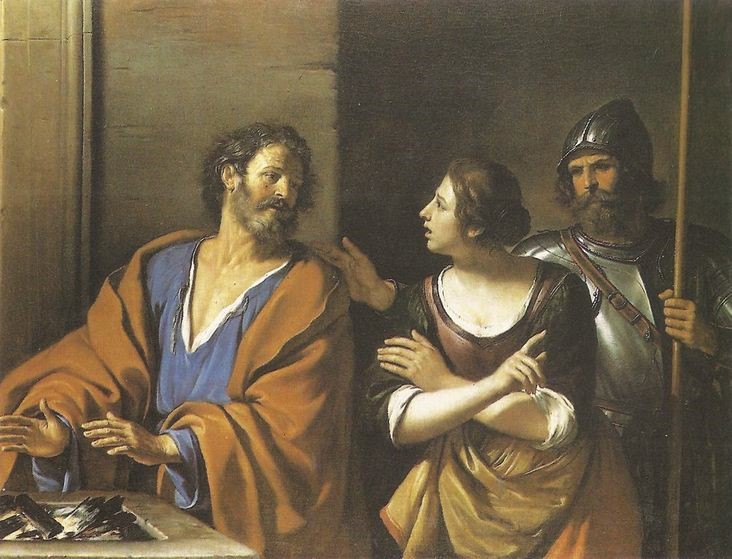 Guerchin, 1646, collection privée
Guerchin, 1646, collection privée Camillo Gavassetti, 1650, Musée des Beaux-Arts, Nantes
Camillo Gavassetti, 1650, Musée des Beaux-Arts, Nantes Spada,1614-1616, Palazzo della Pilotta, Parme
Spada,1614-1616, Palazzo della Pilotta, Parme Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre L’incrédulité de Thomas
L’incrédulité de Thomas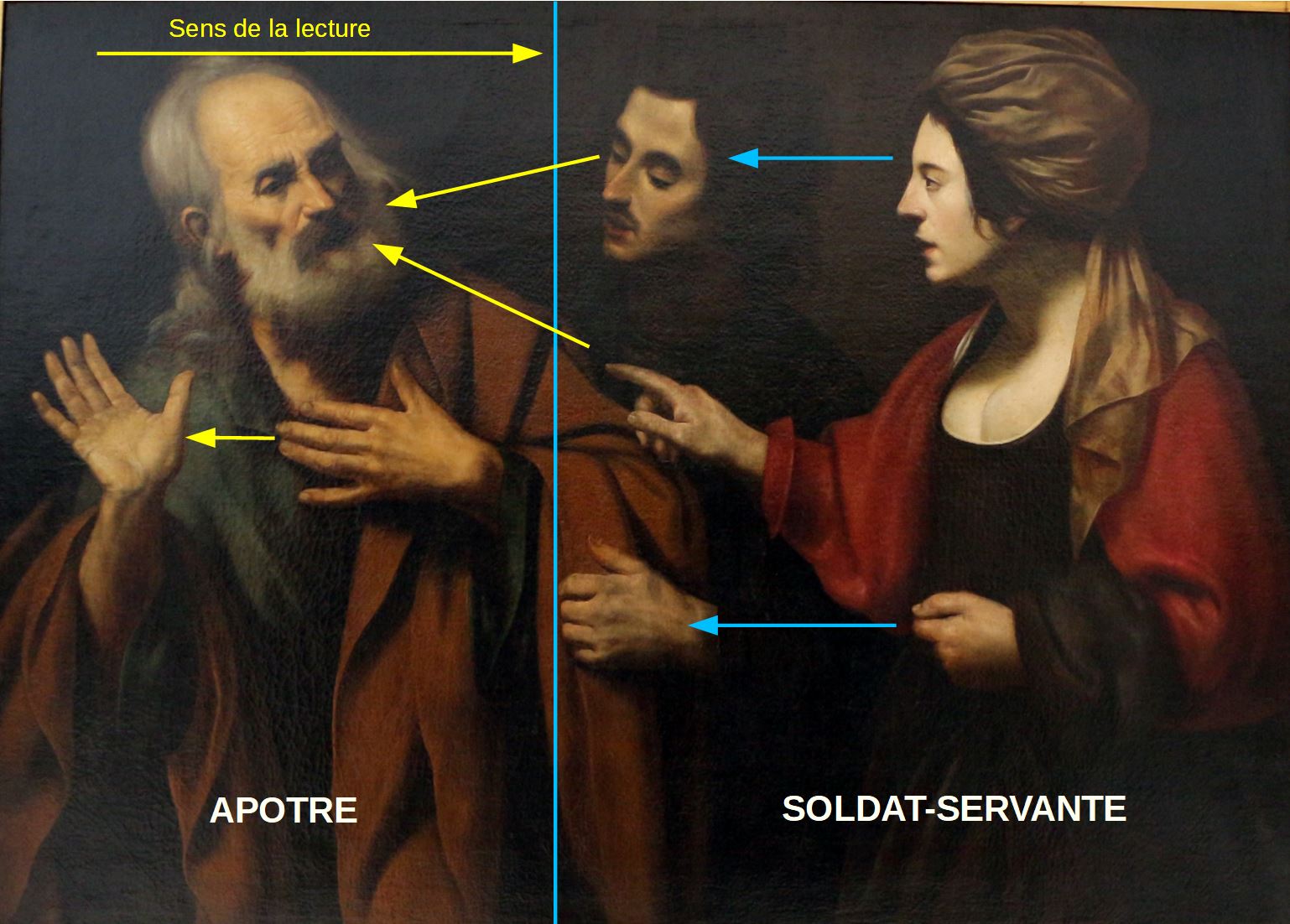 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Ainsi tout l’intérêt se reporte sur la servante à la coiffe immaculée, figure frappante de l’indignation au front bas ; et la scène évangélique se travestit en une scène de genre, l’engueulade d’un vieillard dans une arrière-cuisine.
Ainsi tout l’intérêt se reporte sur la servante à la coiffe immaculée, figure frappante de l’indignation au front bas ; et la scène évangélique se travestit en une scène de genre, l’engueulade d’un vieillard dans une arrière-cuisine. Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Ecole de Seghers, 1620-30, collection particulière
Ecole de Seghers, 1620-30, collection particulière Adam de Coster, 1630-40, collection particulière
Adam de Coster, 1630-40, collection particulière Ecole de Preti, collection particulière
Ecole de Preti, collection particulière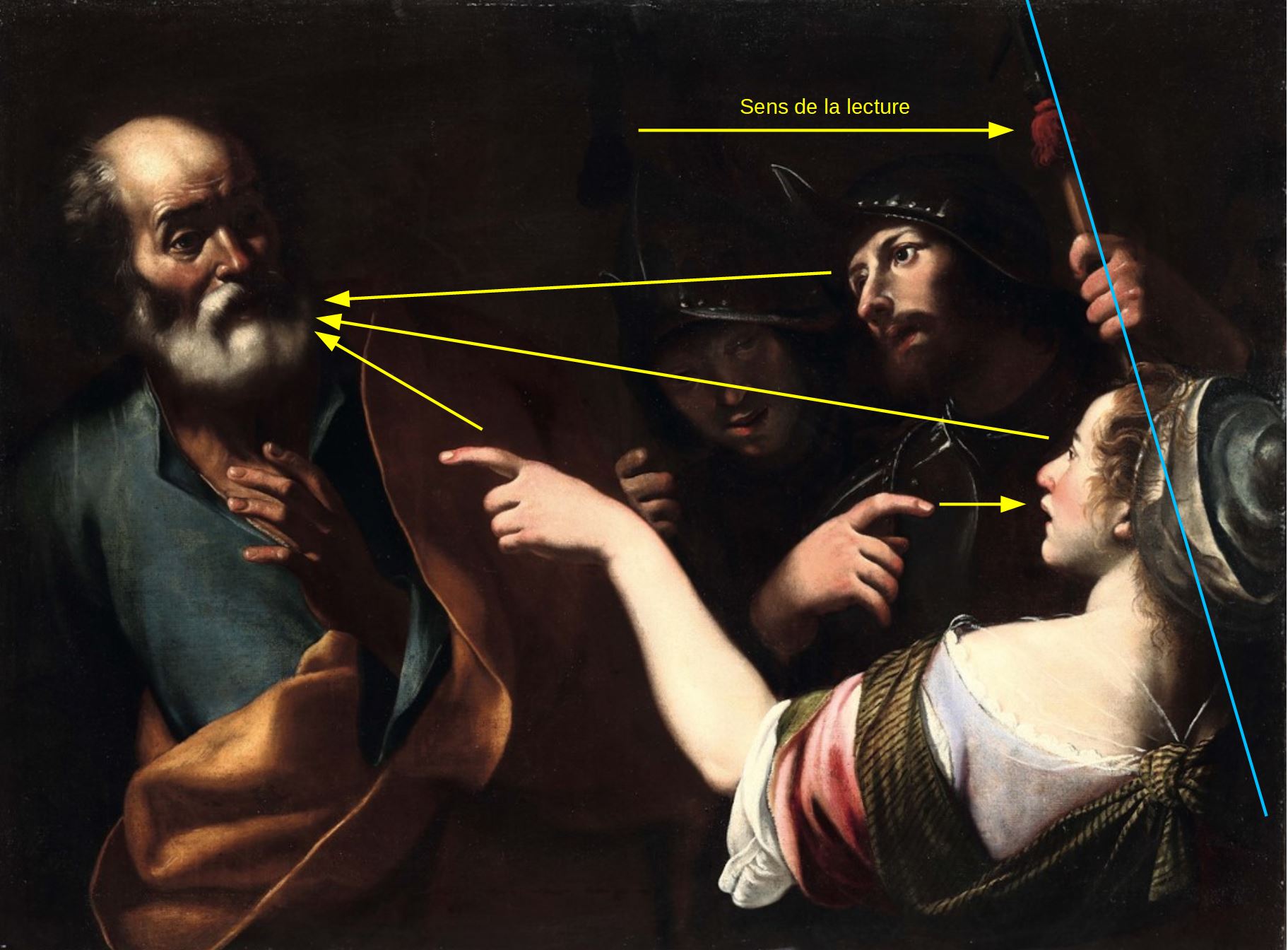

 Strozzi, collection particulière
Strozzi, collection particulière Ermitage
Ermitage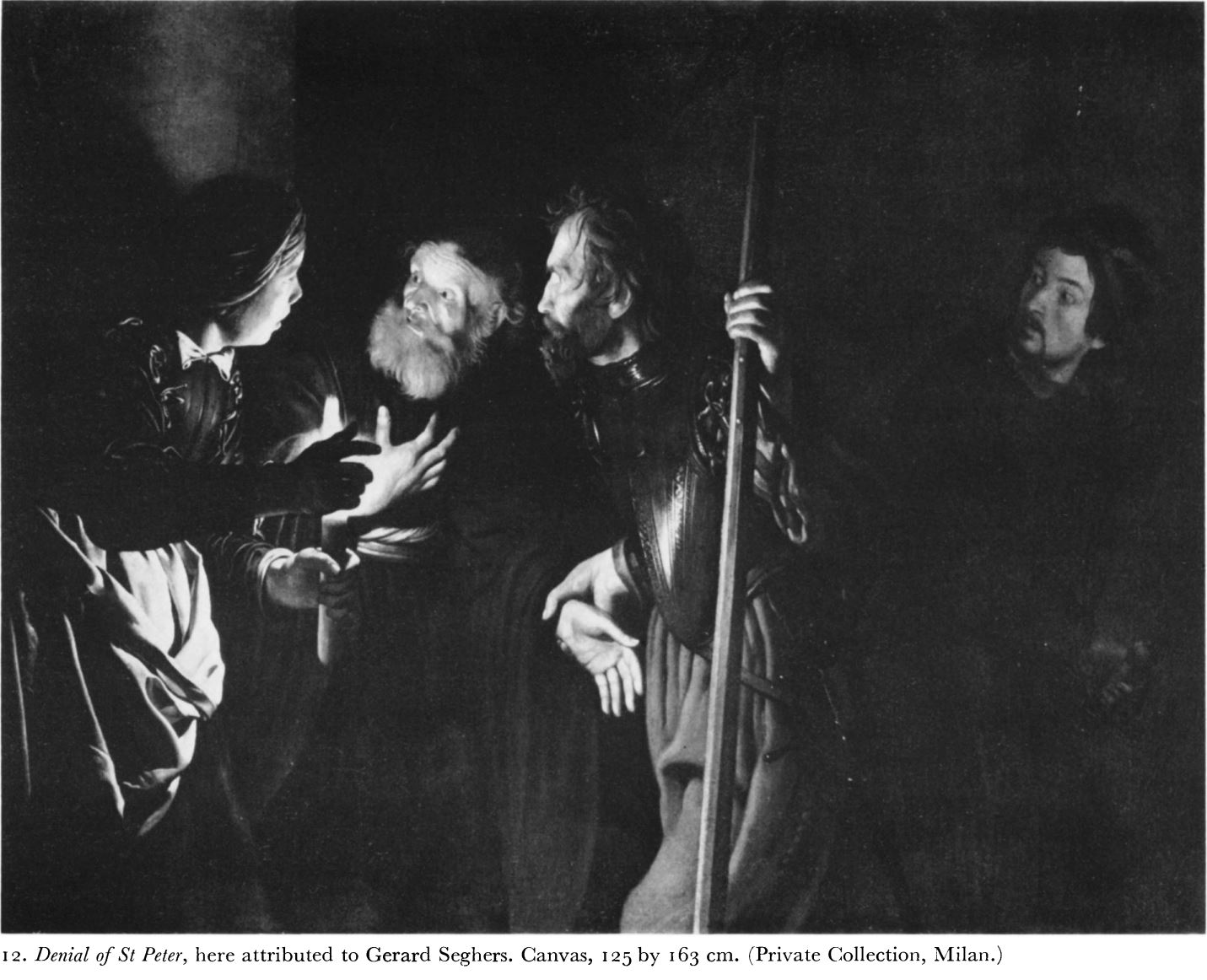 Collection privée, Milan (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] )
Collection privée, Milan (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] ) Collection privée, Milan (inversé)
Collection privée, Milan (inversé) Musée des Beaux-Arts de Tours
Musée des Beaux-Arts de Tours Willem van Hacht, The Gallery of Cornelis van der Geest, 1628 Rubenshuis (détail)
Willem van Hacht, The Gallery of Cornelis van der Geest, 1628 Rubenshuis (détail) Ecole de Seghers
Ecole de Seghers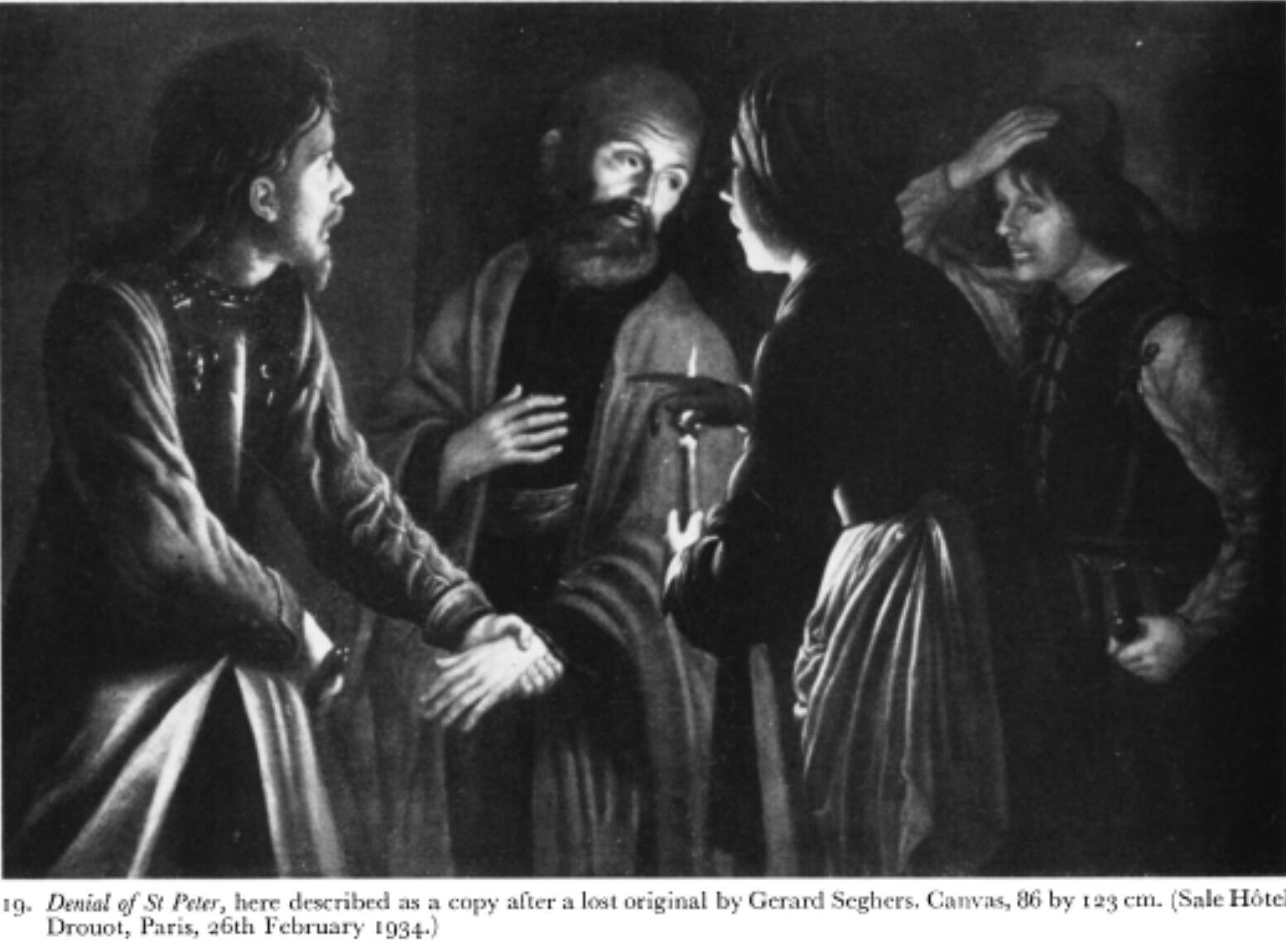 Ecole de Seghers (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] )
Ecole de Seghers (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] ) Adam de Coster, vers 1630, collection particulière
Adam de Coster, vers 1630, collection particulière Guerchin, 1623-26, Pinacoteca Nazionale di Bologna
Guerchin, 1623-26, Pinacoteca Nazionale di Bologna Mattia Preti, 1630–35, Musée des Beaux-Arts, Carcassonne.
Mattia Preti, 1630–35, Musée des Beaux-Arts, Carcassonne. Reniement de St Pierre
Reniement de St Pierre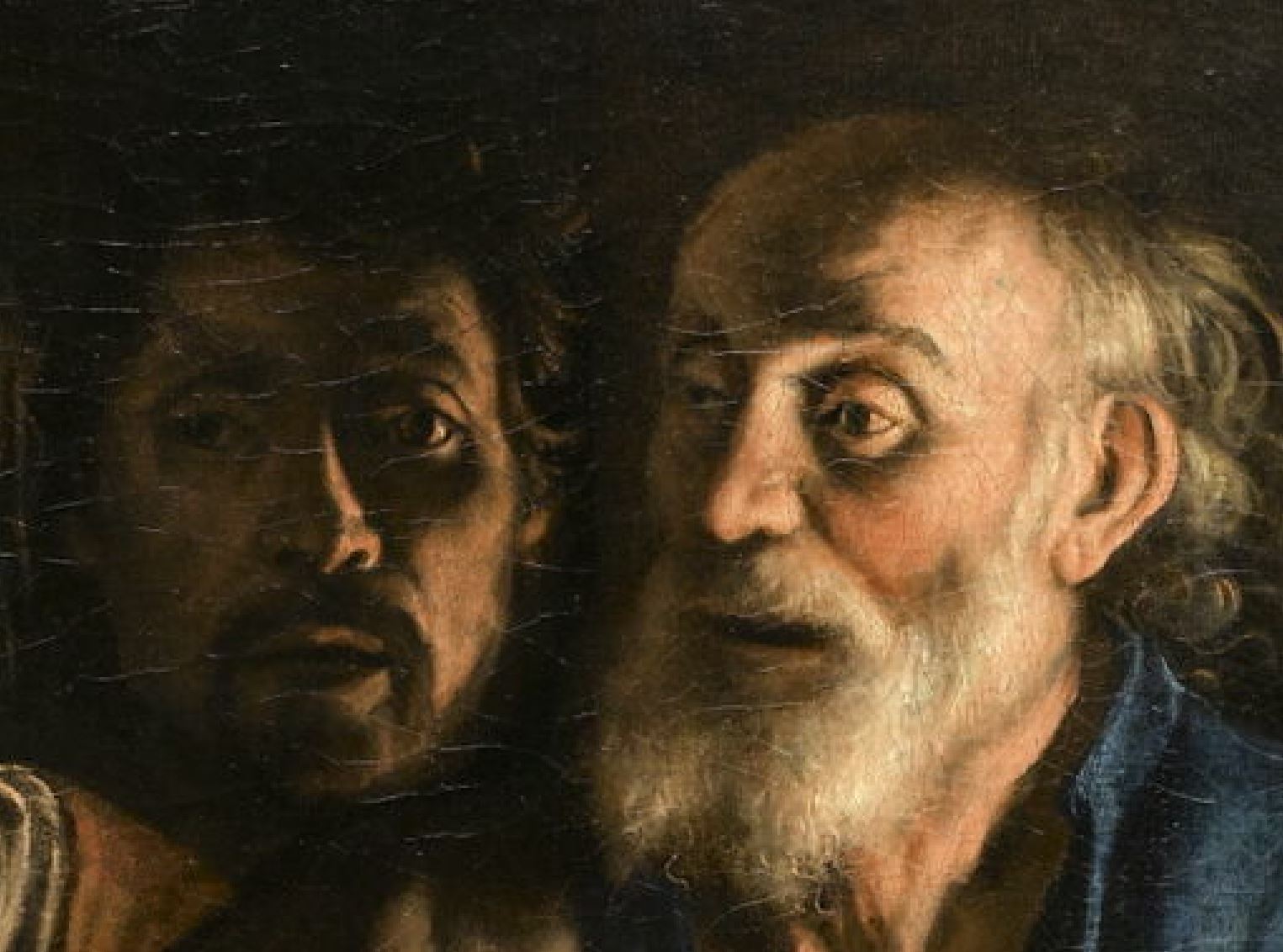
 Reniement de St Pierre
Reniement de St Pierre
 L’efficacité de la composition repose sur une équivoque visuelle : vu de loin ou sous une lumière faible, on voit une servante qui s’en prend à un soldat assis, un peu comme le couple conflictuel du Pensionnaire de Saraceni.
L’efficacité de la composition repose sur une équivoque visuelle : vu de loin ou sous une lumière faible, on voit une servante qui s’en prend à un soldat assis, un peu comme le couple conflictuel du Pensionnaire de Saraceni.
 Le troisième reniement de St Pierre
Le troisième reniement de St Pierre

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre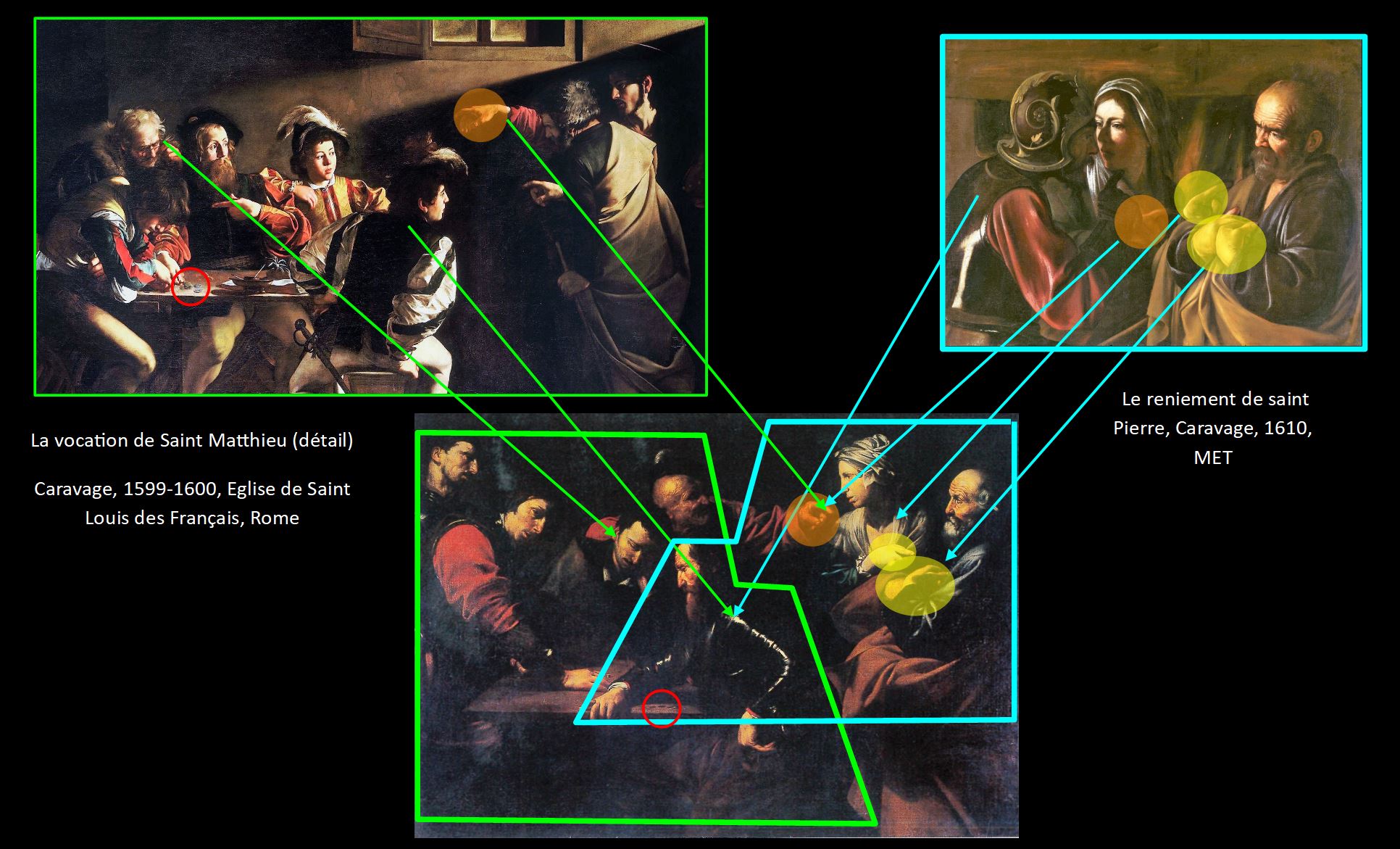
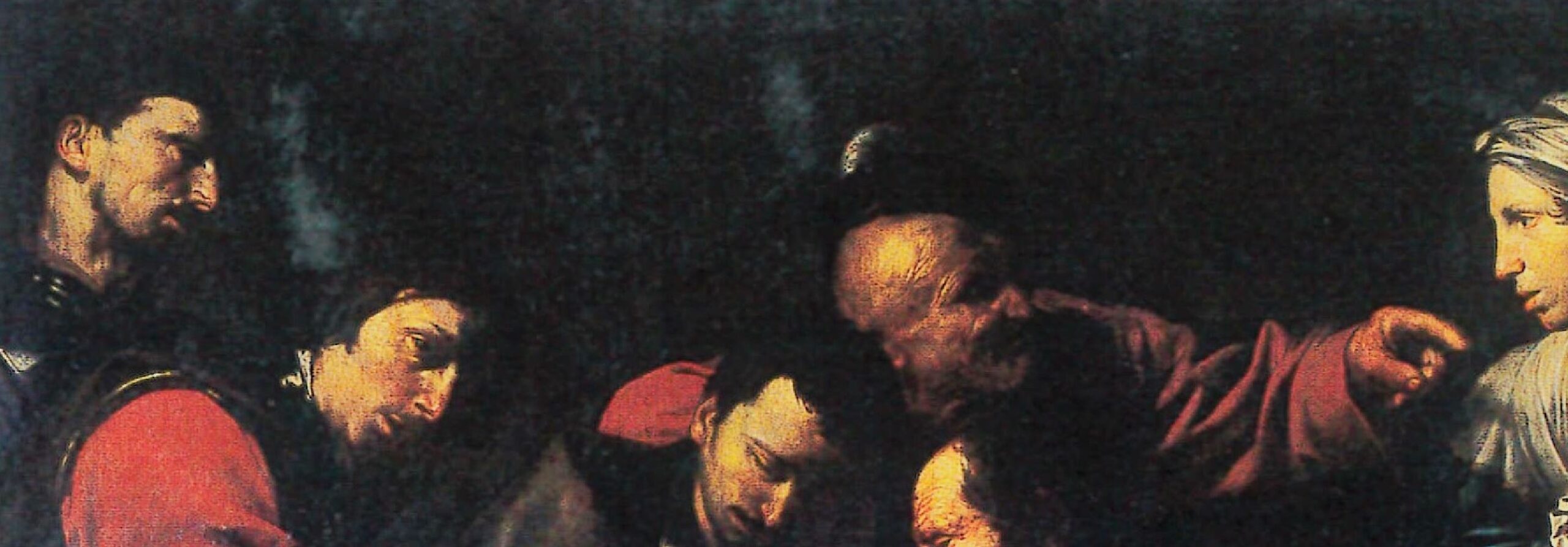 Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement.
Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement. A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction.
A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction. Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre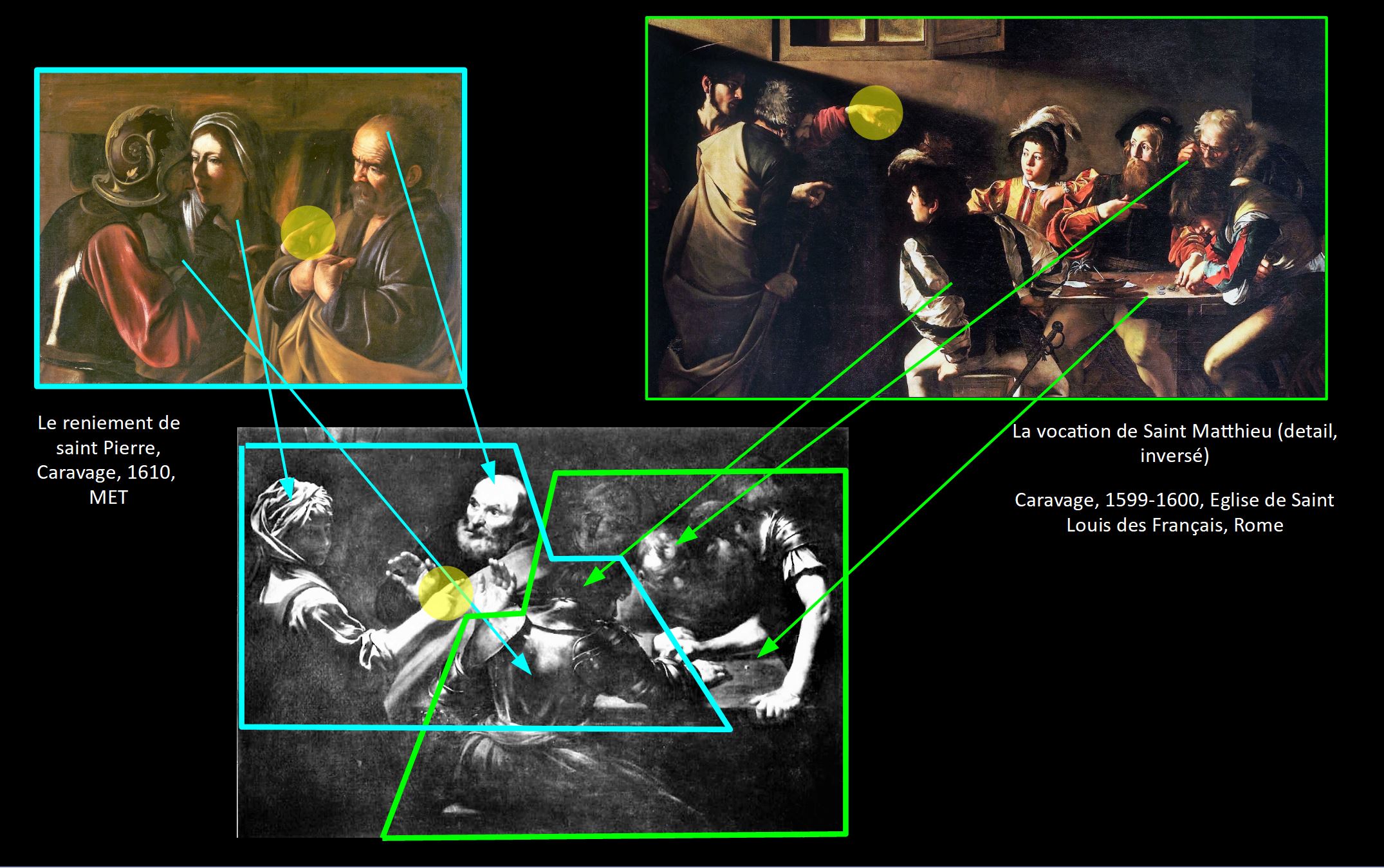 Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.
Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.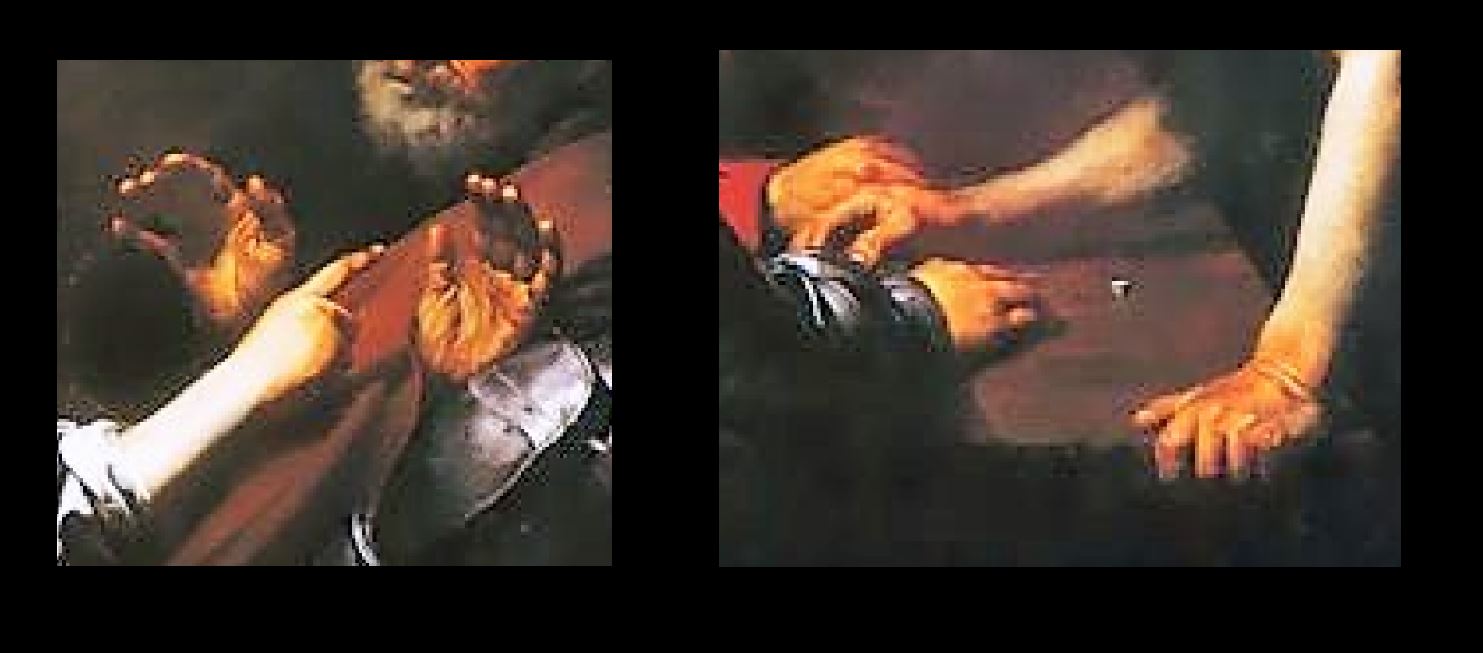
 Crucifixion (détail)
Crucifixion (détail) Soldats jouant aux dès la tunique du Christ
Soldats jouant aux dès la tunique du Christ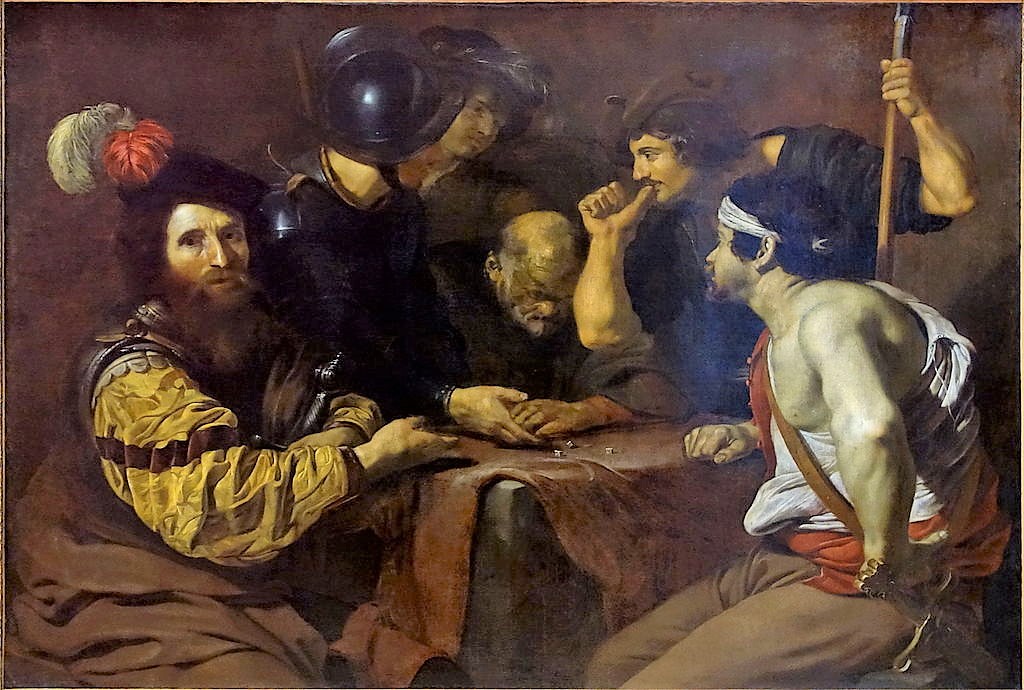 Soldats jouant aux dés la tunique du Christ
Soldats jouant aux dés la tunique du Christ Joueurs de Dés
Joueurs de Dés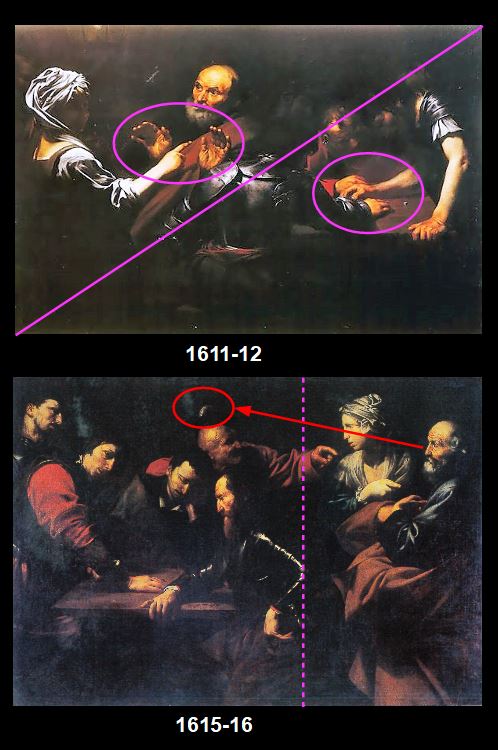
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre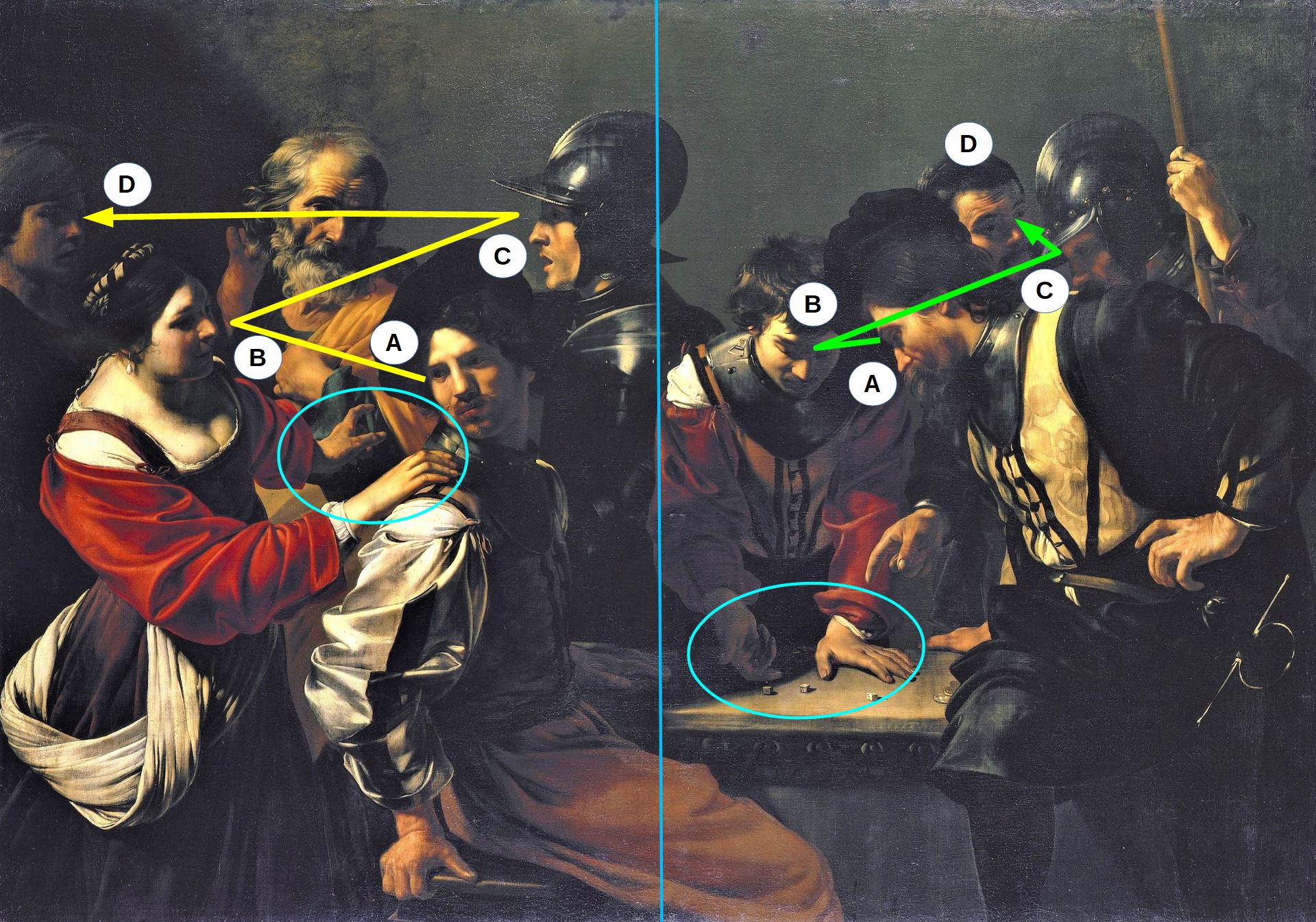 Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :
Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :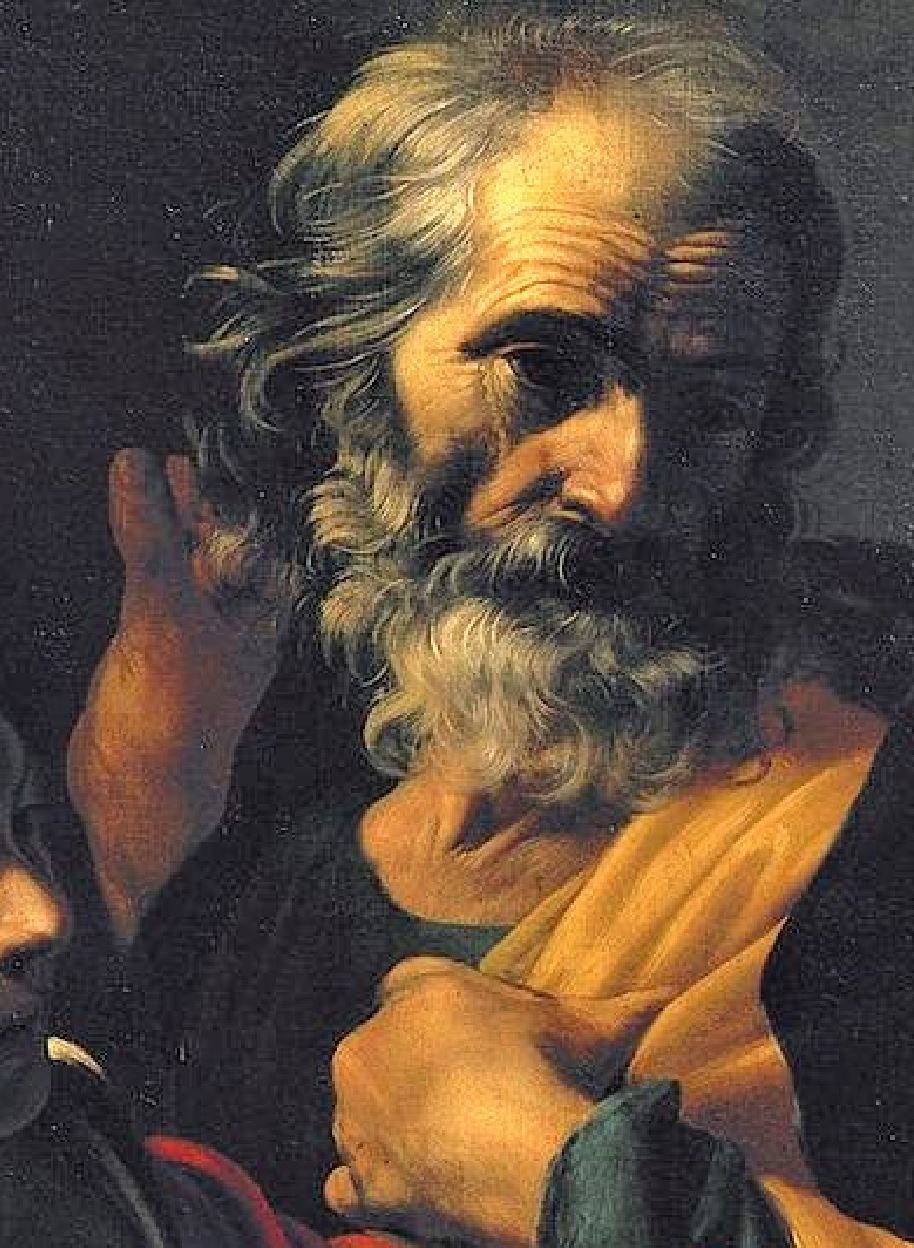 La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés.
La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés. Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail)
Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail) Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre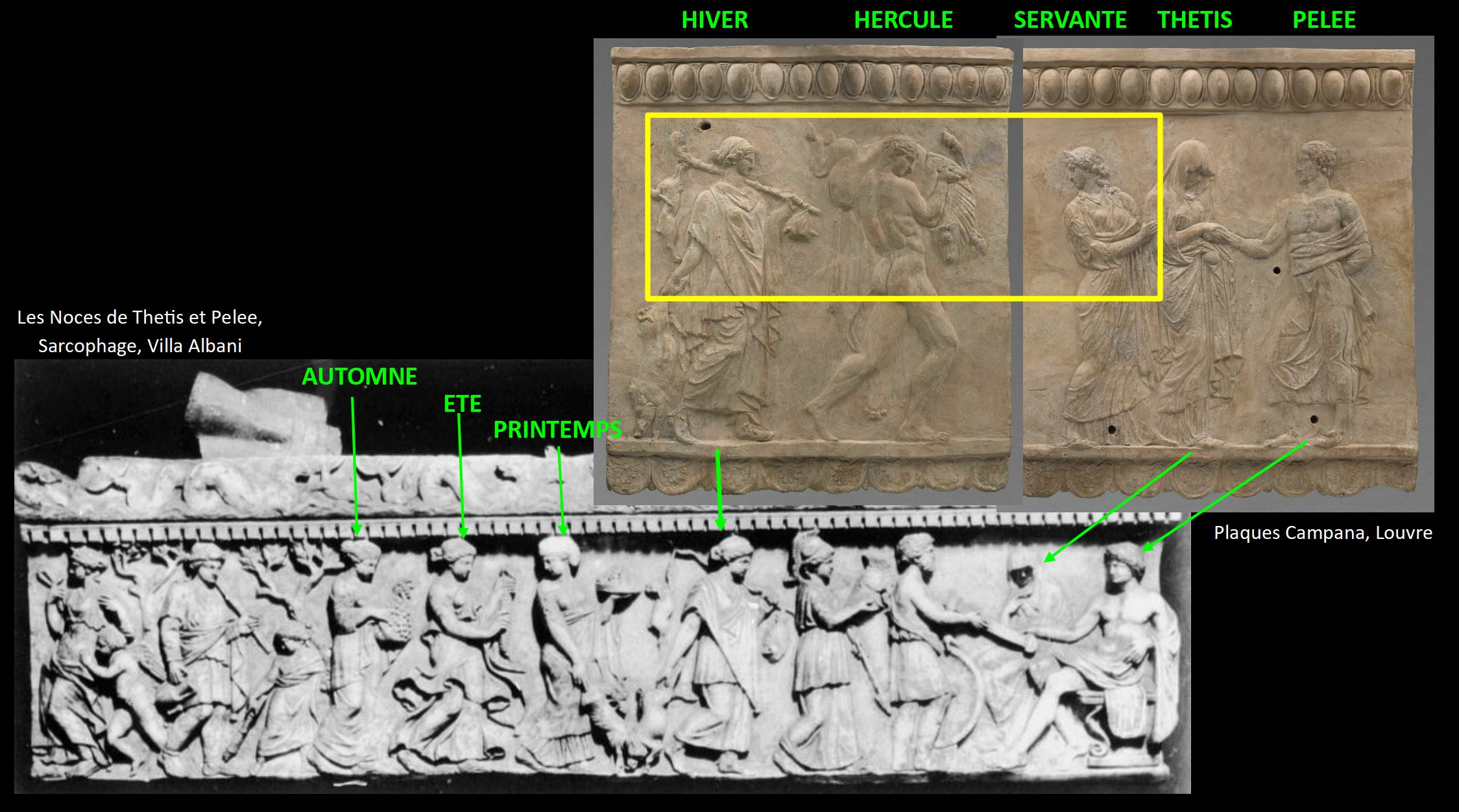
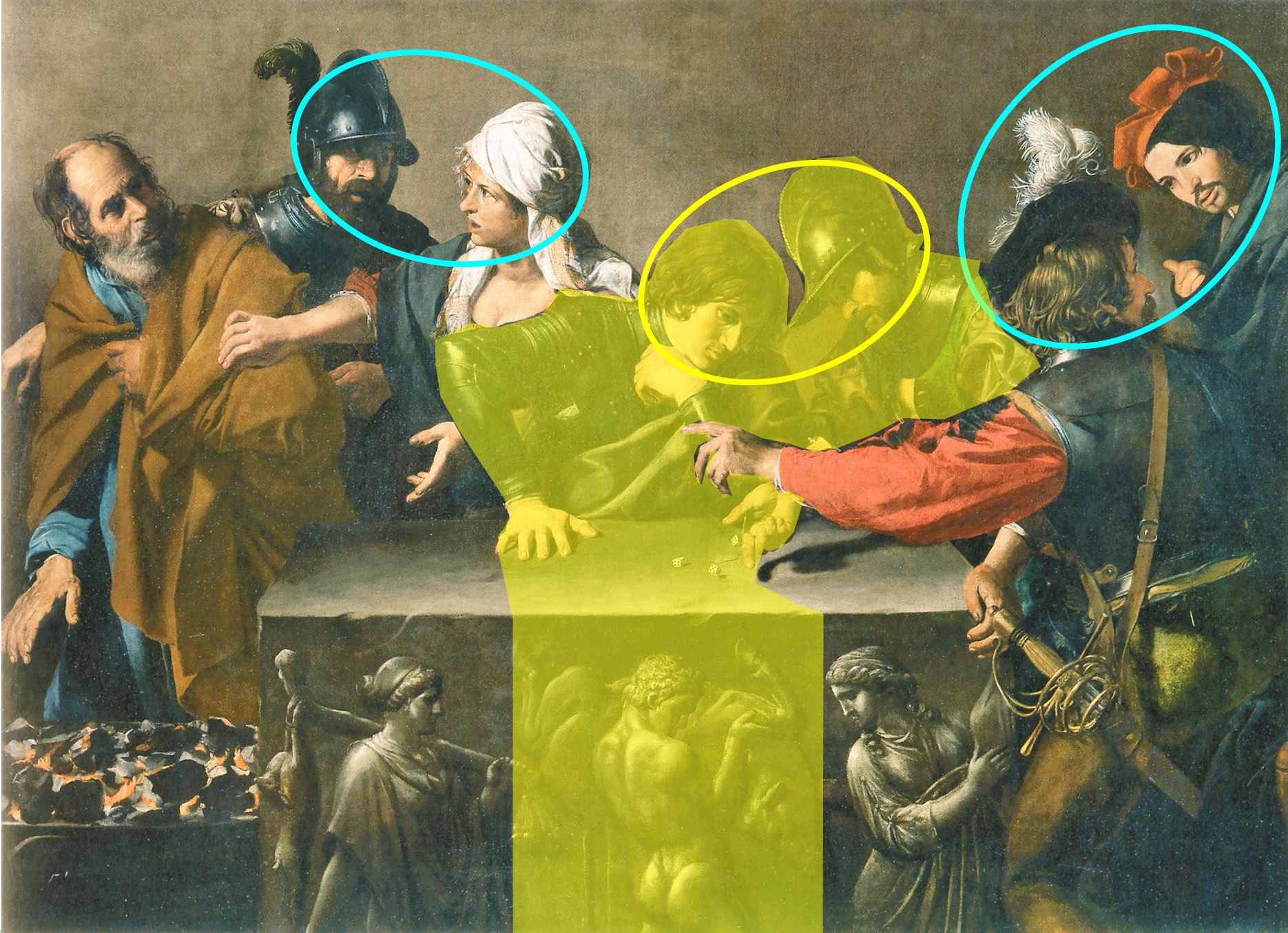

 La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.
La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.
 Les Quatre Ages de la vie
Les Quatre Ages de la vie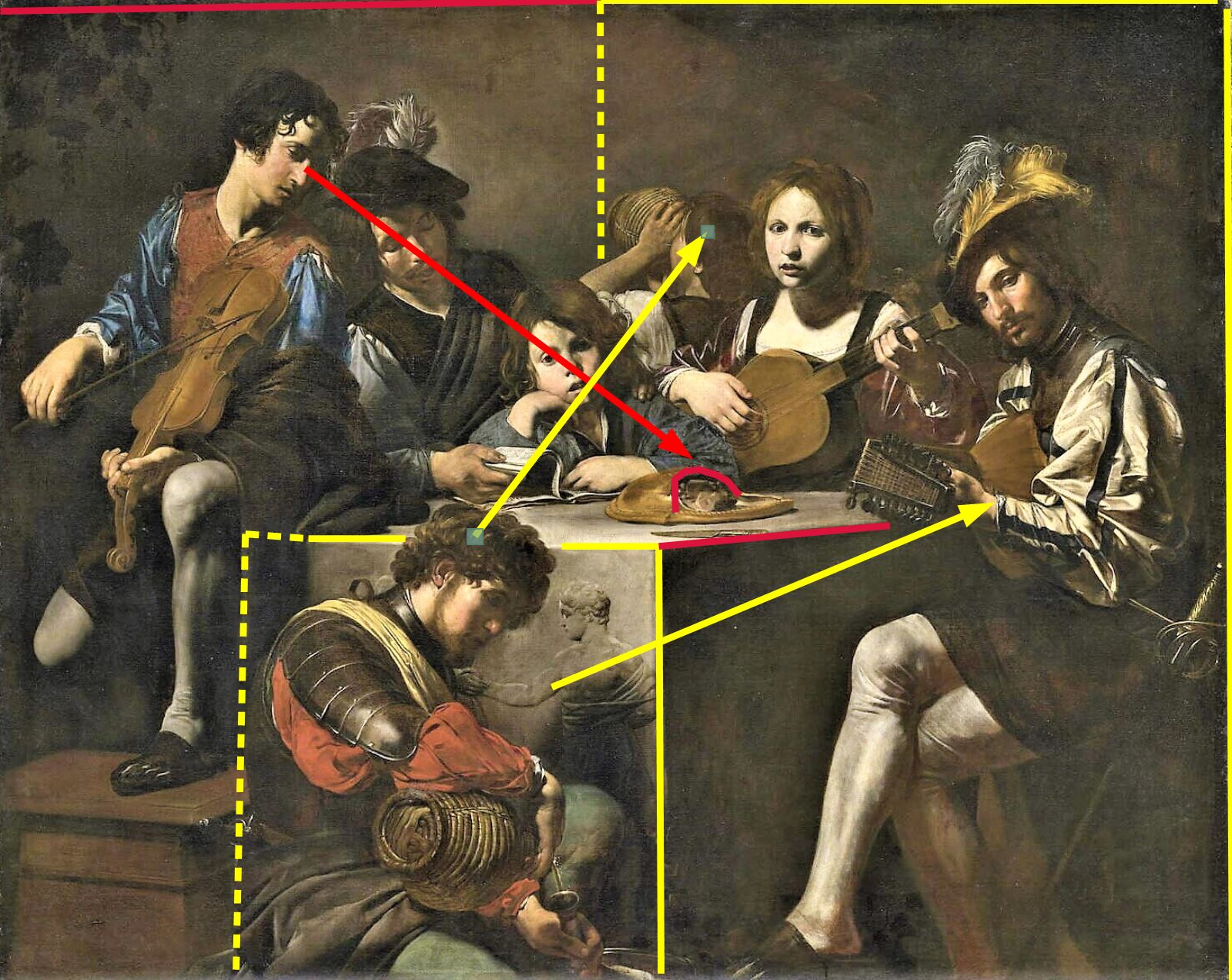

 C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :
C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :
 La Diseuse de Bonne Aventure (détail)
La Diseuse de Bonne Aventure (détail)
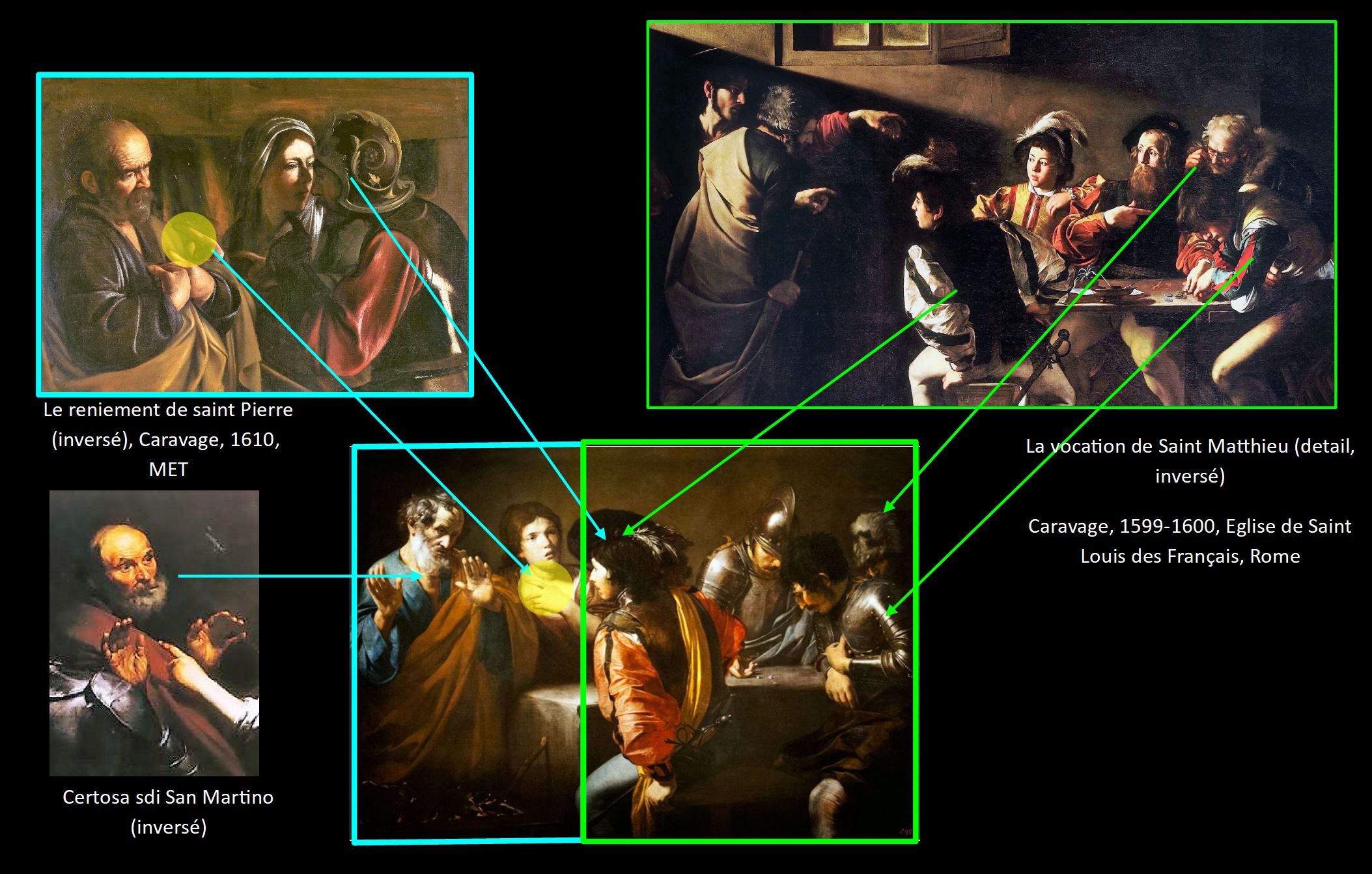
 Collection privée (anciennement Colnaghi)
Collection privée (anciennement Colnaghi) Gemäldegalerie, Dresde
Gemäldegalerie, Dresde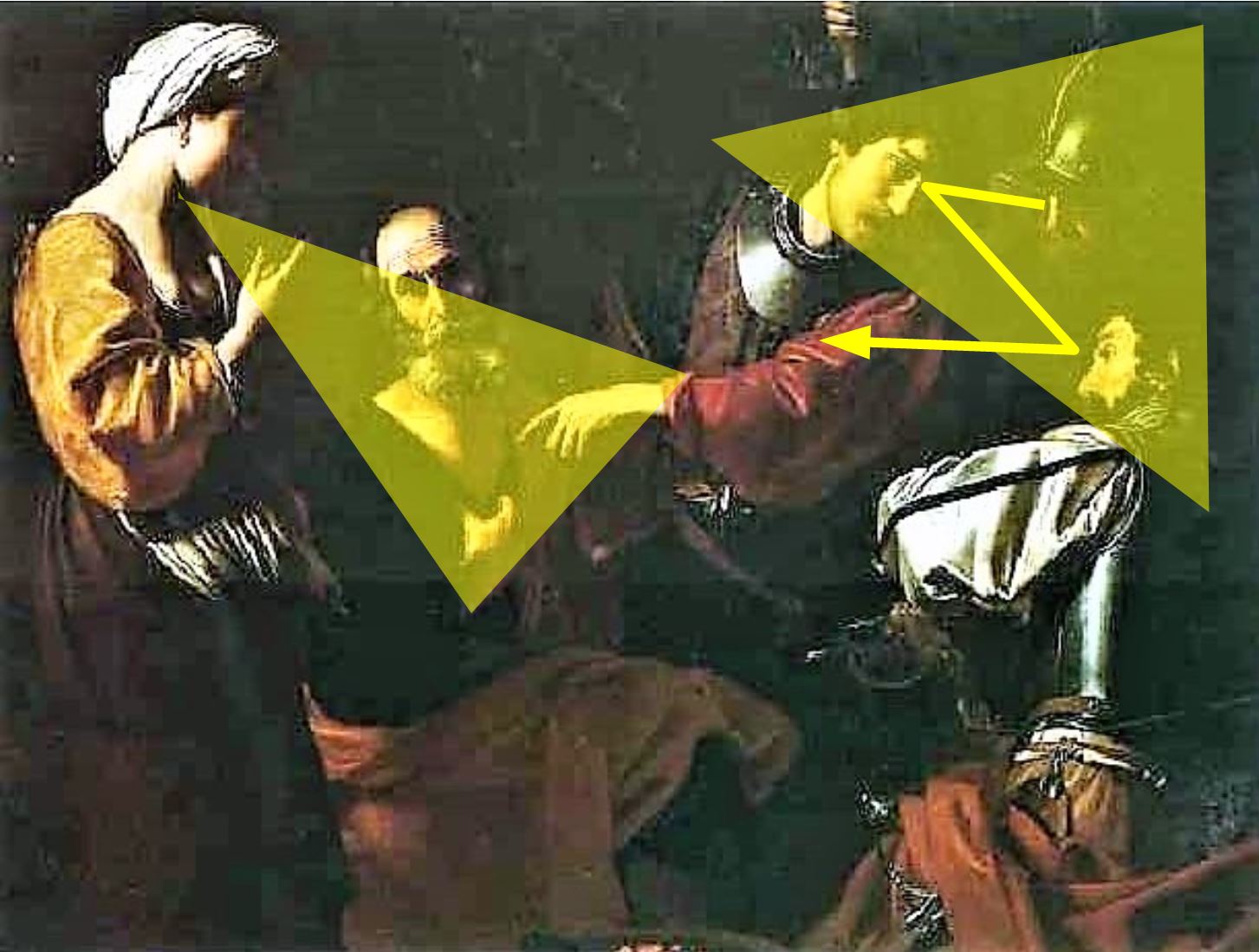
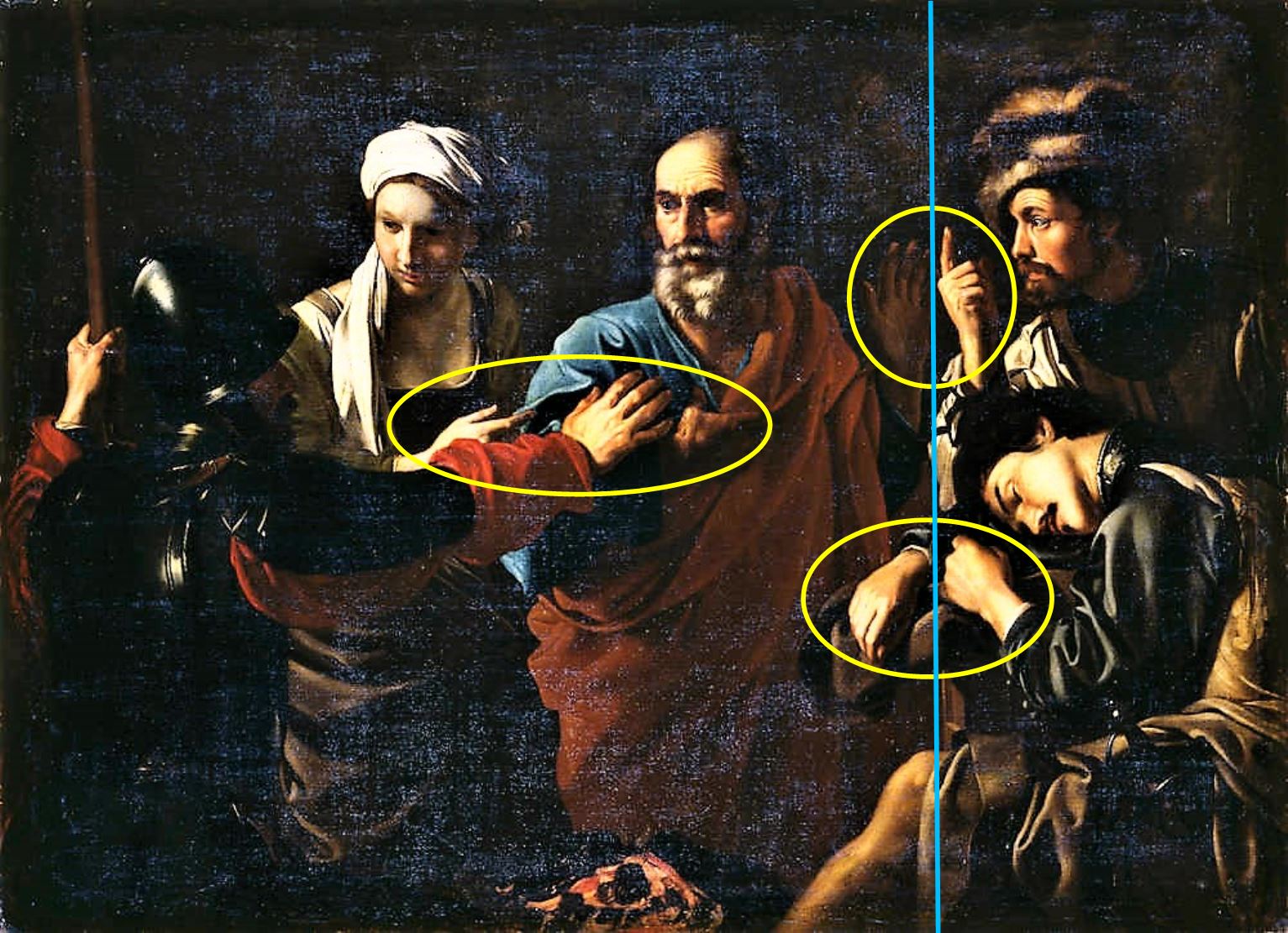
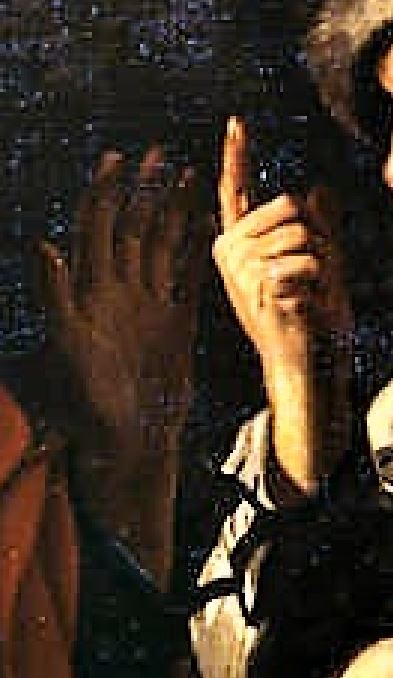
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre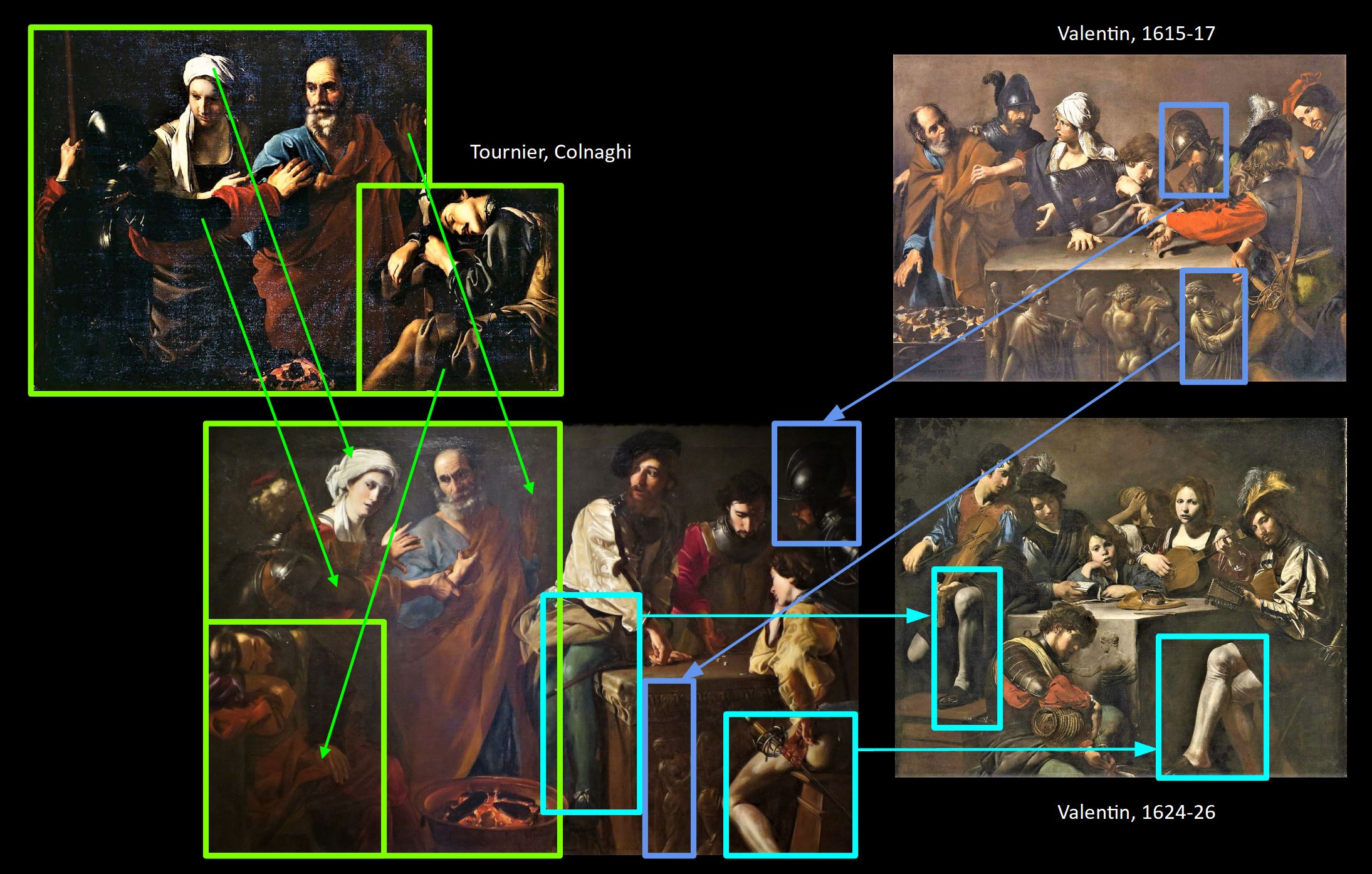
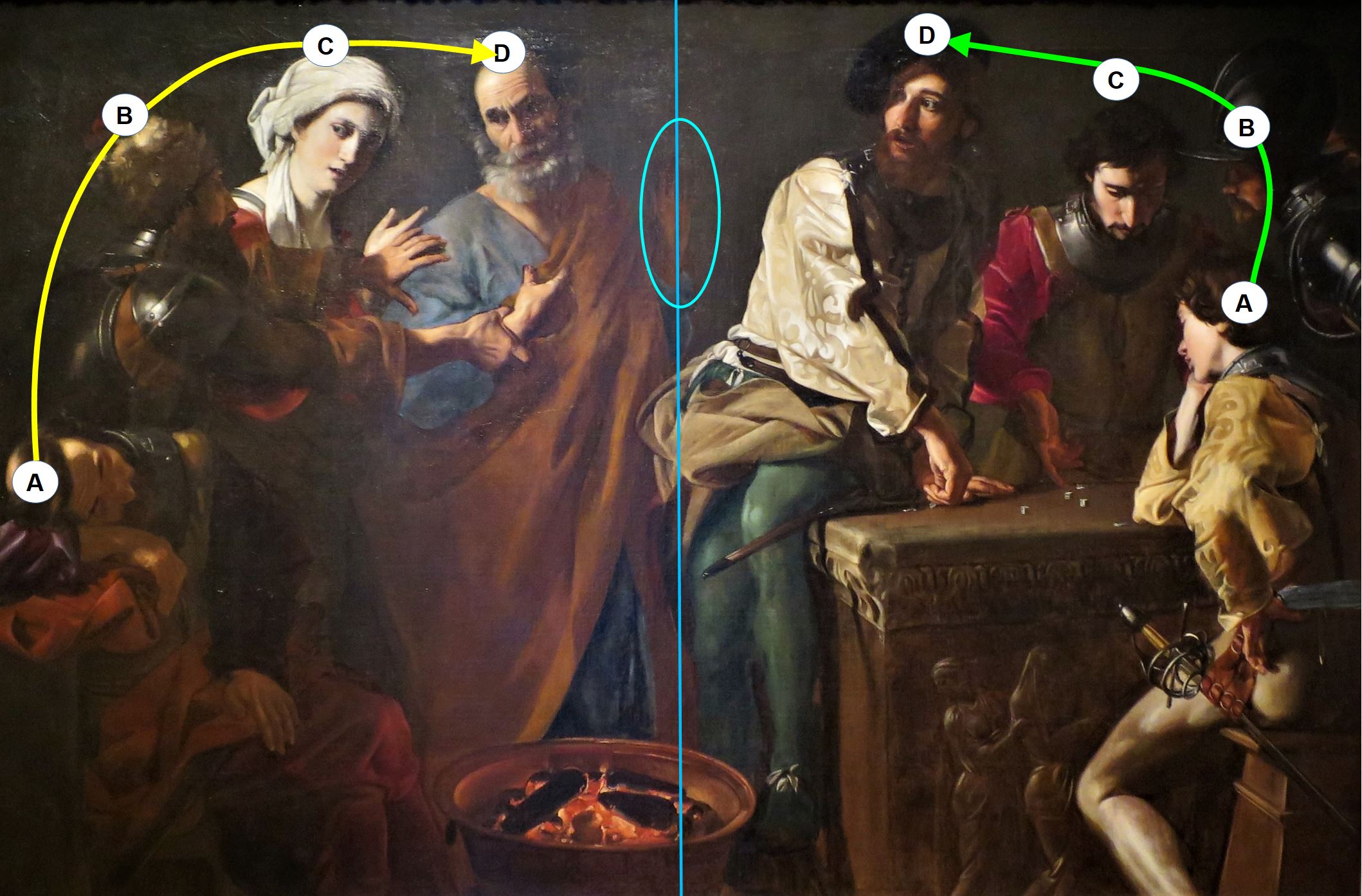
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre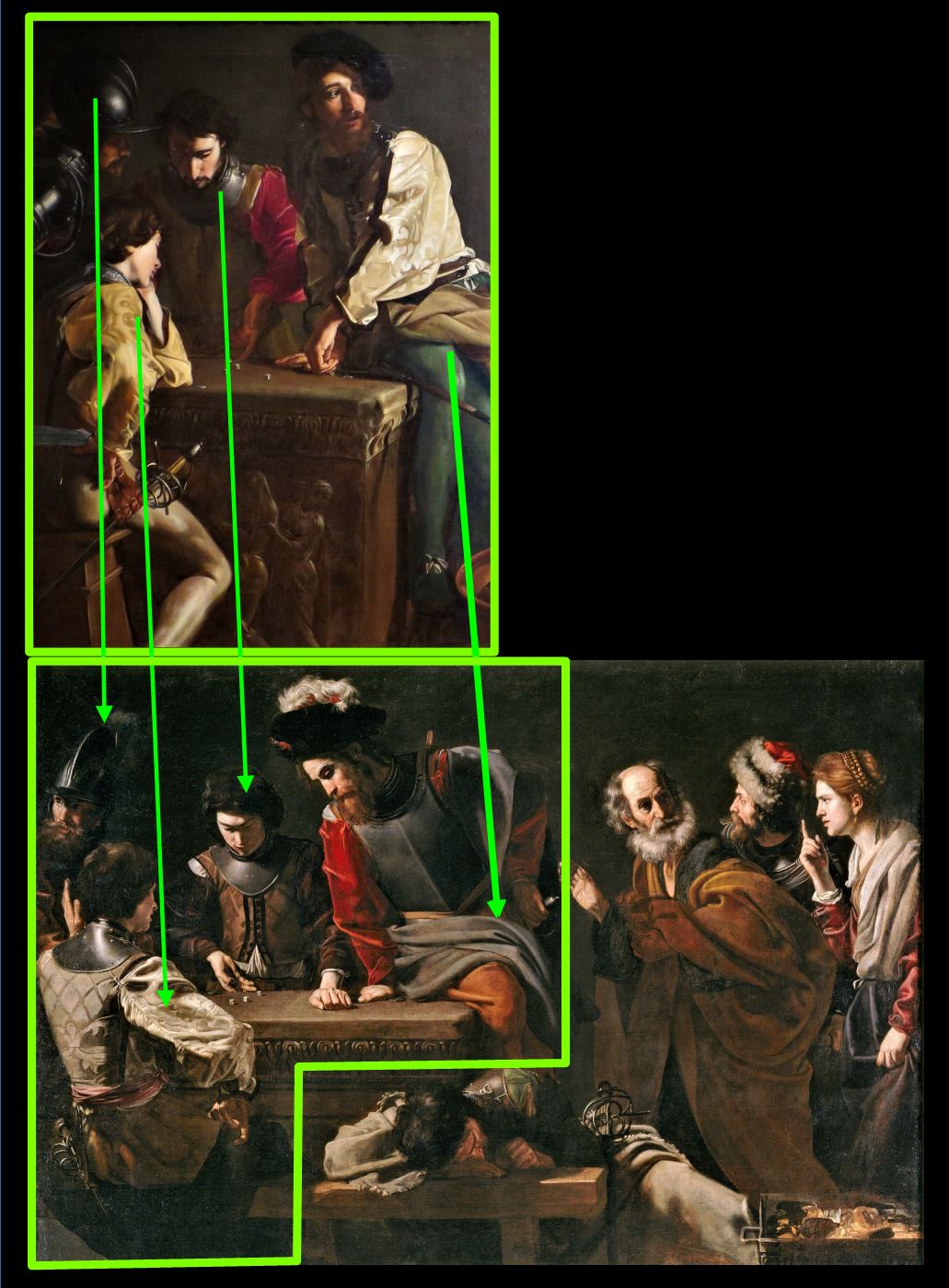

 Le Christ et la femme adultère (détail)
Le Christ et la femme adultère (détail)
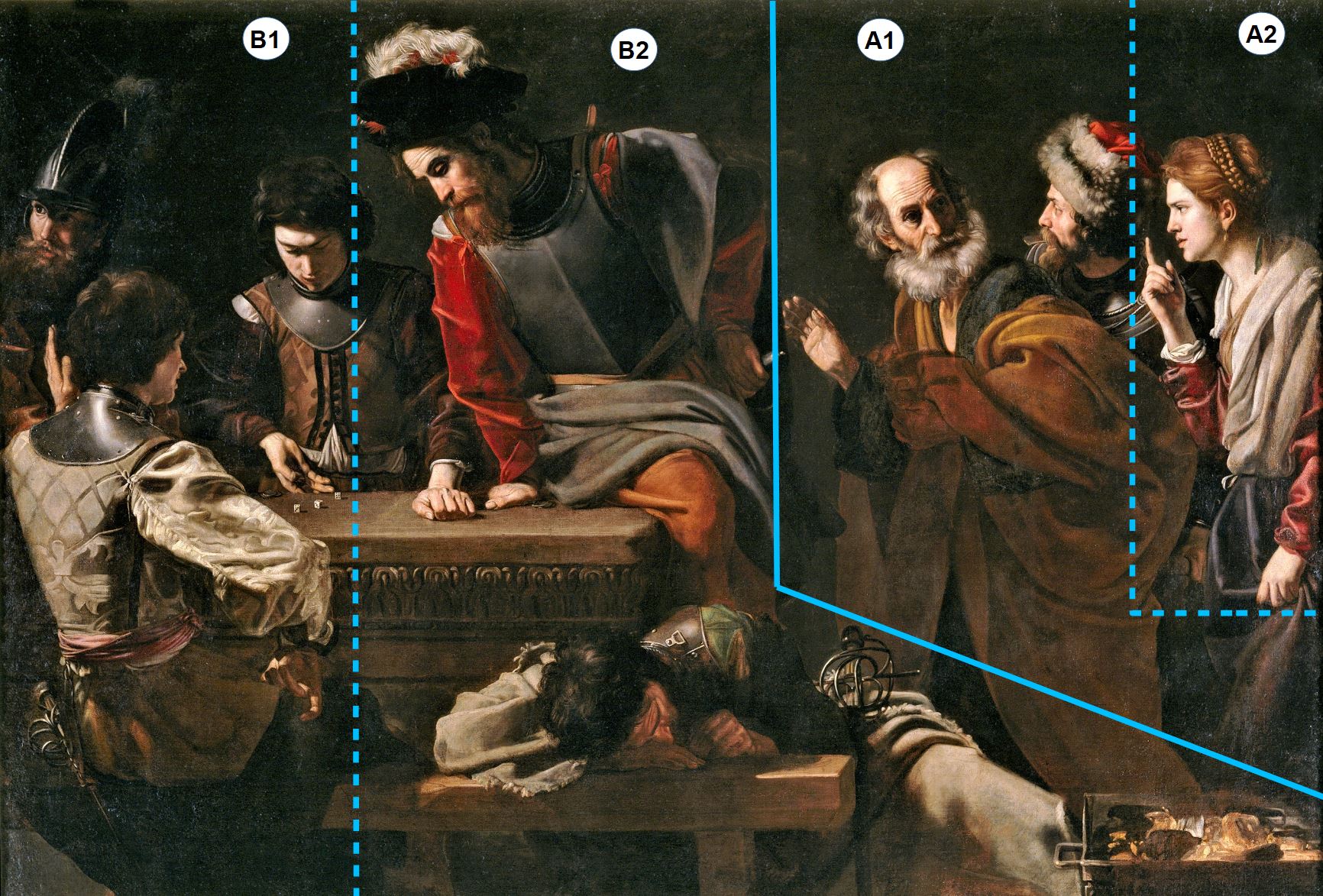
 Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples
Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples Museo civico, Macerata
Museo civico, Macerata
 avant 1620, Musée de Rennes
avant 1620, Musée de Rennes 1620-25, Collection particulière
1620-25, Collection particulière

 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl
Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl
 Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle,
Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle, Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre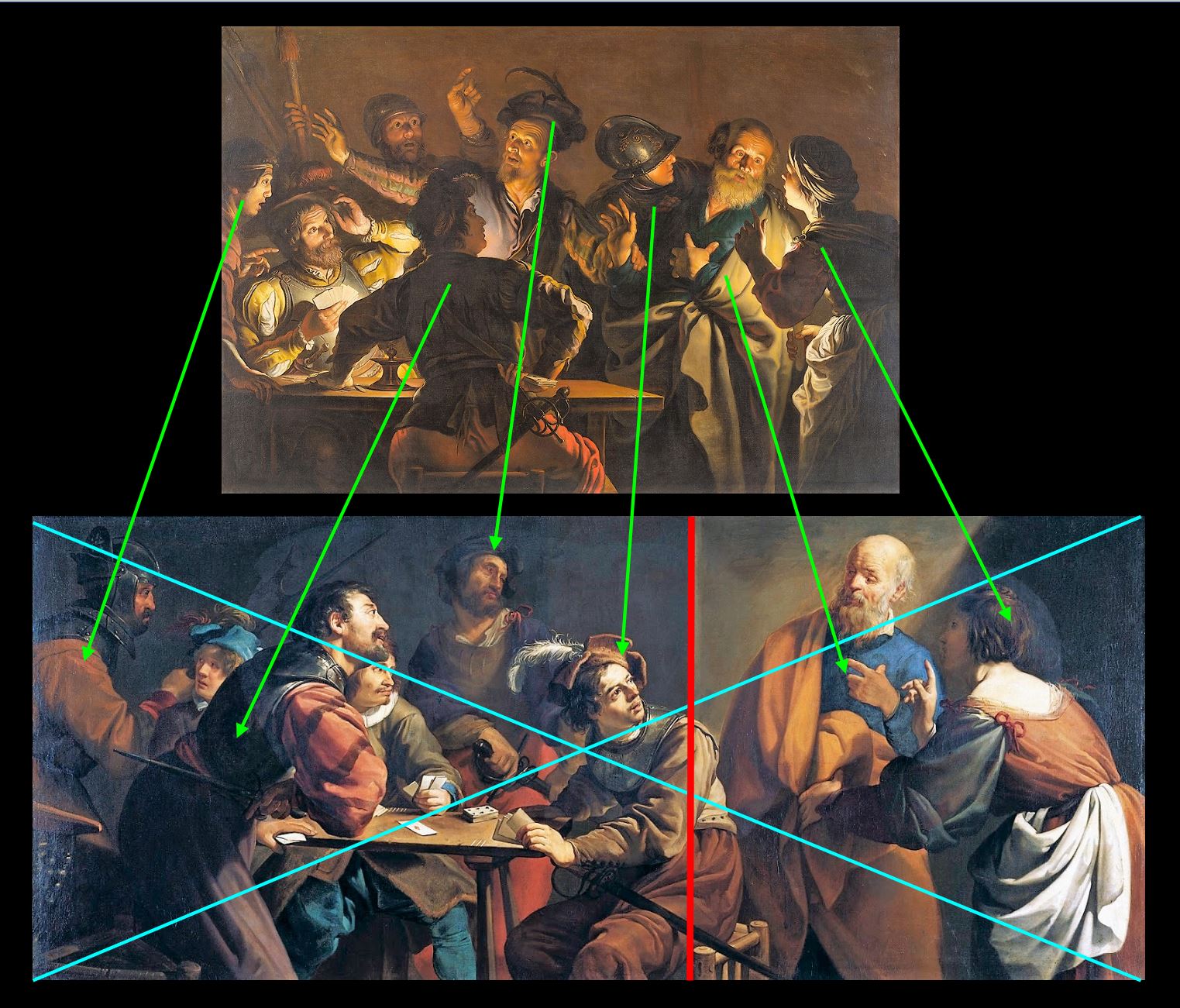
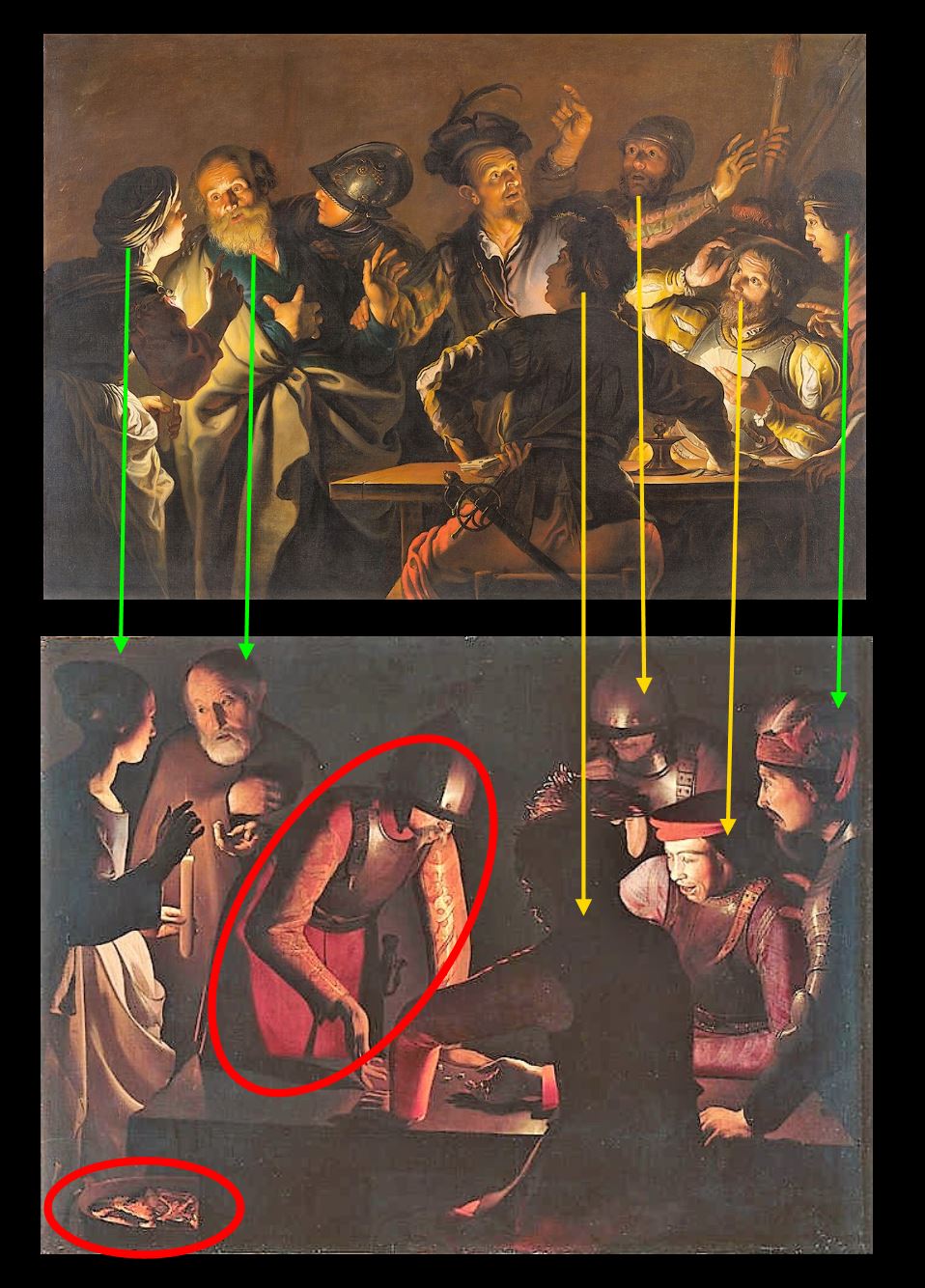 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Le Reniement de St Pierre
Le Reniement de St Pierre Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre
 Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre
Le reniement de saint Pierre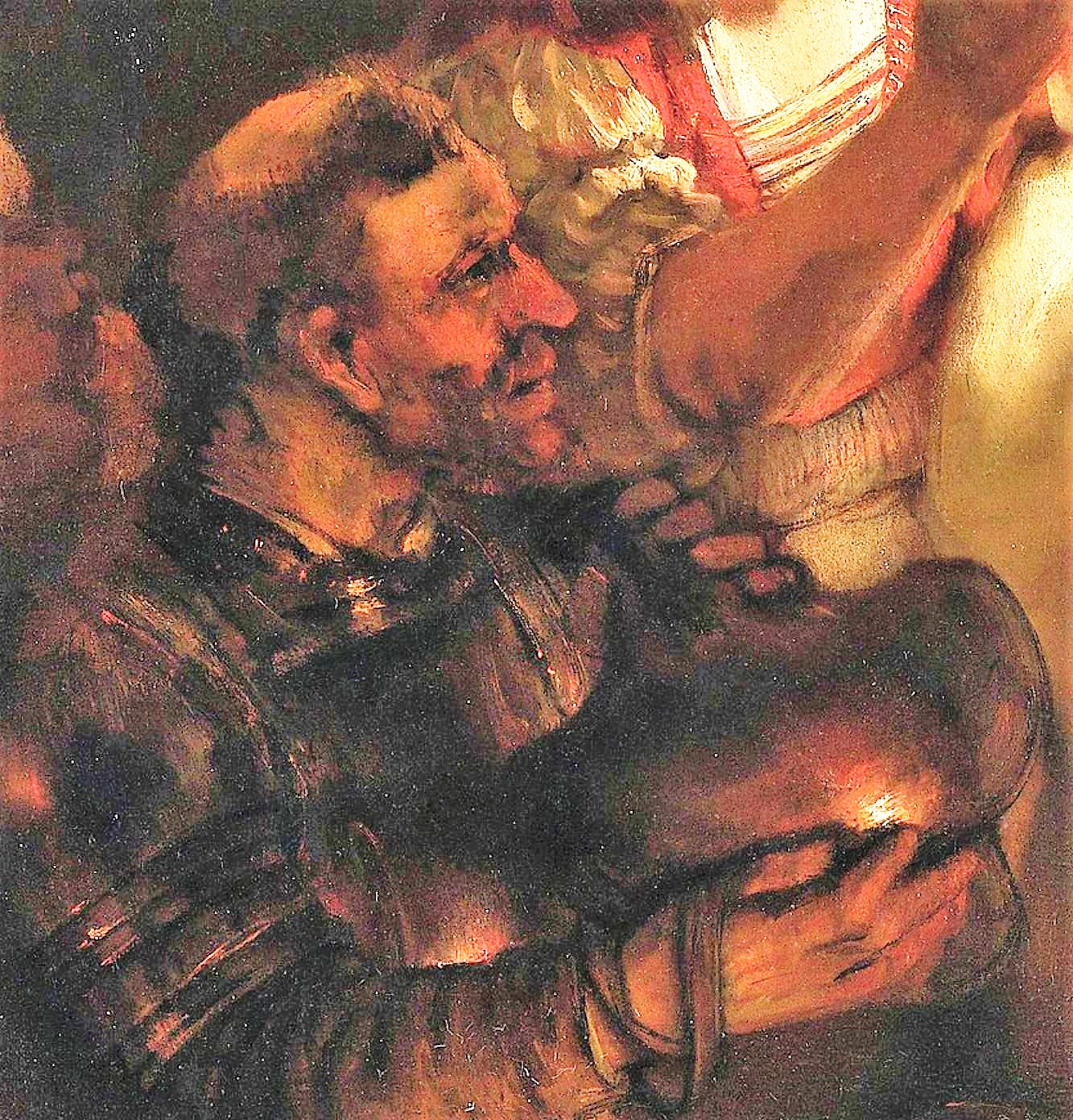

 Sagittaire visant la cour du palais du Tau , XIIIème siècle
Sagittaire visant la cour du palais du Tau , XIIIème siècle



 Jeu des offices de la Cour (Hofämterspiel), vers 1455, Kunsthistorisches Museum, Vienne
Jeu des offices de la Cour (Hofämterspiel), vers 1455, Kunsthistorisches Museum, Vienne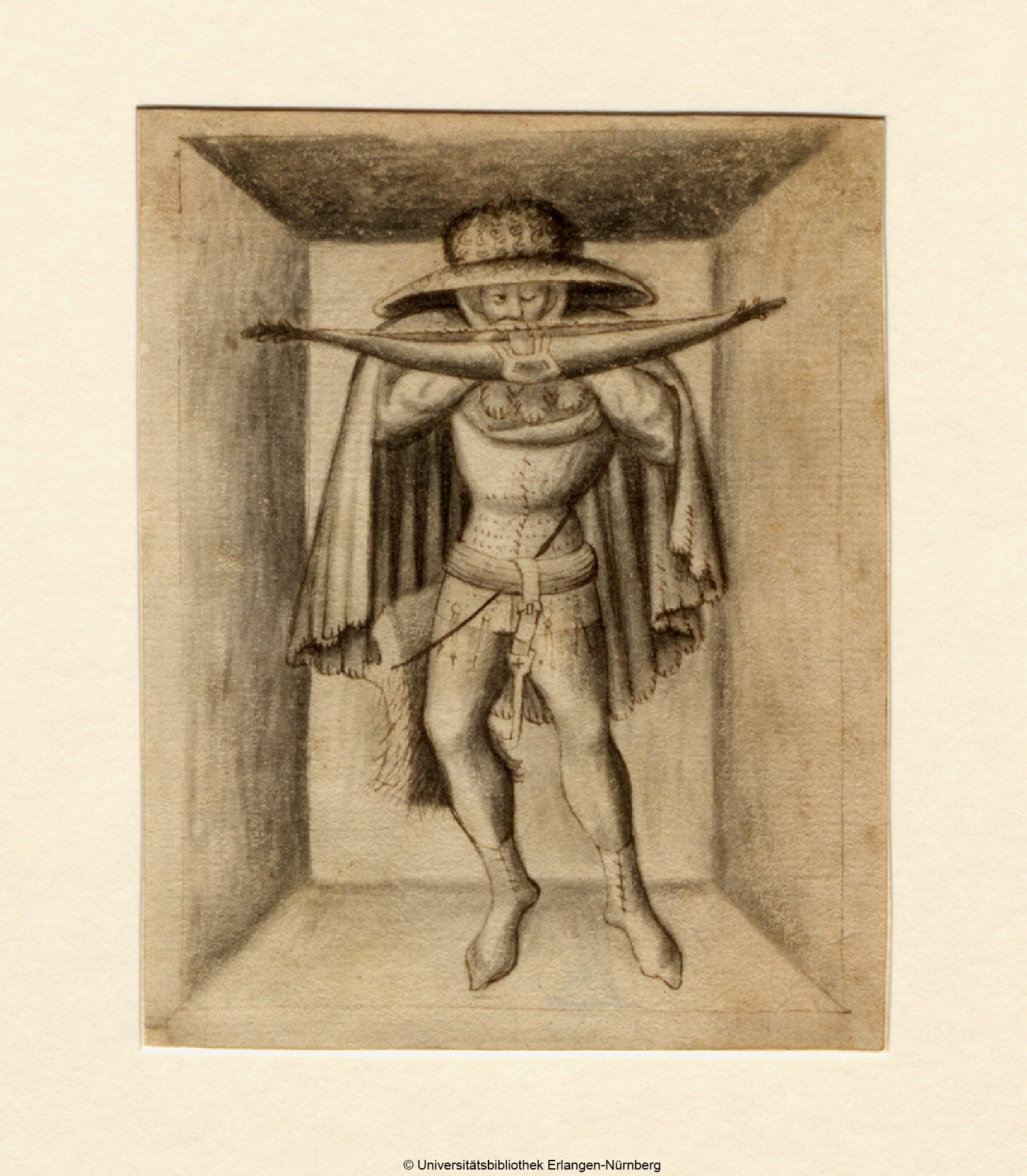 Dessin, vers 1430, Allemagne du sud, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg .
Dessin, vers 1430, Allemagne du sud, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg . Wappenbuch (ONB 12820, fol. 184r), c. 1484-1486
Wappenbuch (ONB 12820, fol. 184r), c. 1484-1486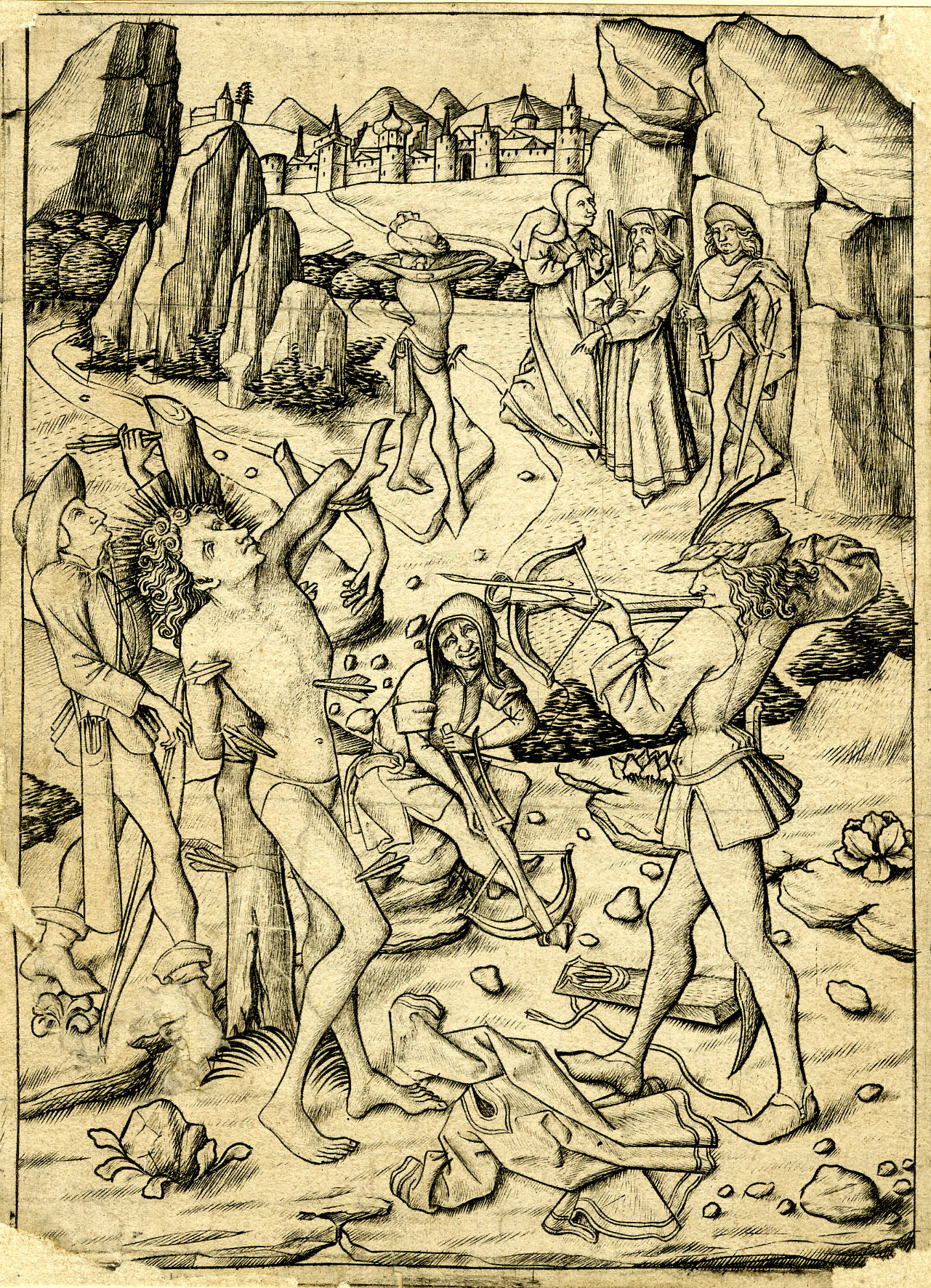 Le Martyre de Saint Sébastien, Maître ES, vers 1450
Le Martyre de Saint Sébastien, Maître ES, vers 1450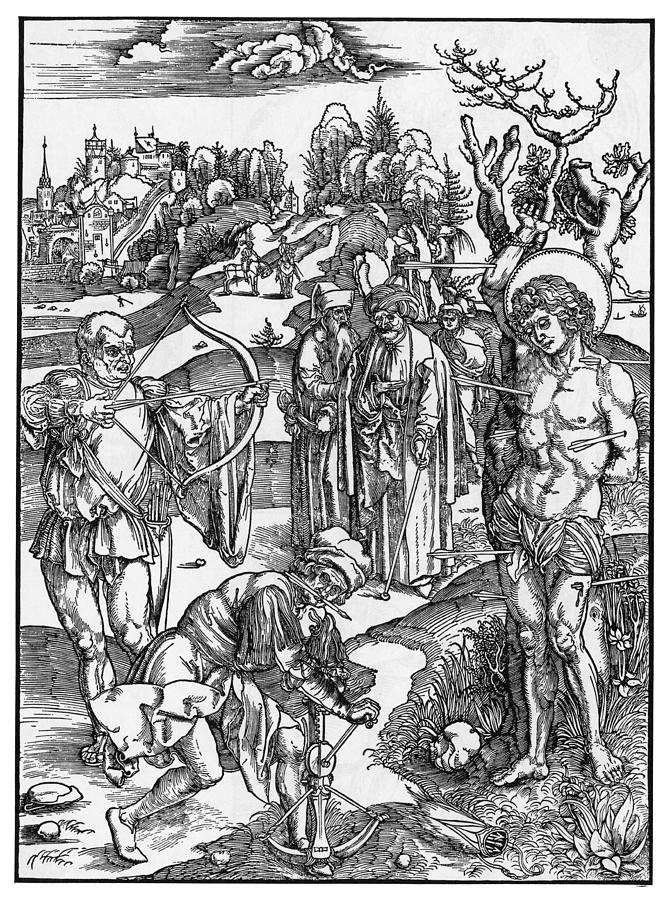

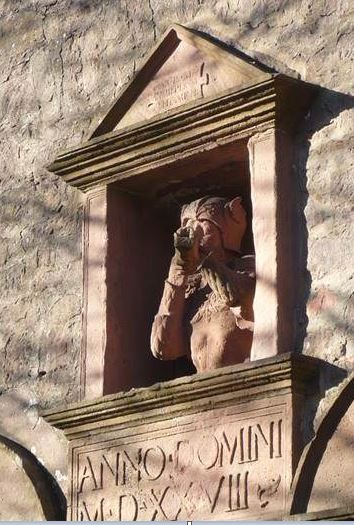 Arbalétrier au-dessus de la porte de l’armurerie des comtes de Wertheim
Arbalétrier au-dessus de la porte de l’armurerie des comtes de Wertheim Royal Collection Trust
Royal Collection Trust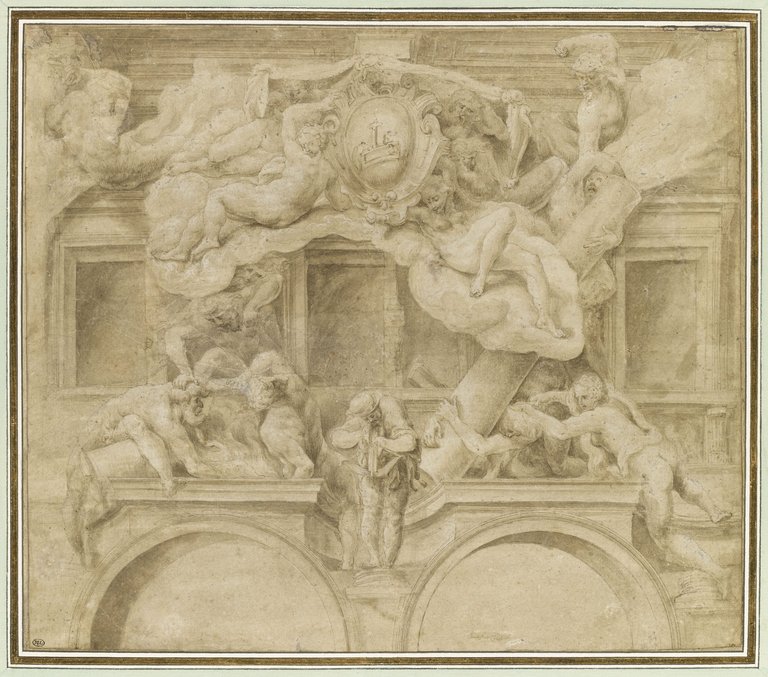 Louvre
Louvre  Gravure de 1579, Attribuée à Cherubino Alberti, d’après Lelio Orsi
Gravure de 1579, Attribuée à Cherubino Alberti, d’après Lelio Orsi Anonyme allemand, vers 1590 , Collection Marolles, volume 197, P. 17382, BNF
Anonyme allemand, vers 1590 , Collection Marolles, volume 197, P. 17382, BNF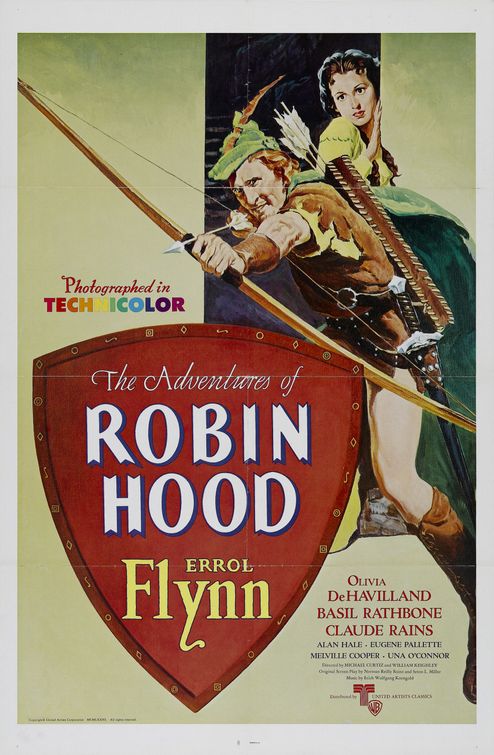 Errol Flynn, 1938
Errol Flynn, 1938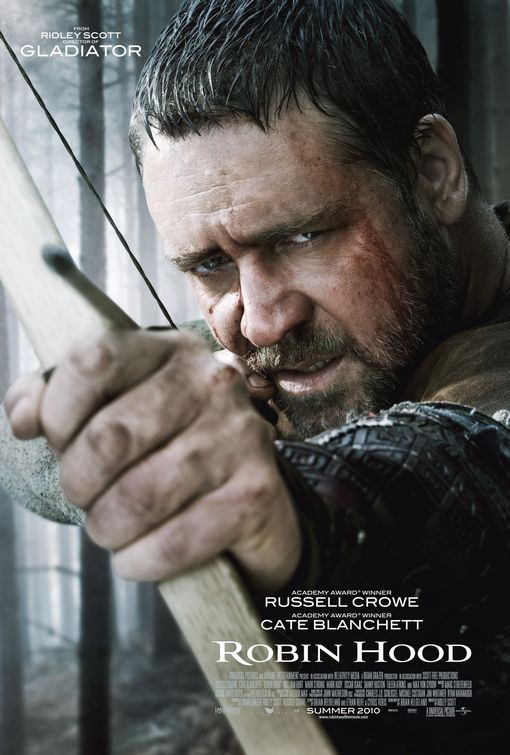 Russell Crowe, 2010
Russell Crowe, 2010




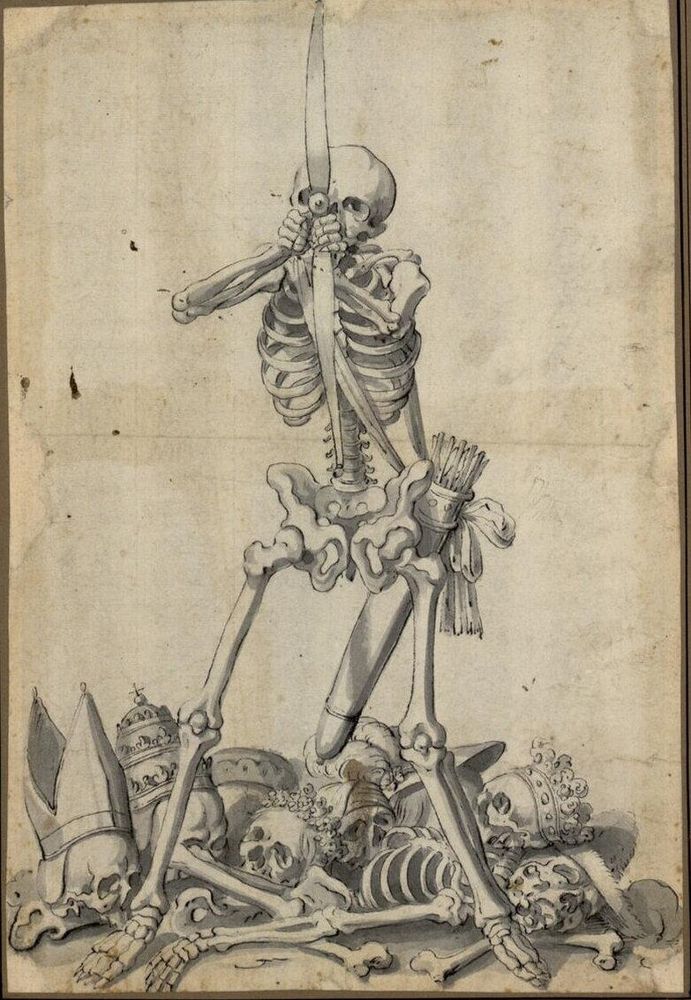 Le triomphe de la Mort
Le triomphe de la Mort La Mort à l’arbalète
La Mort à l’arbalète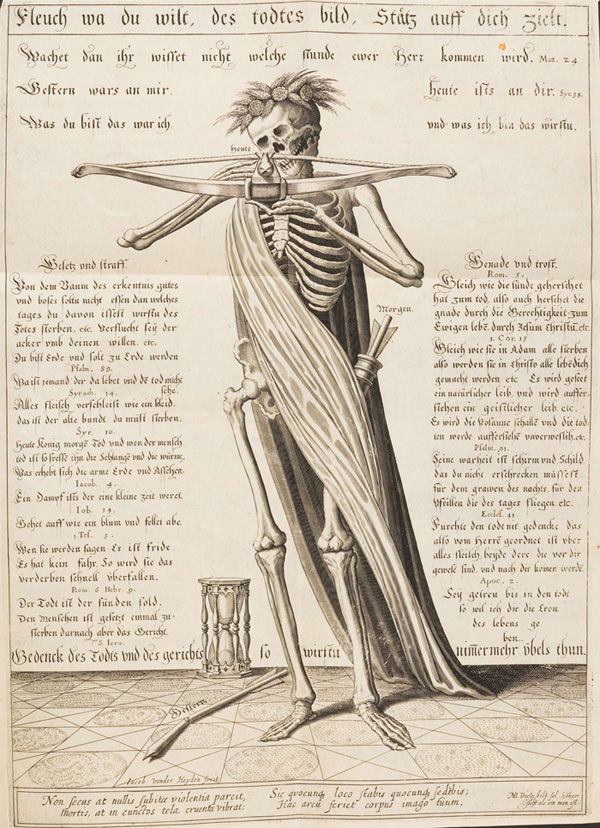 La Mort à l’arbalète
La Mort à l’arbalète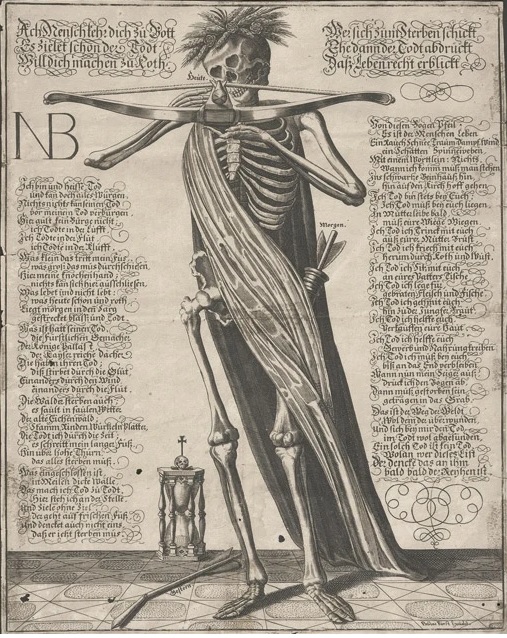 Copie d’après Jacob van der Heyden, 1650
Copie d’après Jacob van der Heyden, 1650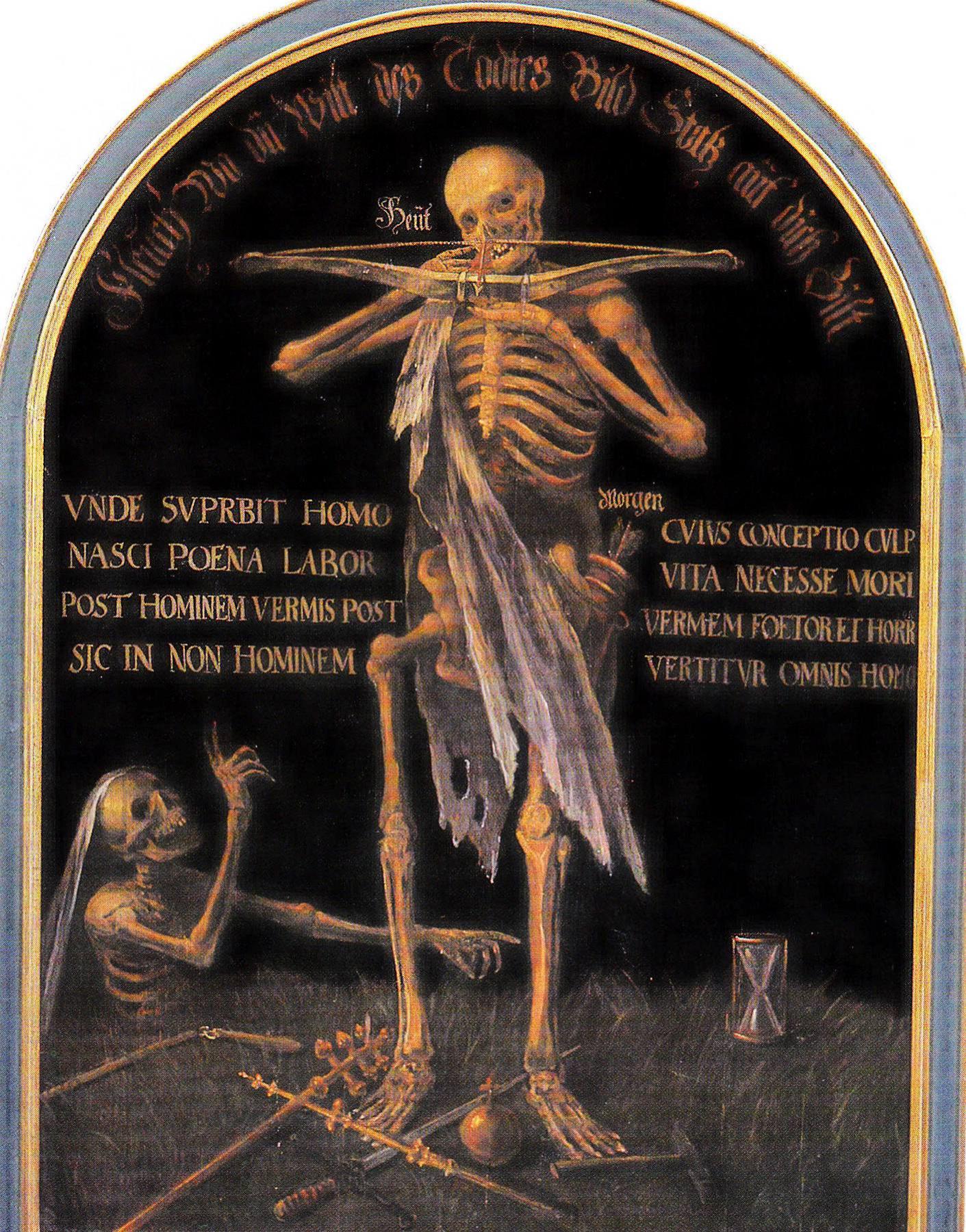
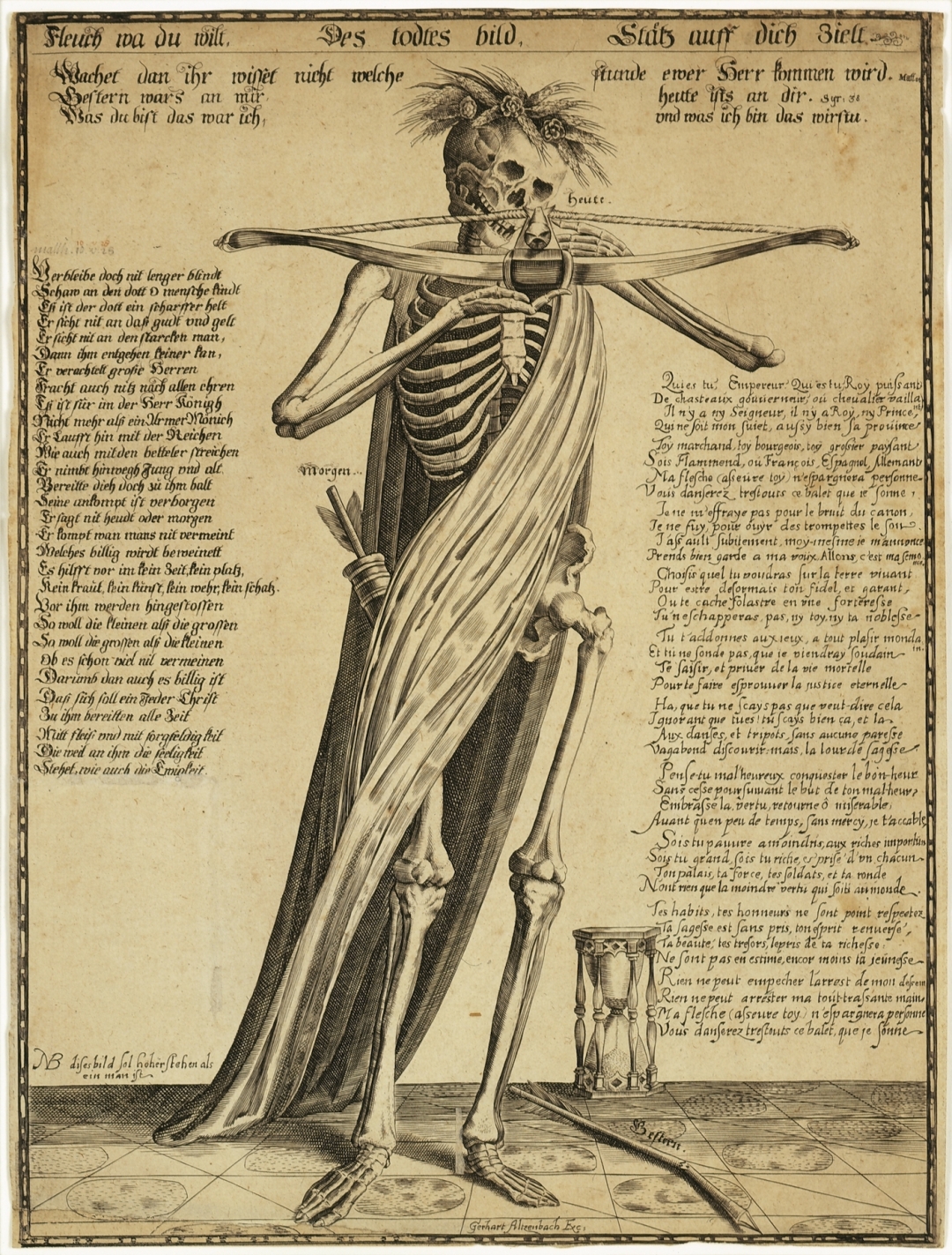 La mort à l’arbalète (“Death with a Crossbow or Death Stays on Target”)
La mort à l’arbalète (“Death with a Crossbow or Death Stays on Target”) L’escalier de la hiérarchie humaine,
L’escalier de la hiérarchie humaine,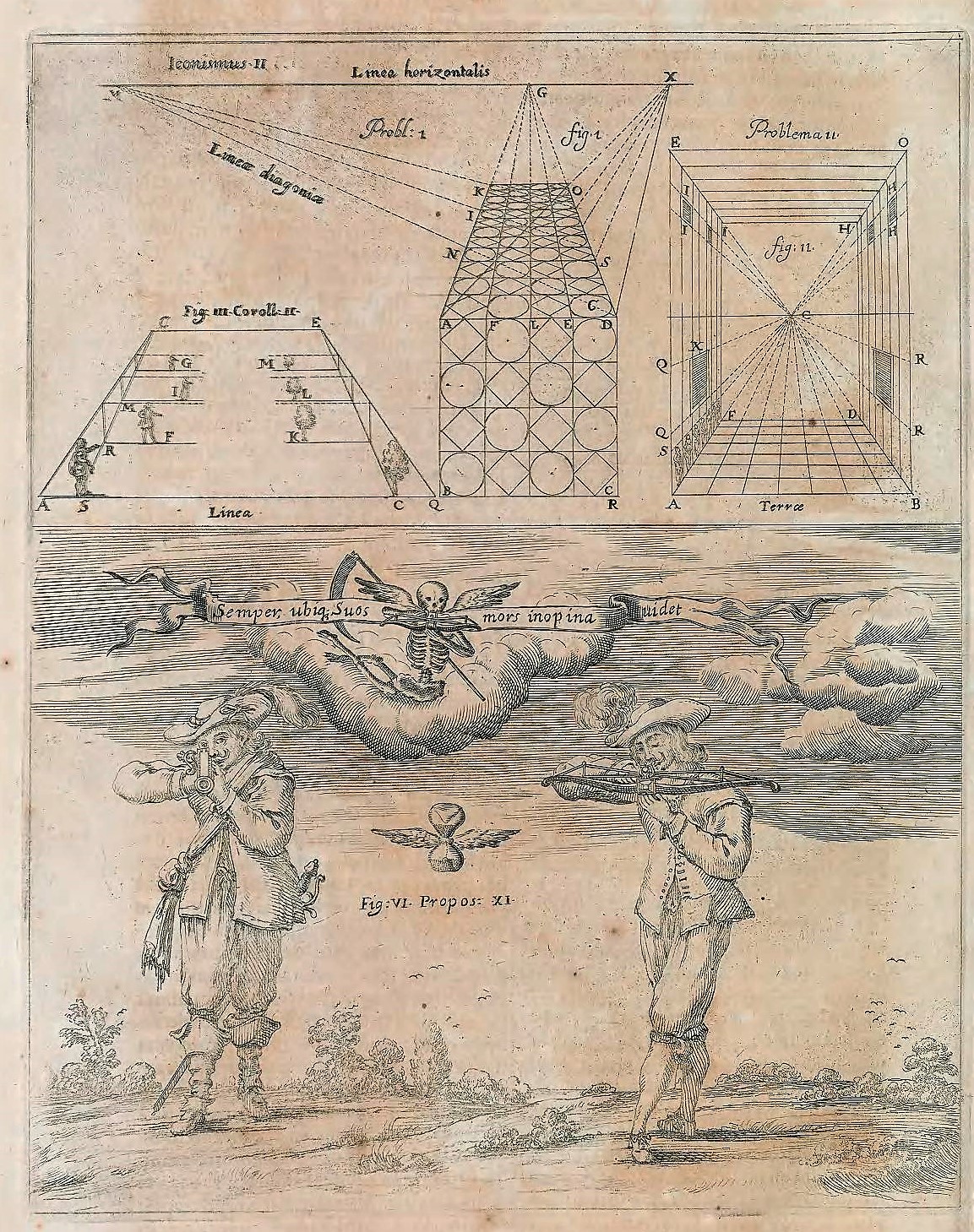 Athanasius Kircher, 1646, Ars Magna Lucis, p 138 [4]
Athanasius Kircher, 1646, Ars Magna Lucis, p 138 [4] Dessin allemand, XVIIIème, collection particulière
Dessin allemand, XVIIIème, collection particulière Le bolchevisme c’est l’esclavage, le viol, le meutre de masse, l’extermination.
Le bolchevisme c’est l’esclavage, le viol, le meutre de masse, l’extermination. Fresque provenant de la Villa Spada (Stati-Mattei) à Rome
Fresque provenant de la Villa Spada (Stati-Mattei) à Rome 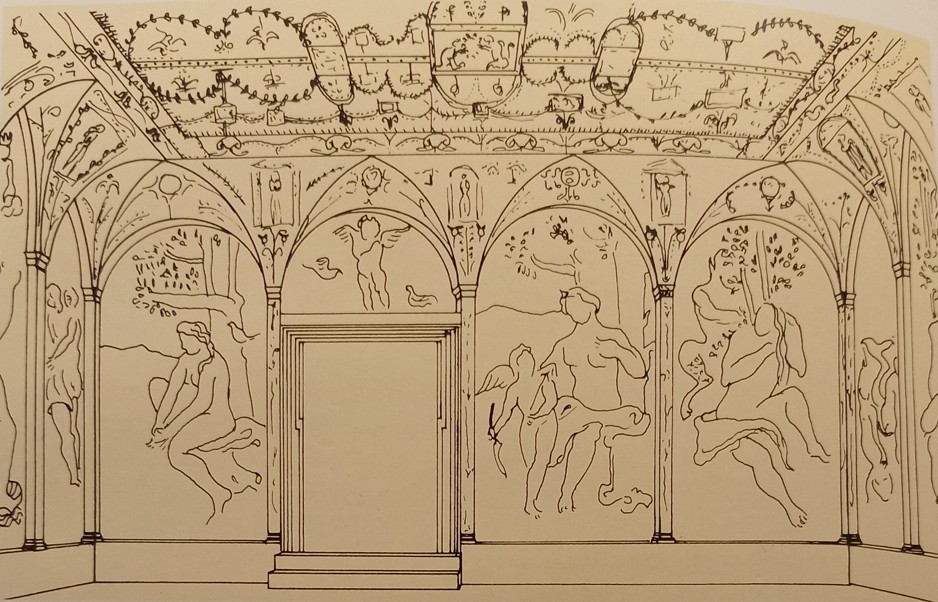 Reconstruction de A.Forcellino, [4a], p 29
Reconstruction de A.Forcellino, [4a], p 29








 Cupidon tirant une flèche
Cupidon tirant une flèche


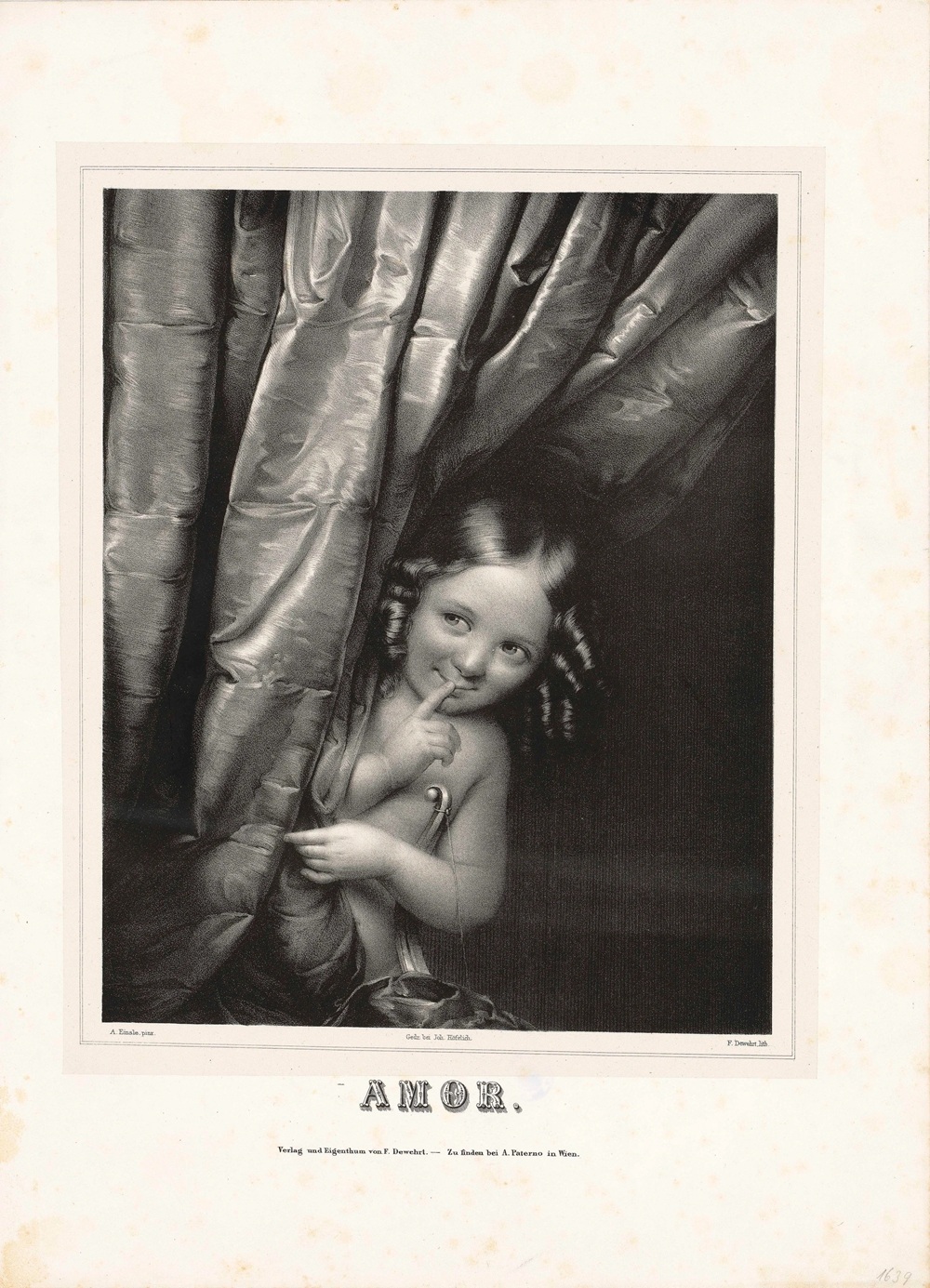 Amor
Amor Cupidon, copie d’après Reynolds, 1780-85, collection particulière
Cupidon, copie d’après Reynolds, 1780-85, collection particulière

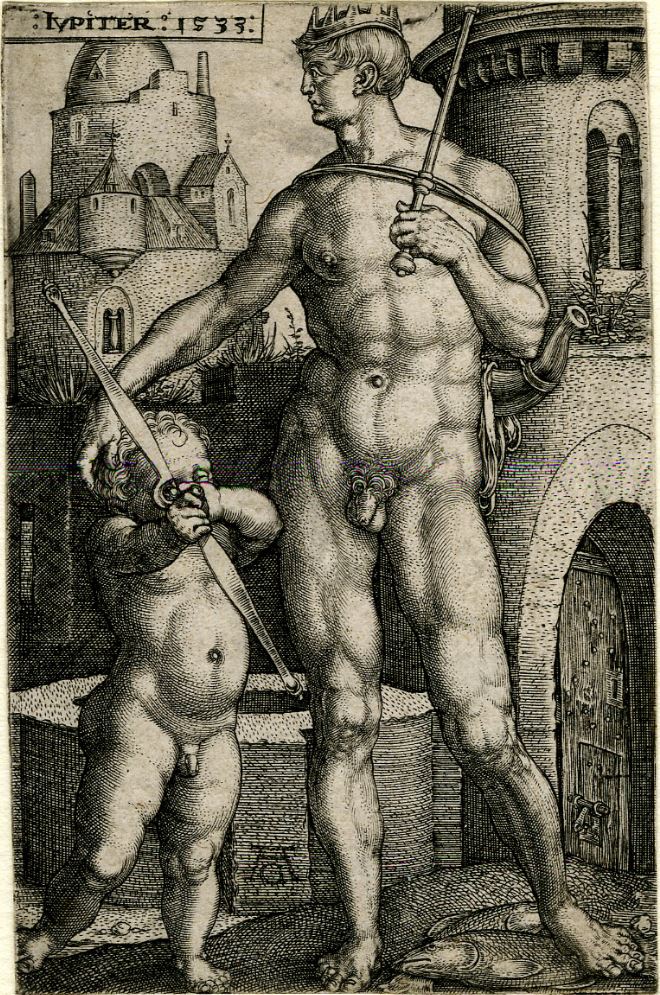
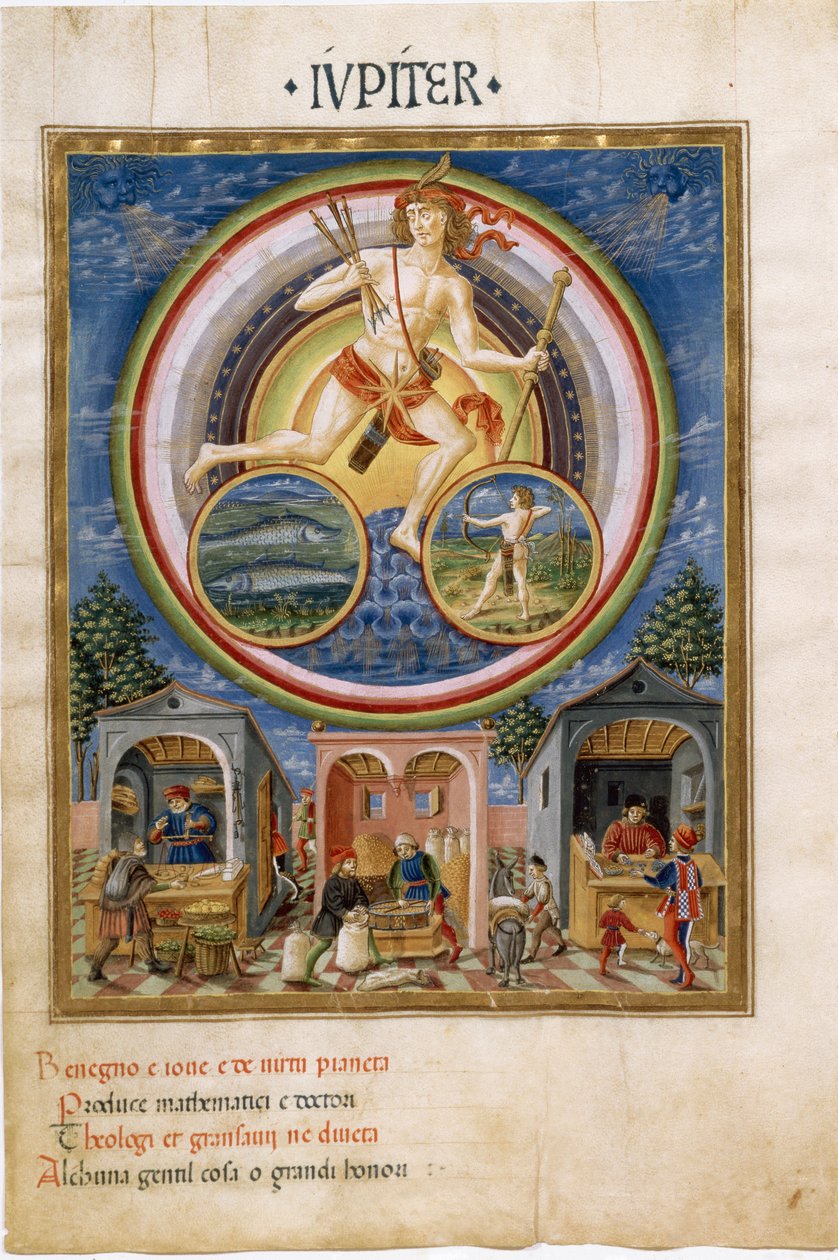 Jupiter avec les Poissons et le Sagittaire
Jupiter avec les Poissons et le Sagittaire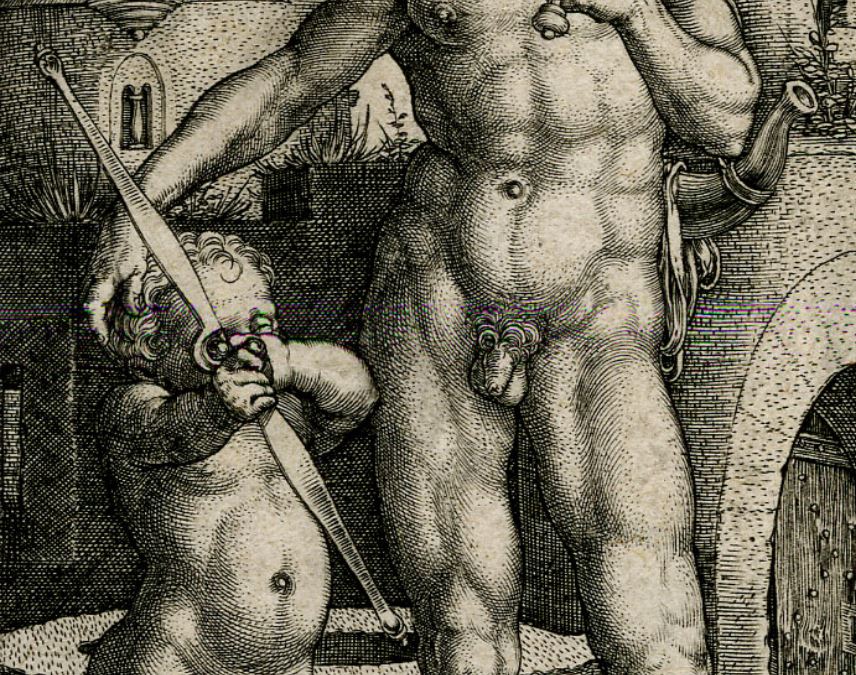
 Vénus et Cupidon
Vénus et Cupidon Vénus, Mars et Amour
Vénus, Mars et Amour
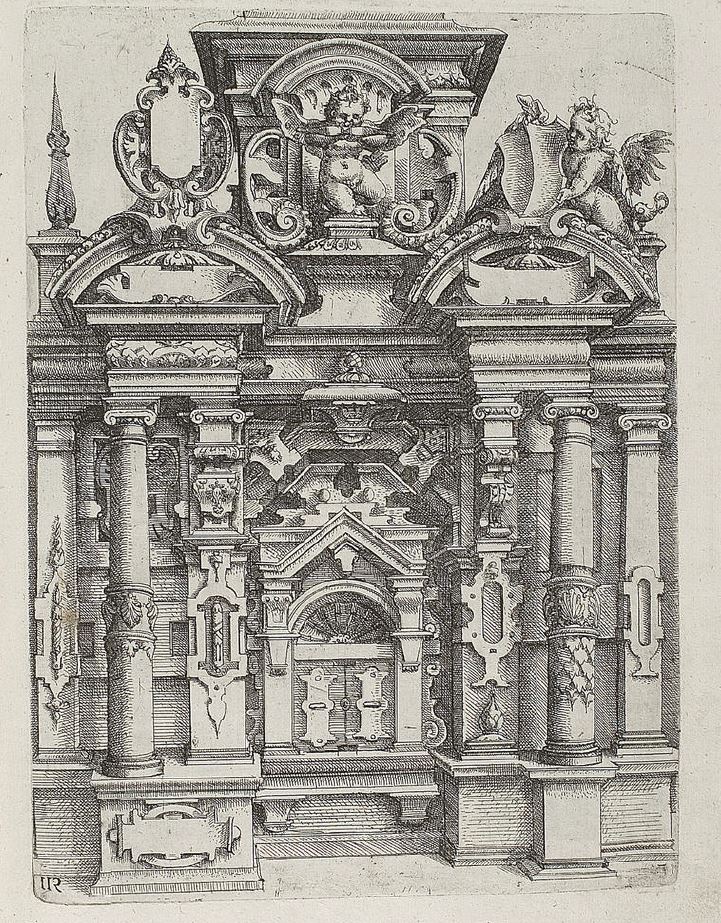 Wendel Dietterlin « Architectvra Von Außtheilung, Symmetria vnd Proportion der Fünff Seulen, und aller darauß volgender Kunst Arbeit, von Fenstern, Caminen … », Nurnberg, 1598 planche 112
Wendel Dietterlin « Architectvra Von Außtheilung, Symmetria vnd Proportion der Fünff Seulen, und aller darauß volgender Kunst Arbeit, von Fenstern, Caminen … », Nurnberg, 1598 planche 112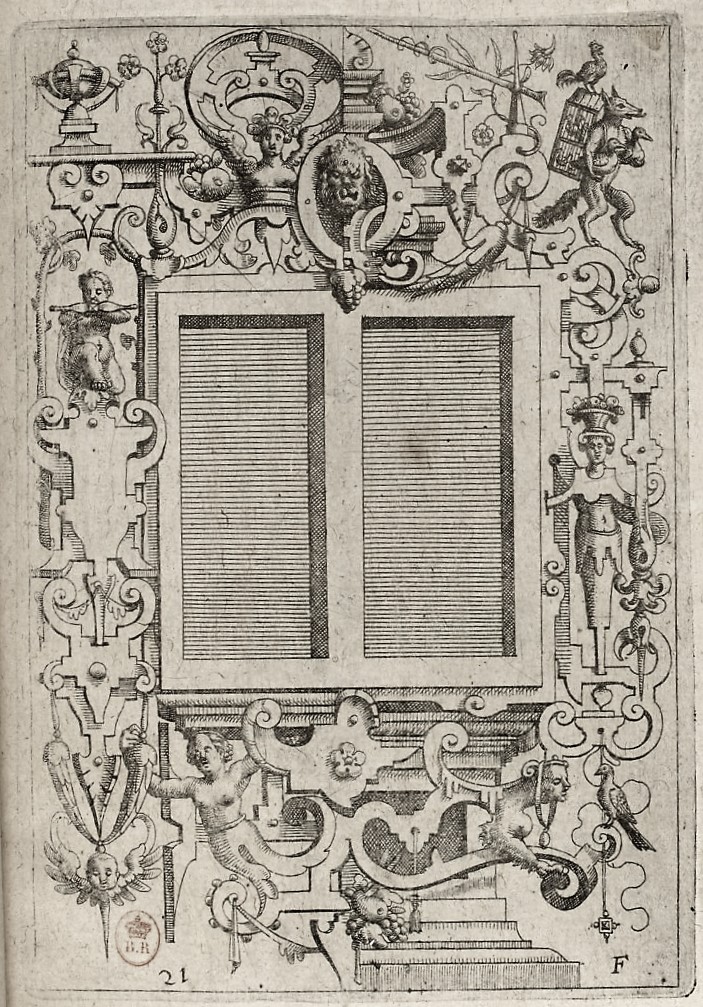 Daniel Meyer, L’ Architecture Ou Demonstration De Toute Sorte d’ Ornemens, és Portes, Fenestres, Planches… a Heydelberg ches Pierre Bourgeat, 1609, planche 21
Daniel Meyer, L’ Architecture Ou Demonstration De Toute Sorte d’ Ornemens, és Portes, Fenestres, Planches… a Heydelberg ches Pierre Bourgeat, 1609, planche 21


 La nymphe de l’amour
La nymphe de l’amour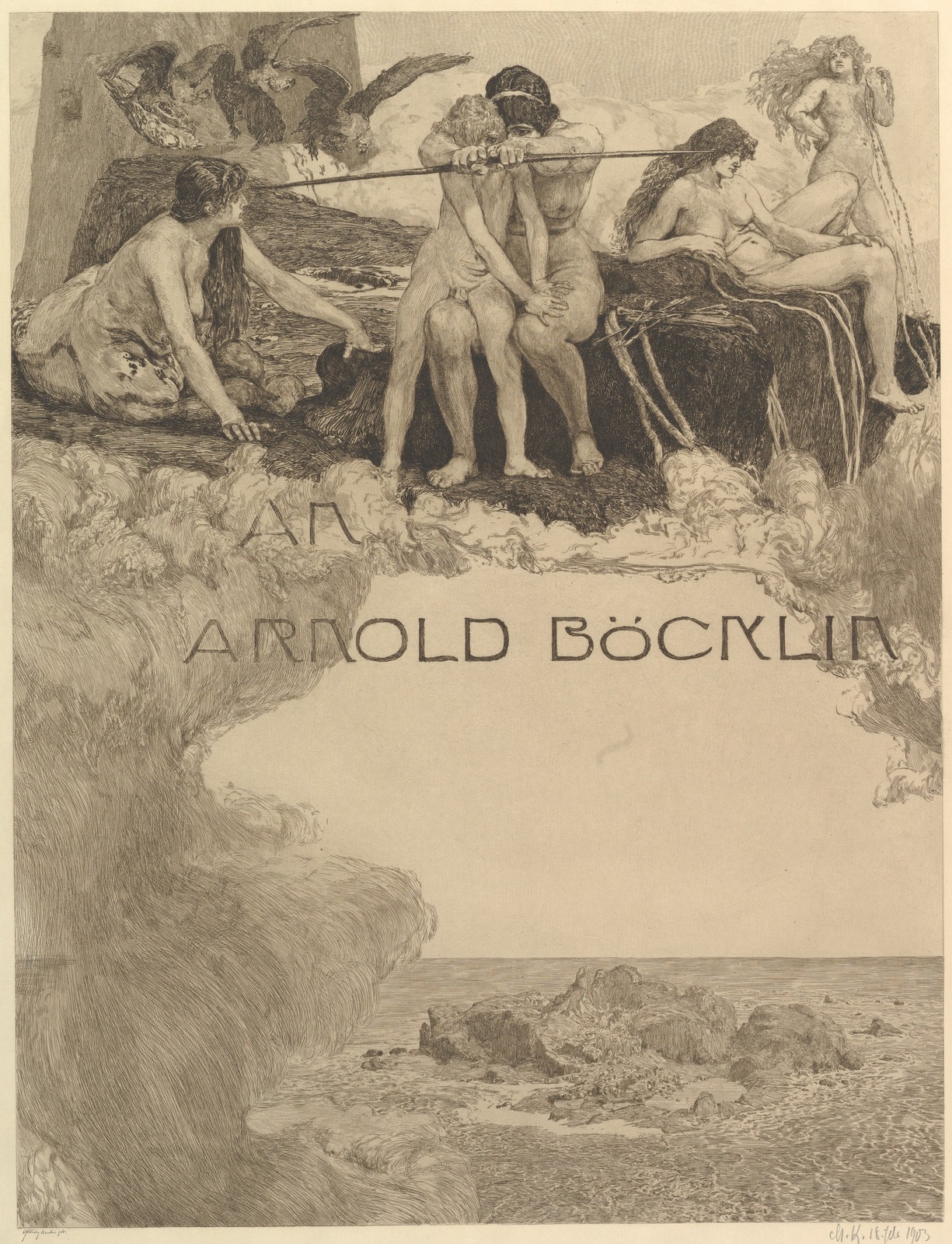 Dédicace à Arnold Böcklin
Dédicace à Arnold Böcklin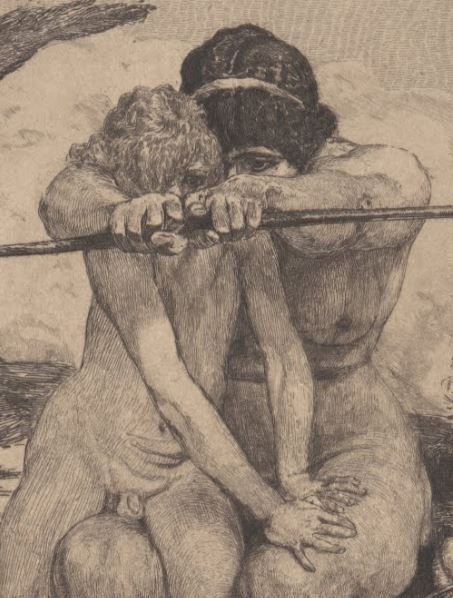
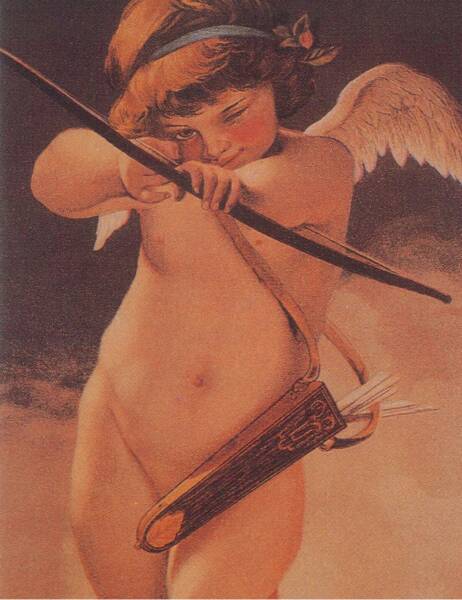 L’art de l’exhibition inversée : l’arc sans flèche et le cache-sexe rendent criant ce qui n’est pas montré.
L’art de l’exhibition inversée : l’arc sans flèche et le cache-sexe rendent criant ce qui n’est pas montré.
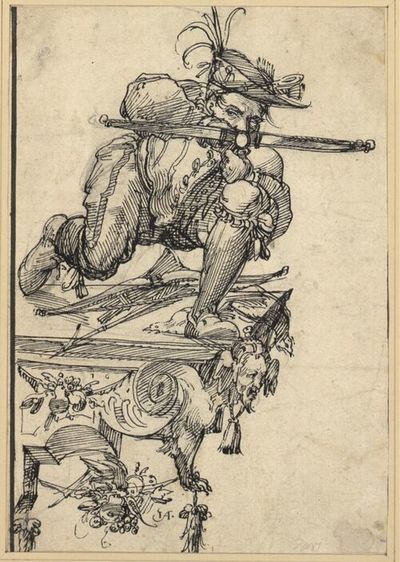 Arbalétrier
Arbalétrier L’arbalétrier et la laitière (The Archer and the Milkmaid)
L’arbalétrier et la laitière (The Archer and the Milkmaid)
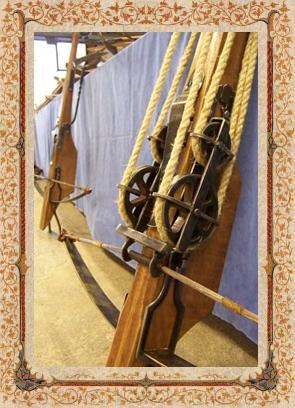
 Arbalétrier et servante tenant un verre de vin (Bogenschütze und Milchmagd mit Weinglas)
Arbalétrier et servante tenant un verre de vin (Bogenschütze und Milchmagd mit Weinglas)


 Arbalétrier
Arbalétrier Pierre Landry 1690
Pierre Landry 1690 Nicolas Simon Duflos 1725-60
Nicolas Simon Duflos 1725-60 Johann Rudolf Schellenberg, fin XVIIe, Kunsthaus Zurich
Johann Rudolf Schellenberg, fin XVIIe, Kunsthaus Zurich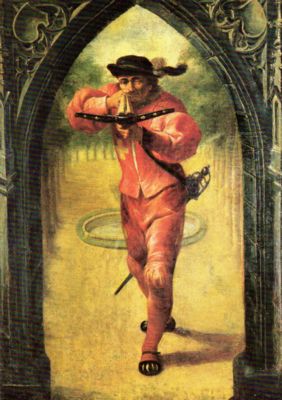 Décoration murale, Schloss Lichtenstein
Décoration murale, Schloss Lichtenstein
 Amazons of the Bow A Sketch at an Archery Meeting. Illustration de Lucien Davis, Supplément de The Illustrated London News, 3 Octobre 1885
Amazons of the Bow A Sketch at an Archery Meeting. Illustration de Lucien Davis, Supplément de The Illustrated London News, 3 Octobre 1885 Lilial Harley, Eine Nacht in Berlin (A Knight in London), 1928
Lilial Harley, Eine Nacht in Berlin (A Knight in London), 1928
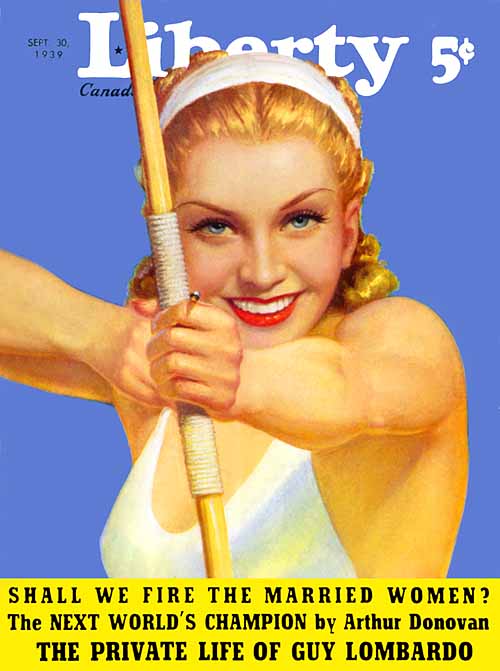 Edition Canada, couverture de Victor Tchetchet
Edition Canada, couverture de Victor Tchetchet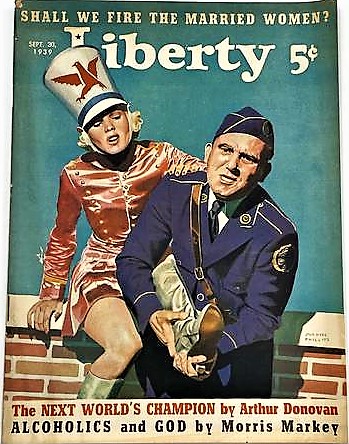 Edition US, couverture de John Hyde Phillips
Edition US, couverture de John Hyde Phillips Jane Russell, Pic Magazine du 10 Novembre 1941
Jane Russell, Pic Magazine du 10 Novembre 1941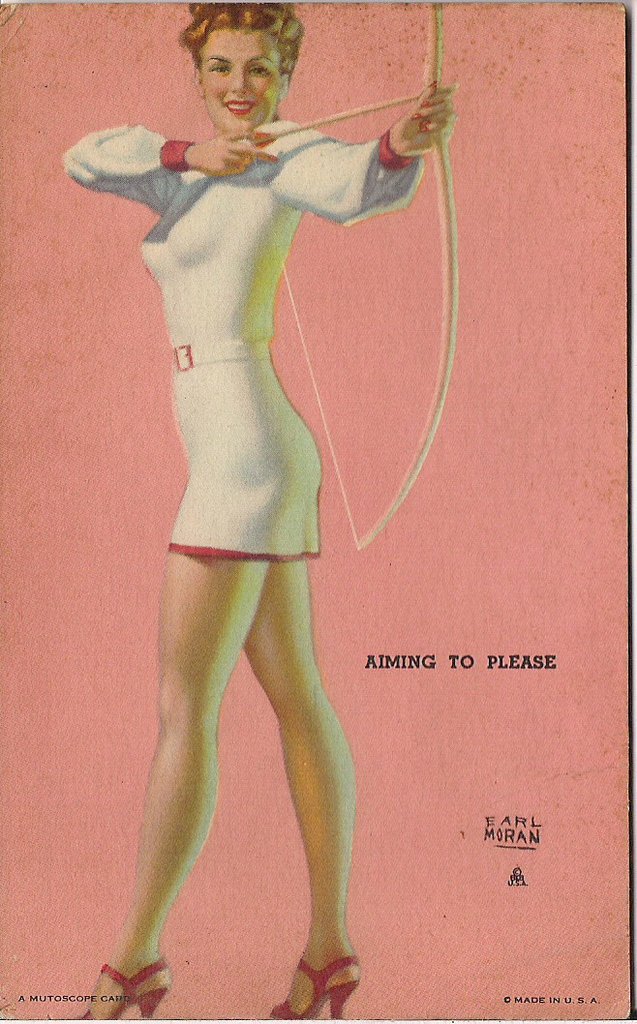 Visant à plaire (Aiming to please)
Visant à plaire (Aiming to please)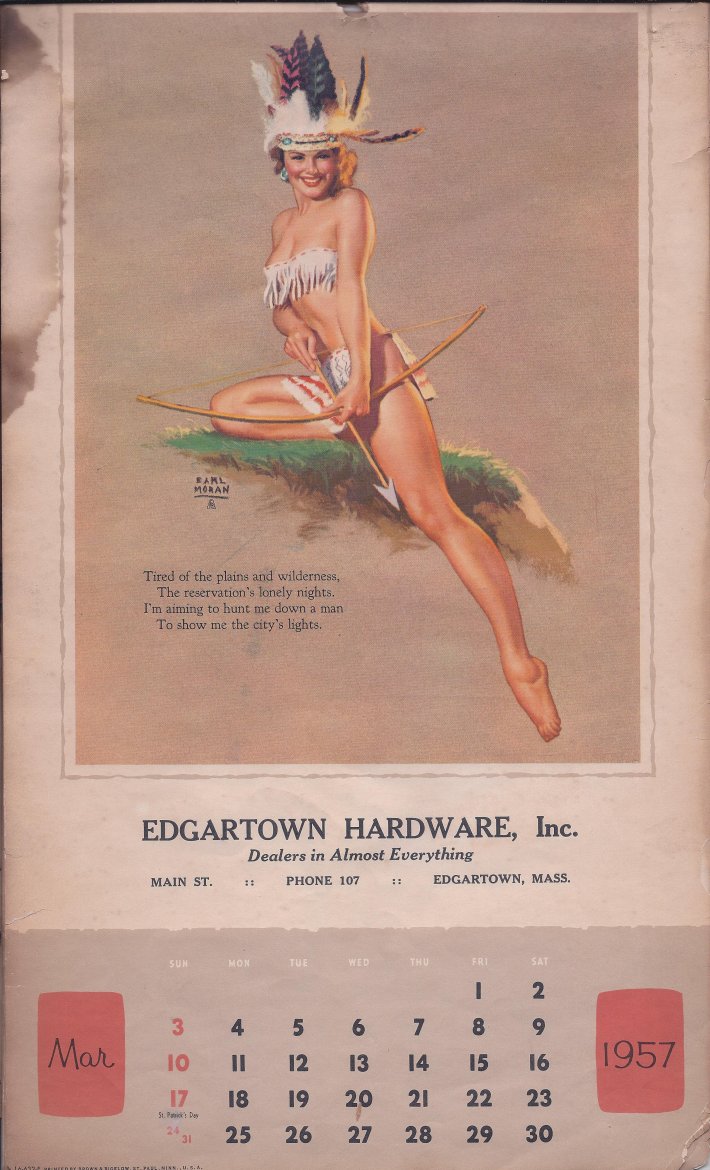 Earl Moran, calendrier Mars 1957
Earl Moran, calendrier Mars 1957 April shower, 8 avril 1944
April shower, 8 avril 1944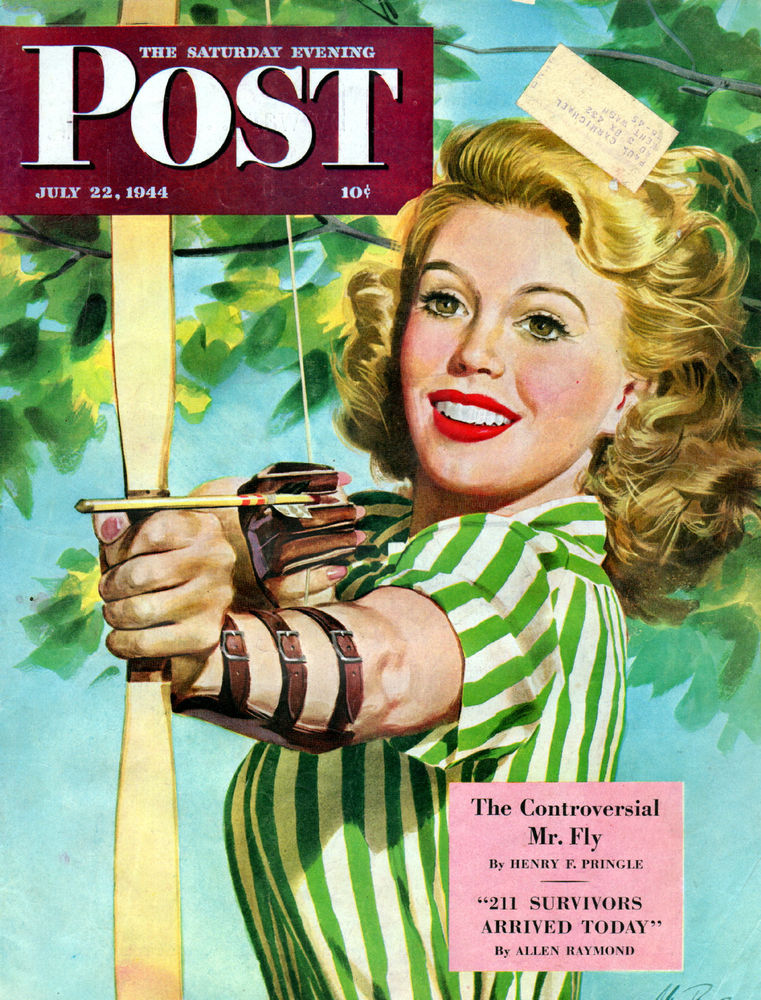 Archer woman, 22 juillet 1944
Archer woman, 22 juillet 1944 23 Juillet 1949, Toronto Star Weekly
23 Juillet 1949, Toronto Star Weekly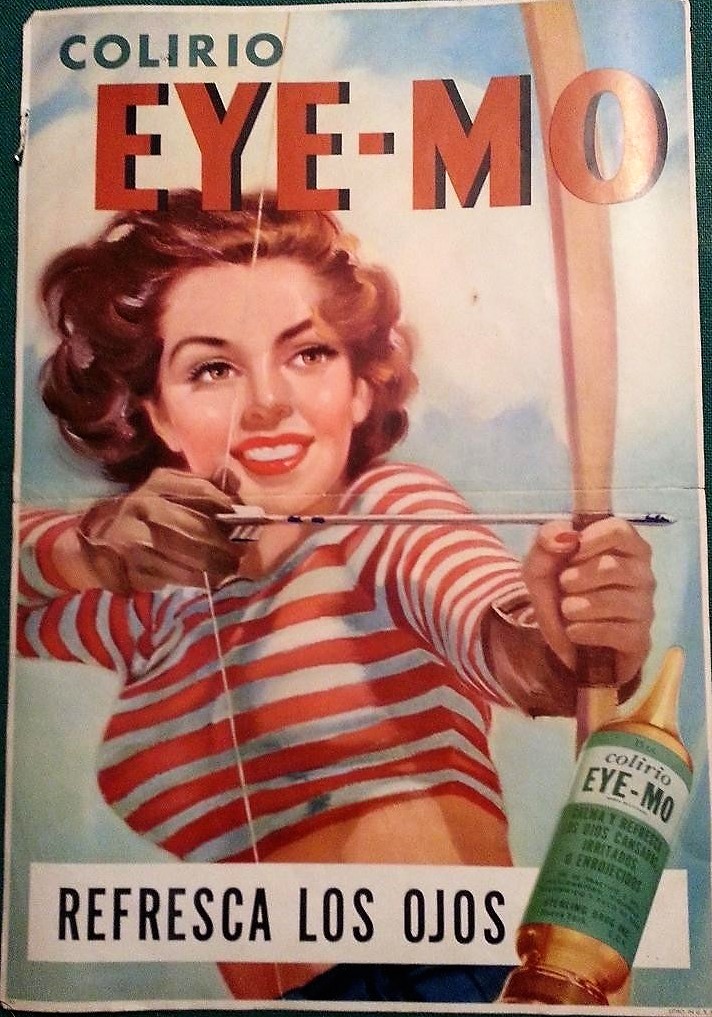 Années 50, publicité espagnole
Années 50, publicité espagnole Cupidon moderne, 1949, Stars et vedettes n°43
Cupidon moderne, 1949, Stars et vedettes n°43

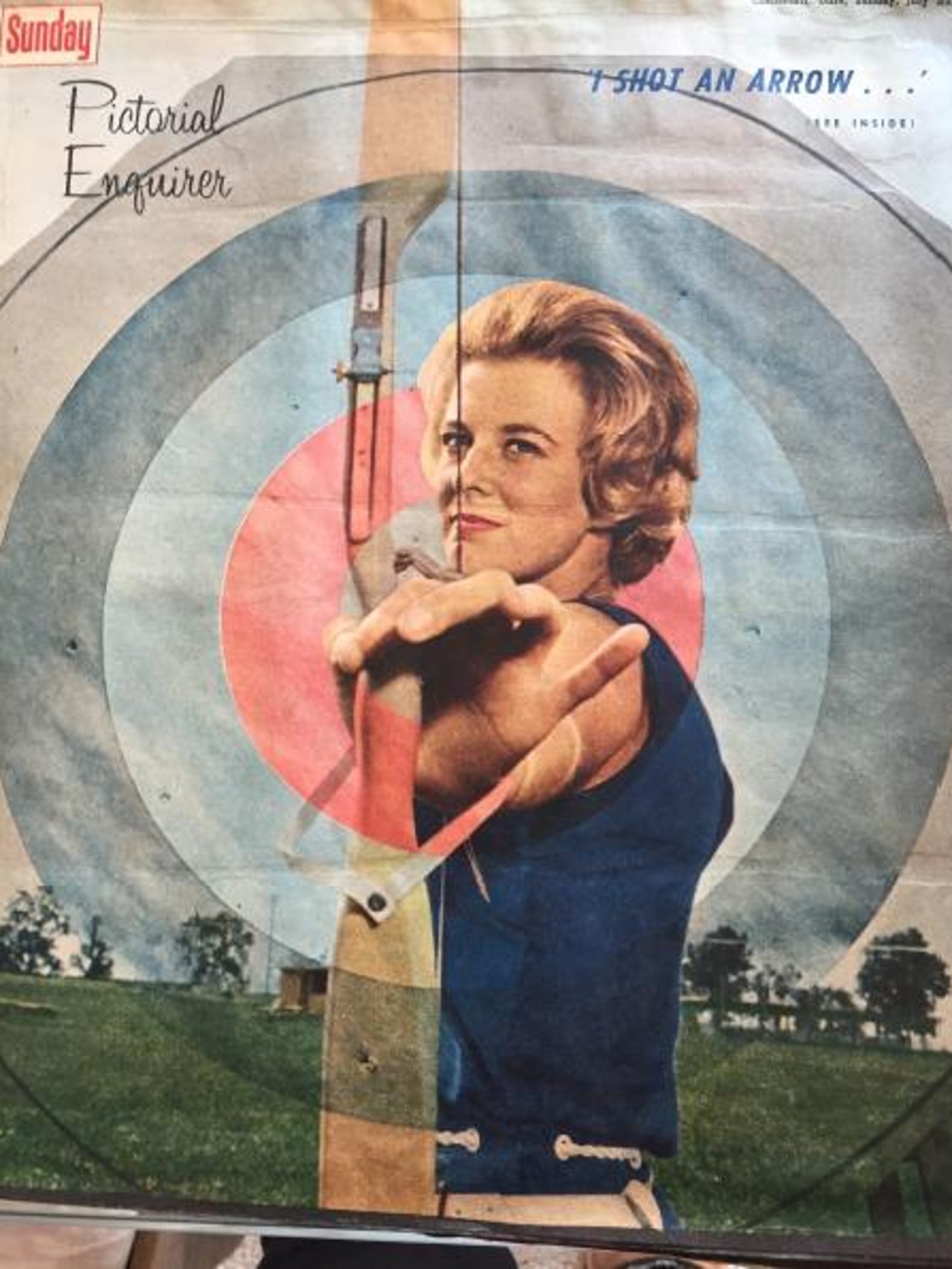 Nancy Kleinman, vers 1960
Nancy Kleinman, vers 1960 Publicité pour le cirage Griffin Microsheen, parue dans Plaboy 1957
Publicité pour le cirage Griffin Microsheen, parue dans Plaboy 1957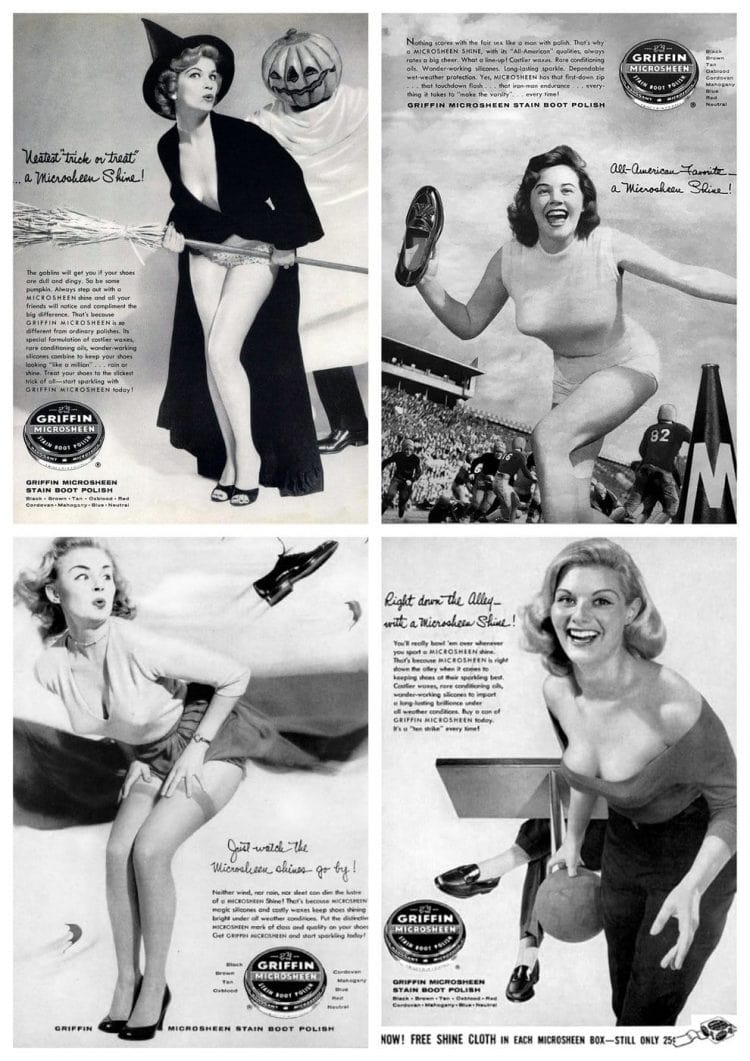
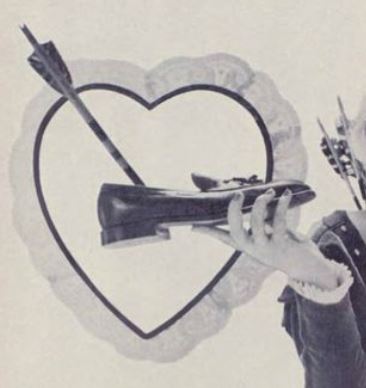 J’appellerais volontiers sursexisme cette interception improbable de la flèche en plein coeur par un mocassin.
J’appellerais volontiers sursexisme cette interception improbable de la flèche en plein coeur par un mocassin.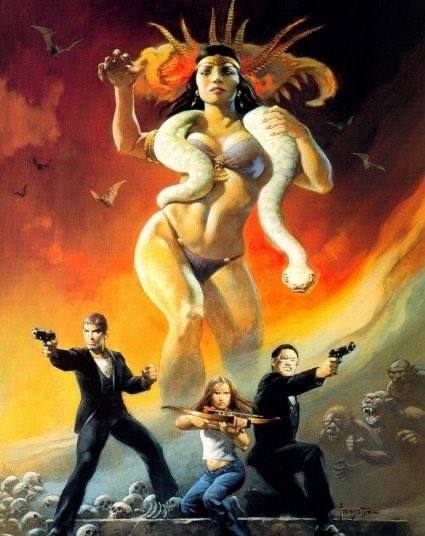 Affiche pour « Une nuit en enfer » (From Dusk till Dawn), Frazetta, 1996
Affiche pour « Une nuit en enfer » (From Dusk till Dawn), Frazetta, 1996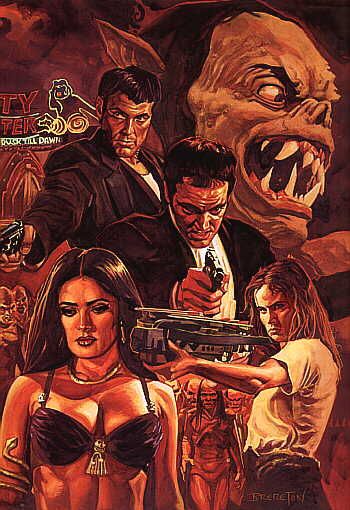 Dans une des affiches retenues, c’est la figure la plus insolite, l’arbalétrière, qui passe en tête des tireurs et supplante le glamour plus banal de la femme fatale.
Dans une des affiches retenues, c’est la figure la plus insolite, l’arbalétrière, qui passe en tête des tireurs et supplante le glamour plus banal de la femme fatale. Merida, Joseph Qiu, 2017, josephqiuart
Merida, Joseph Qiu, 2017, josephqiuart Anatase Flurite, 2020, leksaart
Anatase Flurite, 2020, leksaart
 1.23.29
1.23.29 1.23.43
1.23.43 1-24-18
1-24-18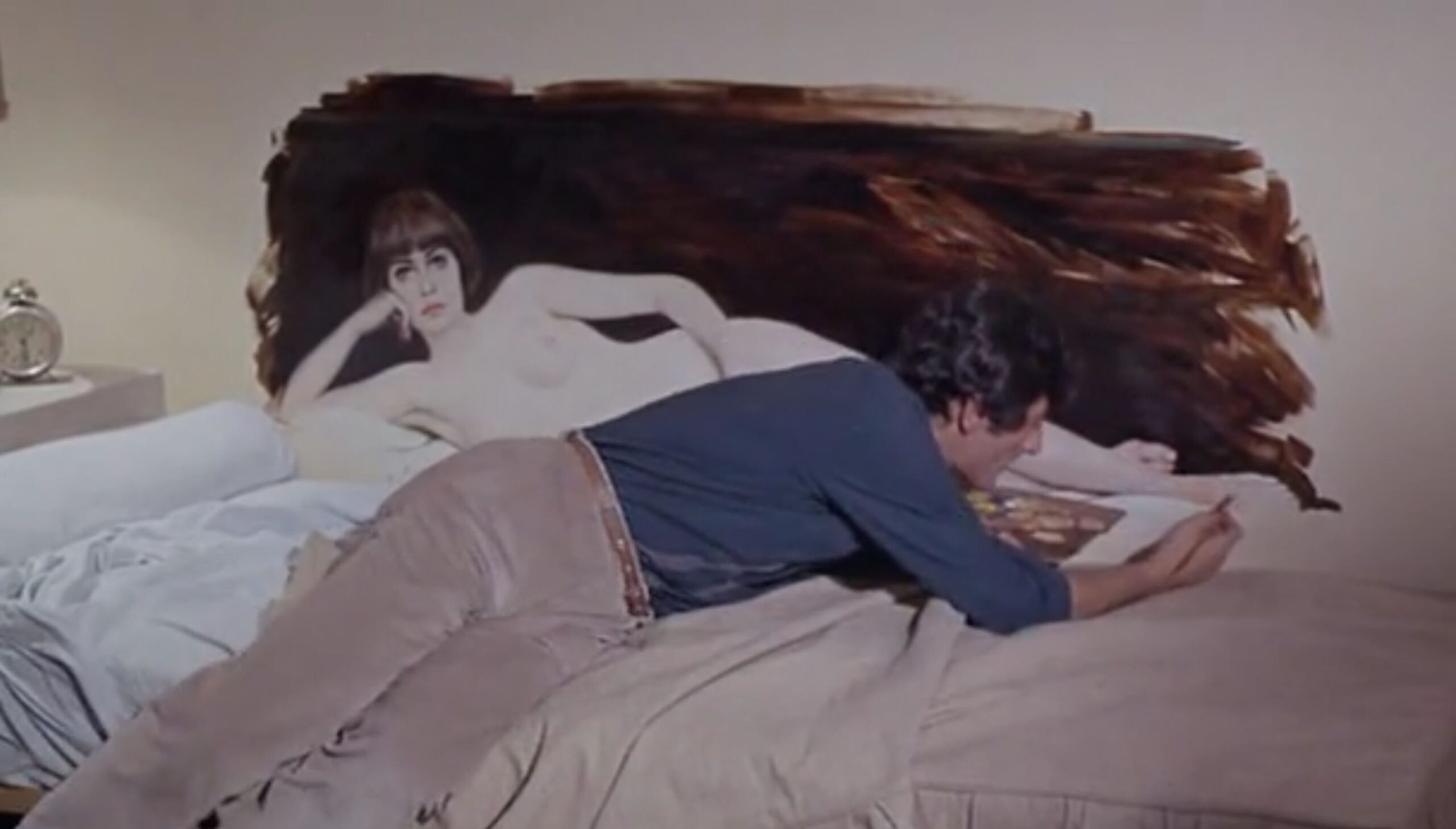 1.26.35
1.26.35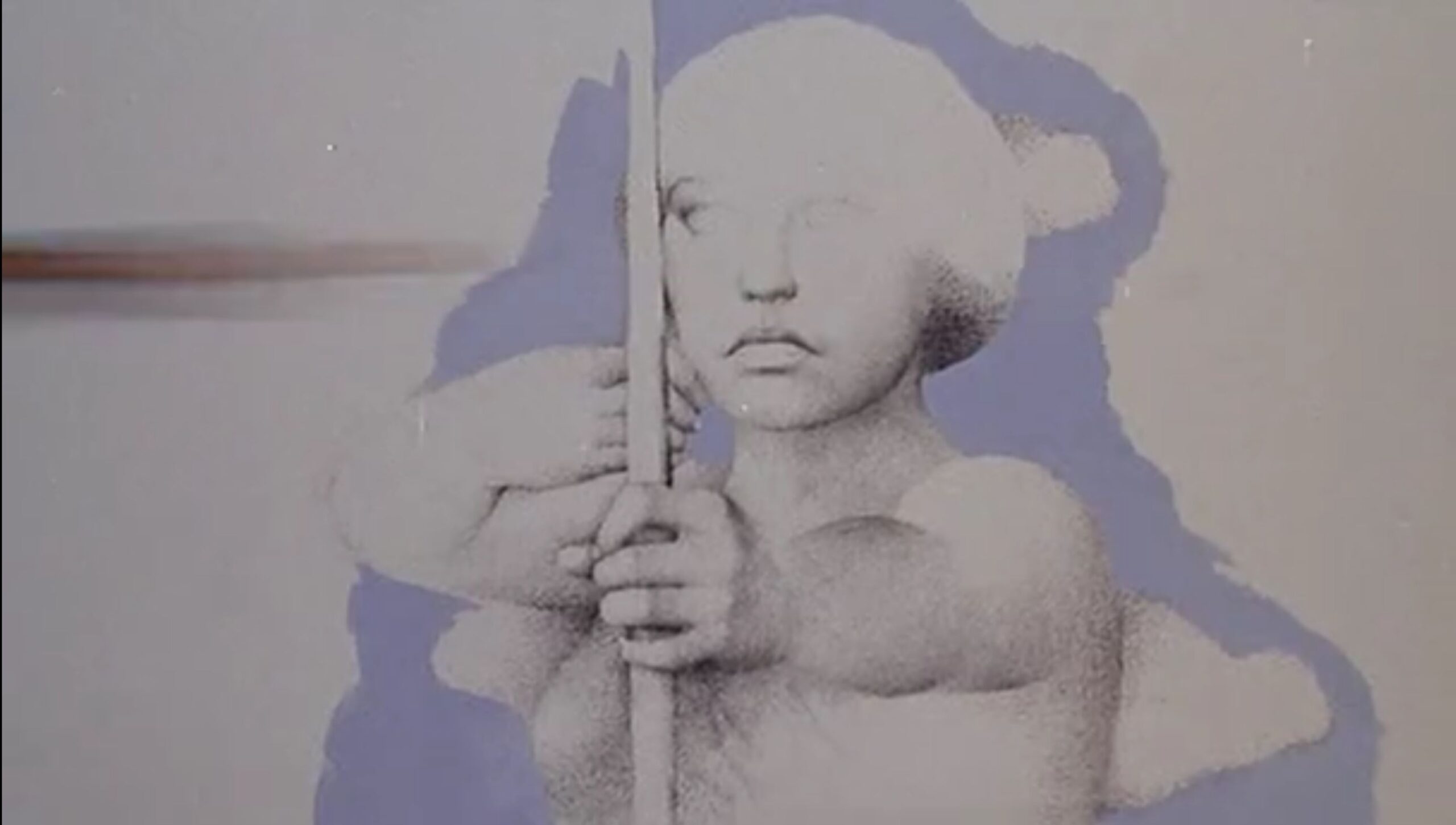 1.26.36
1.26.36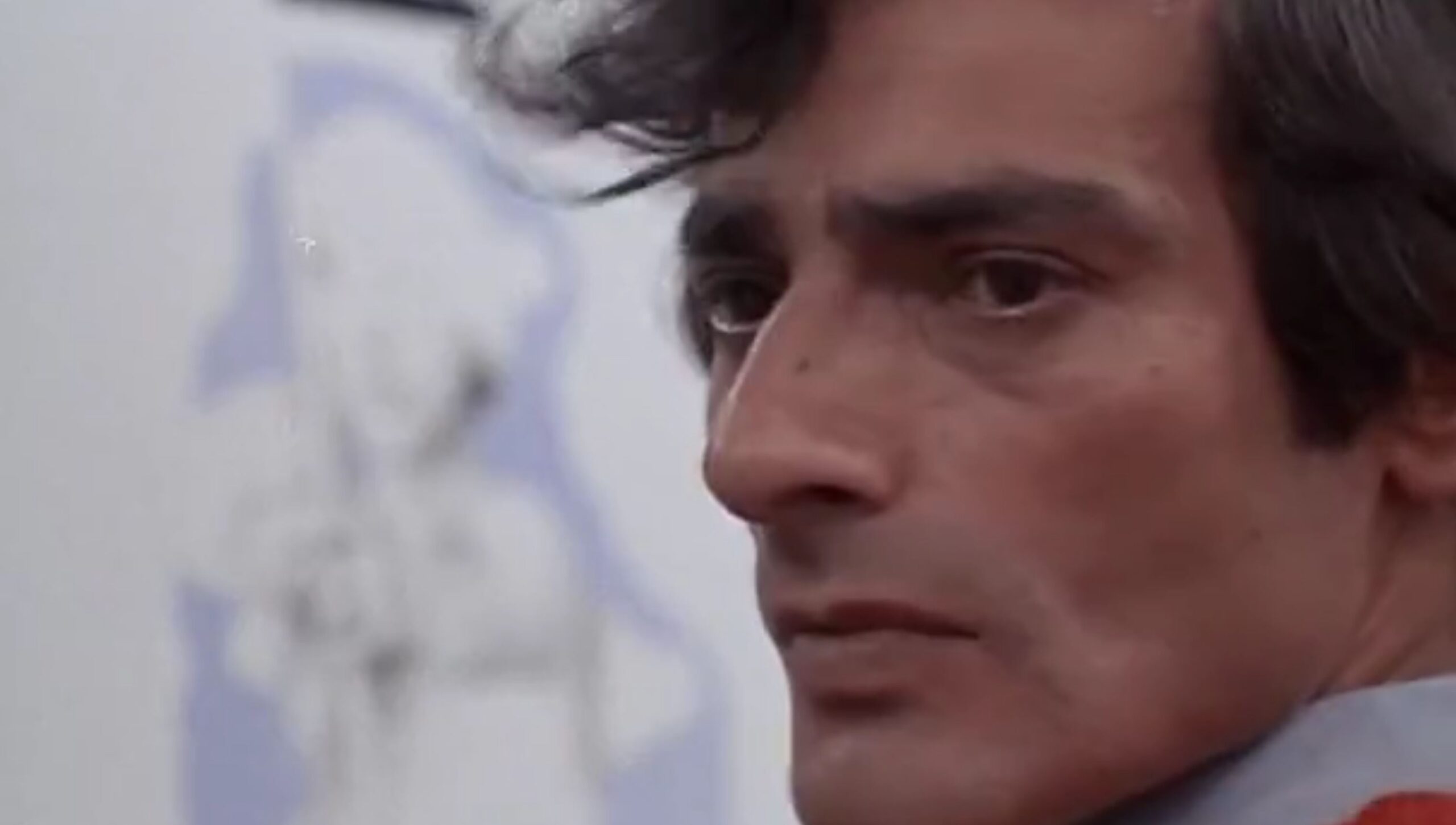 1.26.37
1.26.37 1.26.38
1.26.38 1.28.37
1.28.37 1.28.40
1.28.40 1.28.48
1.28.48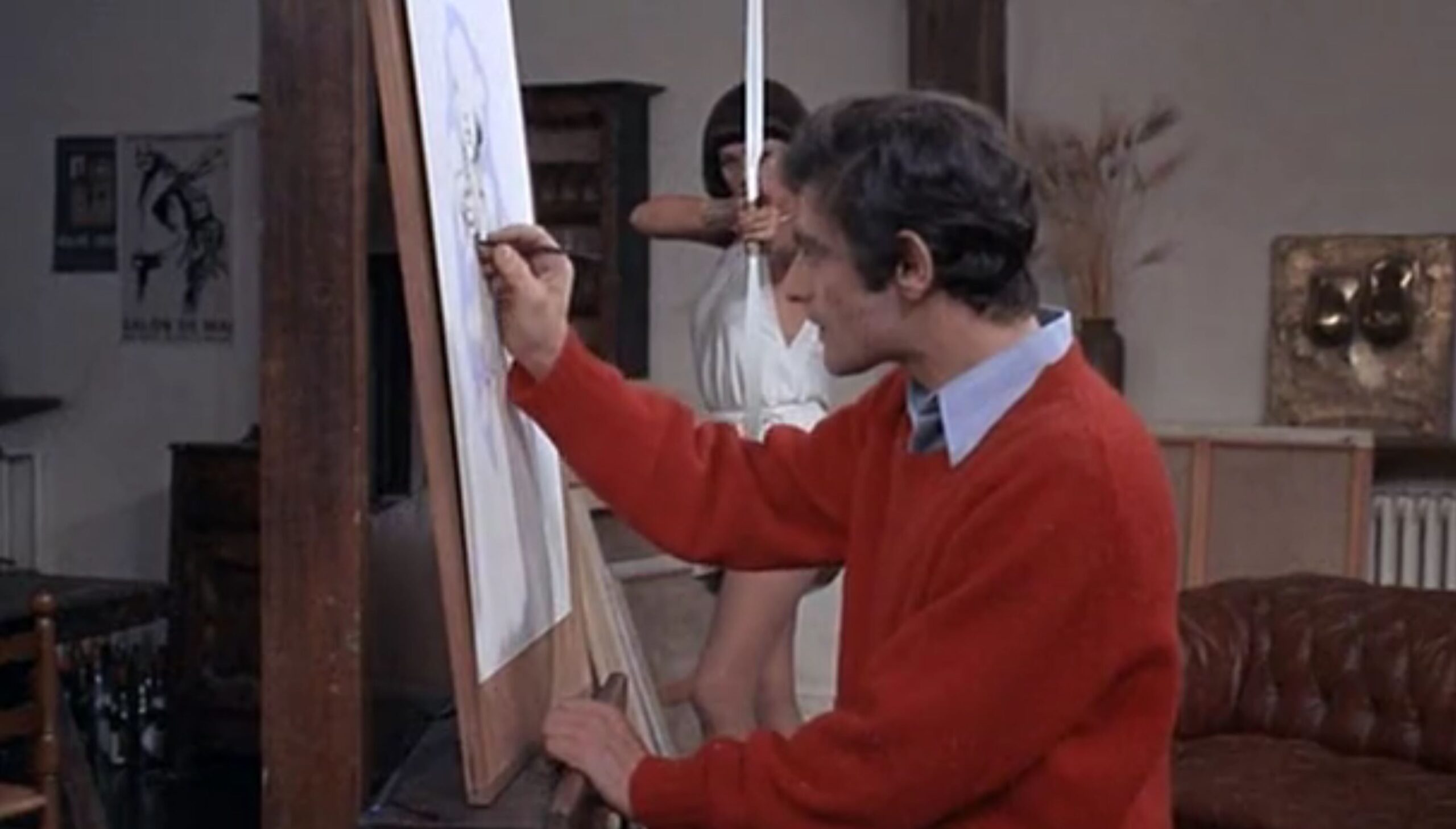 1.28.52
1.28.52 1.33.35
1.33.35 1.34.38
1.34.38 1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »
1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »
 1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »
1930, Joan Crawford dans « Montana Moon » Vers 1956, Natalie Wood
Vers 1956, Natalie Wood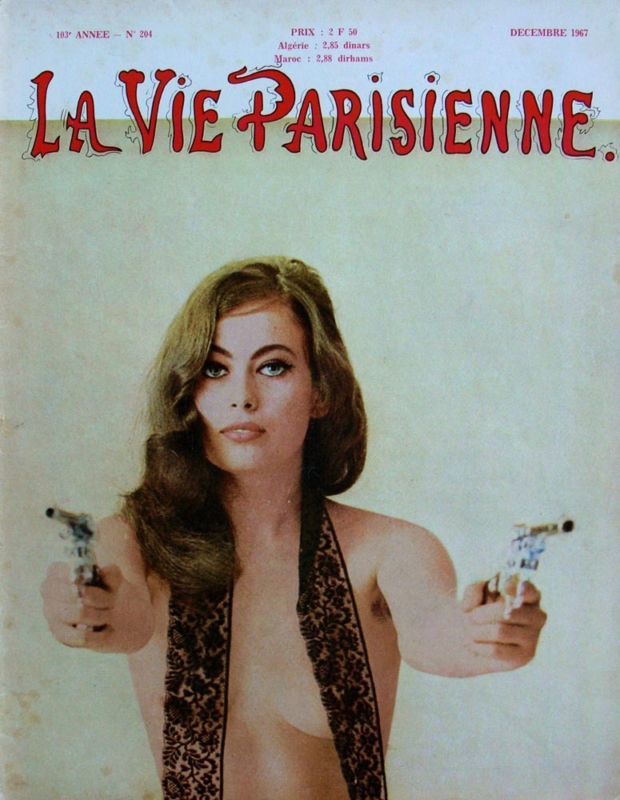 Décembre 1967, La Vie Parisienne
Décembre 1967, La Vie Parisienne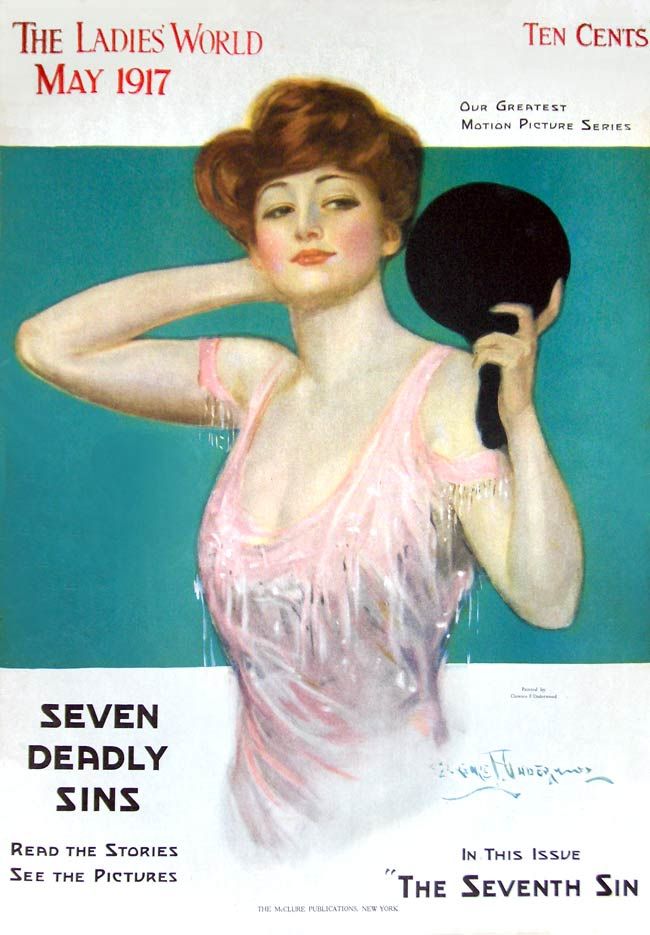 Mai 1917, The seventh sin
Mai 1917, The seventh sin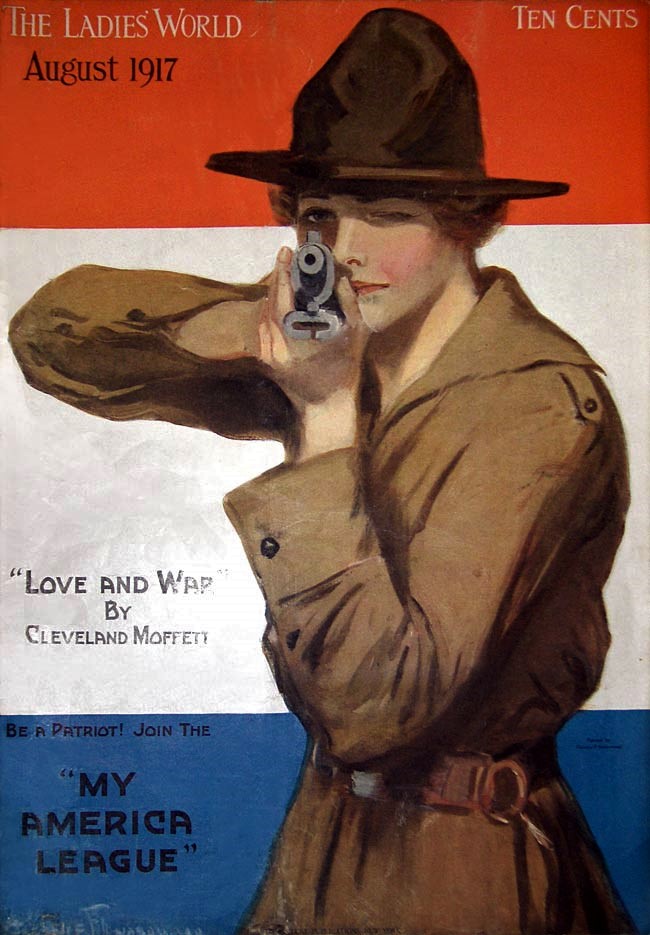 Août 1917, Be a patriot, Join « My America » League
Août 1917, Be a patriot, Join « My America » League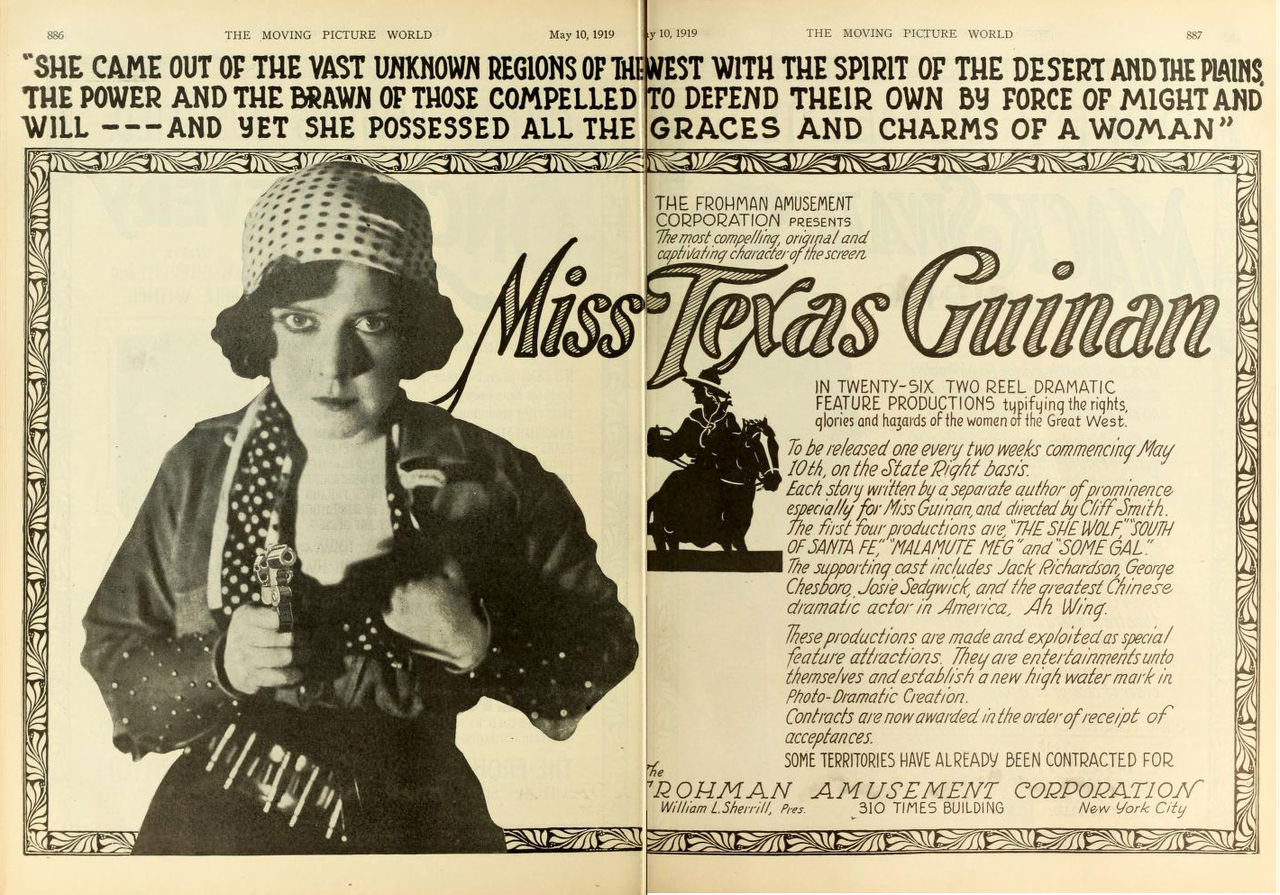 1919, Prospectus pour une série de films avec l’actrice Texas Guinan
1919, Prospectus pour une série de films avec l’actrice Texas Guinan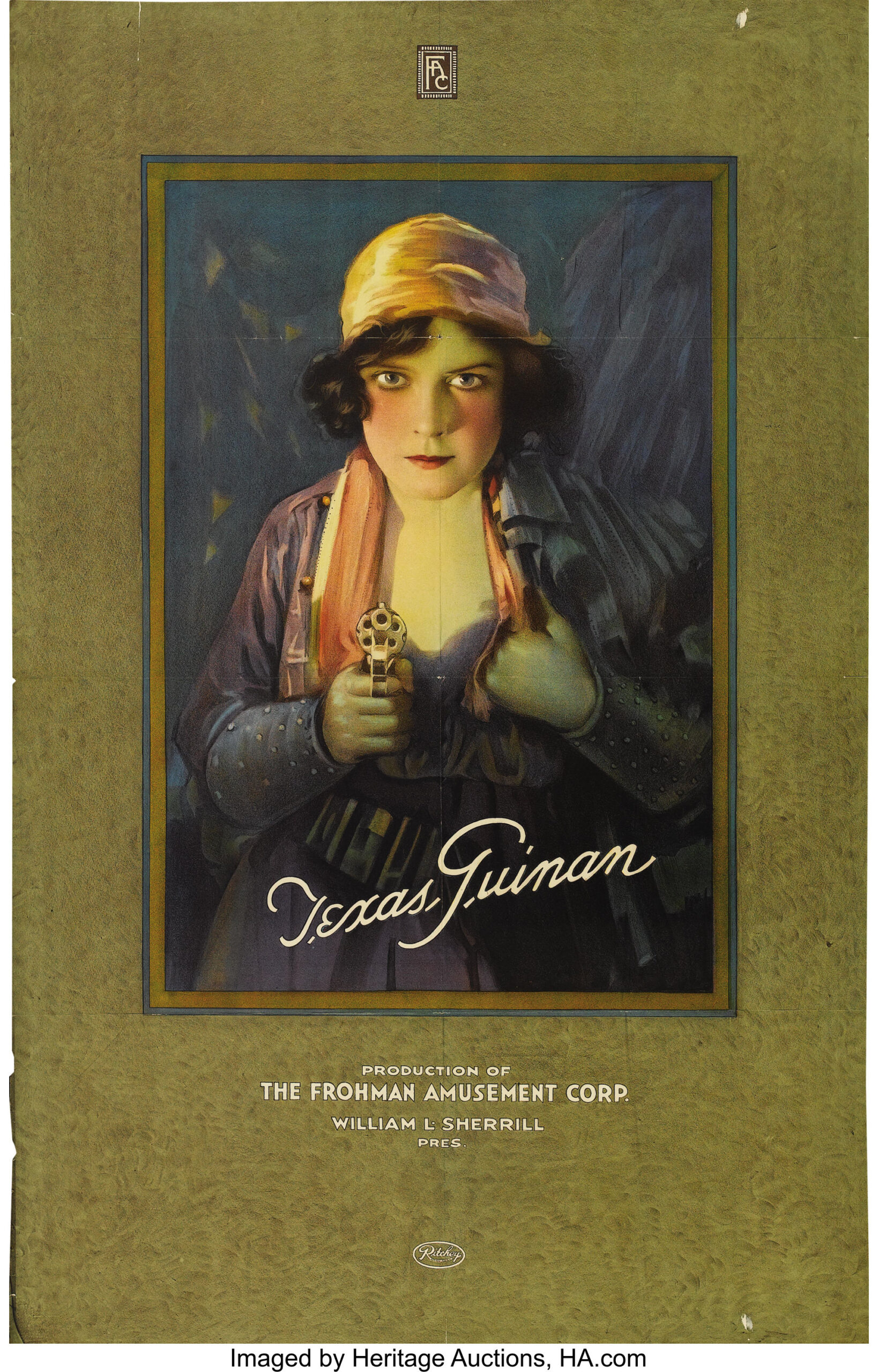 1919, Texas Guinan
1919, Texas Guinan 1934, Equipe championne féminine du club de tir de l’Université du Missouri.
1934, Equipe championne féminine du club de tir de l’Université du Missouri. 1936, les starlettes Eleanor Bayley, Colleen Colman, and Jean Sennett, photo promotionelle pour annoncer « Stage Struck »
1936, les starlettes Eleanor Bayley, Colleen Colman, and Jean Sennett, photo promotionelle pour annoncer « Stage Struck »

 1941, Belle Starr
1941, Belle Starr 1948, The Paleface
1948, The Paleface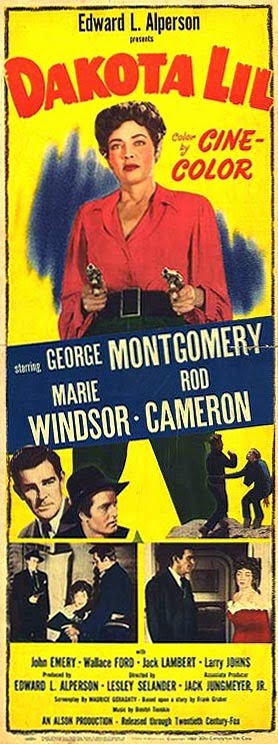 1950, Dakota Lil
1950, Dakota Lil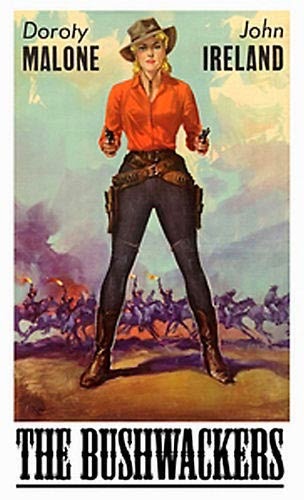 1951, Bushwackers
1951, Bushwackers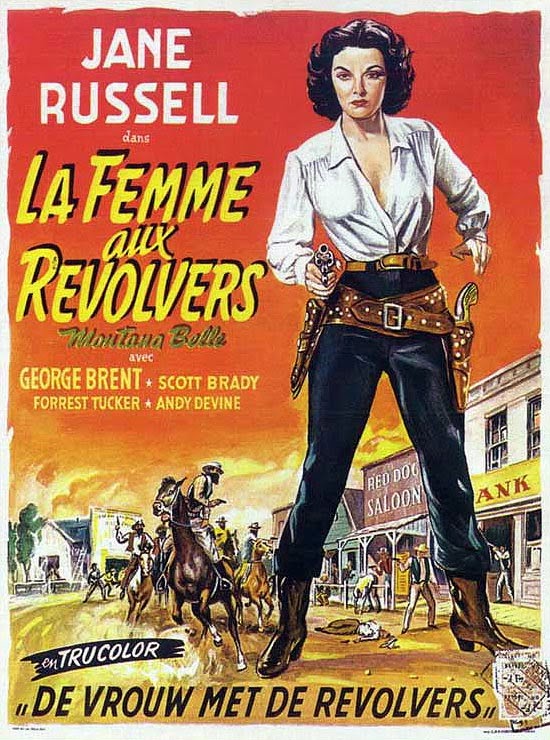 1952, Montana Belle
1952, Montana Belle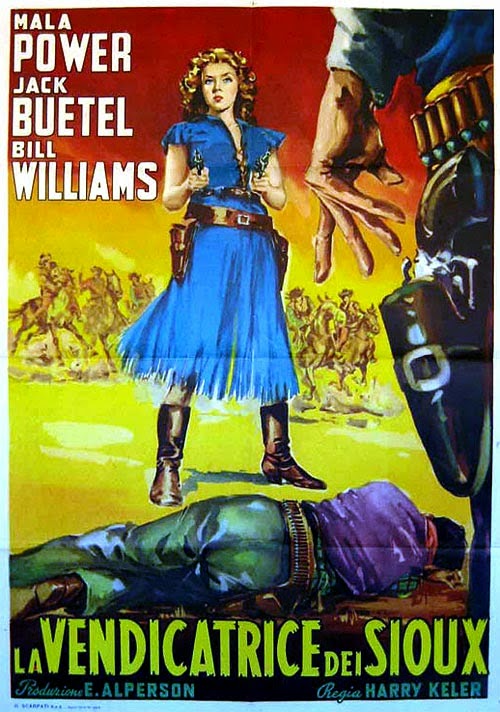 1952, Rose of Cimarron
1952, Rose of Cimarron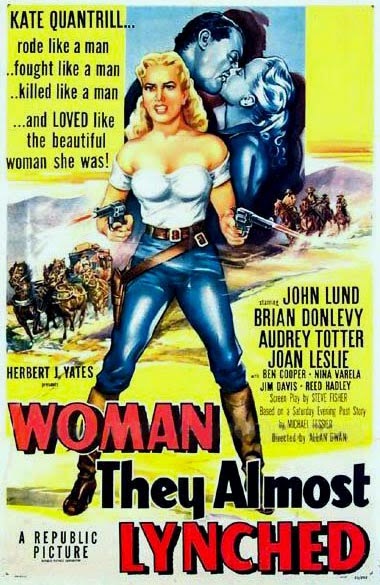 1953, Woman They Almost Lynched
1953, Woman They Almost Lynched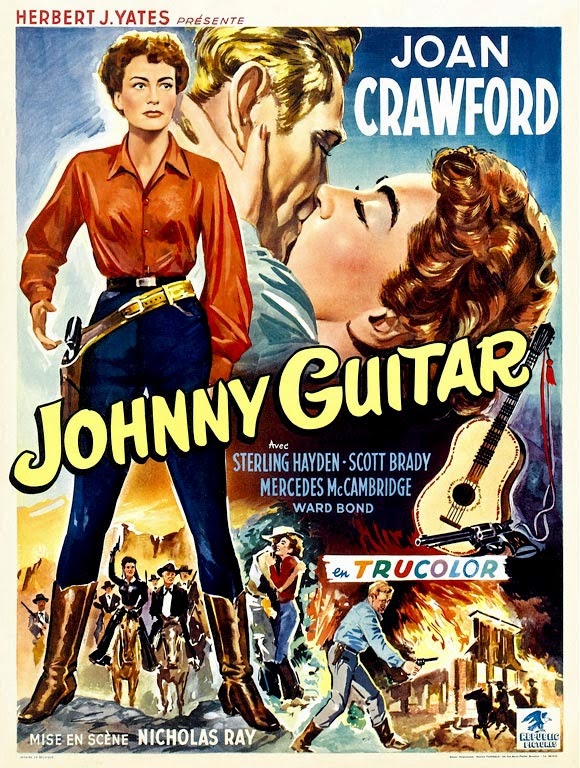 1954, Johnny Guitar
1954, Johnny Guitar 1955, Two-Gun Lady
1955, Two-Gun Lady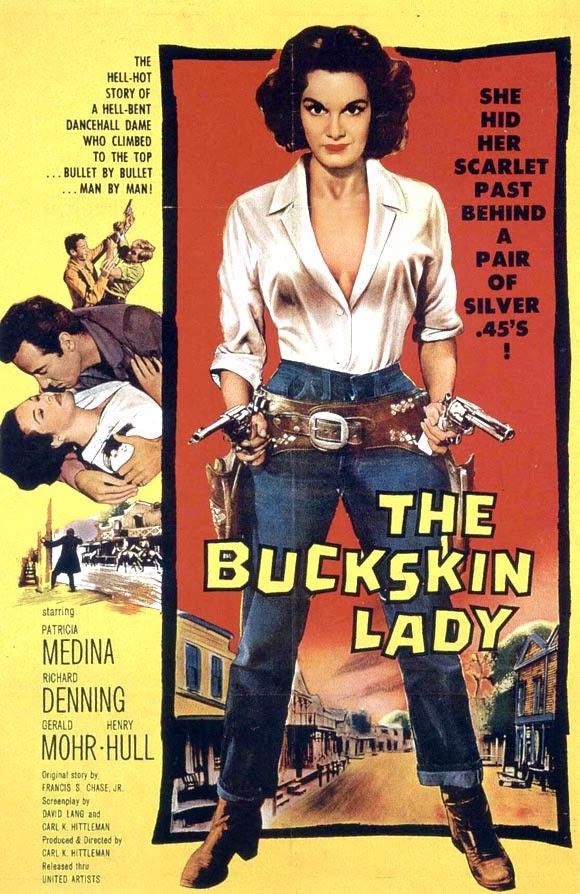 1957, The Buckskin Lady
1957, The Buckskin Lady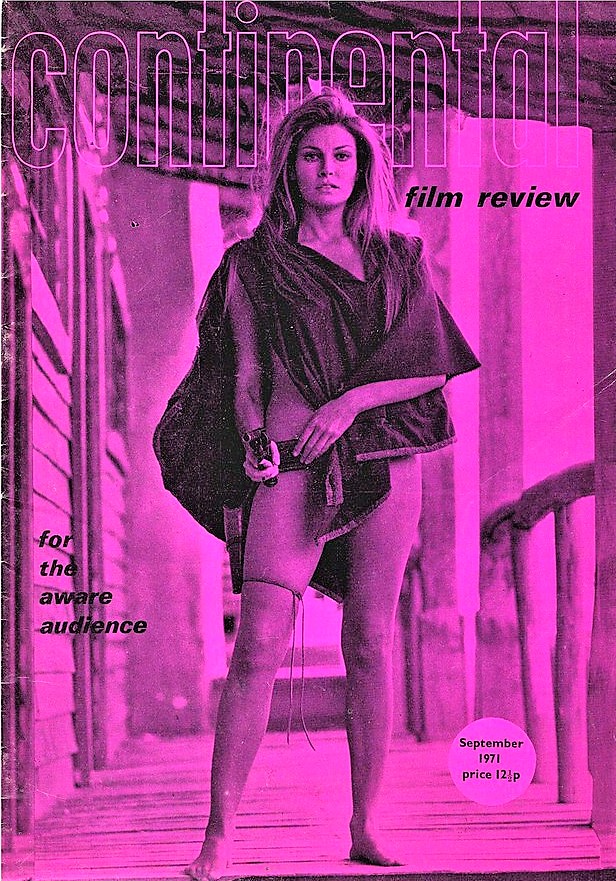 1971, Raquel Welsh dans « Hannie Caulder »
1971, Raquel Welsh dans « Hannie Caulder »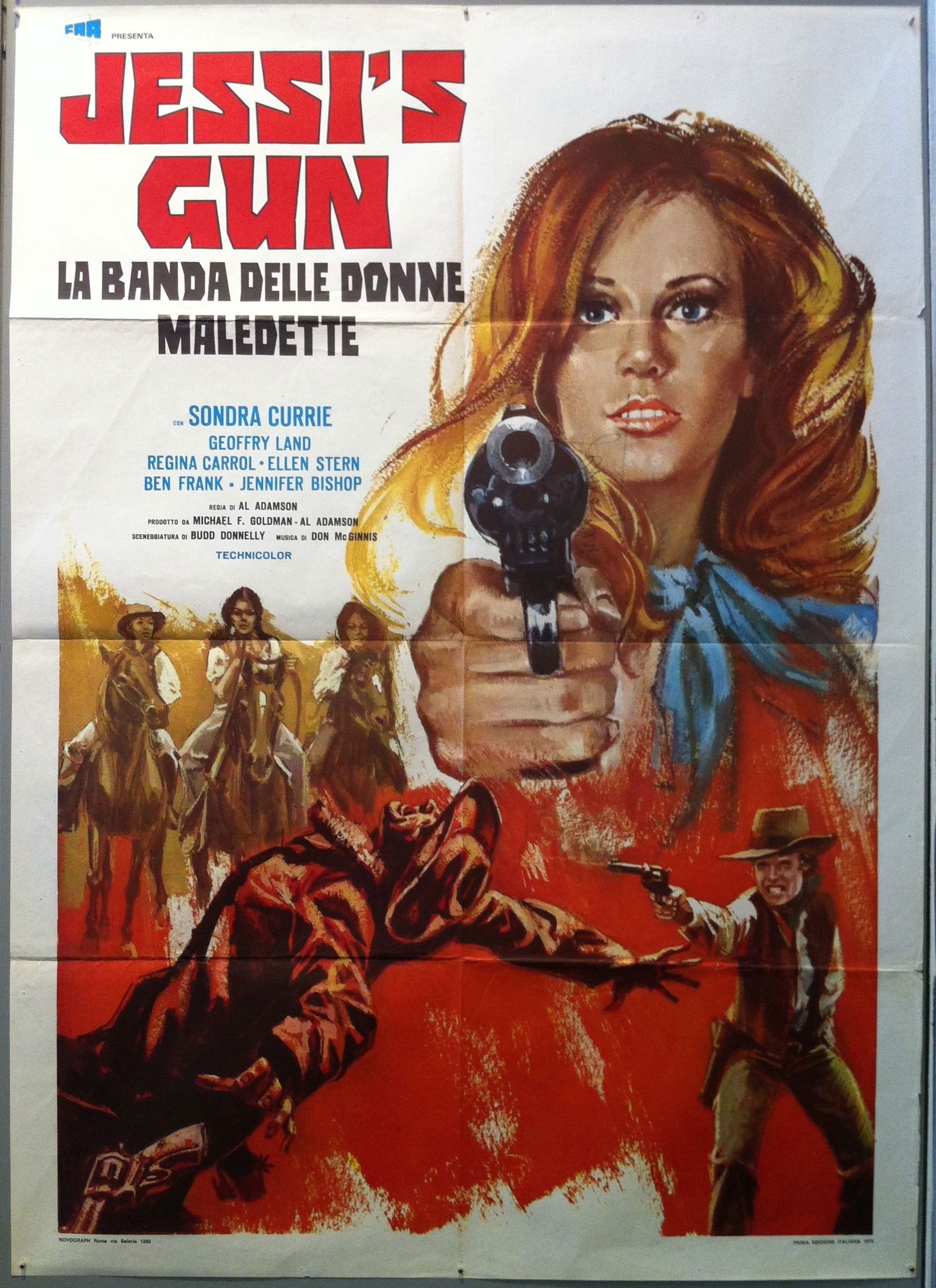 1975, Sondra Currie dans « Jessi’s Girls »
1975, Sondra Currie dans « Jessi’s Girls » Diana Door, 1947
Diana Door, 1947 Candy Barr, vers 1956
Candy Barr, vers 1956


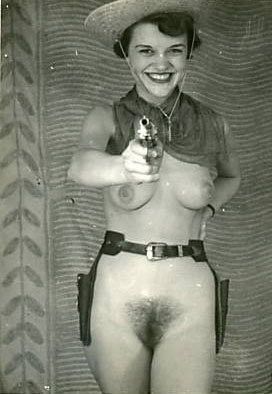
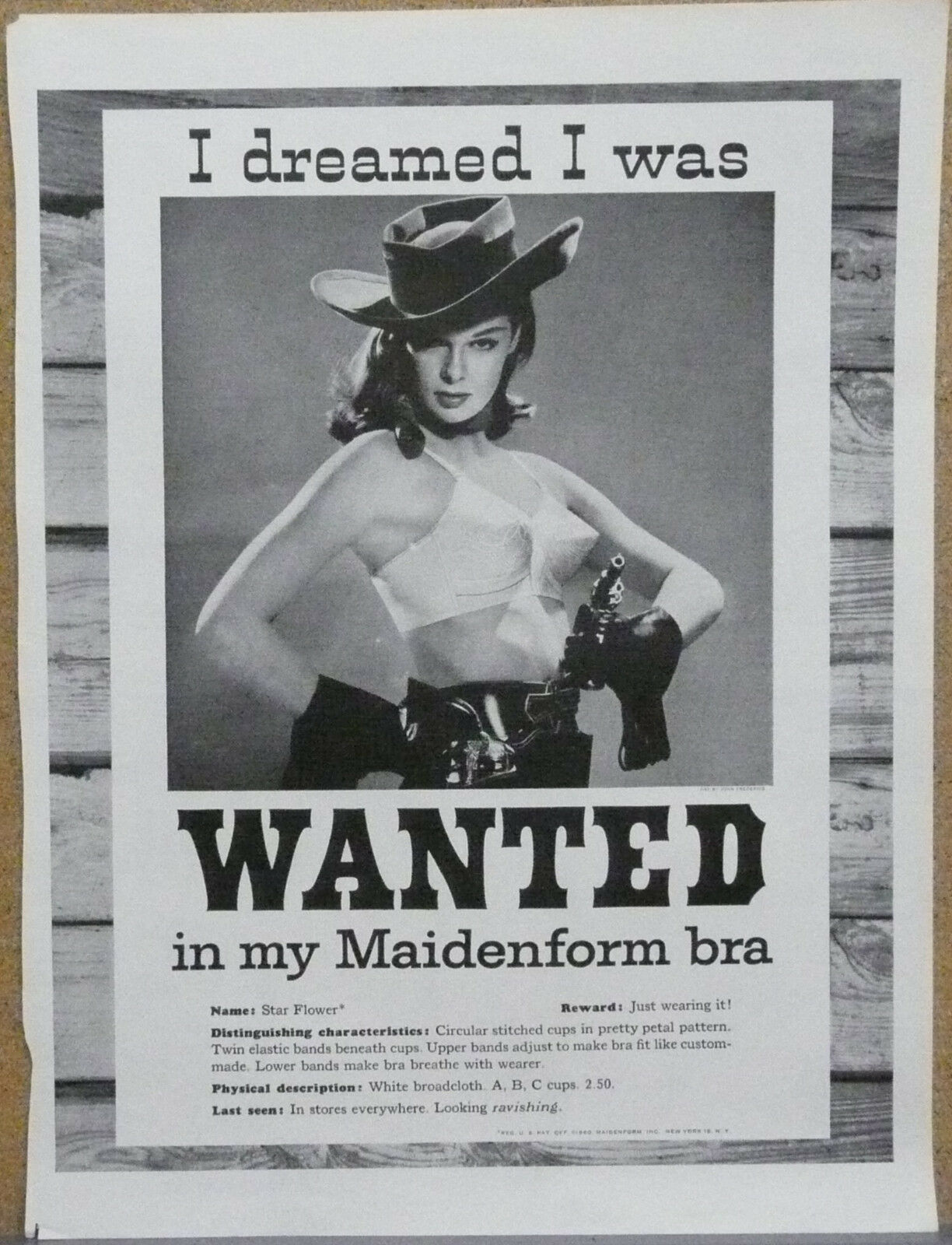 1960, pub Maidenform
1960, pub Maidenform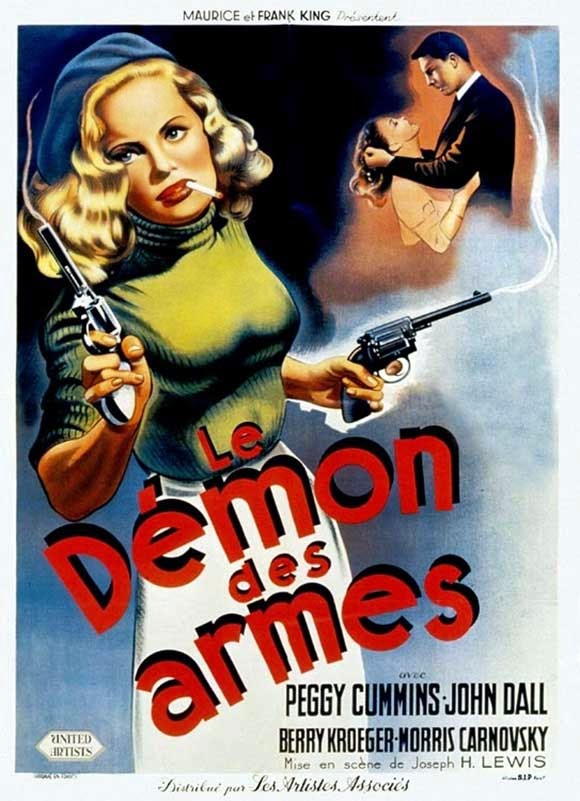 1950, Gun Crazy ( Le Démon des armes)
1950, Gun Crazy ( Le Démon des armes)
 1957, Diana Doors en femme fatale, dans « The unholly wife »
1957, Diana Doors en femme fatale, dans « The unholly wife »

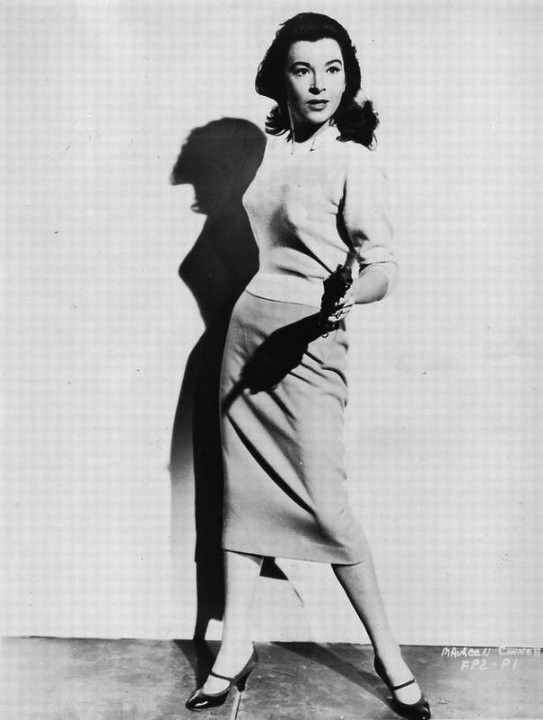 1957, Maureen Connell
1957, Maureen Connell 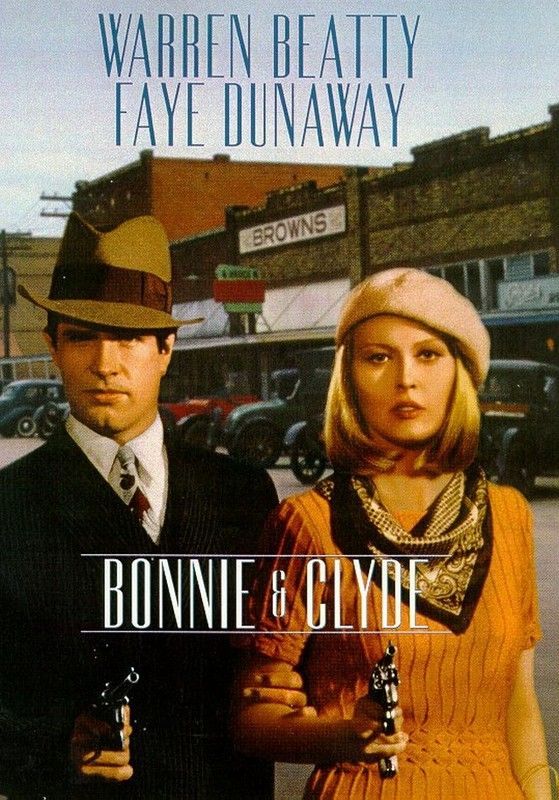 1967, affiche de « Bonnie and Clyde »
1967, affiche de « Bonnie and Clyde »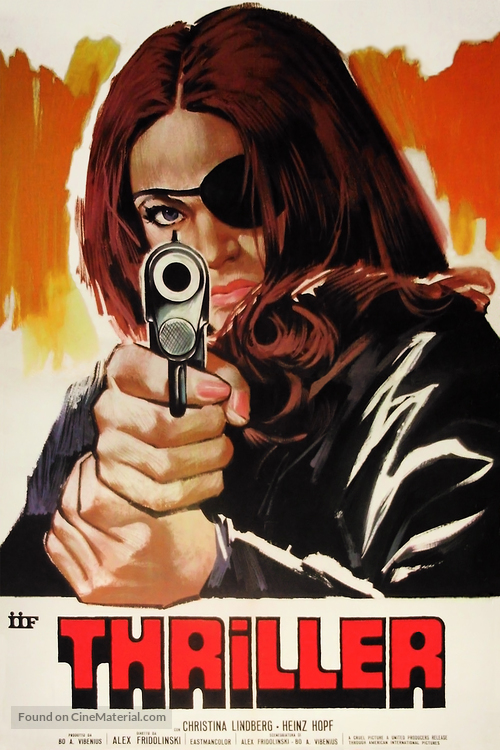 1973, Christina Lindberg, « Crime à froid »
1973, Christina Lindberg, « Crime à froid »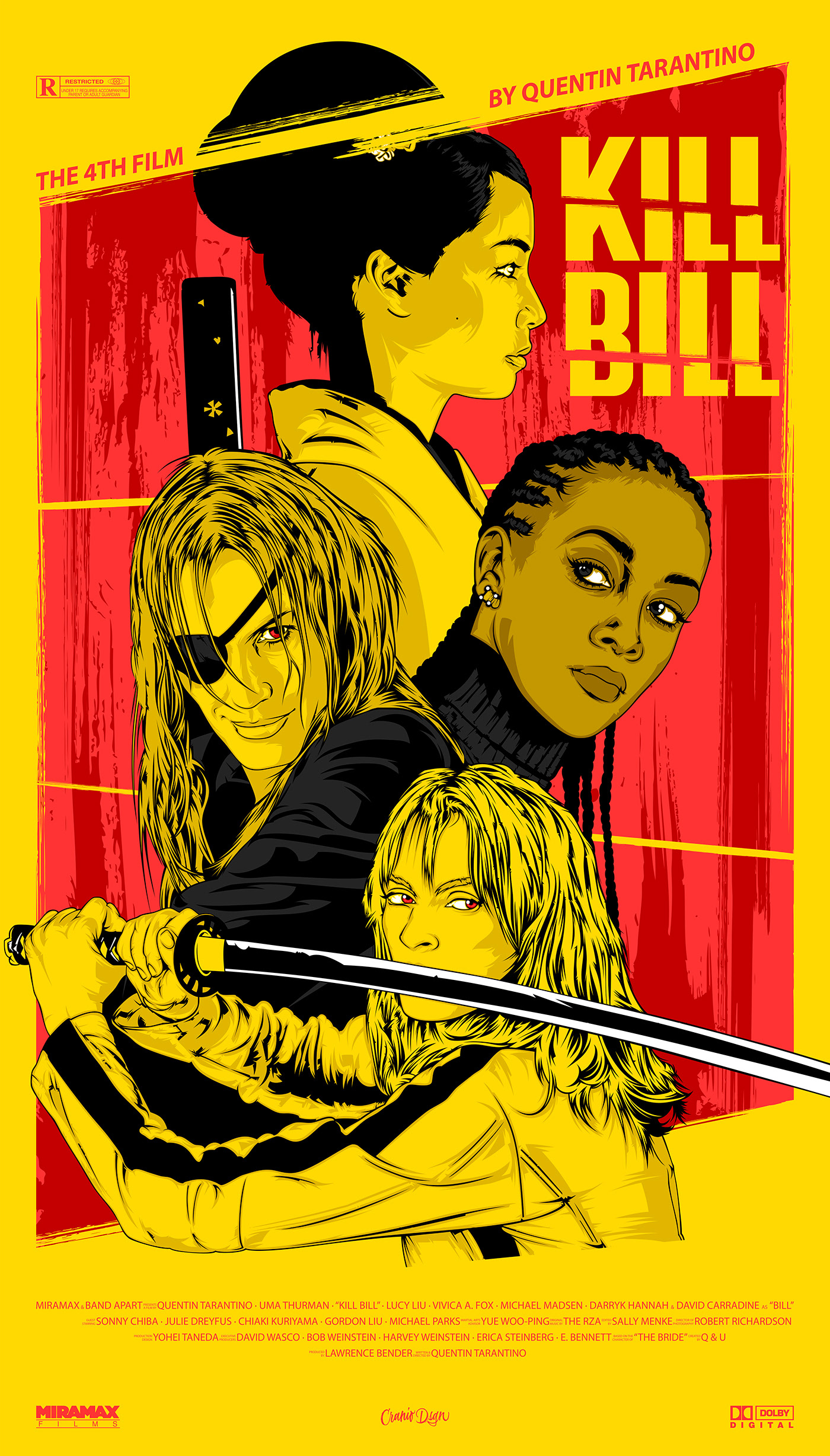 2017 Affiche sur le thème de Kill Bill, par craniodsgn
2017 Affiche sur le thème de Kill Bill, par craniodsgn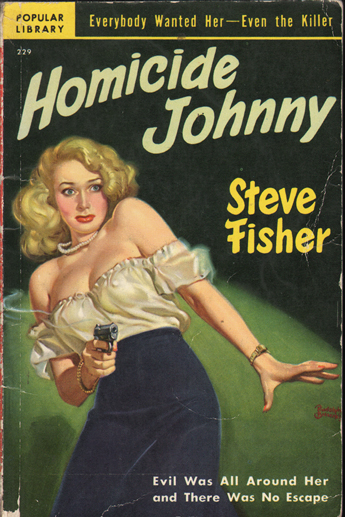 1940, Homicide Johnny, couverture Rudolph Belarski
1940, Homicide Johnny, couverture Rudolph Belarski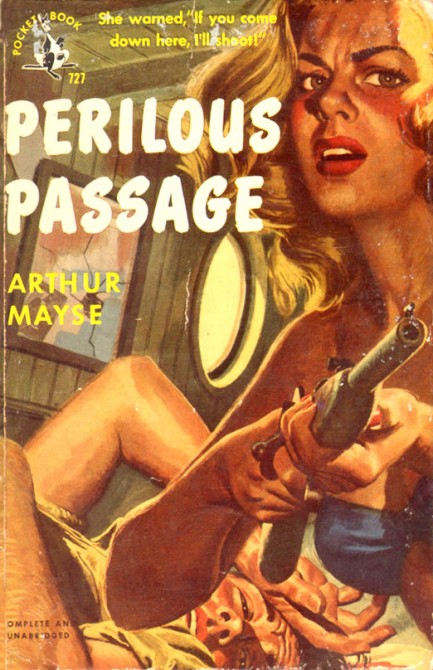 1950 Perilous Passage, couverture James R. Bingham
1950 Perilous Passage, couverture James R. Bingham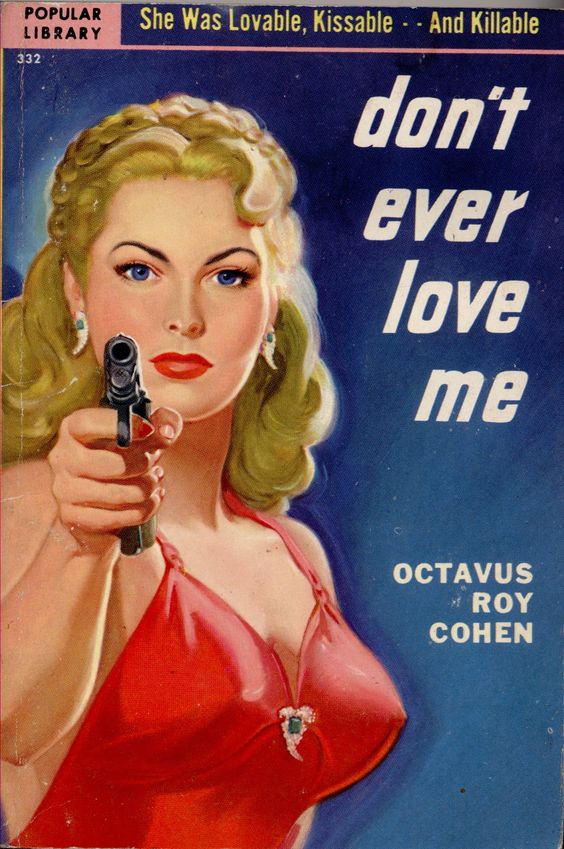 1951, « Don’t Ever Love Me », couverture de Rudolph Belarski
1951, « Don’t Ever Love Me », couverture de Rudolph Belarski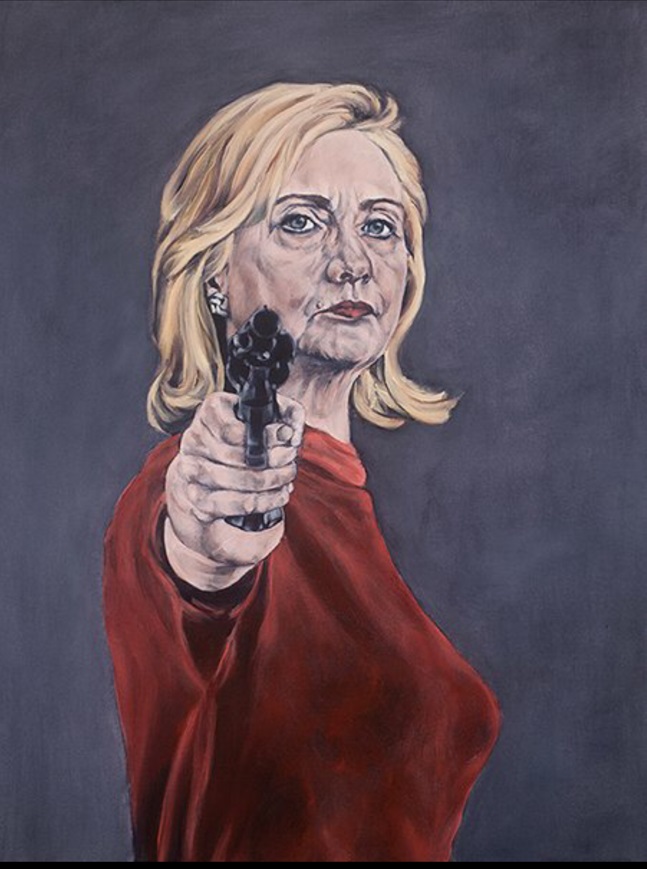 2014, RedGun, par Sarah Sole
2014, RedGun, par Sarah Sole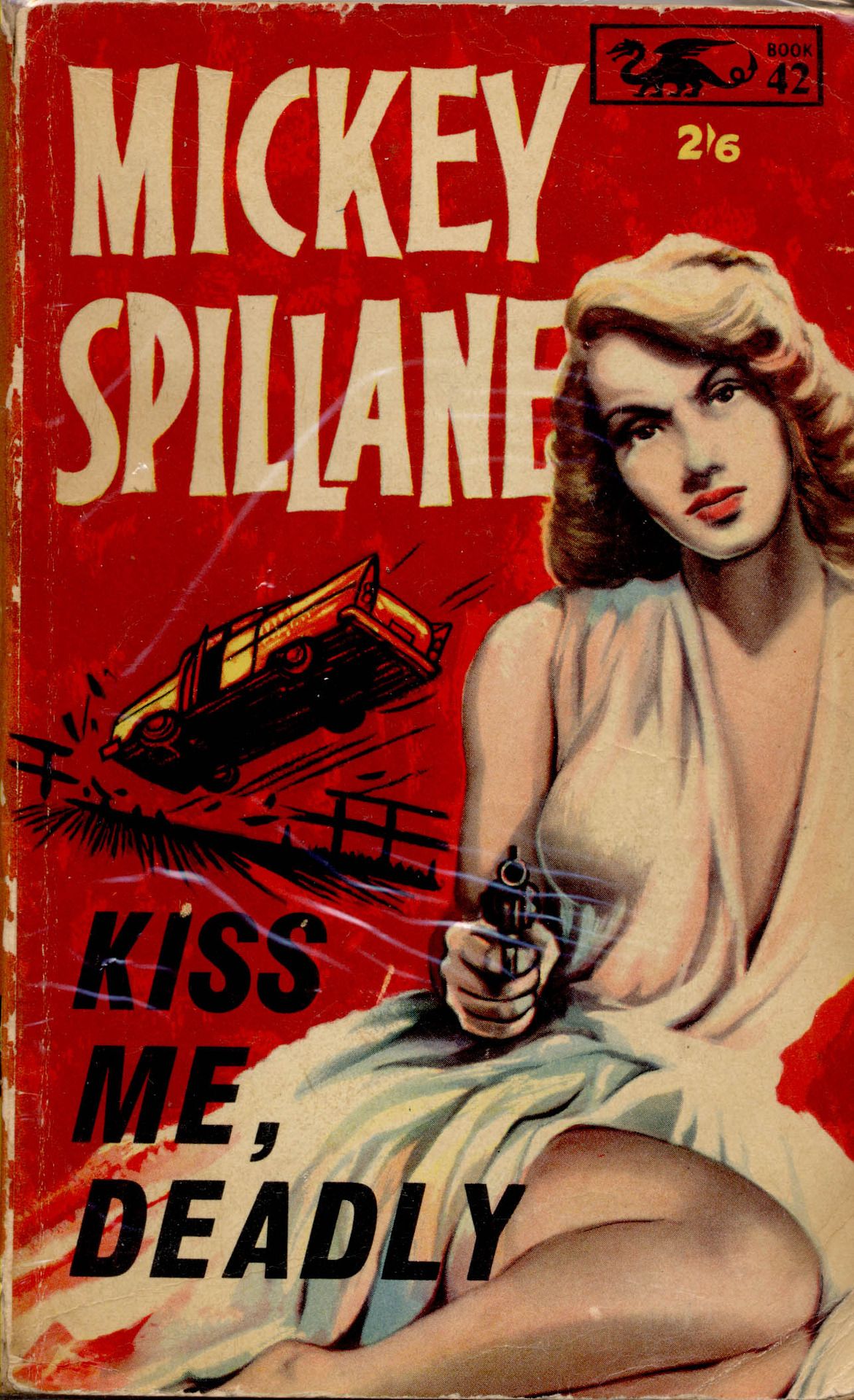 1952, Kiss me deadly
1952, Kiss me deadly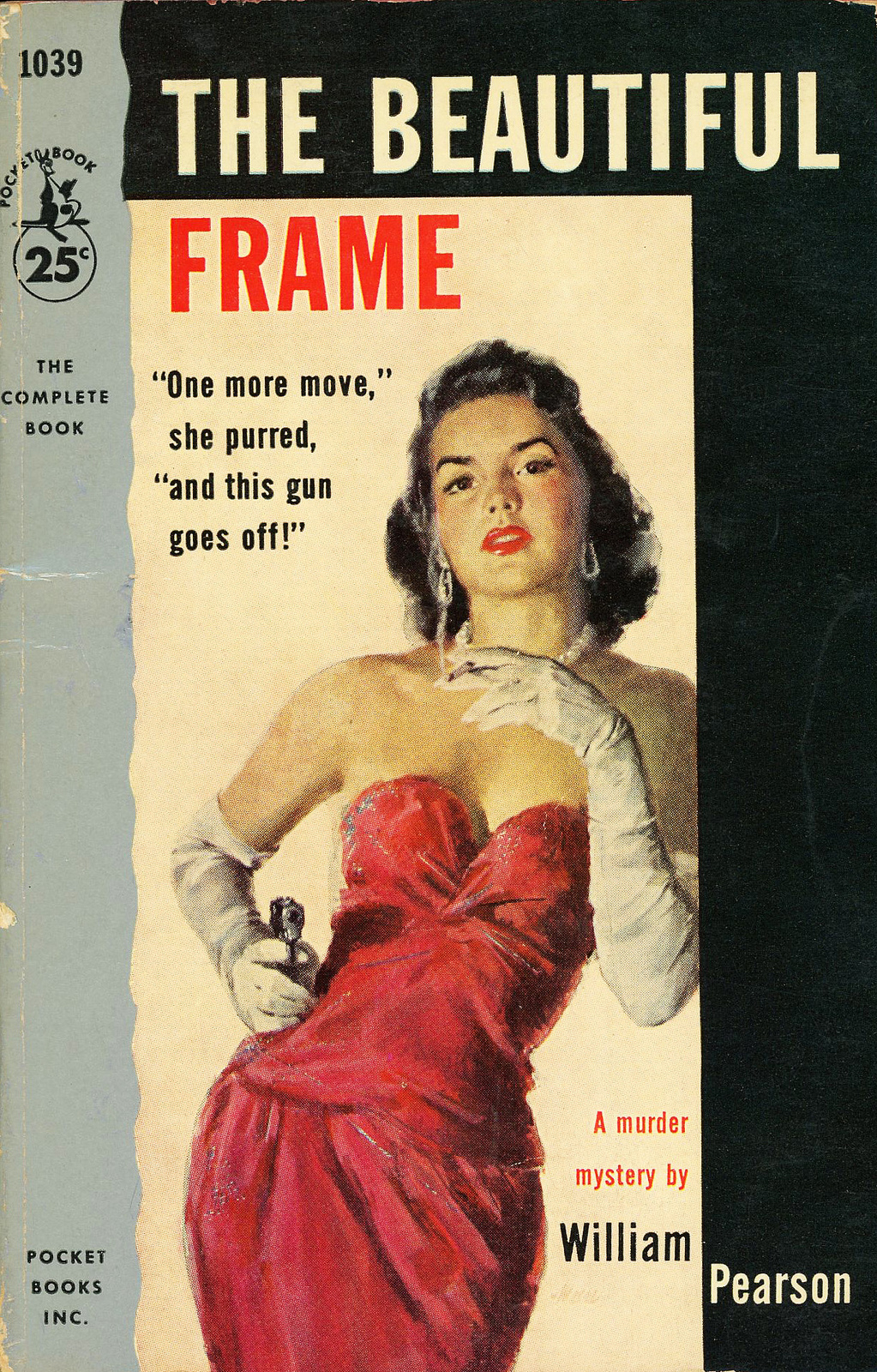 1954, The beautiful frame
1954, The beautiful frame 1952, couverture pour « Death before bedtime »
1952, couverture pour « Death before bedtime » Modèle
Modèle 1955, couverture pour « Dame in danger »
1955, couverture pour « Dame in danger » 1956, couverture pour « Stone cold blonde »
1956, couverture pour « Stone cold blonde »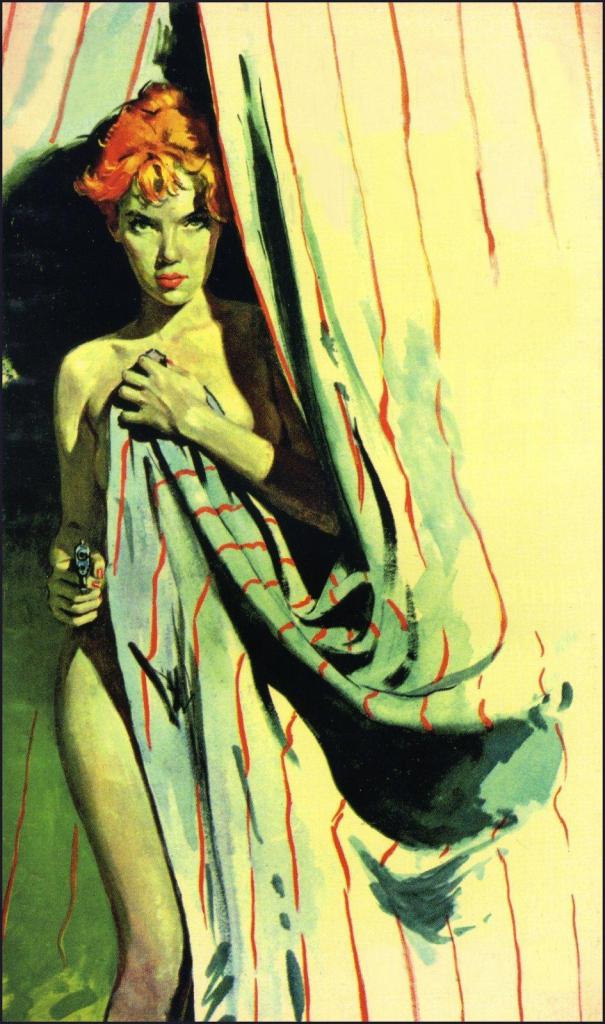 1959, couverture pour « Wild to possess »
1959, couverture pour « Wild to possess »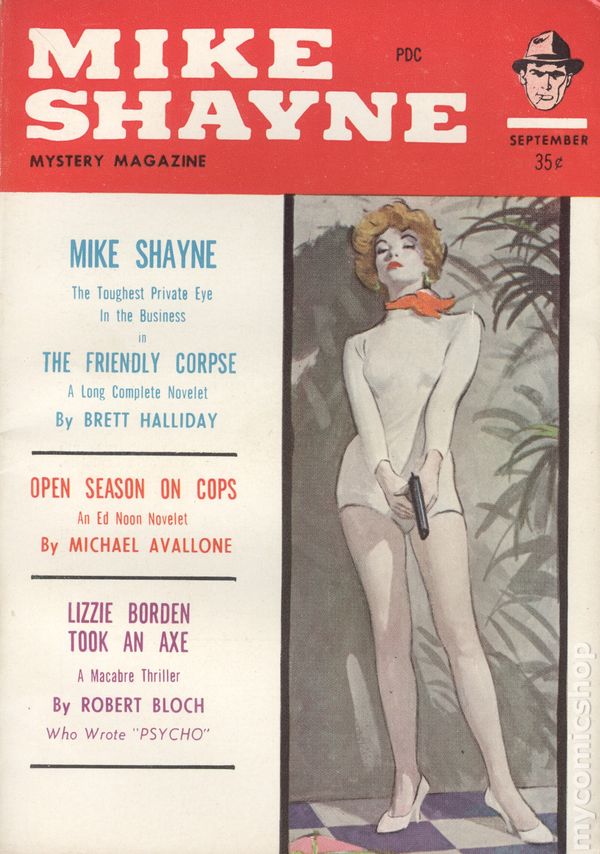 1962, septembre, couverture pour Mike Shayne Mystery Magazine
1962, septembre, couverture pour Mike Shayne Mystery Magazine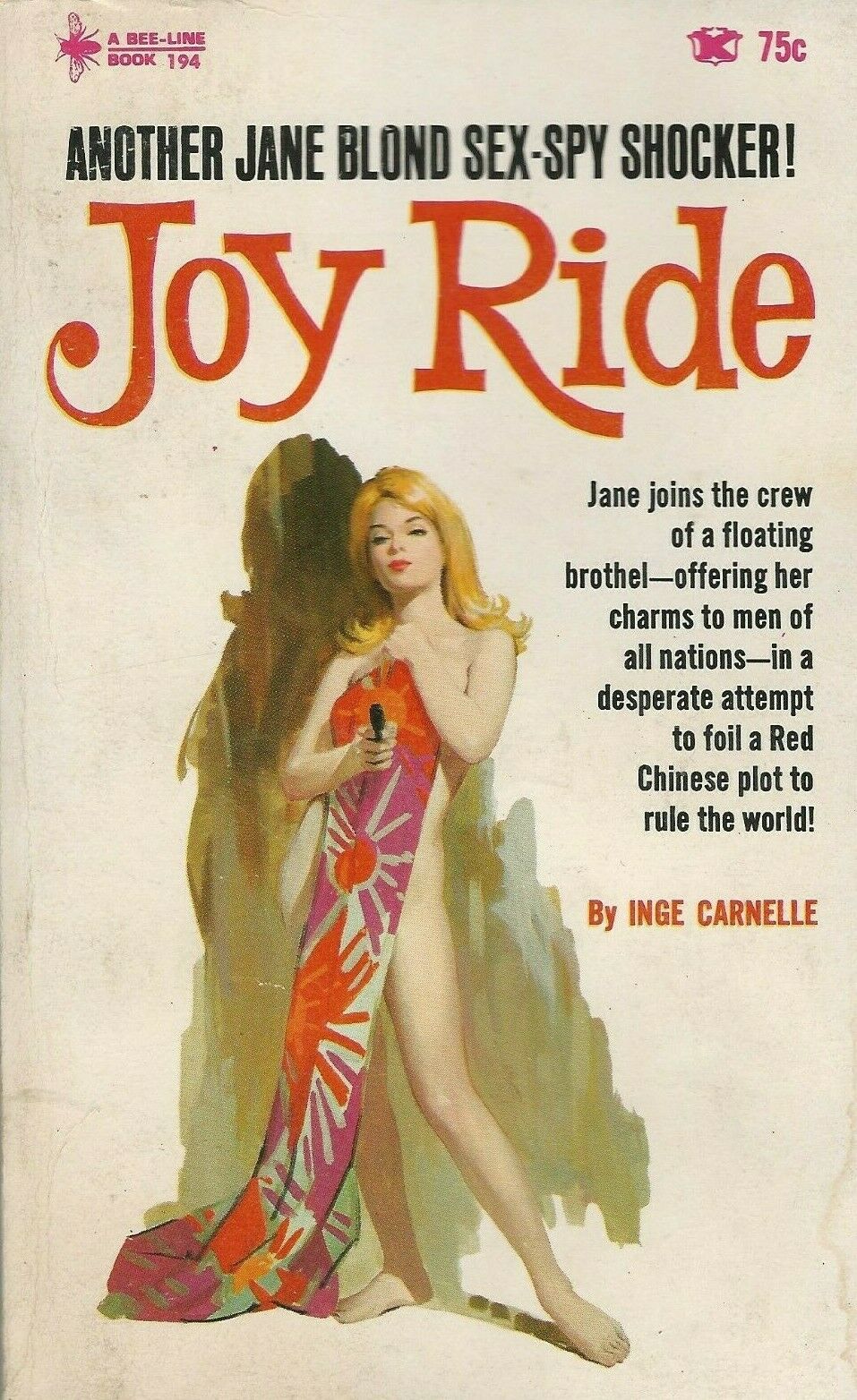 1967, couverture pour « Joy ride »
1967, couverture pour « Joy ride »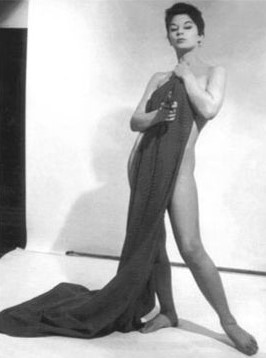 Modèle
Modèle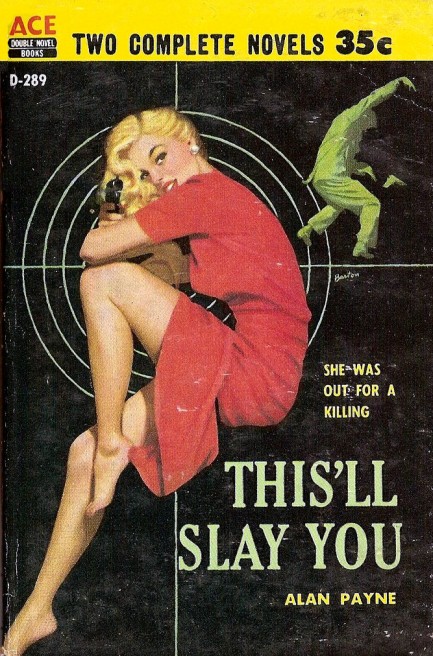 1958 This’ll Slay You
1958 This’ll Slay You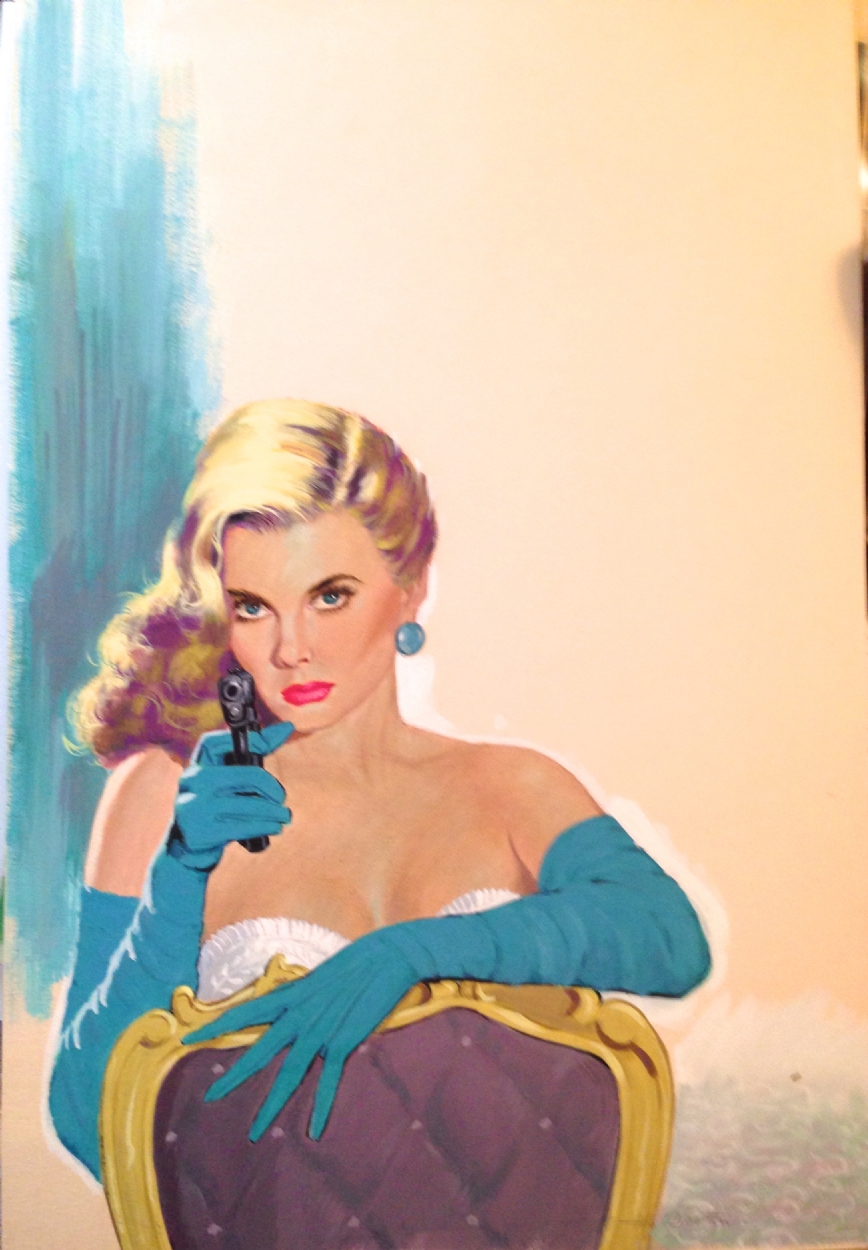 Vers 1960, aquarelle
Vers 1960, aquarelle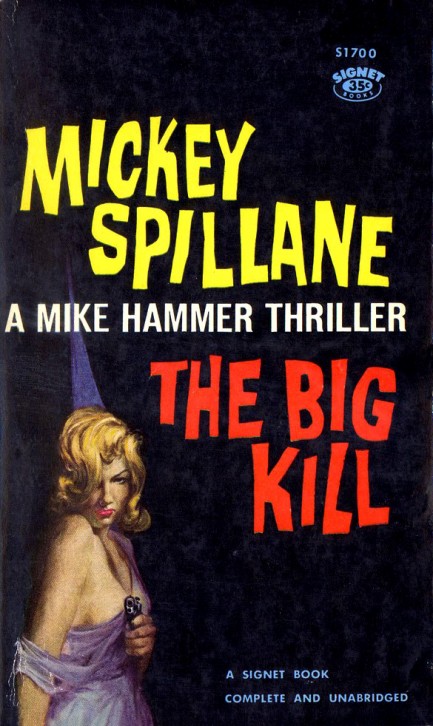 1960,The big kill
1960,The big kill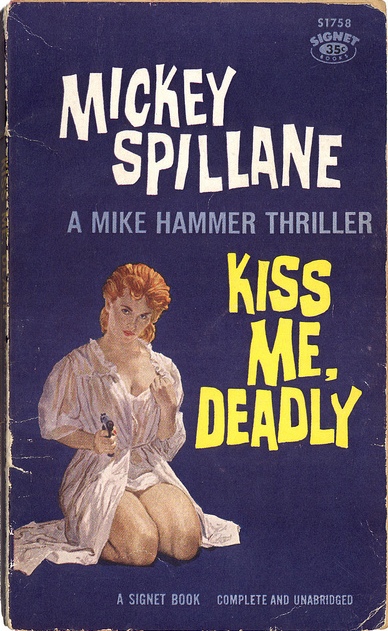 1960, Kiss Me Deadly
1960, Kiss Me Deadly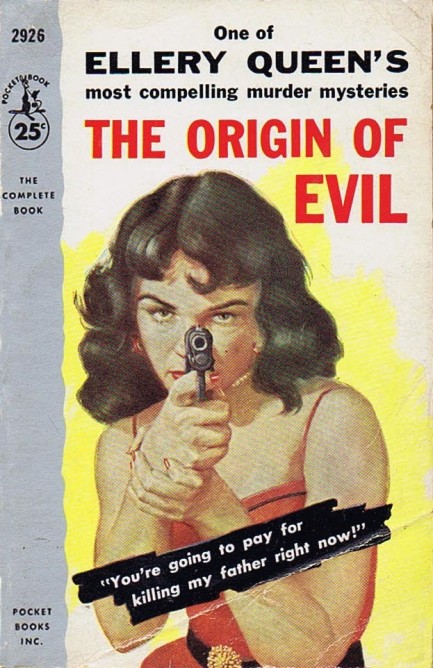 1956, 3ème édition, couverture Larry Newquist
1956, 3ème édition, couverture Larry Newquist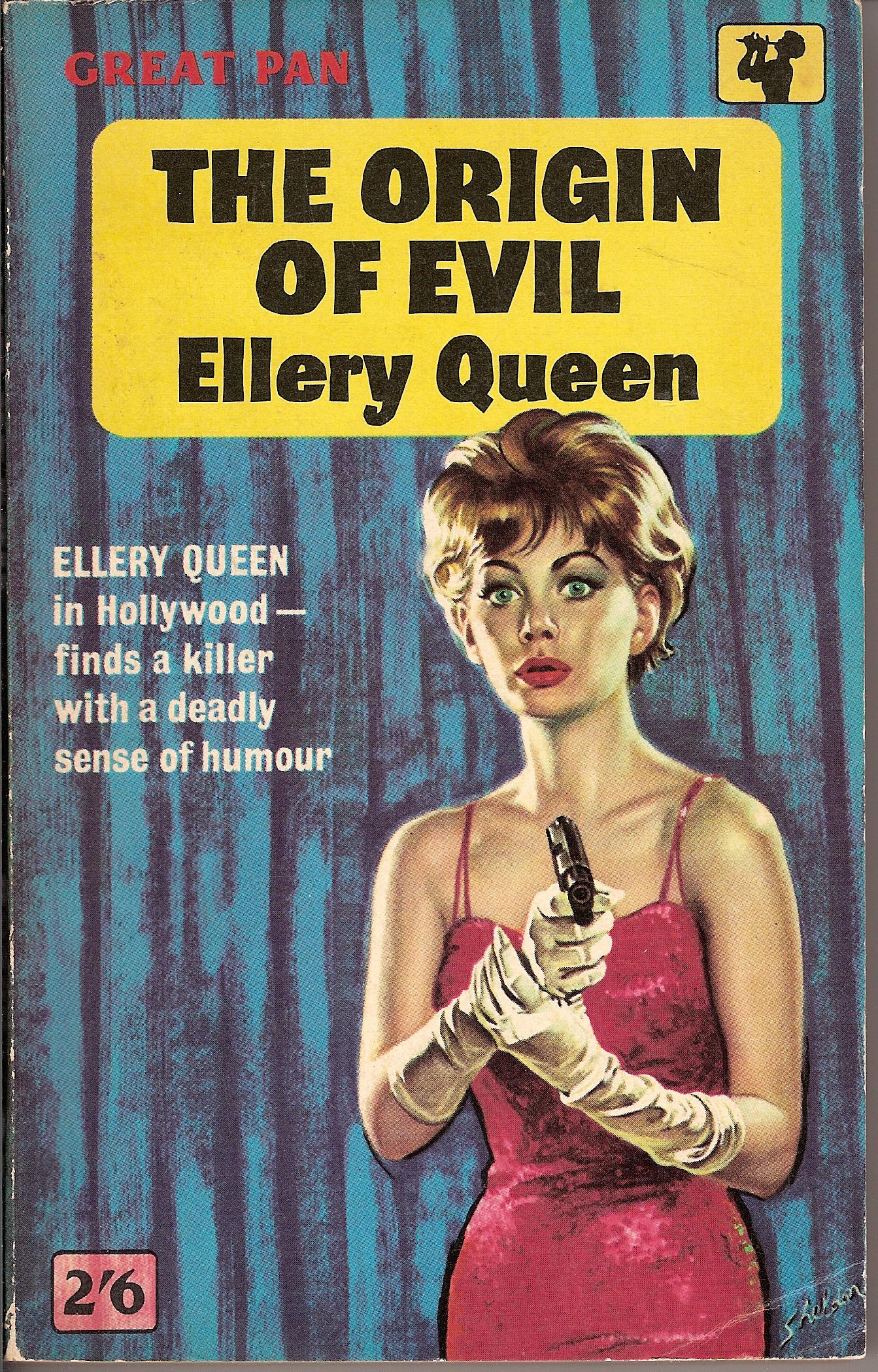 1961, couverture de Harry Sheldon
1961, couverture de Harry Sheldon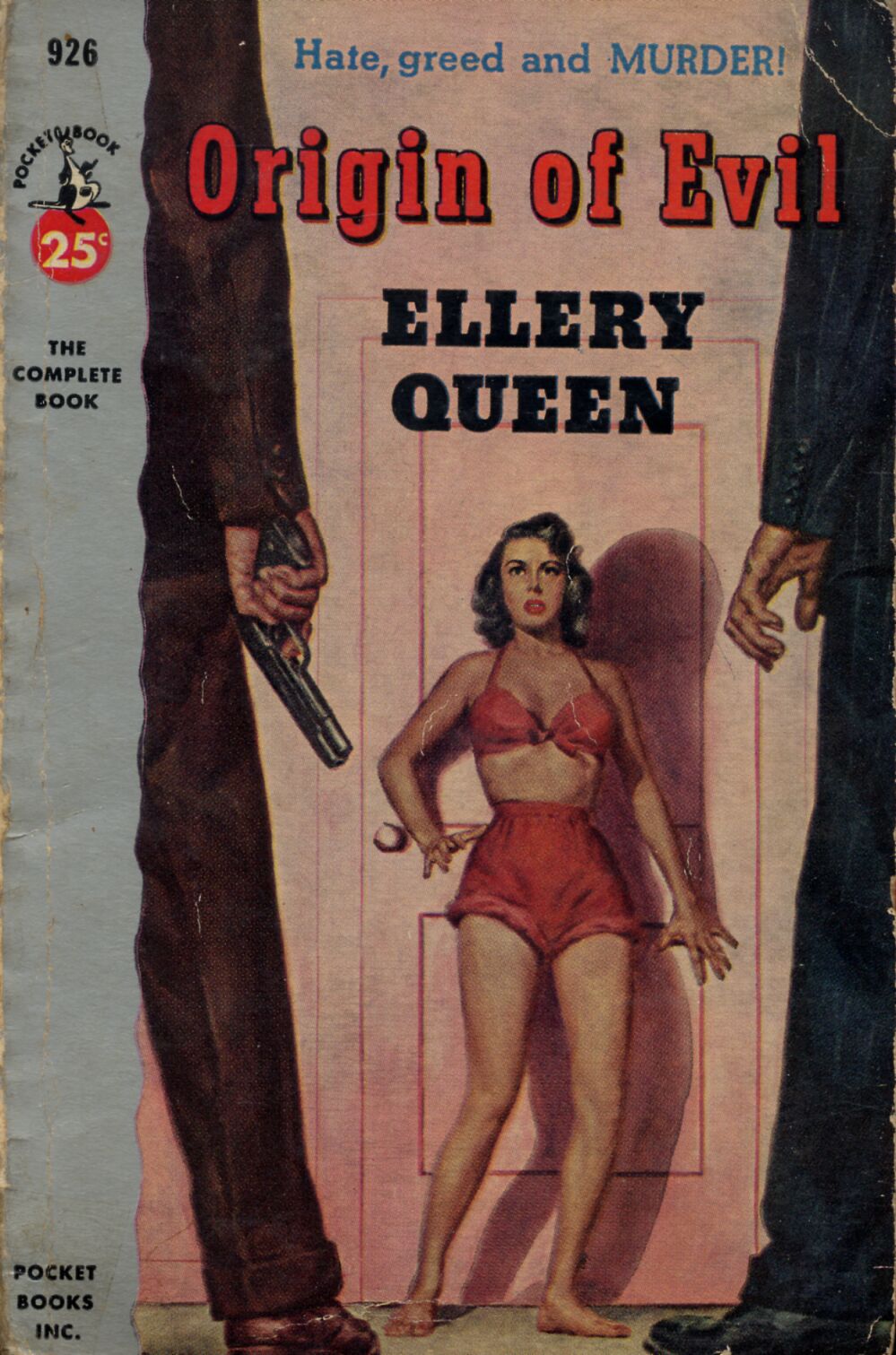 1951, The origin of evil
1951, The origin of evil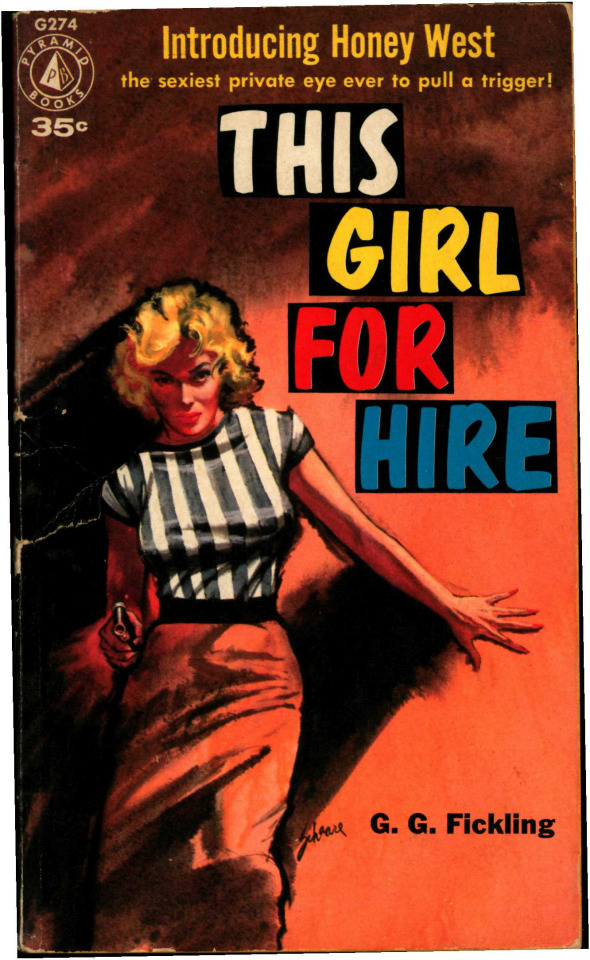 1957, « This girl for Hire », couverture Harry Schaare
1957, « This girl for Hire », couverture Harry Schaare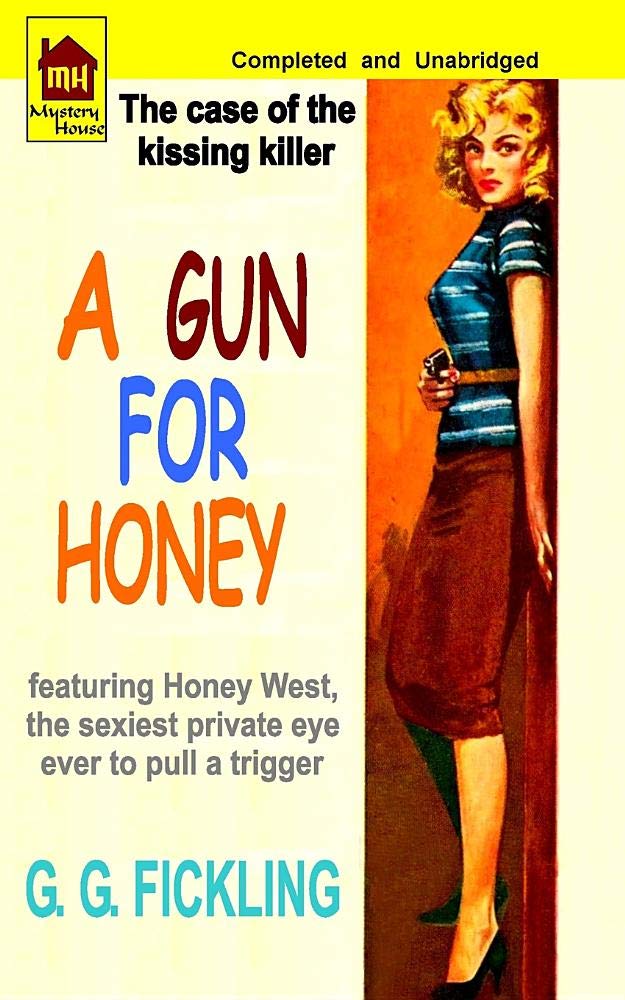 1958, « A gun for Honey », couverture Harry Schaare
1958, « A gun for Honey », couverture Harry Schaare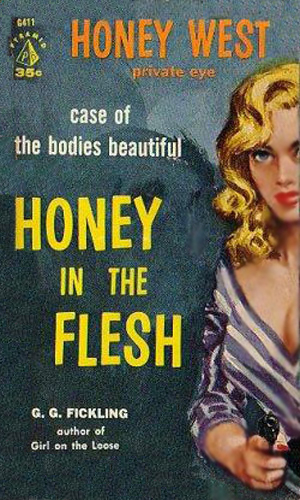 1959, « Honey in the Flesh », couverture Harry Schaare
1959, « Honey in the Flesh », couverture Harry Schaare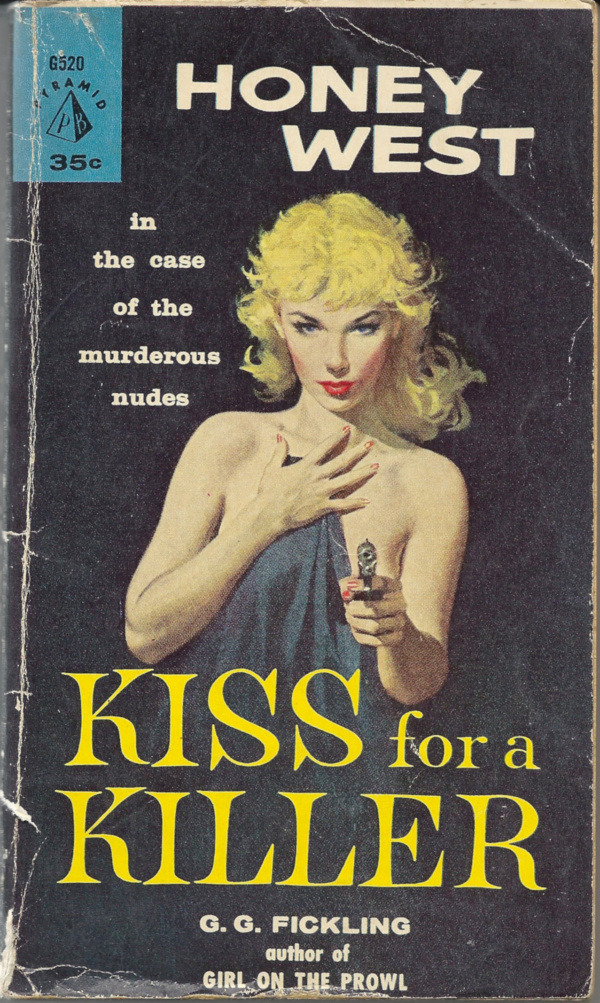 1960, « Kiss for a killer », couverture Robert Maguire
1960, « Kiss for a killer », couverture Robert Maguire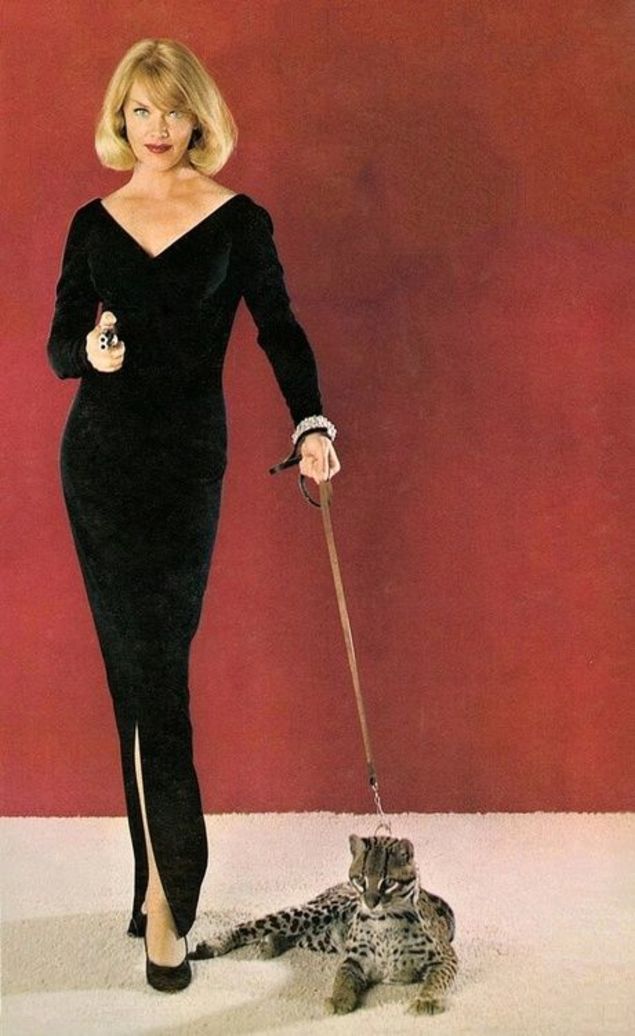 1965, Anne Francis, dans la série TV Honey West
1965, Anne Francis, dans la série TV Honey West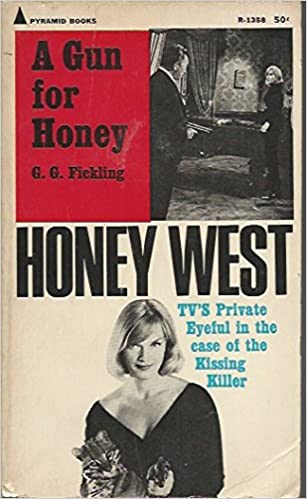 1965, « A gun for Honey »
1965, « A gun for Honey »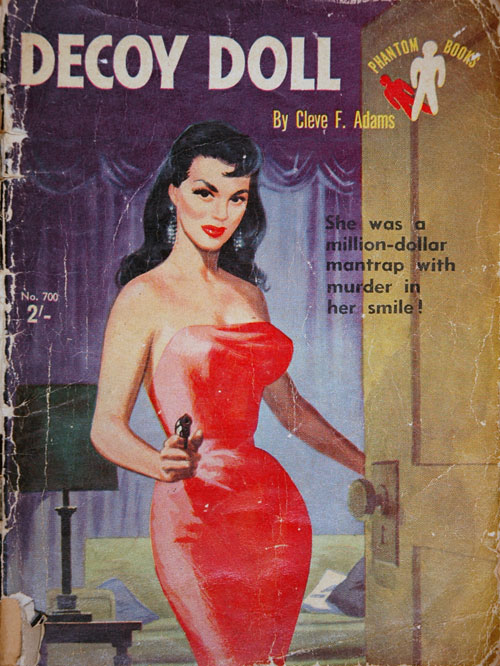 1956, Decoy doll
1956, Decoy doll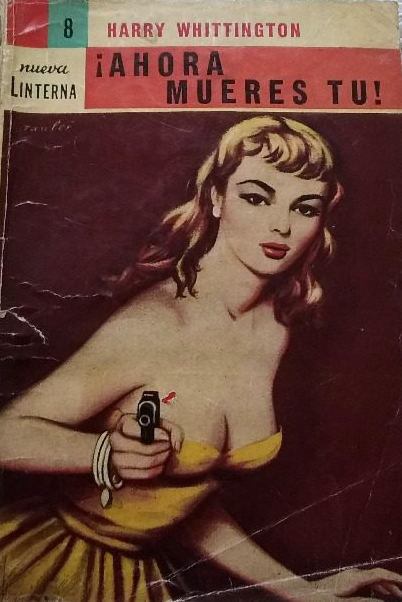 1957, Ahora Mueres Tu (argentin)
1957, Ahora Mueres Tu (argentin) 1959, Or be he dead
1959, Or be he dead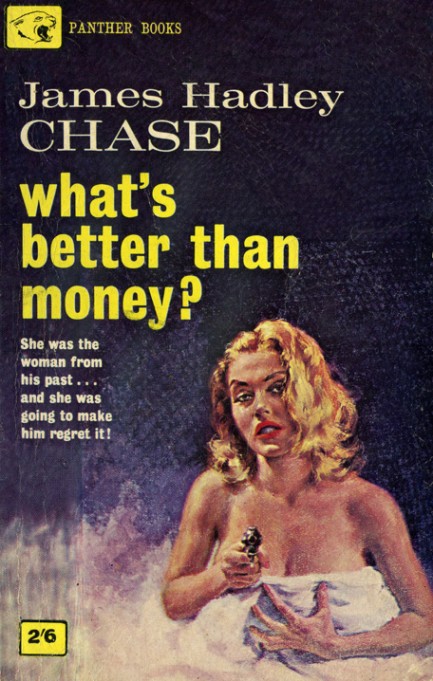 1960, What’s better than money
1960, What’s better than money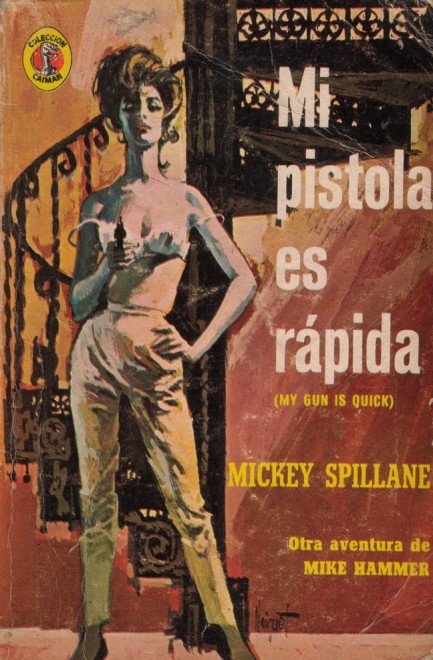 1964, Mi pistola es rapida (mexicain), couverture Noiquet (Joan Beltran Bofill)
1964, Mi pistola es rapida (mexicain), couverture Noiquet (Joan Beltran Bofill)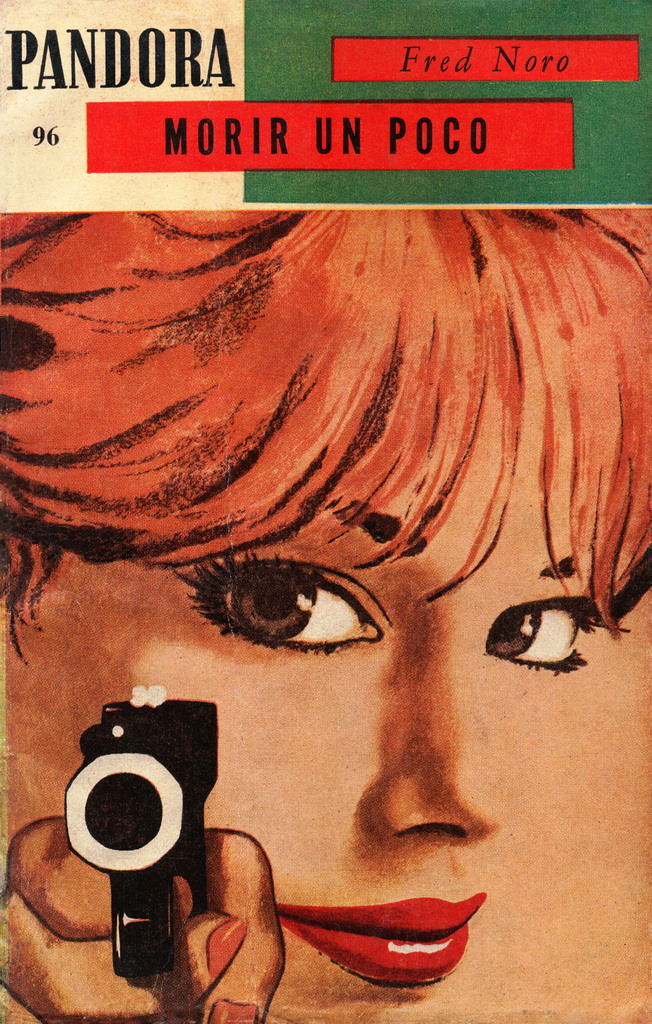 1964, Morir un poco (argentin)
1964, Morir un poco (argentin)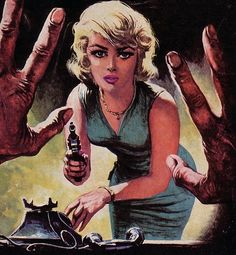 Couverture de « Slow day at the reference desk », éditions ACME
Couverture de « Slow day at the reference desk », éditions ACME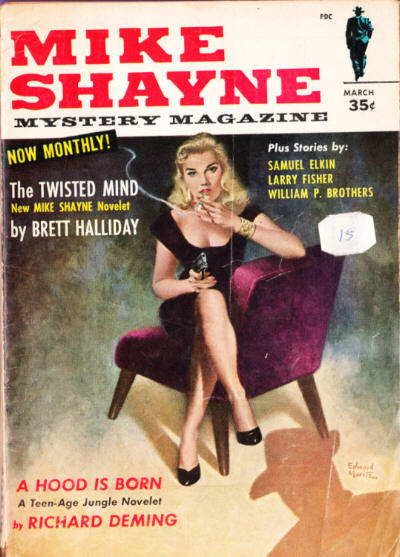 Mars 1959, illustration Edward Moritz
Mars 1959, illustration Edward Moritz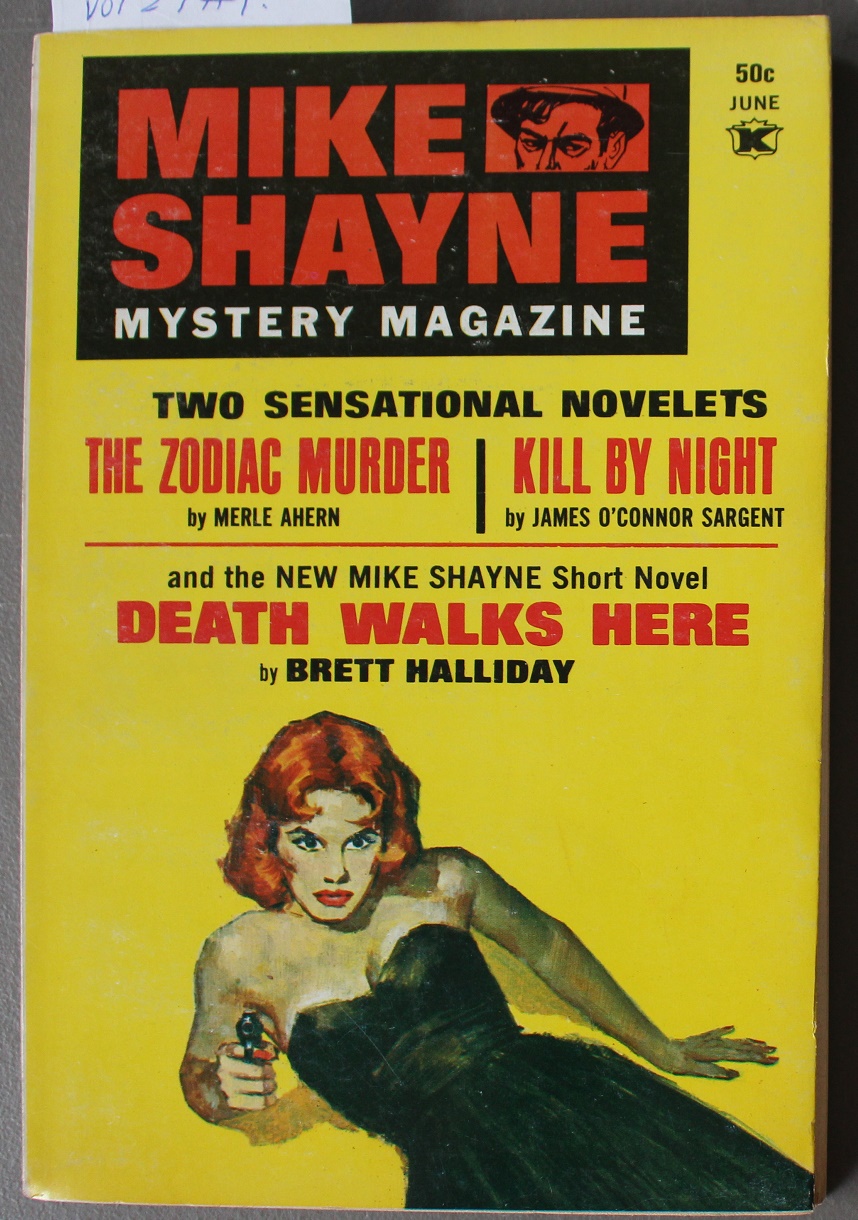 Juin 1970
Juin 1970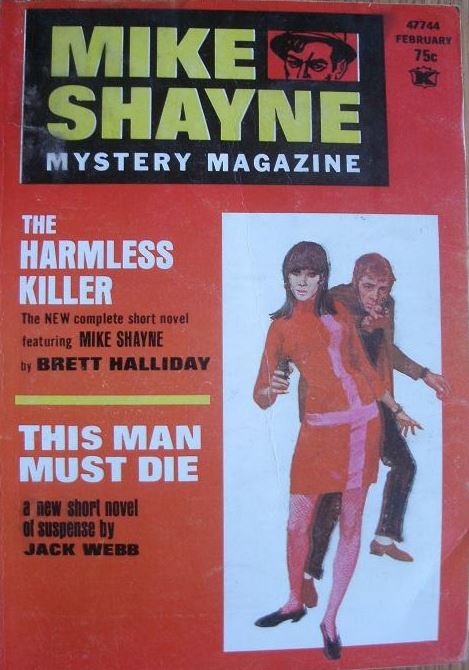 Février 1973
Février 1973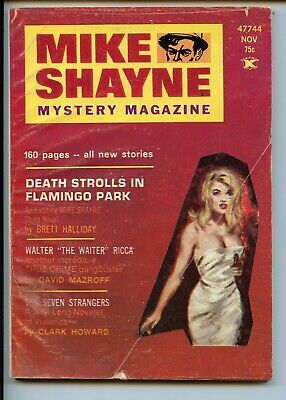 Novembre 1973
Novembre 1973 1998, Prairie Witch dans Starman Episode 44 (Reprise de la BD Phantom Lady de 1943)
1998, Prairie Witch dans Starman Episode 44 (Reprise de la BD Phantom Lady de 1943)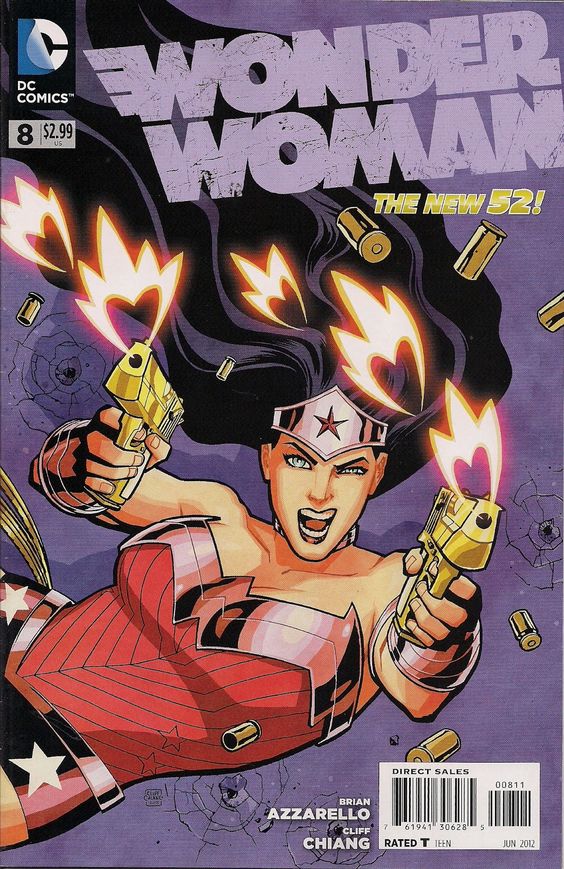 2012, Wonder Woman Episode 8, couverture de Cliff Chiang
2012, Wonder Woman Episode 8, couverture de Cliff Chiang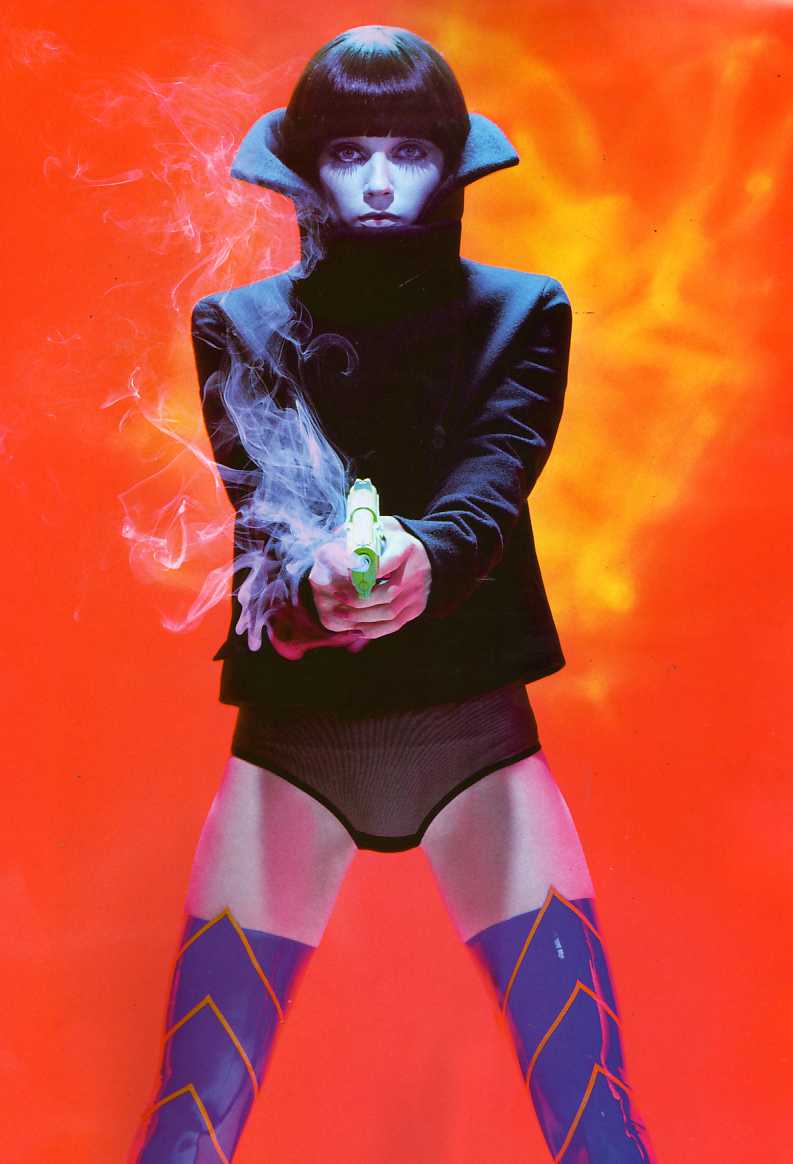 2008, Masha Novoselova Magazine « Numéro » N°97, photo Miles Aldridge
2008, Masha Novoselova Magazine « Numéro » N°97, photo Miles Aldridge 1964, Audrey Hepburn, photo Bob Willoughby à l’occasion du film « Paris When it Sizzles »
1964, Audrey Hepburn, photo Bob Willoughby à l’occasion du film « Paris When it Sizzles »
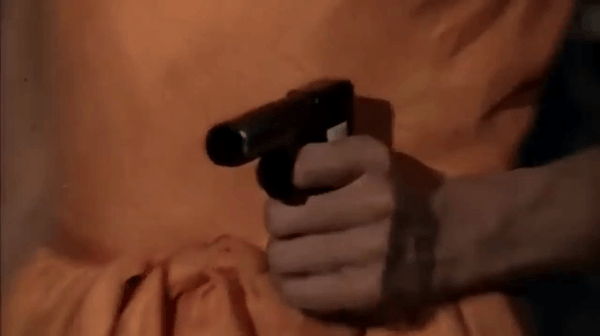
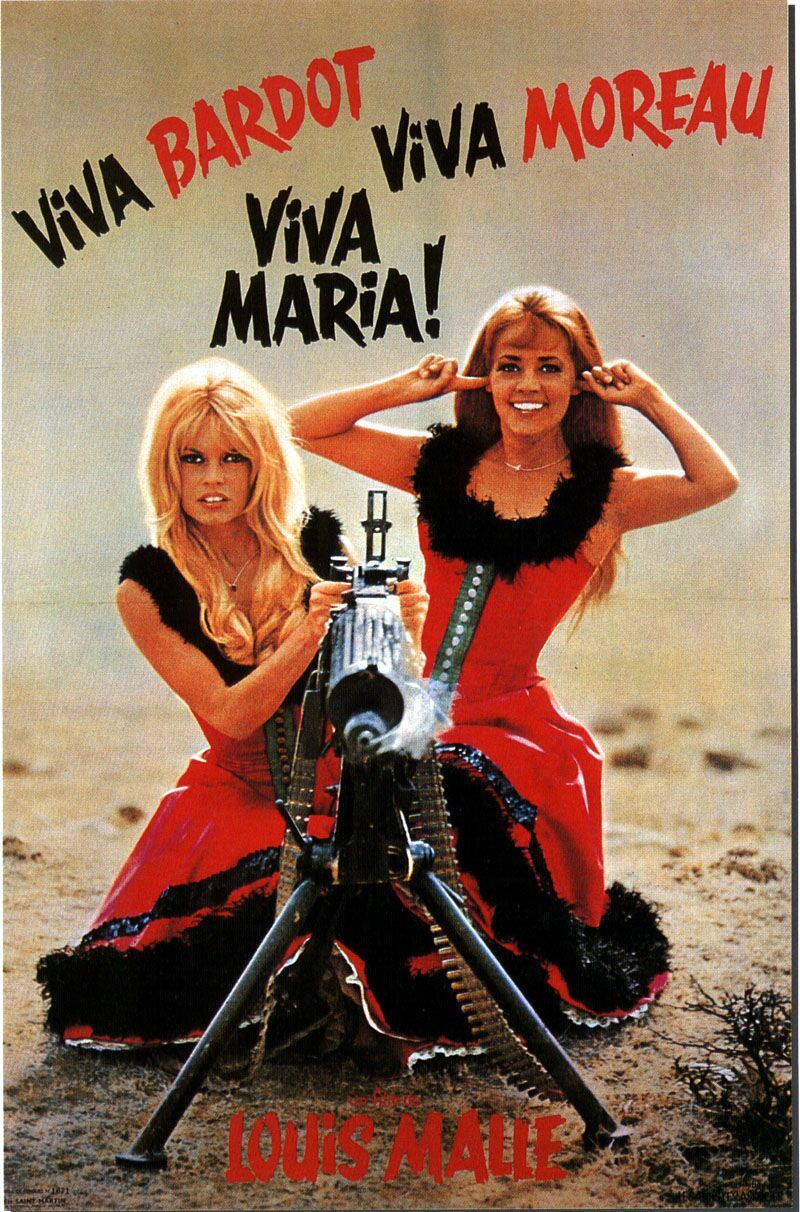 1965, affiche de Viva Maria
1965, affiche de Viva Maria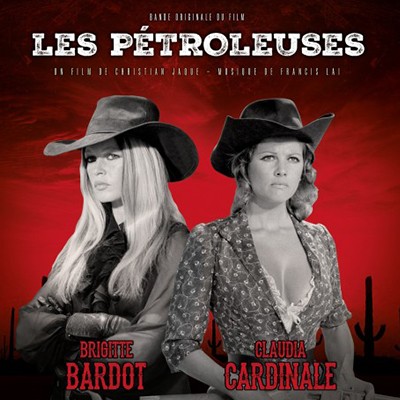
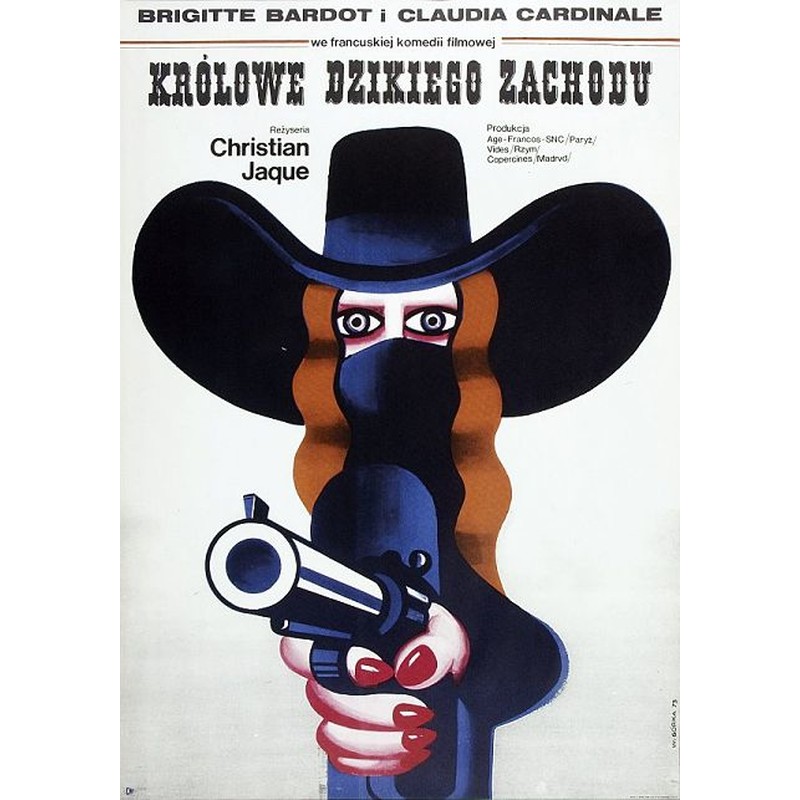 Affiche polonaise
Affiche polonaise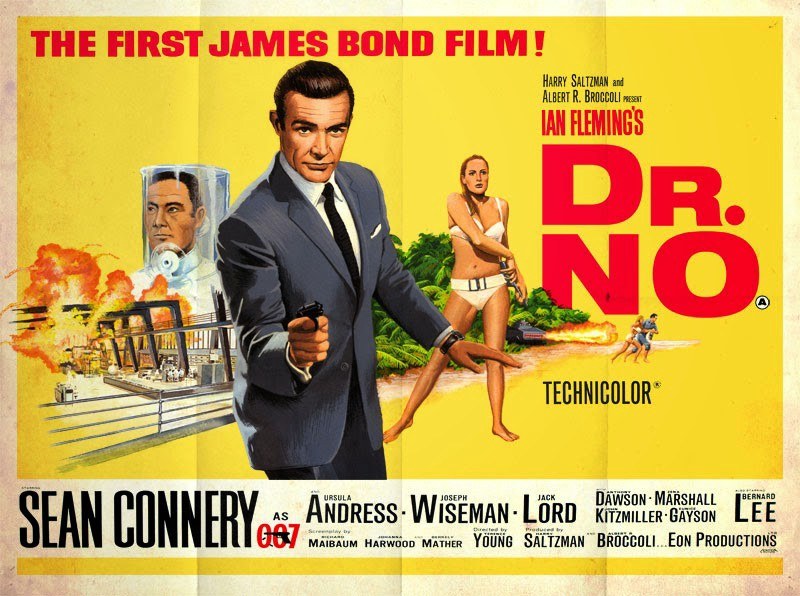
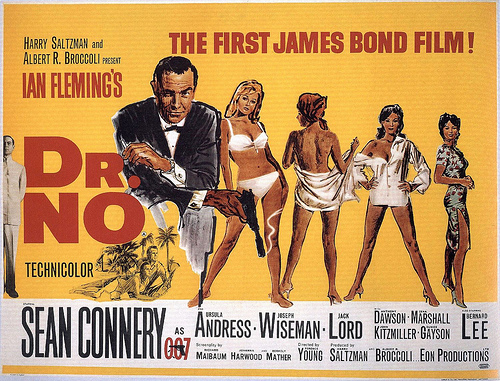
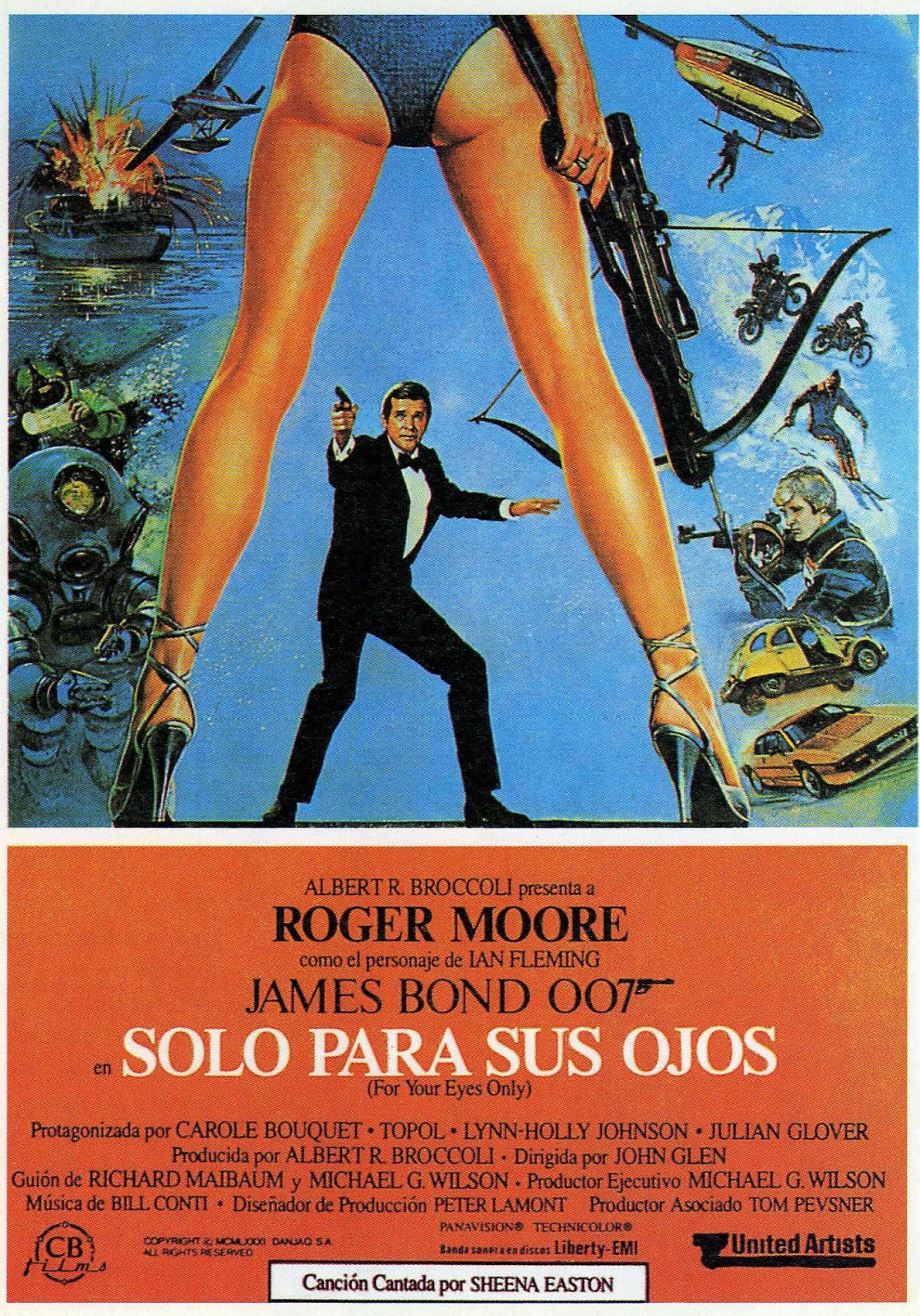
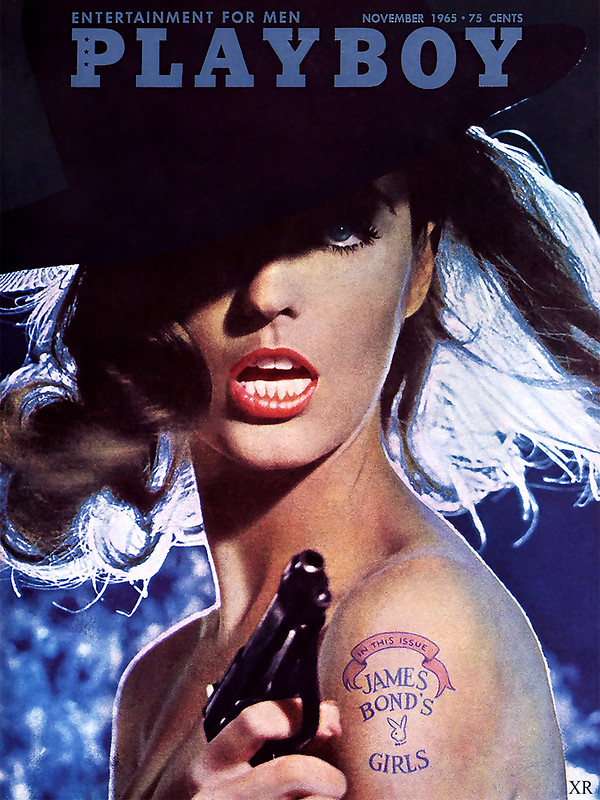
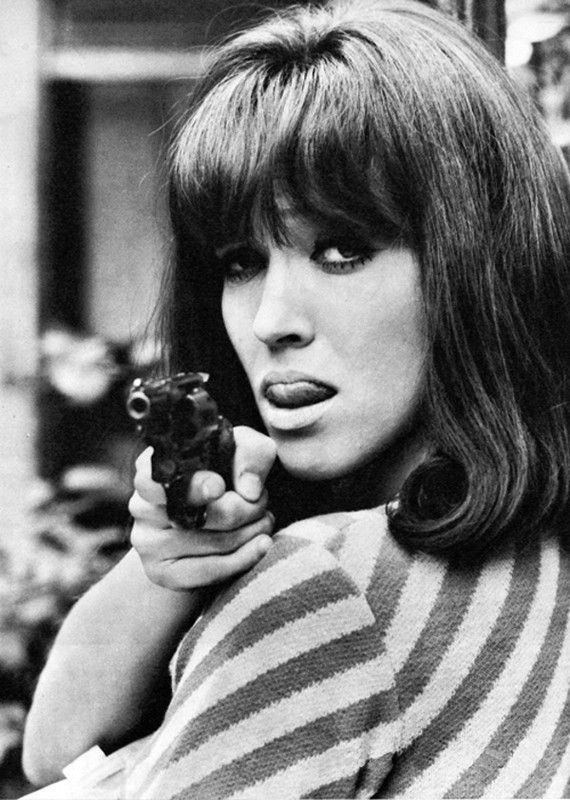
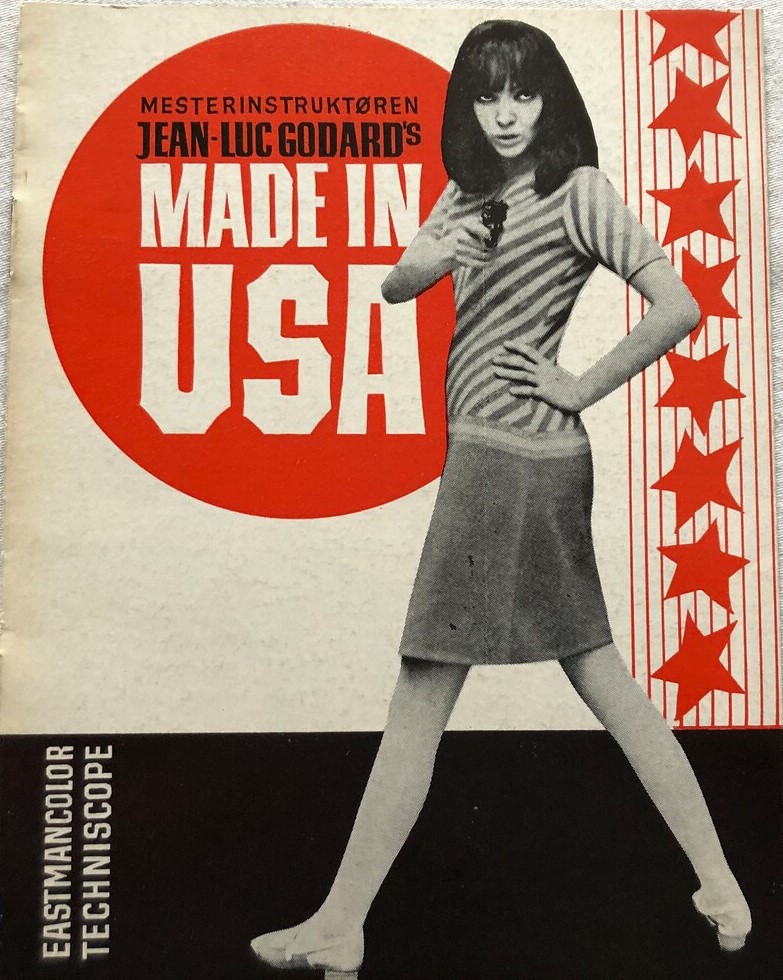 Affiche danoise
Affiche danoise
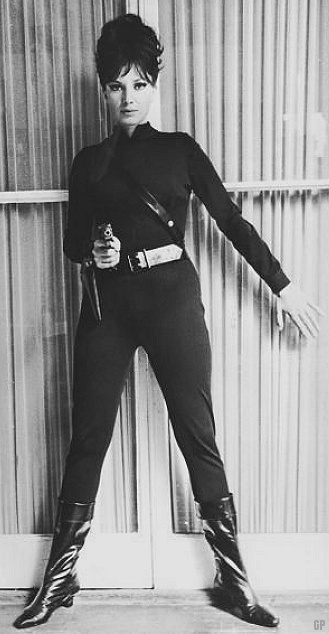
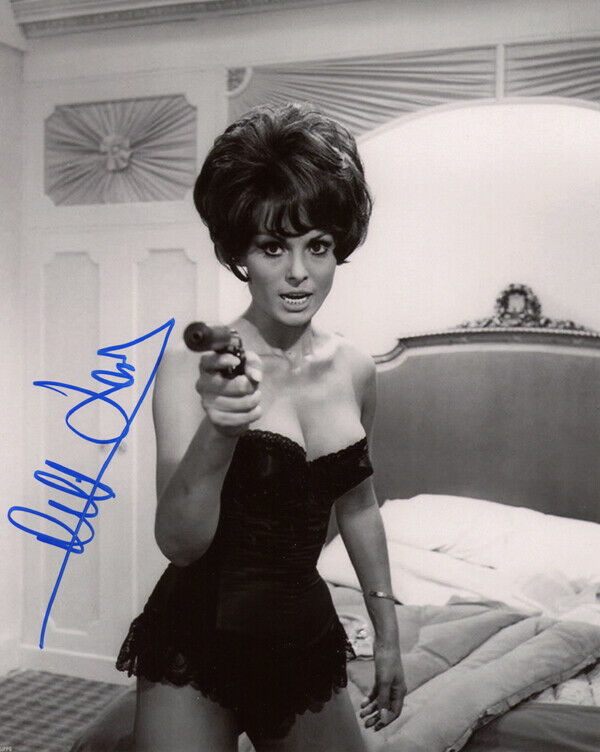 La « Nouvelle Arme Secrète » (Daliah Lavi)
La « Nouvelle Arme Secrète » (Daliah Lavi)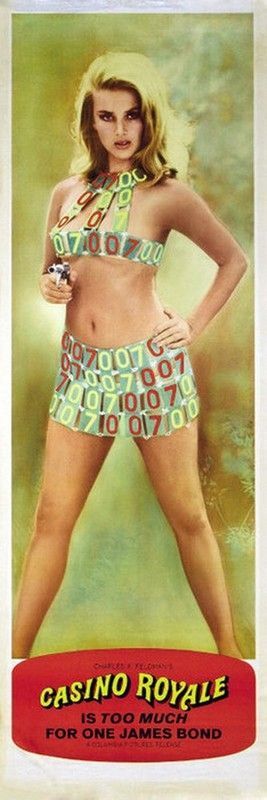 Marie-Minette (Barbara Bouchet)
Marie-Minette (Barbara Bouchet)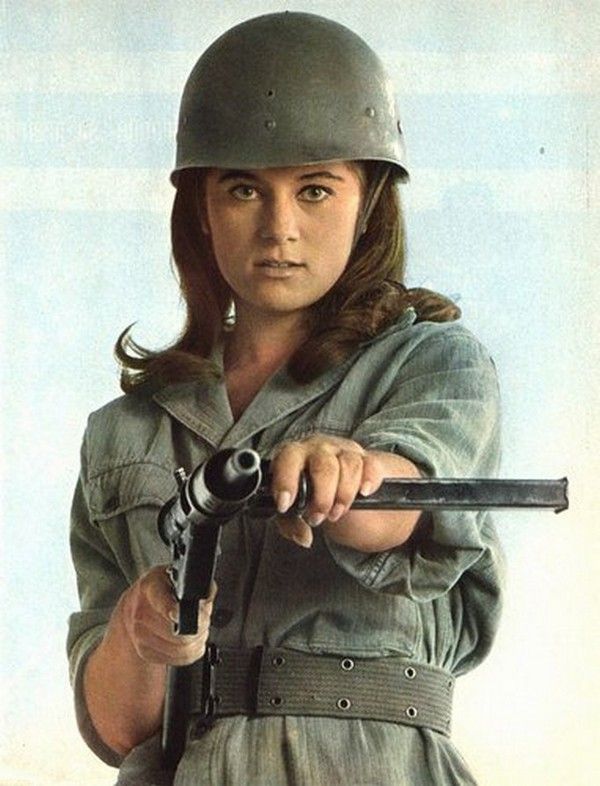 Salut les Copains n°54
Salut les Copains n°54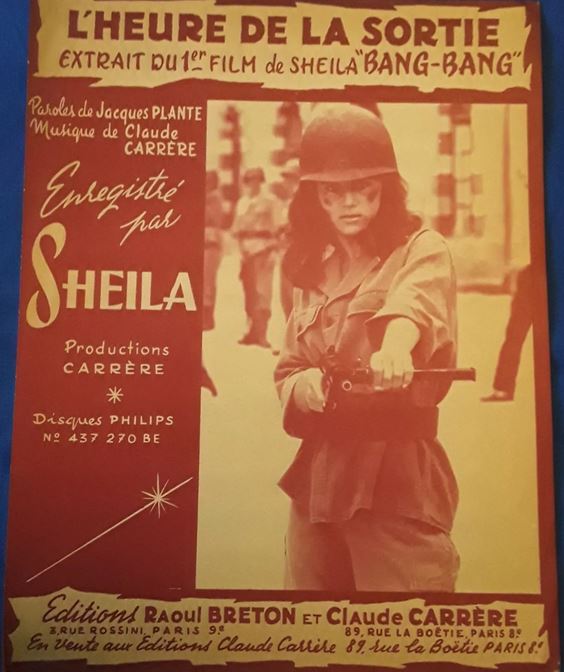 Pochette de la chanson « Bang Bang »
Pochette de la chanson « Bang Bang »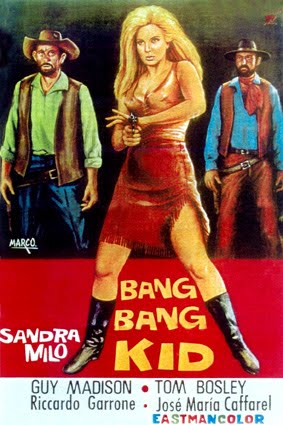 1967, Bang Bang Kid
1967, Bang Bang Kid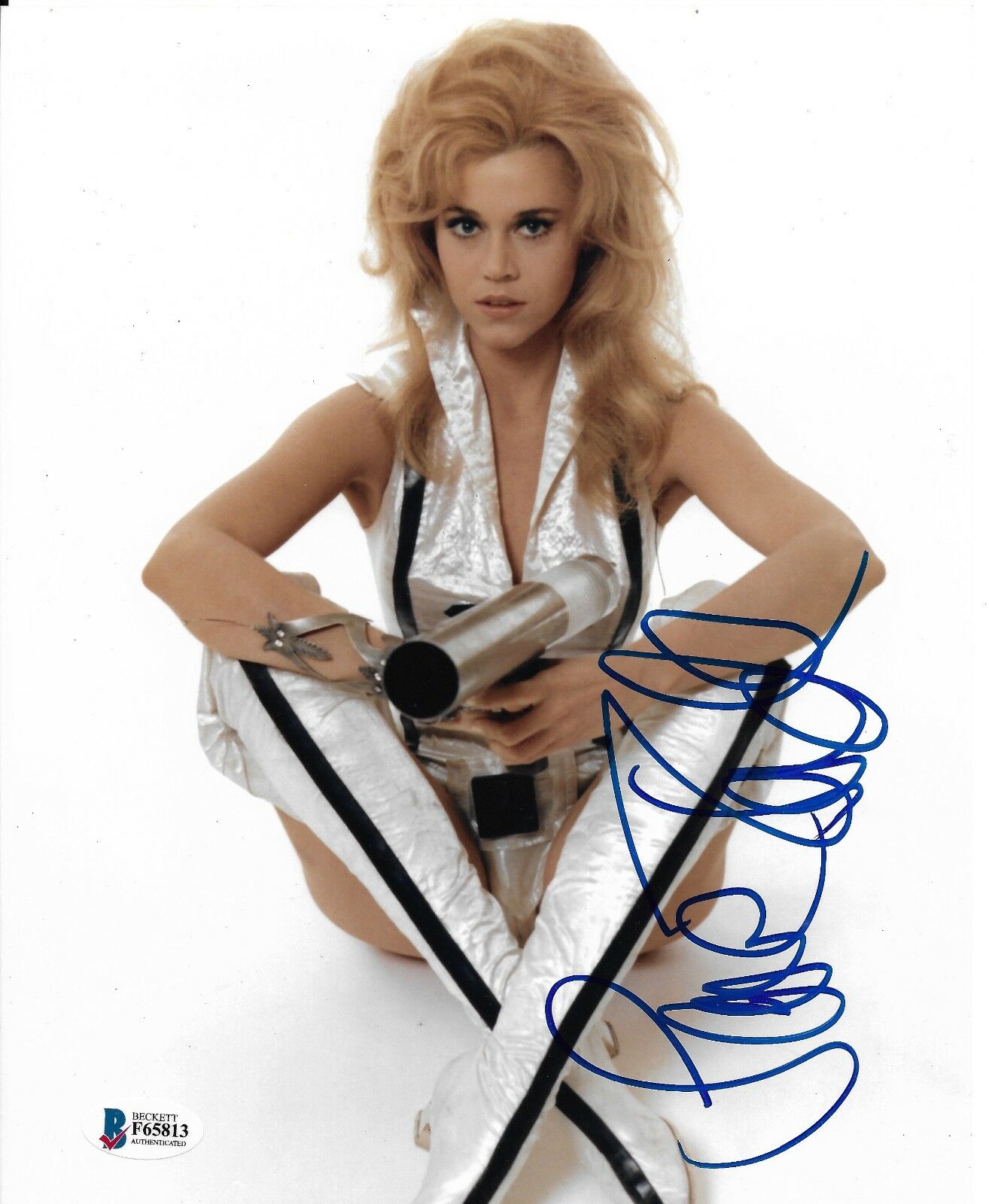 1968, Barbarella, Photo signée Jane Fonda
1968, Barbarella, Photo signée Jane Fonda John Steed (Patrick Mac Nee) et Tara King (Linda Thorson) « Chapeau melon et bottes de cuir » Saison 6, 1968-69
John Steed (Patrick Mac Nee) et Tara King (Linda Thorson) « Chapeau melon et bottes de cuir » Saison 6, 1968-69
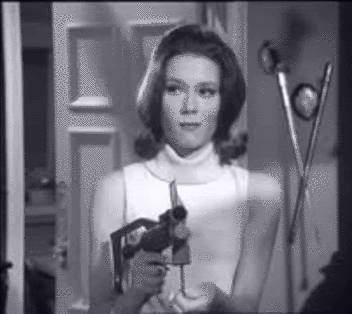
 Lorsque Miss Peel finit par prendre la célèbre pose, c’est avec un sourire ironique.
Lorsque Miss Peel finit par prendre la célèbre pose, c’est avec un sourire ironique. Photo de presse
Photo de presse Scène finale
Scène finale 1966, Senta Berger dans « Cast a giant shadow »
1966, Senta Berger dans « Cast a giant shadow »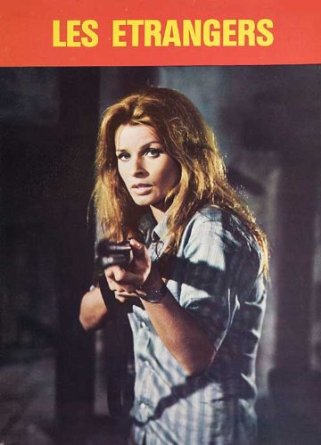 1969, Senta Berger dans « Les étrangers »
1969, Senta Berger dans « Les étrangers »
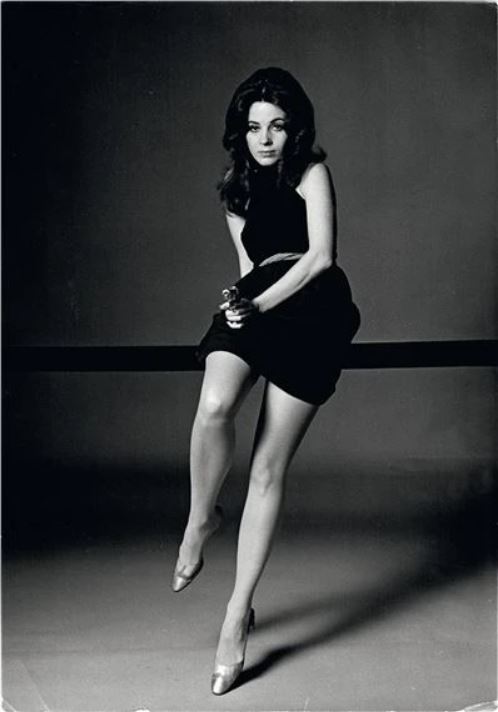
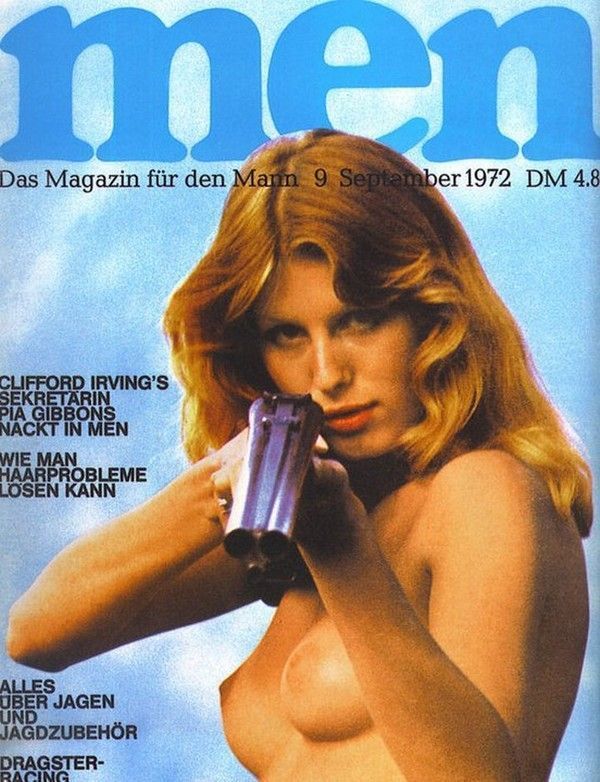 1972, Couverture de Men
1972, Couverture de Men 2012, Girl pointing gun, dessin de Giuseppe Cristiano
2012, Girl pointing gun, dessin de Giuseppe Cristiano 1971, Clint Eastwood dans Dirty Harry
1971, Clint Eastwood dans Dirty Harry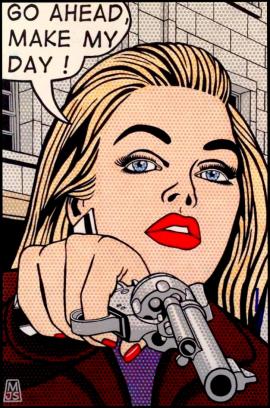 1983, « Go Ahead, Make My Day » par Malcolm Smith
1983, « Go Ahead, Make My Day » par Malcolm Smith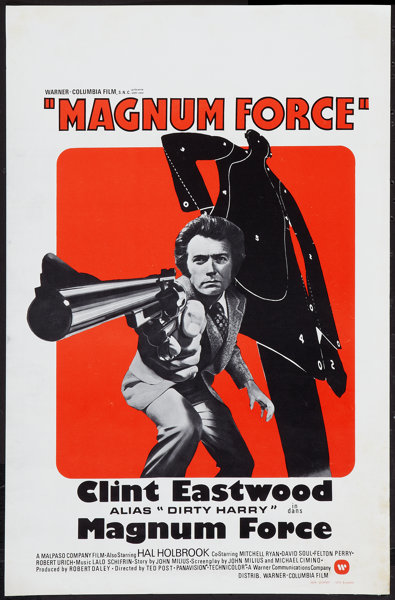 1973, Clint Eastwood dans « Magnum Force »
1973, Clint Eastwood dans « Magnum Force »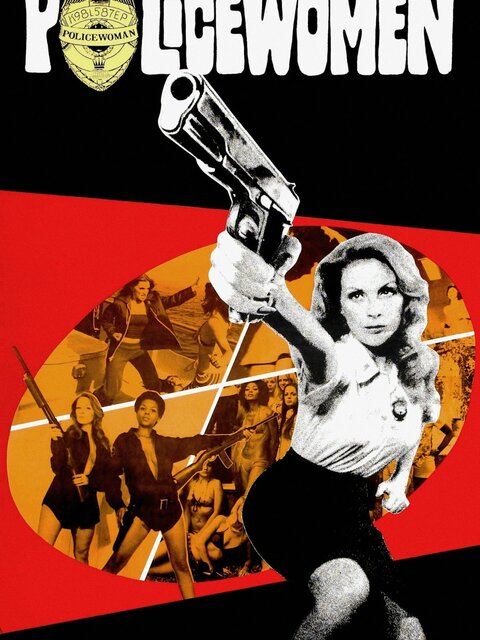 1974, Sondra Currie dans Policewomen
1974, Sondra Currie dans Policewomen Avant 2013, collage anonyme
Avant 2013, collage anonyme
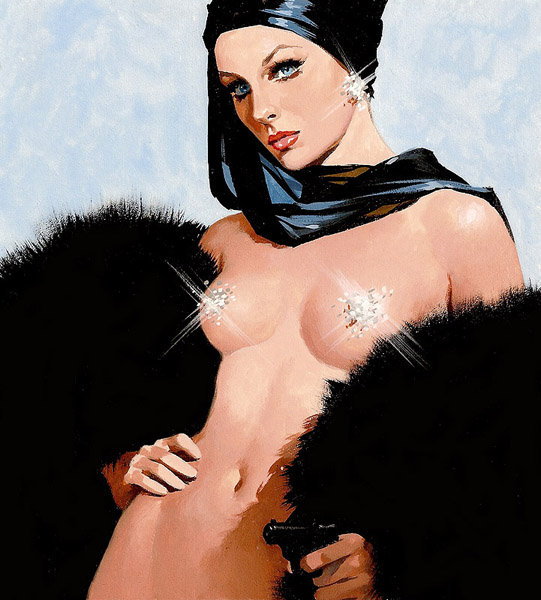




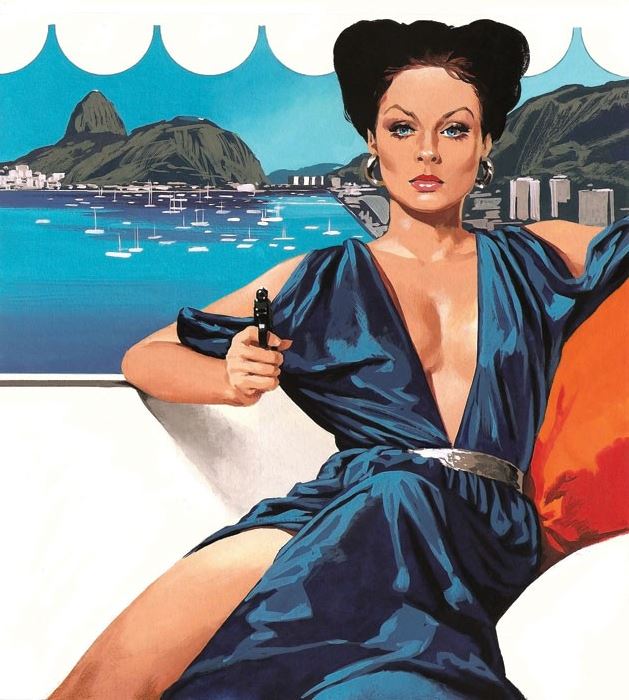
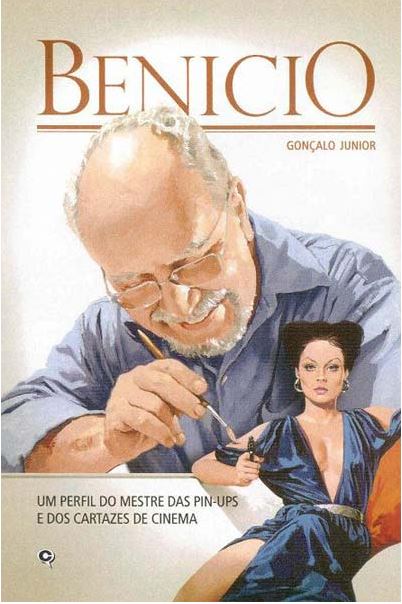
 1980, Gena Rowlands dans Gloria, de Cassevettes
1980, Gena Rowlands dans Gloria, de Cassevettes 1980, Gloria
1980, Gloria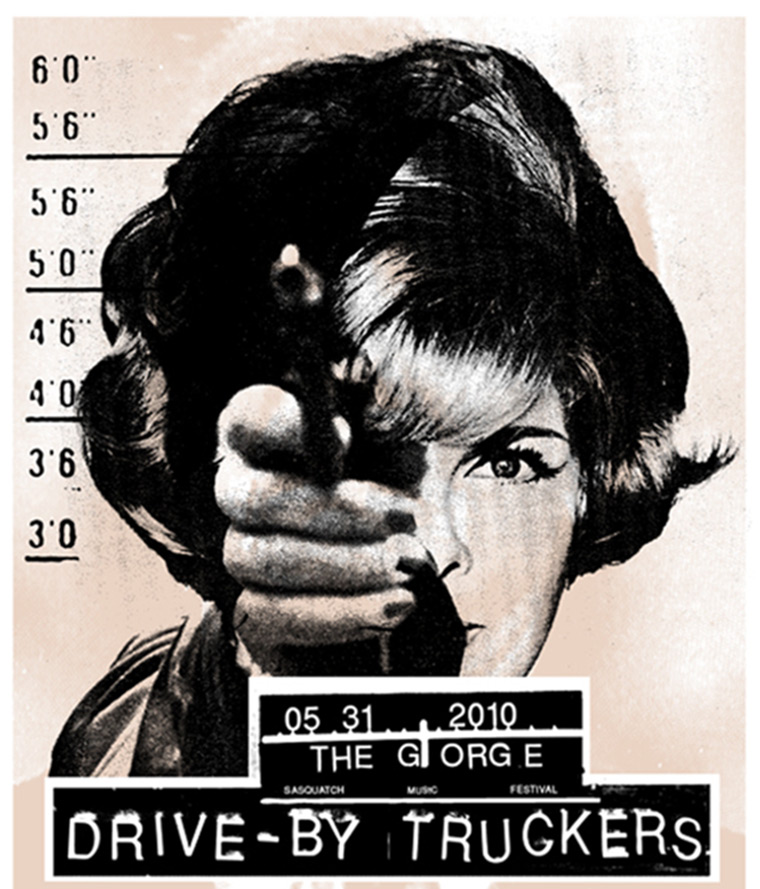 2010, Affiche pour le concert Drive-By Truckers au Sasquatch, collage de Joanna Wecht.
2010, Affiche pour le concert Drive-By Truckers au Sasquatch, collage de Joanna Wecht.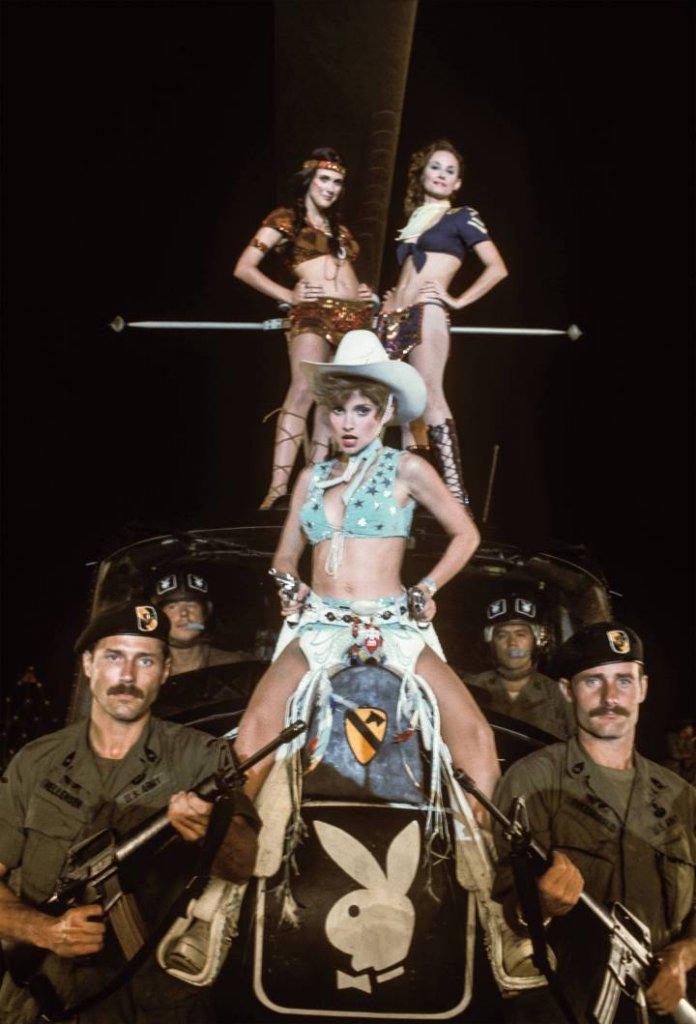 1979, Apocalyse Now, Francis Ford Coppola
1979, Apocalyse Now, Francis Ford Coppola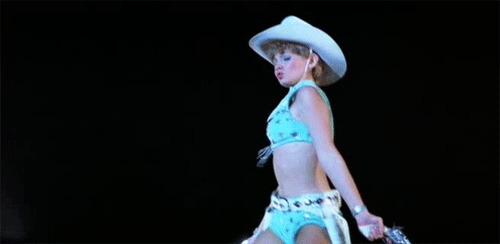
 Autoportrait,Dürer, 1493, Louvre
Autoportrait,Dürer, 1493, Louvre Hans Schäufelein l’Aîné, 1504, Indianapolis Museum of Art
Hans Schäufelein l’Aîné, 1504, Indianapolis Museum of Art Portrait d’un homme tenant une ancolie (Achilleia), Utrecht, vers 1445
Portrait d’un homme tenant une ancolie (Achilleia), Utrecht, vers 1445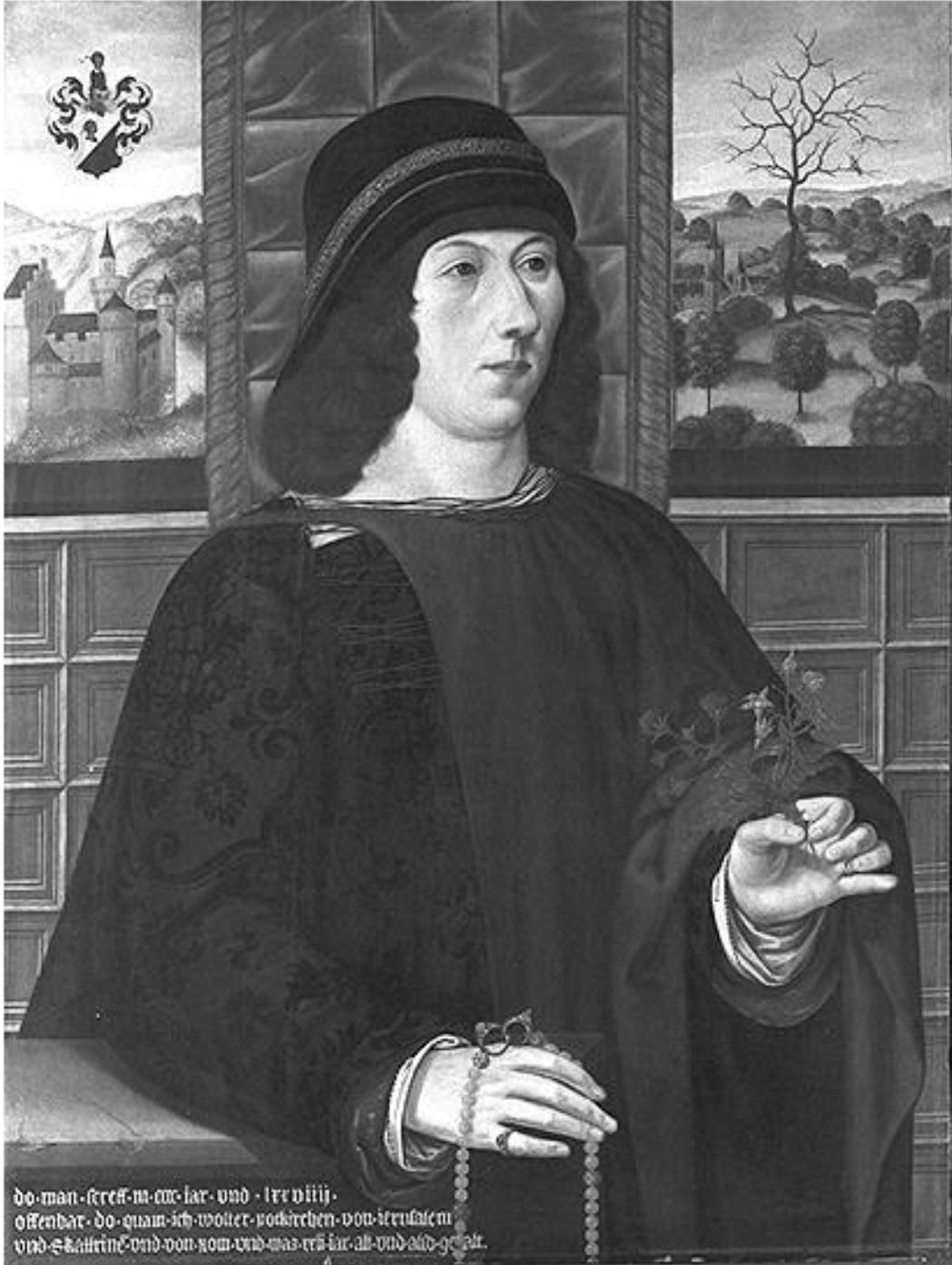 Portrait de Walter Rotkirchen en 1479 tenant un chardon et une ancolie (copie de 1624), attribué au Meister des Bartholomäus-Altars, Wallraf Richartz Museum, Cologne
Portrait de Walter Rotkirchen en 1479 tenant un chardon et une ancolie (copie de 1624), attribué au Meister des Bartholomäus-Altars, Wallraf Richartz Museum, Cologne Autoportrait, Dürer, 1500, Alte Pinakothek, Münich
Autoportrait, Dürer, 1500, Alte Pinakothek, Münich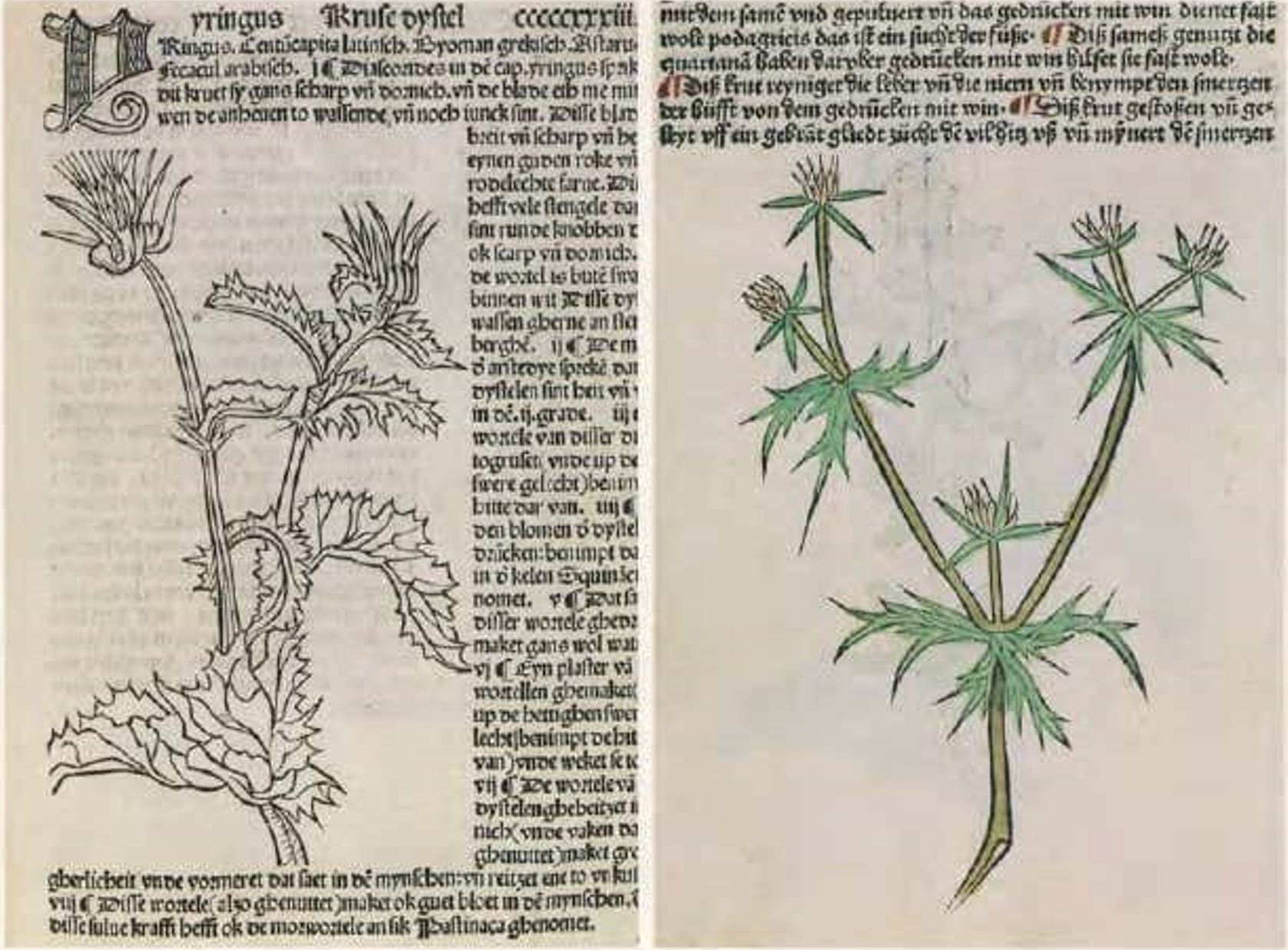
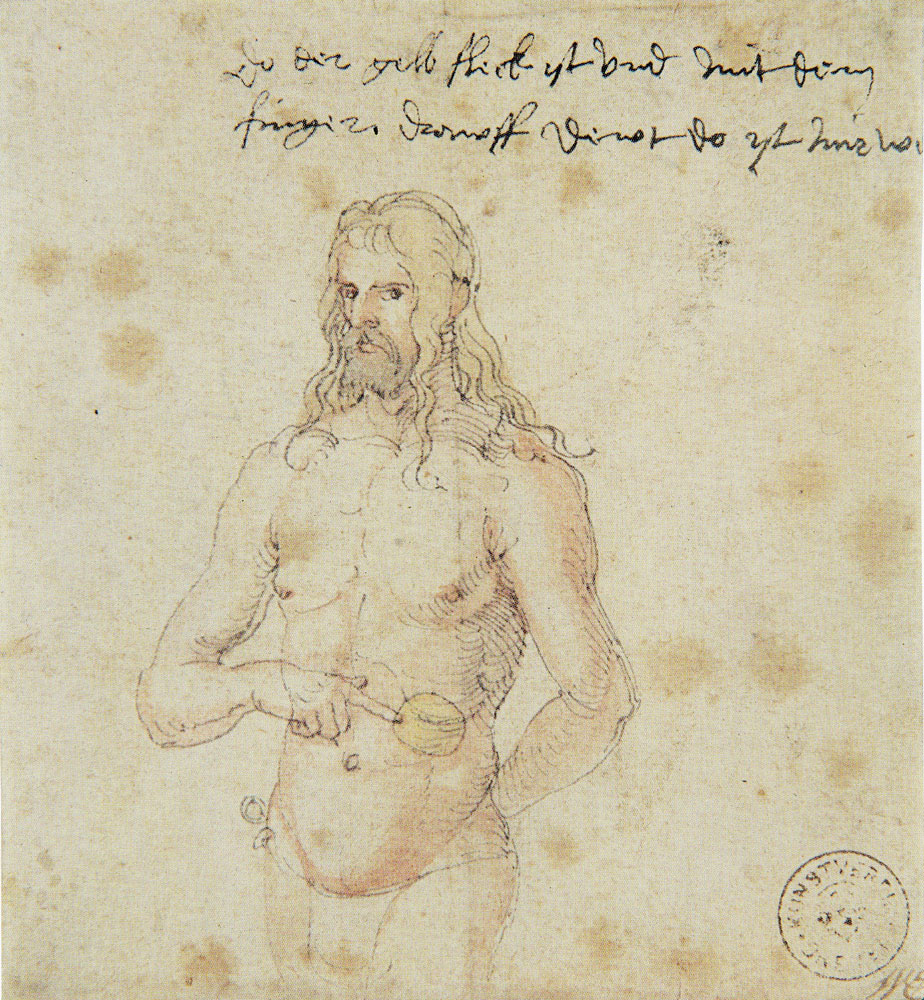 Autoportrait en homme malade, Dürer, 1512-13, Kunsthalle, Breme
Autoportrait en homme malade, Dürer, 1512-13, Kunsthalle, Breme
 Jeune homme à l’oeillet
Jeune homme à l’oeillet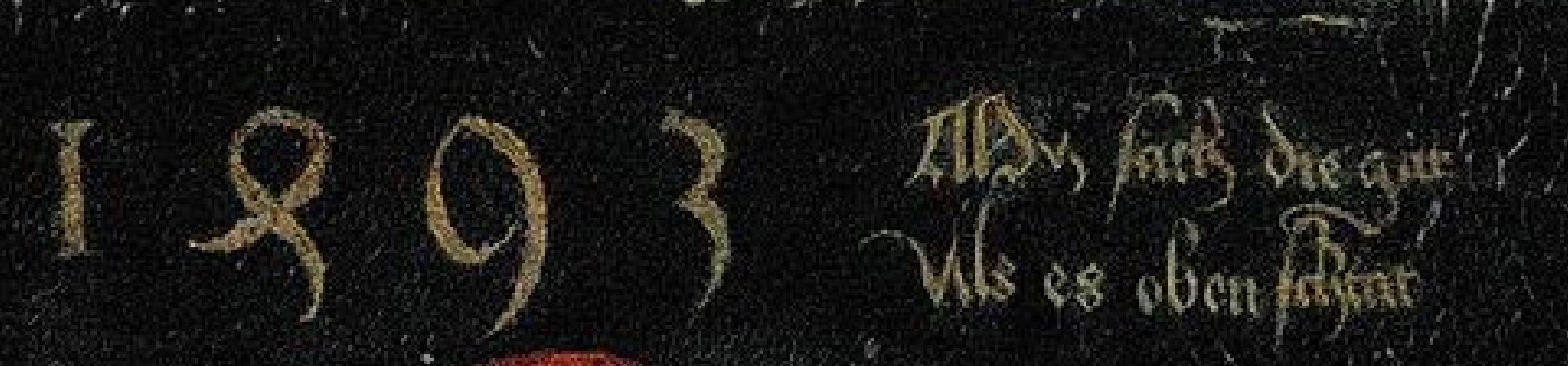
 Copie de l’autoportrait de 1493
Copie de l’autoportrait de 1493 Verso du Saint Jérôme au désert,
Verso du Saint Jérôme au désert, Les amoureux de Gotha
Les amoureux de Gotha Autoportait, Dürer, 1498, Prado, Madrid
Autoportait, Dürer, 1498, Prado, Madrid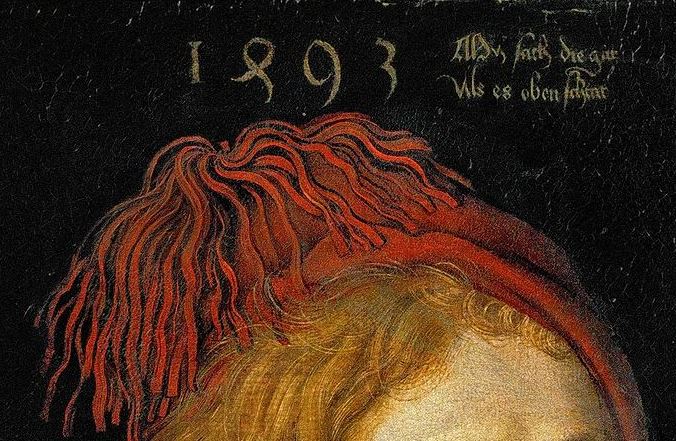
 Le Christ comme Homme de Douleurs
Le Christ comme Homme de Douleurs 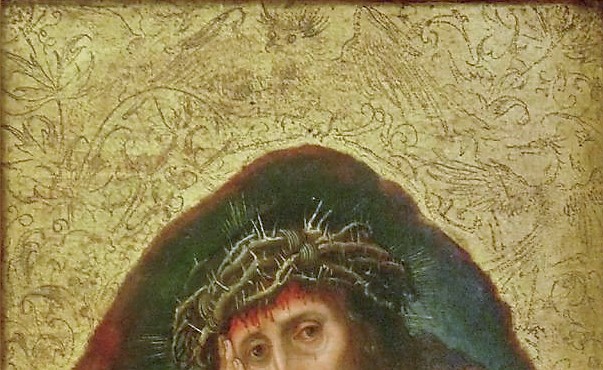
 Couronnement d’épines
Couronnement d’épines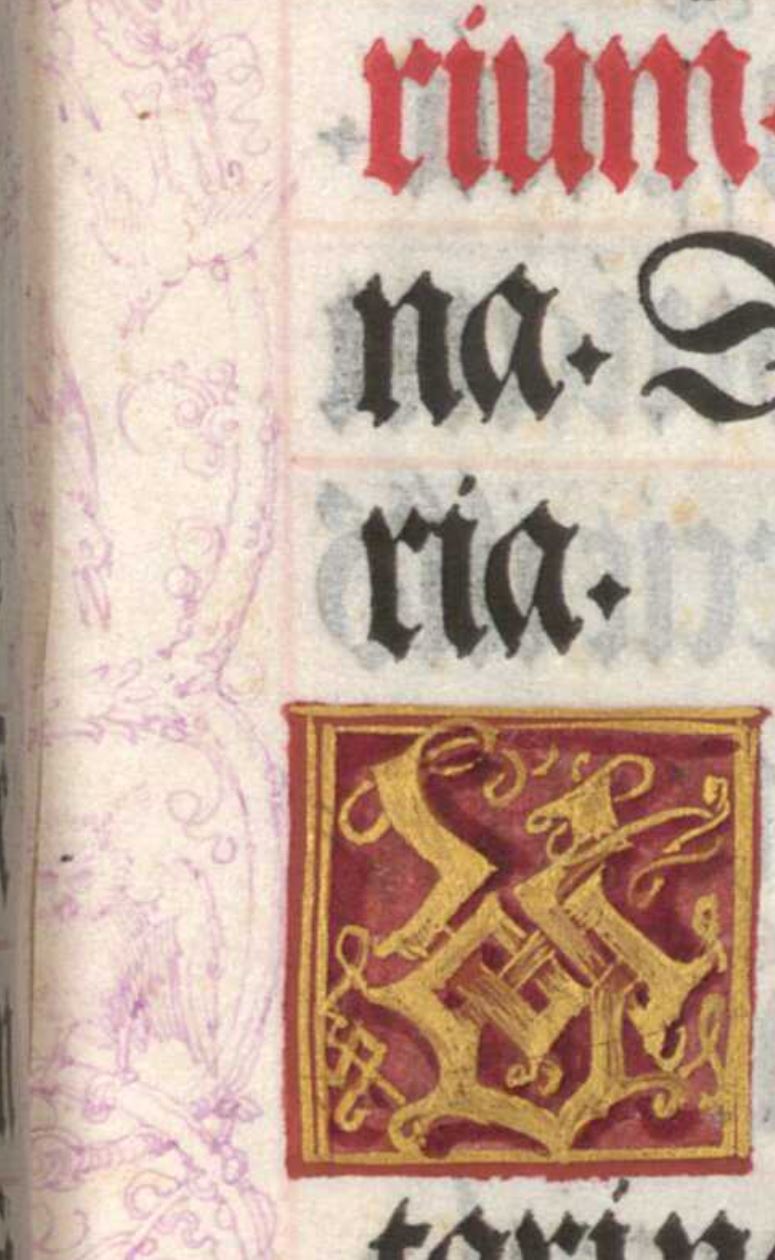
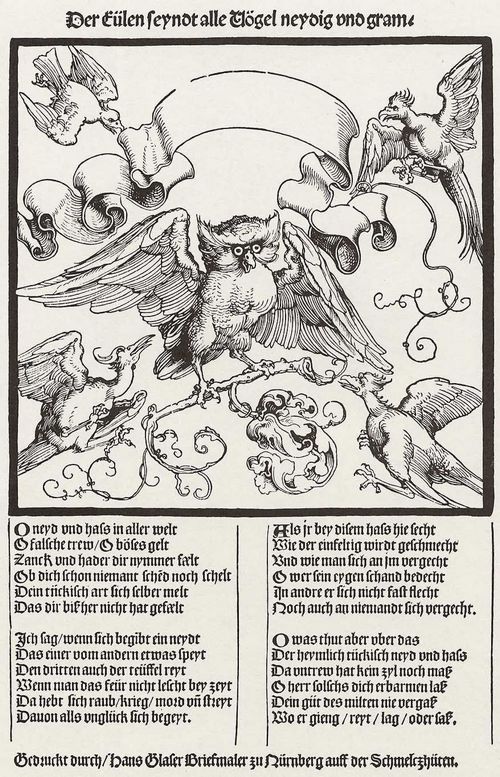 Dürer, 1515
Dürer, 1515 Blason avec un homme derrière un poêle
Blason avec un homme derrière un poêle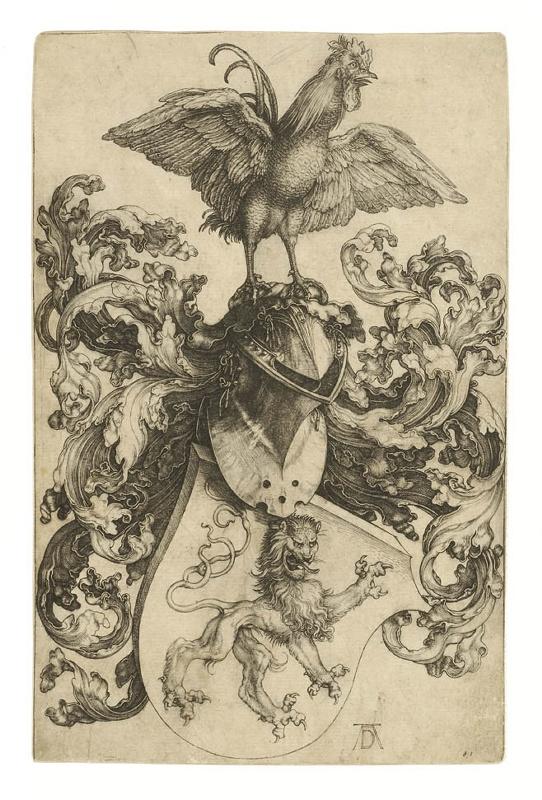 Blason avec coq et lion, Dürer, 1500
Blason avec coq et lion, Dürer, 1500
 Racine de bryone, site hippocratekepos.fr [6]
Racine de bryone, site hippocratekepos.fr [6]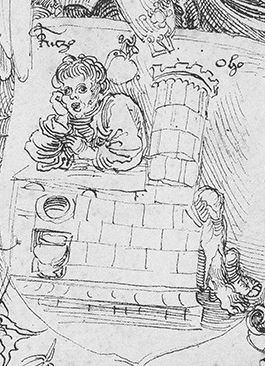
 Le ravisseur, Dürer, 1495
Le ravisseur, Dürer, 1495 La Petite Fortune, Dürer, 1496
La Petite Fortune, Dürer, 1496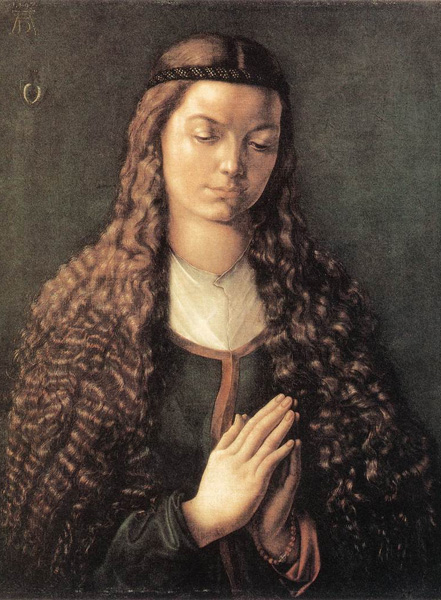 Aux cheveux dénoués, Städel Museum, Francfort
Aux cheveux dénoués, Städel Museum, Francfort Aux cheveux tressés, Gemäldegalerie, Berlin
Aux cheveux tressés, Gemäldegalerie, Berlin Portrait de son père, copie d’après Dürer, 1497, National Gallery
Portrait de son père, copie d’après Dürer, 1497, National Gallery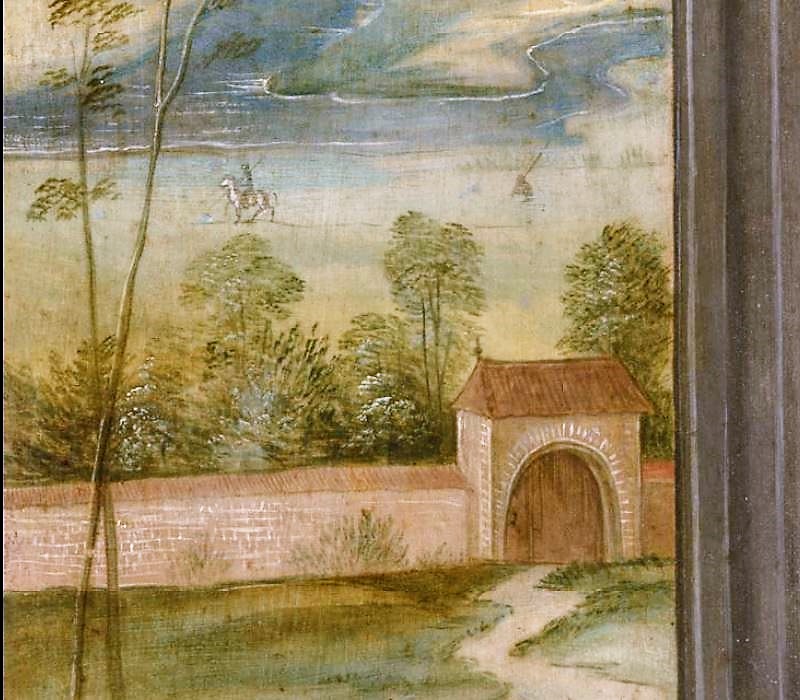 Aux cheveux tressés, copie de Leipzig (détail)
Aux cheveux tressés, copie de Leipzig (détail) Copie, Museum der bildenden Kunste, Leipzig
Copie, Museum der bildenden Kunste, Leipzig Le copiste a reproduit à l’identique les deux énigmatiques séries de lettres de l’encolure, jamais expliquées (KTATDTDTETWT / KAE) : faute de mieux, on suppose que ce sont les initiales d’une devise.
Le copiste a reproduit à l’identique les deux énigmatiques séries de lettres de l’encolure, jamais expliquées (KTATDTDTETWT / KAE) : faute de mieux, on suppose que ce sont les initiales d’une devise.