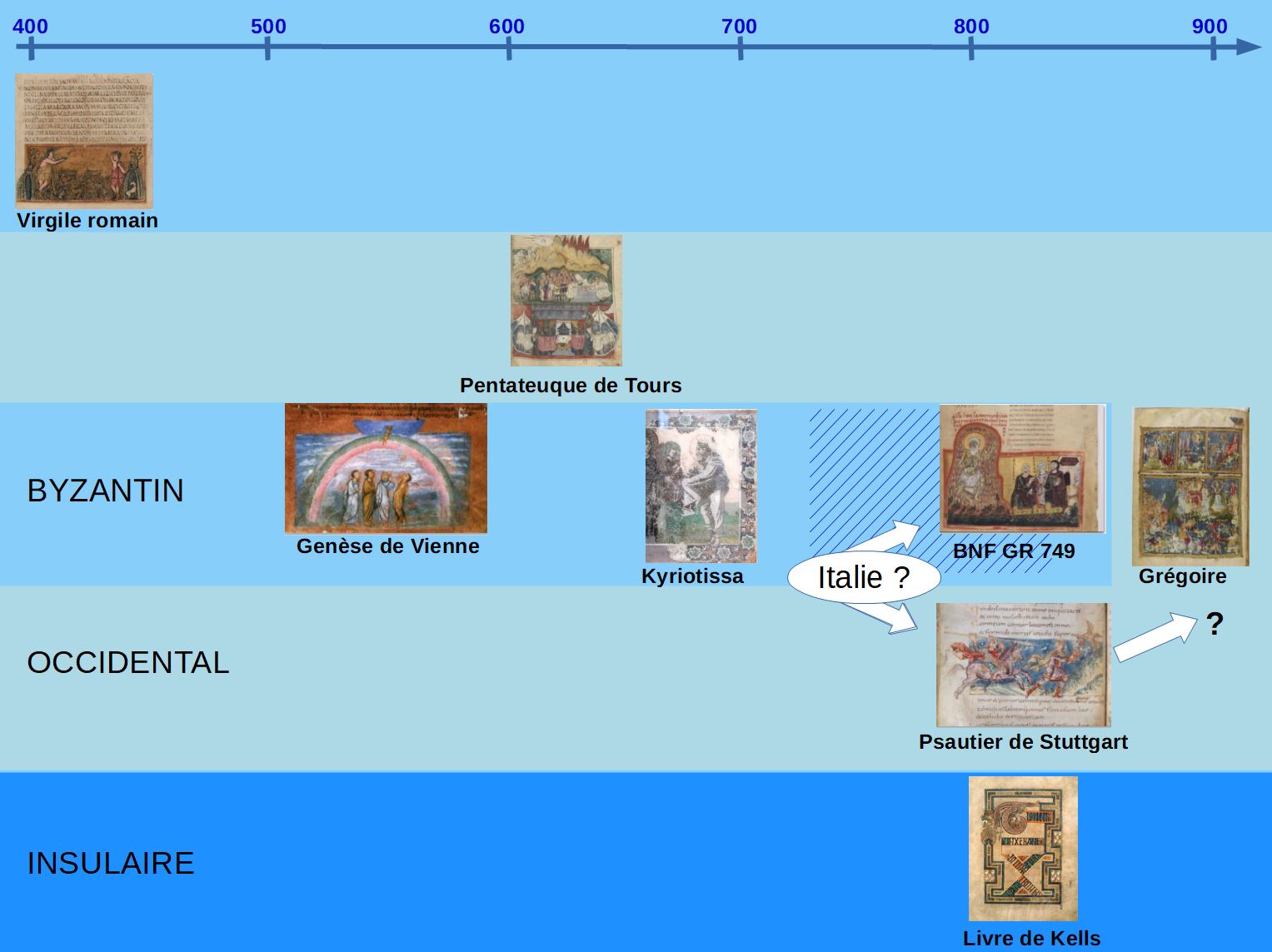Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ?

Introduction
L’histoire des mots n’est pas celle des choses et inversement. Selon les époques, des choses semblables sont désignées différemment et le même mot change de signification. L’histoire de l’art fait partie des domaines où le problème est le plus sensible. Notre discours sur l’art aurait été incompréhensible à d’autres époques et beaucoup d’objets qui sont qualifiés aujourd’hui d’œuvres d’art n’auraient pas été reconnus jadis comme tels. Le présent essai concerne approximativement ce qu’on a appelé les beaux-arts et les arts appliqués, en somme les arts qui visent le beau, par opposition à l’art militaire, par exemple, dont ce n’est pas la fin essentielle. Mais il se trouve que « beaux-arts » et « arts appliqués » sont devenu désuet et qu’on parle aujourd’hui d’art, tout simplement, pour subsumer une bonne partie du contenu hétéroclite de nos musées.
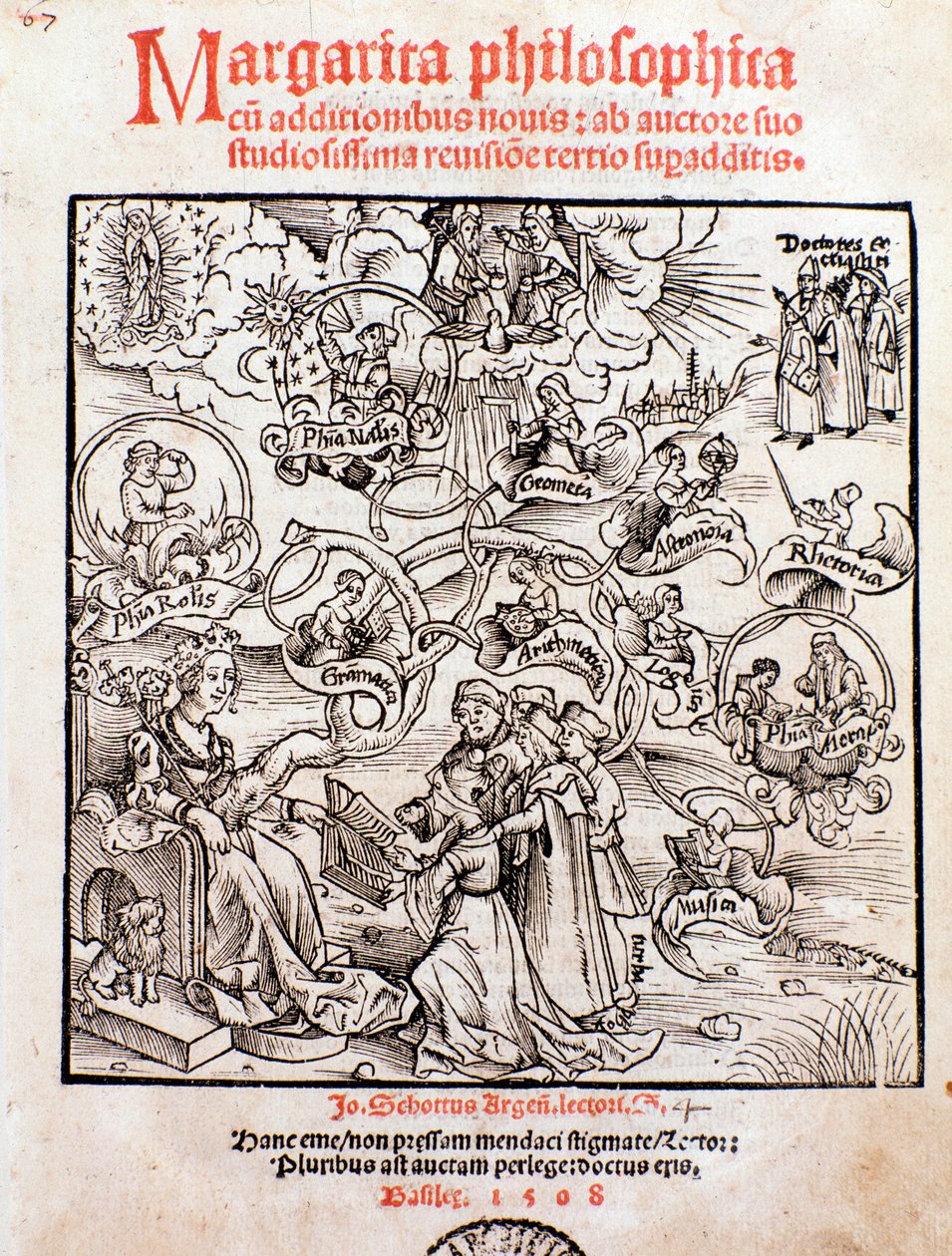 De l’Antiquité à la Renaissance, il n’y a simplement aucun mot pour ce que nous appelons l’art. Le mot « art » désigne les arts libéraux et par « artiste », on entend au Moyen Age un diplômé de la faculté des arts, par exemple un logicien ou un géomètre. Il désigne aussi les arts mécaniques, par exemple la cordonnerie ou l’agriculture. On lit souvent que l’art au sens moderne du mot appartenait à ces derniers au Moyen Age, mais, outre que la distinction entre arts libéraux et mécaniques n’était pas rigide, l’architecture, la sculpture et la peinture faisaient appel à l’art libéral de la géométrie pour se valoriser. En fait, aucun mot avant « beaux-arts » n’a réuni ces trois disciplines dans un concept commun les distinguant de la logique ou de l’art militaire. Jusque-là, les finalités technique et esthétique étaient indissociables. Rien ne distinguait l’architecte de l’ingénieur et la tâche du cordonnier était de faire de belles chaussures. Le problème est comparable pour ce que nous appelons la littérature: l’importante production de poésie scientifique correspond mal à la notion que nous en avons.
De l’Antiquité à la Renaissance, il n’y a simplement aucun mot pour ce que nous appelons l’art. Le mot « art » désigne les arts libéraux et par « artiste », on entend au Moyen Age un diplômé de la faculté des arts, par exemple un logicien ou un géomètre. Il désigne aussi les arts mécaniques, par exemple la cordonnerie ou l’agriculture. On lit souvent que l’art au sens moderne du mot appartenait à ces derniers au Moyen Age, mais, outre que la distinction entre arts libéraux et mécaniques n’était pas rigide, l’architecture, la sculpture et la peinture faisaient appel à l’art libéral de la géométrie pour se valoriser. En fait, aucun mot avant « beaux-arts » n’a réuni ces trois disciplines dans un concept commun les distinguant de la logique ou de l’art militaire. Jusque-là, les finalités technique et esthétique étaient indissociables. Rien ne distinguait l’architecte de l’ingénieur et la tâche du cordonnier était de faire de belles chaussures. Le problème est comparable pour ce que nous appelons la littérature: l’importante production de poésie scientifique correspond mal à la notion que nous en avons.
Lorsque nous parlons du passé, nous devons faire la distinction entre un langage-objet, celui des textes que nous étudions et un métalangage, le nôtre, que nous avons la responsabilité de rendre cohérent, pour désigner par les mêmes mots les choses comparables à travers le temps. Se contenter du langage-objet en disant que l’art n’existait pas de l’Antiquité à la Renaissance comprise ne fait pas que heurter le sens commun, mais interdit de comprendre quoi que ce soit. Dans ce cas, on pourrait aussi dire que le soleil tournait alors autour de la terre. En plus, comment dire que l’art et la technique étaient indissociables en utilisant le même mot, technê ou ars, pour désigner les deux? Mais dès lors, nous sommes responsables d’une définition cohérente de l’art, ce qui nous mène directement à un dilemme.
Spontanément, on est tenté de dire que l’œuvre d’art se définit par sa valeur esthétique et donc que l’art est la capacité de produire le beau. Or, depuis le siècle dernier, la référence au beau s’est éclipsée du discours sur l' » art » contemporain et du discours contemporain sur l’art. Même l’histoire des arts du passé n’utilise pratiquement plus la notion, sauf au second degré en parlant de la réception des œuvres comme belles ou laides. Cette référence serait intempestive. Alors, faut-il s’en passer et définir l’art comme ce que font les artistes? C’est certainement la solution à la mode. Les épistémologues tendent en effet de plus en plus à définir la science comme ce que font les scientifiques. Mais alors, il faudrait pouvoir définir l’artiste ou le scientifique, ce qui ne serait pas plus facile. Faute de cela, tout point de vue véritablement critique disparaît et tant l’esthétique que l’épistémologie mène la politique du chien crevé au fil de l’eau. Du reste, c’est peut-être bien ce qu’on leur demande de faire. Faut-il donc revenir au point de vue spontané? On objectera sans doute qu’on risque ainsi d’exclure l’art contemporain de notre définition de l’art. Mais ce serait faire un mauvais procès. Il appartient en effet à ceux qui se veulent artistes de savoir si leurs œuvres obéissent ou non à la même définition que celles des Anciens, dont le caractère artistique n’est guère contesté. S’ils s’y refusent, ils proclament ou bien la mort de l’art, ou bien sa naissance récente. On objectera encore qu’au-delà de la référence au beau, il peut y avoir d’autres dénominateurs communs entre les deux catégories. Mais alors, il faudra en trouver un qui les recouvre toutes deux et rien qu’elles, sans quoi il ne s’agirait pas d’une définition de l’art.
On objectera enfin que cela suppose de définir le beau et donc qu’il n’y a pas grande différence entre substituer la définition de l’artiste à celle de l’art et lui substituer celle du beau. Mais il y en a une d’essentielle. L’art et l’artiste sont deux notions solidaires, car il n’y a ni art sans artiste ni artiste sans art, alors que le beau ne saurait se limiter aux productions artistiques. Pour autant qu’il soit permis de dire que quelque chose est beau, cela se dit aussi bien d’une personne ou d’un coucher de soleil que d’un tableau. Le problème est donc de savoir si c’est légitime ou s’il s’agit d’une confusion, car il est possible que ce que nous appelons un beau coucher de soleil ne soit rien d’autre qu’un coucher de soleil ressemblant à ceux des peintres. C’est donc la définition du beau qui va nous occuper dans une première partie. Une fois que nous en aurons proposé une, il sera possible de définir l’art par rapport au beau sans nous enfermer dans un raisonnement circulaire. La seconde partie sera consacrée à l’évolution du système artistique et donc de la définition de l’art, pour en arriver à la situation d’aujourd’hui, où le beau en a été évacué. Il faudra enfin essayer de saisir la manière dont nous appréhendons les arts du passé.
![]()
Le beau
Trois types d’objets peuvent être qualifiés de beaux. On parle de beau naturel pour ceux qui ne sont pas dus à la main de l’homme. Cela correspond à l’ancienne acception du mot « nature », censé désigner plus ou moins la création divine. Au beau naturel s’oppose le beau artistique, celui d’œuvres humaines qu’on peut diviser en mimétiques et abstraites. Les œuvres mimétiques sont celles qui imitent l’aspect d’objets naturels ou d’œuvres humaines. On qualifiera d’abstraites les œuvres humaines non-mimétiques, comme le sont normalement l’architecture (abstraction faite de son décor figuratif) et la musique. Il existe bien sûr des exceptions, comme la musique imitative.
Les trois formes du beau
Le beau naturel est le parent pauvre de l’esthétique depuis Hegel. Il suffit de voir la manière dont il s’en débarrasse pour s’en convaincre. La réflexion des scolastiques sur le beau, ce que nous appelons leur « esthétique » mais qui ne formait pas une spécialité, était au contraire centrée sur le beau naturel et n’abordait que très rarement le beau artistique. La différence de conception s’explique facilement. Les scolastiques, faisant de la nature l’œuvre de Dieu, la donnaient en modèle de perfection, tandis que Hegel assimilait le beau à un produit de l’esprit et de sa liberté qui transcenderait une nature mécanique. Nous verrons que les principaux problèmes de l’esthétique se posent déjà en fait au niveau du beau naturel. La réticence à l’aborder pourrait bien tenir aux intérêts primaires qu’il met en jeu directement, comme ceux qui sont liés à la sexualité, alors que la représentation met une distance entre le spectateur et l’objet: dans un salon, la présence d’un nu féminin ne fait pas le même effet que celle d’une femme nue. La meilleure manière de déjouer le puritanisme de l’esthétique est de prendre autant en considération les intérêts les plus primaires que les autres.
Le beau naturel
Nous parlons du beau naturel comme de ce que les hommes trouvent beau dans les objets qu’ils n’ont pas façonnés. A supposer que cette beauté soit objective, ce ne serait pas au sens où elle serait belle indépendamment d’un point de vue humain, mais où elle serait reconnue ou devrait l’être par l’humanité entière. Qu’il s’agisse du beau naturel ou artistique, il est aujourd’hui plus à la mode d’insister sur les variations du goût que sur les constantes et même de nier qu’il y ait quelque constante que ce soit. Il semble cependant possible pour un esprit non prévenu de dégager prudemment quelques formes universelles ou presque du comportement esthétique, ce qui ne nous empêchera pas de relever des variations non moins évidentes, voir des déviations.
La beauté est liée à l’intégrité physique et donc à la santé, à la force et à la jeunesse. On parle bien d’un beau vieillard, mais il s’agit alors d’un vieillard en bonne santé. Le choix n’est pas moins sélectif pour les animaux ou les plantes. Des peintures pariétales de la préhistoire aux remarques sur les animaux de Karl Rosenkranz[1], disciple de Hegel, la préférence porte sur les animaux puissants et agiles, aux dépens des batraciens et des insectes par exemple. Il s’agit souvent d’animaux dangereux, mais pratiquement jamais de petits animaux nuisibles, gluants ou noirâtres. Le goût des fleurs fanées serait assez paradoxal.
La durabilité, sous la forme de la permanence ou du renouvellement semble également entrer dans les catégories esthétiques. On ne peut expliquer l’attrait de l’or par son prix, largement dû à cet attrait. Il ne répond qu’accessoirement à des besoins pratiques, mais il est inaltérable. L’amour des fleurs semble à peu près universel, alors qu’elles n’ont pas d’intérêt pratique dans un vase et sont éphémères. En revanche, elles conviennent à un usage momentané et on peut les renouveler régulièrement.
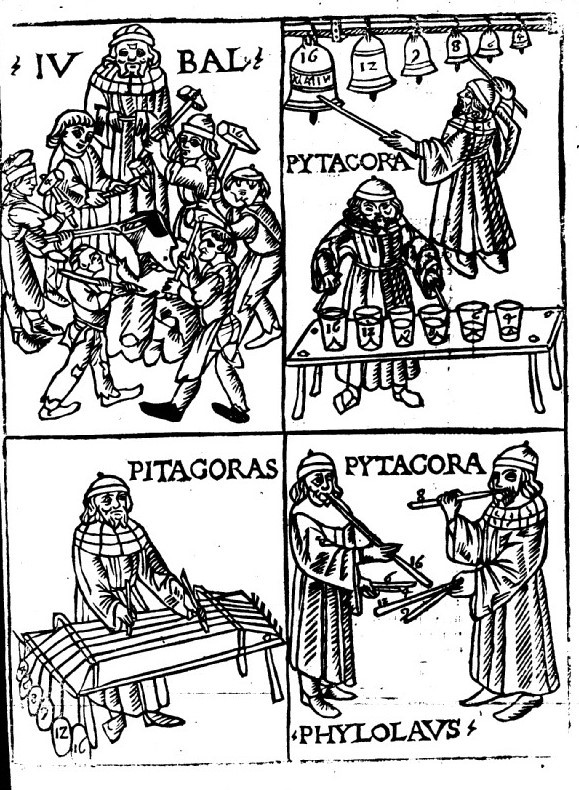 Les conceptions de l’harmonie sont très variables, car les différentes musiques divisent l’octave différemment, mais les fondements de l’harmonie sont universels, ainsi la satisfaction provoquée par les consonances, riches en harmoniques. Nous distinguons un son d’un bruit, y compris face aux musiques les plus exotiques et jugeons les chants de différents oiseaux comme plus ou moins harmonieux. En général, nous préférons le chant du rossignol au croassement du corbeau. Il en va de même pour les rythmes et les intensités sonores: le bruit léger et régulier d’un ruisseau est plus agréable que des claquements soudains et imprévisibles.
Les conceptions de l’harmonie sont très variables, car les différentes musiques divisent l’octave différemment, mais les fondements de l’harmonie sont universels, ainsi la satisfaction provoquée par les consonances, riches en harmoniques. Nous distinguons un son d’un bruit, y compris face aux musiques les plus exotiques et jugeons les chants de différents oiseaux comme plus ou moins harmonieux. En général, nous préférons le chant du rossignol au croassement du corbeau. Il en va de même pour les rythmes et les intensités sonores: le bruit léger et régulier d’un ruisseau est plus agréable que des claquements soudains et imprévisibles.
Ce qui est vrai du son l’est certainement des proportions en général. Il est normal que les plus simples soient jugées les plus harmonieuses, comme la répétition d’une unité, la symétrie, la succession de grandeurs croissantes ou décroissantes, des dispositions dont la nature donne suffisamment l’exemple et qui satisfont chez l’homme un besoin d’ordre et de mesure.
Cette énumération des quasi-constantes du sentiment esthétique est certainement bien incomplète, mais suffisante pour en baliser les limites. C’est ainsi que l’idéal du corps connaît des variations importantes, quant à l’embonpoint par exemple. On constante aisément que d’une société à l’autre, les normes peuvent varier de la sveltesse à l’obésité. Alors que l’iconographie médiévale stigmatise les gros (on les rencontre essentiellement dans les enfers, suppliciés par les diables), le XVIe siècle fait plus que les tolérer.  A regarder les portraits, le ventre est devenu indispensable, au point que la mode invente le ventre d’oie, un pourpoint facile à rembourrer, pour les hommes qui ne parviennent pas à grossir. De Titien à Rubens et au-delà, le canon féminin est aussi éloigné de la diététique médiévale que de la nôtre. Mais le gavage des femmes dans certains pays d’Afrique centrale va aujourd’hui bien plus loin dans la même tendance.
A regarder les portraits, le ventre est devenu indispensable, au point que la mode invente le ventre d’oie, un pourpoint facile à rembourrer, pour les hommes qui ne parviennent pas à grossir. De Titien à Rubens et au-delà, le canon féminin est aussi éloigné de la diététique médiévale que de la nôtre. Mais le gavage des femmes dans certains pays d’Afrique centrale va aujourd’hui bien plus loin dans la même tendance.
Beaucoup de déviations semblent reposer sur un jeu avec la norme, proche de la transgression. Il en va ainsi du pourri dans la nourriture, normalement écarté, et pourtant présent avec certaines limites dans des mets spécifiques de nombreuses cuisines, ainsi en Occident le fromage ou le gibier faisandé. La recherche du piquant, comme on disait au XVIIIe siècle, est une composante fréquente de l’érotisme. Là aussi, il s’agit d’une déviation mesurée de la norme. Lorsque la blonde est supposée plus belle que la brune, cette dernière à l’avantage d’être supposée piquante, ainsi dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, pour ne rien dire de l’ambivalence prêtée aux rousses. Alors que les musulmans sont regardés avec méfiance sinon avec hostilité dans la France d’aujourd’hui, les grosses barbes noires sont venues à la mode. Si le bruit s’oppose à la musique, il n’en reste pas moins que la musique l’utilise, plus ou moins apprivoisé, comme en témoignent les percussions ou certains effets échappant à l’harmonie, comme le glissando, et virtuellement tous les procédés possibles dans la musique imitative.
Le XVIIIe siècle s’est passionné pour une négation de l’ordre et de la mesure qu’il désigne comme le sublime, non plus la connivence entre l’organisation du monde naturel et l’esprit humain, mais ce qui défie l’entendement, les grandeurs disproportionnées ou jugées telles, les forces déchaînées et ainsi de suite. Dans la Critique du Jugement d’Emmanuel Kant, il y a là quelque chose qui va au-delà du beau.
Chacune de ces variations du sentiment esthétique est explicable. Le surpoids peut devenir un élément de statut, une manière de montrer qu’on dispose d’un excédent de richesse. Le pourri élargit la gamme culinaire à des saveurs nouvelles. Les problèmes de Rousseau avec les blondes célestes et les brunes piquantes se clarifient lorsqu’on sait qu’il ne parvient pas à demander à celles qu’il aime la petite fessée coquine qu’il demande aux autres. Les modes s’inspirent souvent, à divers époques, du vêtement des groupes sociaux réprouvés. Le sublime kantien procède d’une volonté de trouver la transcendance dans la nature sauvage et de sortir ainsi de l’anthropomorphisme chrétien, fondé sur le dogme de l’Incarnation.
Il n’en reste pas moins que, déjà au niveau du beau naturel, les extravagances du goût peuvent faire supposer qu’on peut considérer comme beau tout et son contraire. Kant veut échapper à ce dilemme par la distinction entre le beau et l’agréable: contrairement au beau, l’agréable dépend des déterminations de chacun. Mais il n’est pas facile de le suivre, car cela conduirait à rejeter dans l’agréable des faits esthétiques fondamentaux. Le seul exemple du sublime suffit à le montrer. En effet, il est trop terrifiant pour qu’on le rejette dans l’agréable, alors qu’il s’oppose aux normes les plus universelles du beau, à commencer par l’ordre et la mesure. Et il faudrait valider des choix métaphysiques et même religieux pour s’en tirer à l’aide de la transcendance. Il est donc clair que les problèmes fondamentaux de l’esthétique se posent déjà au niveau du beau naturel.
Le beau artistique abstrait
A lire les Anciens, il n’existe pas de beau artistique abstrait: tous les arts sont plus ou moins mimétiques. L’architecte imite la nature, les colonnes ressemblant à des troncs d’arbres, tandis que la musique humaine imite celle des sphères ou les passions. Plus généralement, l’ordre réel ou supposé de la nature sert de guide à l’artiste. En fait, la notion d’imitation de la nature était très large, sans doute trop, car elle englobait des démarches très différentes. Que les maisons protègent de la pluie comme les cavernes est un fait: il n’en reste pas moins qu’une maison n’est pas l’imitation d’une caverne au sens où la statue de Louis XIV est l’imitation des traits de Louis XIV. Albert le Grand nous déconcerte lorsqu’il affirme que la nature procède comme le peintre, dessinant les choses avant d’y placer les couleurs[2]. Mais il est vrai aussi que les distinctions que nous sommes amenés à faire découpent un continuum: il n’est pas possible de dire où s’arrête l’imitation et où commence l’abstraction. Si des dispositions telles que la symétrie sont fréquentes dans la nature, les considérer comme mimétique dans une œuvre, c’est nier l’existence de l’abstraction. La meilleure solution consiste probablement à considérer comme abstraite toute œuvre qui n’est pas l’image d’un objet du monde extérieur, réel ou fictif. Bien entendu, il peut s’agir d’un objet physique imaginaire, tel qu’un ange, mais aussi d’un objet sonore, tel qu’un chant d’oiseau par exemple. Il ne s’agit pas d’ignorer le continuum, car l’ornemental est souvent à moitié mimétique.  C’est ainsi qu’une frise de volutes d’origine grecque, les postes, peut être pensée comme un motif géométrique ou comme la représentation de vagues. Cela dit, le chaud et le froid forment également un continuum et, de même qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le chaud ou le froid absolu pour constater que le chaud fait transpirer et le froid greloter, il n’y a aucune raison de ne pas faire état des propriétés de l’abstraction et de la mimésis. Nous verrons en conclusion de cette première partie que l’idée de l’art comme imitation de la nature au sens large est finalement fondée. En ce sens, on pourrait dire que l’abstraction n’existe pas, mais, en définissant cette dernière comme l’absence d’imitation d’objets déterminés, réels ou imaginaires, on évite toute confusion.
C’est ainsi qu’une frise de volutes d’origine grecque, les postes, peut être pensée comme un motif géométrique ou comme la représentation de vagues. Cela dit, le chaud et le froid forment également un continuum et, de même qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le chaud ou le froid absolu pour constater que le chaud fait transpirer et le froid greloter, il n’y a aucune raison de ne pas faire état des propriétés de l’abstraction et de la mimésis. Nous verrons en conclusion de cette première partie que l’idée de l’art comme imitation de la nature au sens large est finalement fondée. En ce sens, on pourrait dire que l’abstraction n’existe pas, mais, en définissant cette dernière comme l’absence d’imitation d’objets déterminés, réels ou imaginaires, on évite toute confusion.
Qu’on parle de la musique ou du décor ornemental, l’abstraction réduit l’œuvre à ses propriétés formelles de rigueur ou de fantaisie, de simplicité ou de complexité, de répétition ou de variété, et ainsi de suite. La disposition formelle en musique se nomme harmonie, mais le mot se dit aussi métaphoriquement de n’importe quel type d’œuvre, avec raison parce qu’on y retrouve facilement le même problème clairement exposé par saint Augustin dans son De musica: le beau suppose la présence contradictoire de l’unité et de la diversité. La répétition des mêmes motifs satisfait notre sens de l’ordre, mais elle est insupportable sans les variations qui les renouvellent. Nous préférons à l’évidence les accords consonants, mais ils seraient incurablement lassants et inexpressifs sans le voisinage des accords dissonants, permettant des alternances de tension et de repos. Songeons à ce que serait la répétition d’un ornement quelconque, une grecque par exemple, tapissant toute la surface d’un mur.
On retrouve le même paradoxe en matière de couleurs. Les scolastiques prenaient l’exemple du noir qu’ils considéraient comme laid en soi, mais qui embellit les peintures en faisant ressortir les autres couleurs. On pense bien sûr à ce propos à l’heureux effet que produisent les plombs des vitraux. Une gamme colorée n’incluant que les couleurs pures est à la fois criarde et ennuyeuse. Mais le choix des couleurs est proverbial de la subjectivité: « des goûts, des couleurs ». Comme la dose de dissonances dans la musique, comme la variété du décor ornemental, il dépend non seulement du goût personnel de chacun, mais de celui de chaque culture et souvent de chaque génération. Et pourtant, un habile dosage de ces éléments est un trait général de la production artistique. Cela conduit à la même conclusion que pour le beau naturel: pour le beau abstrait aussi, il est difficile de trancher entre objectivité et subjectivité.
Le beau mimétique
La mimésis présente la forme la plus complexe du beau. L’image emprunte jusqu’à un certain point les propriétés des objets représentés, tout en présentant des propriétés formelles qui n’appartiennent pas à ces objets et peuvent être qualifiées d’abstraites. Elle se situe donc entre les deux pôles de l’identité avec l’objet représenté et de l’abstraction.
Le besoin d’imiter, par la peinture, la sculpture, le théâtre, la danse ou virtuellement n’importe quel art le monde qui nous entoure est universel. On peut parler d’images dans tous les cas, quoiqu’on nomme plus souvent ainsi les représentations peintes et sculptées (du moins jusqu’au XXe siècle où le mot ne se dit plus guère que des représentations bidimensionnelles)[3]. Les pratiques d’imitation et l’importance qu’elles prennent varient considérablement d’une société à l’autre. Elles peuvent être limitées par un intérêt plus grand pour la parure du corps: dans bien des sociétés, la peinture corporelle est plus développée que la représentation du corps. Dans les pays musulmans, le décor des monuments et des objets est abstrait ou emprunté à l’écriture, alors que les églises médiévales et les temples hindous sont des supports de l’image. En outre, le degré de fidélité de la figuration est non moins variable, parfois à l’intérieur d’une même culture. Dans l’art pariétal préhistorique, les grands animaux sont représentés de manière fortement suggestive, alors que les rares représentations humaines sont schématiques.
Il faut d’emblée faire une distinction entre les limites et les restrictions volontaires de la mimésis, quoiqu’elles puissent coïncider dans bien des cas: la capacité de figurer des objets demande un apprentissage qui n’a pas lieu lorsqu’il n’y a pas de raison de s’y livrer. La ressemblance perceptive, celle qui donne l’illusion de la réalité de l’objet, est loin d’être toujours le but et il y a de nombreux cas où son absence n’est pas due à un interdit. Le plus parlant pour nous est certainement le dessin technique. Ni un plan, ni une élévation au géométral ne ressemble à un édifice tel que nous le percevons, mais l’un et l’autre apportent une connaissance précise de ses dimensions et de ses proportions qu’on ne saurait attendre d’un dessin illusionniste. Dans les deux cas, la réduction de l’objet au plan, le fait de renoncer à en présenter la troisième dimension, permet de lire correctement les deux autres. Mais il est aussi possible, sans perte d’information, de présenter les trois dimensions en superposant deux axes de vision, comme on le fait dans les épures où plan et élévation sont dessinés l’un sur l’autre.
 En étant conscient de l’intérêt de ces pratiques, on comprend mieux la peinture de l’Egypte ancienne. Elle renonce au point de vue unique du spectateur pour représenter les différentes parties du corps dans l’axe jugé le plus favorable, de sorte que le tronc est vu de face et les membres, tête comprise, de profil. On trouve le même procédé dans la peinture préhistorique, lorsque les cornes des bovidés sont présentées de face sur une tête de profil, au lieu que leur superposition en cacherait une. Le choix de peindre sur un plan est loin d’être universel, comme le montrent les peintures préhistoriques sur le support accidenté des parois d’une caverne et à plus forte raison la sculpture polychrome, mais la peinture sur support plan et plus encore le dessin sont aussi des réductions des possibilités expressives visant souvent un gain de clarté.
En étant conscient de l’intérêt de ces pratiques, on comprend mieux la peinture de l’Egypte ancienne. Elle renonce au point de vue unique du spectateur pour représenter les différentes parties du corps dans l’axe jugé le plus favorable, de sorte que le tronc est vu de face et les membres, tête comprise, de profil. On trouve le même procédé dans la peinture préhistorique, lorsque les cornes des bovidés sont présentées de face sur une tête de profil, au lieu que leur superposition en cacherait une. Le choix de peindre sur un plan est loin d’être universel, comme le montrent les peintures préhistoriques sur le support accidenté des parois d’une caverne et à plus forte raison la sculpture polychrome, mais la peinture sur support plan et plus encore le dessin sont aussi des réductions des possibilités expressives visant souvent un gain de clarté.
Il y a bien sûr les limites matérielles. Le nomadisme exclut les œuvres massives et peu transportables; il rend difficile de dédoubler le corps humain par des statues de pierre. Les peuples des steppes cultivent donc la parure du corps, en particulier les bijoux.
Il y a enfin les restrictions que les sociétés s’imposent. Elles peuvent être liées à des causes matérielles: le refus des images dans le protestantisme est indissociable d’une lutte contre les pratiques somptuaires. Ses causes peuvent aussi être imaginaires. La Bible assimile le nomadisme au bon comportement religieux dans une population devenue sédentaire. Son dieu agrée l’offrande du berger Abel et rejette celle de l’agriculteur Caïn. Le Temple se présente donc comme un campement nomade: le Tabernacle est supposé une tente contenant comme objet de culte un coffre transportable, l’Arche d’alliance. Le refus protestant des images se prétend une simple application de l’interdit biblique.
La mimésis est souvent considérée comme mensongère et immorale: les images ne sont pas ce pour quoi elles se donnent; elles sont muettes et représentent des faux dieux; le théâtre et le roman pervertissent les mœurs. Dans la Bible, le culte des images est une prostitution, liée à la fréquentation des femmes étrangères comme dans le cas de Salomon; s’y livrer, c’est tromper un dieu jaloux. Les images peuvent aussi, comme chez les Grecs, tromper sur la nature des vrais dieux et les présenter comme d’infâmes libertins. Quel que soit leur bienfondé, ces reproches mettent en évidence une raison essentielle de la pulsion mimétique: en reproduisant le monde, l’homme n’est pas neutre, mais le façonne comme il lui convient. Le choix même des objets représentés se porte sur ceux qu’il en juge dignes, par exemple les souverains. Ils ont plus de chance d’être représentés tels qu’ils devraient être plutôt que tels qu’ils sont. C’est ainsi que les statues du pharaon Hatshepsout qui est une femme la présentent comme un homme et les portraits tendent généralement à embellir leurs modèles. Enfin, les êtres imaginaires, comme les dieux, prennent une réalité concrète et manipulable, qu’il s’agisse de la manière de les représenter ou de la manière d’agir envers leur image.
Plus les images sont centrées sur la figure humaine, plus elles se prêtent à ces manipulations, telles que l’envoûtement, la damnatio memoriae, la maltraitance de l’image du dieu et enfin l’iconoclasme lui-même. Le dogme de l’Incarnation a rendu l’art chrétien aussi anthropomorphique que ses précédents antiques dans l’art méditerranéen, à l’inverse du judaïsme et de l’islam. Aussi a-t-il connu deux grandes vagues d’iconoclasme, celle de Byzance, puis celle de la Réforme. Dans les deux cas, il s’en est suivi un changement iconographique. Les empereurs iconoclastes de Byzance ont décoré leurs palais de sujets profanes, comme des scènes de chasse. A l’époque de la Réforme, la méfiance envers l’image a fait naître des paysages où la figure humaine est devenue minuscule et secondaire, puis a souvent totalement disparu. Progressivement, une religiosité qui n’était plus centrée sur l’Incarnation a cherché Dieu dans la nature étrangère à l’homme, jugée sublime. Il est significatif que Kant ait expressément qualifié de sublime l’interdiction des images dans le décalogue, la considérant comme une injonction théiste à chercher Dieu hors de l’humain.
La beauté de l’image est un problème complexe, parce qu’elle a deux sources distinctes, celle de l’objet représenté et celle de la manière de le représenter. S’il est aujourd’hui considéré comme une manifestation d’inculture de trouver belle l’image d’un bel objet, il n’en a pas toujours été ainsi. La représentation du laid posait problème tant qu’il y avait en art un concept du beau. Ce fut bien sûr le cas avec la querelle du Réalisme au XIXe siècle et c’est justement à ce propos que Rosenkranz écrivit son Esthétique du laid. Mais le problème se posait déjà au Moyen Age, lorsque saint Bernard parlait avec indignation de « beauté difforme et belle difformité » (deformis formositas ac formosa difformitas) à propos du décor exotique et monstrueux des chapiteaux romans[4]. Saint Bonaventure remarquait qu’on dit belle l’image bien dessinée d’un diable qui est laid[5]. L’argument le plus fréquent en faveur de la représentation du laid était à l’époque gothique, comme pour la couleur noir, sa place dans un ensemble[6]. Ce qui est laid en soi appartient à la Création qui est belle prise comme un tout. On retrouve ainsi au niveau des objets représentés l’équivalent du problème de l’harmonie qui serait fade sans la dissonance.
Il est certainement significatif que cet argument n’apparaisse pas encore à l’époque romane où le problème est plus profond. Les sculpteurs romans sont généralement bien plus habiles dans la représentation des animaux fantastiques ou de l’ornemental que dans celle du corps humain, dont les membres disproportionnés ont tendance à s’articuler en zigzags dépourvus d’organicité et de grâce. Il faut y voir l’expression d’un mépris du corps, lié à l’ambiance de la réforme grégorienne, qui disparaît progressivement au cours du XIIe siècle, faisant progressivement place à une esthétique sereine. En somme, la subordination des normes esthétiques à d’autres, religieuses ou morales, entraîne l’ambivalence du beau et du laid. Cela vaut aussi au niveau du choix des sujets. On pense à la centralité du crucifix dans le christianisme, la représentation d’un supplice ignoble. Au niveau de la forme comme du choix des sujets, la critique sociale du Réalisme et, bien plus encore, celle de l’Expressionnisme entraînent également une esthétique paradoxale. Ce rapide examen du beau mimétique oblige à conclure que sa définition cumule les difficultés de celle du beau naturel et de celle du beau abstrait.
Le plaisir esthétique
A lire les traités d’esthétique, on se demande parfois s’ils ont été écrits par de purs esprits dans l’oubli ou même le refus du corps. Proclamer comme le fait Kant la gratuité du jugement de goût peut répondre à ce qu’il ressent en contemplant un coucher de soleil ou les qualités formelles d’un tableau dont le sujet ne l’intéresse pas, mais on s’est souvent demandé comment le philosophe appliquait son pur jugement de goût à un nu féminin.
Esthétique et refus du corps
A première vue, la musique est un art assez abstrait, mais il suffit d’en constater les effets pour comprendre qu’elle concerne le corps avant même l’esprit. Le plaisir que donne une mélodie pousse à chanter à son tour et un rythme de danse nous entraîne par compulsion.
Kant doit l’éprouver et cela lui pose problème, car il rejette la musique hors des beaux-arts, en lui comparant la plaisanterie « qui, tout comme la musique, mérite d’être considérée comme un art agréable plutôt que d’être comptée parmi les beaux-arts »[7]. Il y a peut-être des causes contingentes à ce jugement aberrant, ce que semble avouer une note de la page précédente: « Ceux qui ont recommandé le chant de cantiques même pour les cultes domestiques n’ont pas songé à la grave incommodité qu’ils causaient au public par un culte aussi bruyant (et, par là même, bien souvent, pharisaïque), en contraignant le voisinage à se joindre aux chants ou à interrompre ses activités intellectuelles ». Il aurait peut-être changé d’avis si ses voisins avaient été des musiciens plus raffinés, mais ce n’est pas sûr. Bien que cela ne justifiât pas la condamnation de la musique, Kant a mis l’accent sur un fait incontestable: la musique n’est que du bruit lorsqu’elle n’est pas désirée. La contrainte physiologique qu’elle exerce en devient désagréable.
Mais est-ce une particularité de la musique? Kant remarque avec raison qu’on peut s’abstraire d’un spectacle désagréable en détournant les yeux alors qu’on est impuissant devant une musique désagréable. Mais il ne voit pas qu’il ne s’agit là que d’une différence de degrés: qui accrocherait un tableau qu’il déteste dans son séjour? 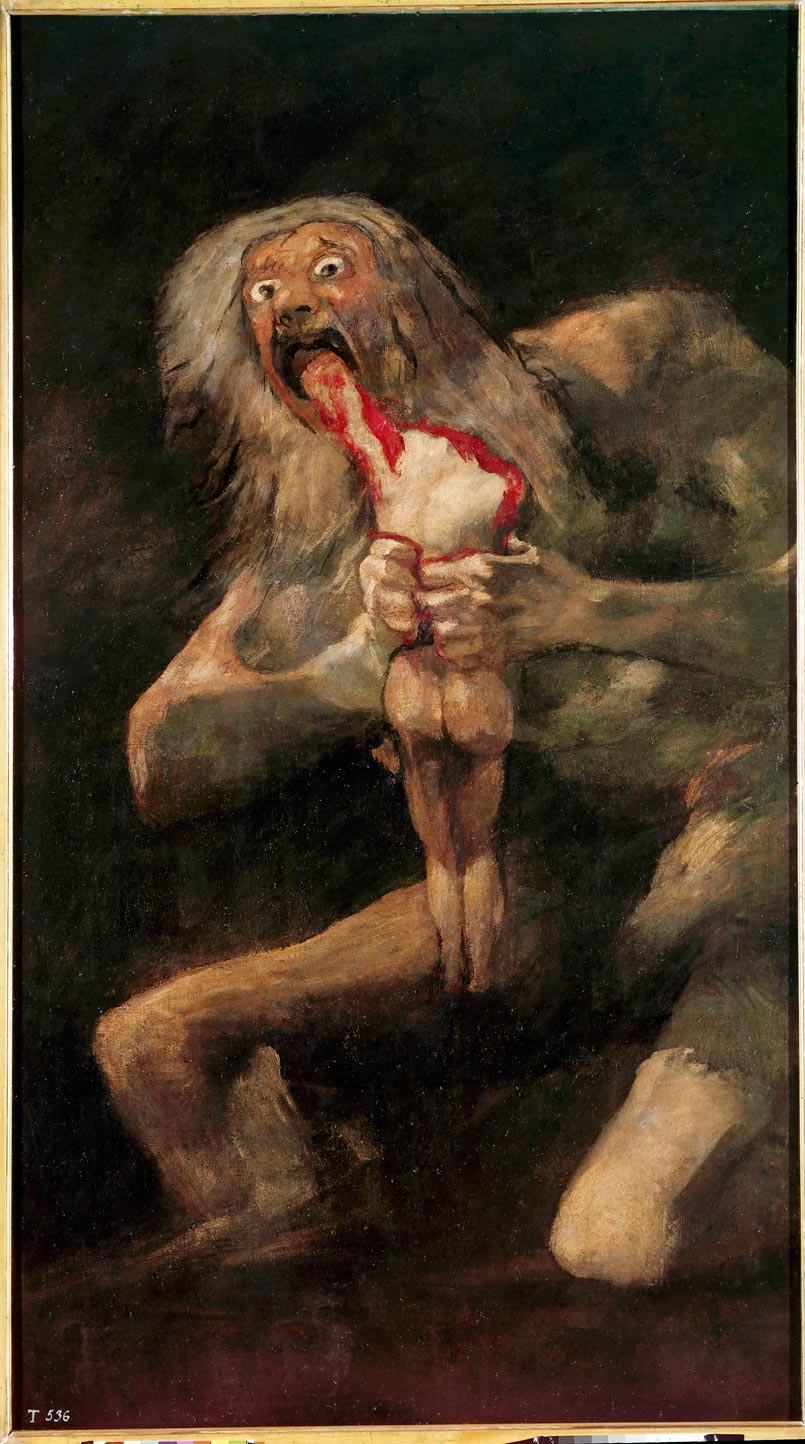 Goya avait peint Saturne dévorant son enfant (aujourd’hui transposé sur toile, Madrid, Prado) sur le mur de sa salle à manger et on raconte qu’il s’agissait de couper l’appétit à ses hôtes, lui-même tournant le dos à son œuvre.
Goya avait peint Saturne dévorant son enfant (aujourd’hui transposé sur toile, Madrid, Prado) sur le mur de sa salle à manger et on raconte qu’il s’agissait de couper l’appétit à ses hôtes, lui-même tournant le dos à son œuvre.
Comment en arriver à comparer la musique et la plaisanterie? La longue Remarque qui clôt le paragraphe 53, où la musique est exclue des beaux-arts, développe la distinction entre ce qui plait dans le jugement et ce qui fait plaisir, c’est-à-dire ce qui plait dans la sensation. Le rire y est expliqué comme une détente suivant une tension, avec un effet compulsif sur le corps qu’on retrouve dans la musique. Il s’agit donc de sensations agréables qui ne font pas intervenir la raison et le jugement: Kant exclut donc des beaux-arts, non seulement la musique, mais encore le comique.
Beau et agréable
La forme la plus primaire du sentiment esthétique est certainement le plaisir des sens, relatif à la nourriture et au sexe, ce qui pose immédiatement, non seulement le problème du beau et de l’agréable, mais aussi celui du beau et du bon. Comme l’ont remarqué les scholastiques, la qualité gustative se juge sur l’échelle du bon et du mauvais et non sur celle du beau et du laid, tout comme les odeurs, et on ne parle pas en termes esthétiques des qualités relevant du toucher: c’est doux ou rugueux et non pas beau ou laid. Pour saint Thomas d’Aquin, le bien comble l’appétit de l’homme par la possession, le beau par la connaissance, car il plaît par son seul aspect[8]. D’où le primat de la vue et de l’ouïe, propres à la contemplation[9]. Mais il ne s’agit que d’une distinction de raison face à un même objet: ce qui est bon est forcément beau et ce qui est beau et forcément bon. Cela l’amène à reconnaître une capacité esthétique aux sens inférieurs10 et à remplacer l’opposition des sens supérieurs et inférieurs par une gradation, en donnant des exemples tels que le goûter du vin.
On chercherait donc vainement dans la pensée médiévale une distinction entre le beau et l’agréable telle que ce qui est agréable puisse ne pas être beau et inversement. Les termes que nous pourrions traduire par « agréable », tels que dulcis, suavis ou jucundus, sont aussi bien utilisés pour la béatitude céleste que pour les jouissances de ce monde. Comme on l’a vu, la question de la représentation du laid s’était posée, mais elle se résolvait dans la beauté du tout où une figure laide comme celle du diable rehaussait celle des autres. Le Moyen Age refusait donc d’imaginer une contemplation désintéressée de l’objet, de séparer le jugement esthétique de l’appétition.
Aristote avait pourtant posé le problème et proposé une solution: « des êtres dont l’original fait peine à la vue, nous aimons en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude; par exemple les formes des animaux les plus vils et des cadavres »[10]. La raison en est selon lui le plaisir qu’ont naturellement les hommes depuis l’enfance à imiter et à voir imiter. Et ce plaisir est aussi lié depuis l’enfance à celui d’apprendre.
Quelques pages plus loin, il traite du problème assez comparable de la catharsis. La tragédie inspire par son sujet et par sa mise en œuvre un plaisir paradoxalement lié à la peur et à la pitié, car il « purge » ces émotions[11]. Les explications douteuses du phénomène ne manquent pas. On fait état de la mise en forme esthétique qui atténue l’émotion. Il est bien vrai que la littérature ou la peinture représenteront un massacre avec plus d’art que ne le fait une vidéo d’amateur. Mais je ne peux pas à la fois jouir de la forme artistique et l’oublier pour m’absorber dans le contenu. Ou bien je contemple les effets de clair-obscur, ou bien je vois couler le sang. Le réformateur pragois Jan Hus se plaignait des connaisseurs qui, face aux représentations de la Passion, admiraient la qualité des œuvres au lieu de s’apitoyer[12]. Dire que la représentation permet une perception au second degré n’est pas inexact, car on accepte l’image de beaucoup de choses dont on ne supporterait pas la vue, mais cela ne résout pas le problème: une émotion désagréable atténuée devrait rester une émotion désagréable et le plaisir qu’on peut en tirer tout aussi énigmatique. Enfin, opposer la fiction à la réalité ne vaut pas mieux, car la catharsis opère aussi bien à la lecture d’un ouvrage historique qu’à celle d’un roman.
Mais de quelle sorte de peur s’agit-il au théâtre? Il faut en distinguer deux sortes, celle que provoque une situation réelle et subie, laquelle est totalement déplaisante, et celle qu’on éprouve en jouant à se faire peur, où elle est recherchée, domestiquée et plaisante. Il s’agit alors de ce que Stendhal a appelé l’illusion imparfaite, car si l’illusion donnée par le spectacle est parfaite, c’est la catastrophe[13]. Pour faire la différence, il raconte une anecdote. Lorsqu’on jouait Othello au théâtre de Baltimore, un soldat en faction, voyant le protagoniste menacer Desdémone, ouvrit le feu en s’écriant « Il ne sera jamais dit qu’en ma présence un maudit nègre aura tué une femme blanche ». Il est évident, comme le montre Stendhal, que ce n’est pas le comportement normal du spectateur et que c’est bien l’illusion « imparfaite » que nous sommes supposés ressentir au théâtre.
La qualification de cette illusion comme imparfaite est équivoque et il y a peut-être une confusion de la part de Stendhal qui en parle à propos des limites de la vraisemblance au théâtre. Il vaudrait mieux parler d’illusion totale ou partielle, car les deux formes d’illusion sont possible même devant un simulacre totalement illusionniste, par exemple un animal empaillé animé par un moteur. Il suffit en effet que je sache qu’il s’agit d’un simulacre pour que l’illusion ne soit plus que partielle. La même différence existe entre le rêve que je subis et la rêverie que je dirige. Si l’animal empaillé est d’une espèce dangereuse et si l’illusion est totale, la peur éprouvée n’est pas cathartique, de même si le rêve est un cauchemar. Il n’y a pas d’effet cathartique dans un spectacle pour une personne trop sensible pour « jouer le jeu » et simplement révulsée par ce qu’elle voit. Au mieux, elle se détourne du spectacle; au pire, c’est le soldat de Baltimore.
Si Aristote souhaite l’habileté de la construction dramatique, il ne réduit pas la catharsis à un effet de l’art. Il admet que l’histoire mise en scène est suffisante pour la provoquer, mais trouve plus admirable de l’obtenir ou de la renforcer par une habile construction de l’intrigue. En effet, la catharsis peut se produire à la lecture d’un récit historique écrit sans talent ou à celle d’un fait divers dans le journal. Dans tous ces cas, il est possible de s’imaginer à la place des personnages et d’éprouver à travers eux des émotions nouvelles.
En fin de compte, la catharsis aristotélicienne ne contredit qu’en apparence la solidarité du beau et de l’agréable, pour autant que l’agréable ne soit pas confondu avec la forme anodine du beau. Saint Augustin y voyait un comportement paradoxal: les gens vont au théâtre pour pleurer « et la douleur même est leur plaisir » (Confessions, III, 2). En fait, il semble projeter sur eux la douceur des larmes qu’il se surprend d’avoir éprouvé après la mort d’un ami. Or il s’agissait là d’un deuil réel et non d’une fiction cathartique. Il fait un paradoxe de plus de la pitié éprouvée pour des malheureux imaginaires au lieu de prendre en considération l’aspect ludique de la catharsis que Stendhal avait bien perçu.
Le plaisir gratuit et désintéressé
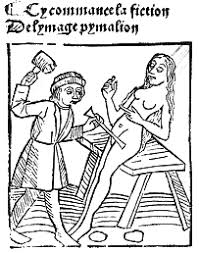 L’histoire du sculpteur Pygmalion qui tomba amoureux de sa propre statue, aurait voulu qu’elle soit vivante et fut exhaussé par Vénus qui l’anima, donne une bonne idée de l’esthétique antique et médiévale. Qu’on la lise dans les Métamorphoses d’Ovide ou dans la continuation du Roman de la Rose par Jean de Meun, elle témoigne au plus haut point d’une esthétique fondée sur le plaisir des sens[14]. Le comble du plaisir esthétique est la possession d’une femme parfaitement belle, car sculptée par le plus grand des artistes. Il serait difficile d’imaginer une conception du beau plus éloignée de l’esthétique kantienne. Selon Kant, en effet, « la satisfaction, qui détermine le jugement de goût, est pure de tout intérêt. La satisfaction se change en intérêt lorsque nous la lions à la représentation de l’existence d’un objet[15]. Dès lors aussi, elle se rapporte toujours à la faculté de désirer ou comme son motif, ou comme nécessairement unie à ce motif. Or quand il s’agit de savoir si une chose est belle, on ne cherche pas si soi-même ou si quelqu’un est ou peut être intéressé à l’existence de la chose, mais seulement comment on la juge dans une simple contemplation (intuition ou réflexion) ».
L’histoire du sculpteur Pygmalion qui tomba amoureux de sa propre statue, aurait voulu qu’elle soit vivante et fut exhaussé par Vénus qui l’anima, donne une bonne idée de l’esthétique antique et médiévale. Qu’on la lise dans les Métamorphoses d’Ovide ou dans la continuation du Roman de la Rose par Jean de Meun, elle témoigne au plus haut point d’une esthétique fondée sur le plaisir des sens[14]. Le comble du plaisir esthétique est la possession d’une femme parfaitement belle, car sculptée par le plus grand des artistes. Il serait difficile d’imaginer une conception du beau plus éloignée de l’esthétique kantienne. Selon Kant, en effet, « la satisfaction, qui détermine le jugement de goût, est pure de tout intérêt. La satisfaction se change en intérêt lorsque nous la lions à la représentation de l’existence d’un objet[15]. Dès lors aussi, elle se rapporte toujours à la faculté de désirer ou comme son motif, ou comme nécessairement unie à ce motif. Or quand il s’agit de savoir si une chose est belle, on ne cherche pas si soi-même ou si quelqu’un est ou peut être intéressé à l’existence de la chose, mais seulement comment on la juge dans une simple contemplation (intuition ou réflexion) ».
Pour les scolastiques, le beau plaît par son seul aspect sans même qu’on en ait la jouissance, mais cela ne signifie pas qu’il plaise indépendamment du désir de le posséder et donc de l’intérêt pour son existence. On pourrait objecter que la contradiction entre l’ancienne conception du beau et celle de Kant n’est pas aussi profonde qu’il semble. Kant ne dit pas que le jugement de goût ne peut pas cohabiter avec le désir de possession, mais qu’il en est distinct. Mais y aurait-il alors dans la tête de Pygmalion deux jugements distincts, l’un selon lequel la statue est belle indépendamment de son envie de l’épouser, l’autre selon lequel il a l’envie de l’épouser indépendamment de sa beauté?
L’objection conduisant à une absurdité, il faut se demander ce qui pousse Kant à séparer l’esthétique du désir. En fait, il s’agit pour lui de fonder l’universalité du jugement. Les hommes ayant des intérêts divers et divergents, les jugements motivés par ces intérêts le sont tout autant et, si le jugement esthétique en faisait partie, il ne pourrait plus prétendre à l’universalité. Il ne resterait plus qu’à dire: des goûts, des couleurs. Or les hommes ont des intérêts communs. Y aurait-il des peuples qui préfèrent la vieillesse et la maladie à la jeunesse et à la santé? Comme on l’a suggéré, aussi relatifs qu’ils soient, les universaux du beau s’enracinent dans l’universalité de certains intérêts, à commencer par la nourriture et la reproduction. Mais on peut se demander si Kant aurait pu mettre le beau en relation avec des intérêts si vulgaires.
On peut encore prendre le problème autrement. La thèse kantienne du plaisir gratuit et désintéressé repose sur la séparation entre la représentation qu’on a de l’objet et de l’existence de l’objet. Mais peut-il y avoir une représentation de l’objet qui ne comprenne pas celle de son existence? Est-il possible de regarder sans émotion le sexe ou la mort, dans la réalité ou en image, en faisant abstraction de nos réactions physiologiques? Ou alors, faut-il exclure l’érotique et le macabre des beaux-arts après la musique et le comique?
Si on admet au contraire l’enracinement physiologique de l’esthétique, un autre problème se pose: existe-t-il un plaisir esthétique gratuit ou désintéressé? On peut tout au plus le supposer dans certains cas, ainsi face à un coucher de soleil. Mais le problème est alors de savoir ce qu’on entend par « gratuit » ou « désintéressé ». Si on veut dire que ce plaisir ne répond pas à un besoin pratique ou à un intérêt financier, c’est entendu. Mais il peut être dû à un fort investissement idéologique, tel que la recherche rousseauiste du divin dans la nature, elle-même dirigée contre l’anthropocentrisme chrétien. Cela, Kant ne le voit pas, car il le vit au premier degré en assimilant le sublime au divin.
Le jugement du connaisseur
Dans l’histoire de Pygmalion, le jugement de goût est celui de deux personnes particulièrement compétentes, le sculpteur lui-même et la déesse de la beauté. Chez Kant, la compétence de celui qui l’exerce n’entre pas en ligne de compte, car le jugement ne porte pas sur le concept. Comme on l’a vu, Kant exclut la musique et le comique des beaux-arts parce qu’ils ont un effet compulsif sur le corps et ne parlent pas à la raison. Ce jugement est aberrant non seulement par la conception du beau qu’il implique, mais encore comme exemple caricatural de ce que je propose d’appeler le point de vue du consommateur. L’œuvre d’art n’est envisagée que du point de vue de son effet et, pire encore, de l’effet qu’elle produit sur le profane. Il va de soi que Mozart ou Haydn, pour en rester aux contemporains du philosophe, mettent en œuvre des formes musicales rationnelles dans des développements complexes, ce qui en fait plus que de charmantes mélodies. Du point de vue du compositeur, le jugement kantien est absurde, mais il l’est aussi du point de vue d’un auditeur suffisamment musicien pour percevoir la métamorphose des thèmes et la symétrie architecturale des développements dans une forme sonate. En exerçant sur la forme son jugement de goût, ce connaisseur ne se contente pas de se trémousser dans le rythme.
Le « pur jugement de goût » kantien apparaît ainsi comme vraiment trop pur: non seulement il exclut la musique des beaux-arts à cause de ses effets physiologiques, mais en plus il ne porte que sur le phénomène sans considération du concept. On se demande même en quoi il consiste. Il porterait en somme sur une impression subjective, mais en même temps dénuée de désir ou de répulsion. Il serait ainsi gratuit et désintéressé, mais en quel sens? Le désintéressement est une valeur morale qui peut s’appliquer à un acte charitable, mais on ne voit pas de rapport entre le jugement de goût et l’amour du prochain. Dès lors, ce jugement gratuit et désintéressé ressemble plutôt à l’acte gratuit, celui qui n’aurait aucune détermination et aucun but. Et il est très possible que la contemplation des couchers de soleil en était un bon exemple aux yeux de Kant.
Pour en rester aux couchers de soleil, il serait intéressant de savoir ce qu’ils suscitent chez un météorologue ou un astronome par exemple. L’un et l’autre ont une connaissance du phénomène supérieure à celle du commun des mortels, ce qui ne les empêche certainement pas de le trouver beau. En revanche, leur connaissance du phénomène a toutes les chances de leur permettre de voir et de comprendre plus de choses, d’être sensibles à des aspects qui nous échappent. S’il y a contemplation esthétique, elle portera donc sur un objet dont la complexité est mieux perçue, tout comme le musicien et le musicologue apercevront dans une symphonie des beautés dont d’autres ne soupçonnent pas l’existence.
La dissociation entre le jugement esthétique et la connaissance des objets est aujourd’hui courante. On entend parfois dire que la connaissance de la musique peut réduire la jouissance qu’on en tire, qu’elle la rend trop intellectuelle. Réciproquement, on ne demande plus à l’historien de l’art des jugements de goût et, s’il a le malheur d’en faire, il se discrédite. On ne lui demande pas non plus d’avoir la moindre expérience personnelle de l’expression graphique, ni même d’exercer son jugement en collectionnant des œuvres. Dans le cercle des historiens de l’art que je connais, il n’y en a qu’une petite minorité qui dessine ou collectionne.
La situation est à l’inverse de celle du passé. Les ancêtres de l’histoire de l’art, Giorgio Vasari, Karel Van Mander ou Joachim Sandrart étaient des peintres et n’auraient pas imaginé un instant que le jugement de goût puisse être indépendant d’un savoir théorique et pratique ou encore que ces savoirs excluaient le jugement de goût. En fait, ils avaient raison. On ne peut écrire l’histoire de l’art sans décider de la valeur artistique des objets pour les inclure, les exclure ou leur donner plus ou moins d’importance. L’option aujourd’hui fréquente qui consiste à dire qu’on fait l’histoire de ce qui était considéré comme l’art à une époque ou une autre ne peut échapper à l’inconsistance que de deux manières: soit en se limitant à l’histoire du vocabulaire artistique, soit en incorporant l’art militaire.
La dissociation entre savoir et pratique n’est pas générale. Du fait de la technicité particulière de la musique, il est difficile d’imaginer un musicologue incapable de se servir d’un clavier. Il est encore moins imaginable qu’un expert en vins soit incapable de les identifier, qu’il évalue un bourgogne en le prenant pour un bordeaux. Cela rendrait pourtant les mêmes services, dès lors qu’il saurait se prononcer sur le niveau de qualité du vin et sur son accord avec les mets. En réalité, on sait bien que s’il y parvient, il parvient aussi à identifier les vins. On s’opposera donc doublement à Kant, en considérant le jugement de goût à la fois comme intéressé et comme dépendant d’un savoir. Mais alors, qu’en est-il de son universalité?
Nier qu’il y parvienne sous prétexte que la grande majorité de l’humanité ignore la peinture de Boucher et que beaucoup de gens ne font pas la différence entre une peinture sur toile et sa reproduction photographique serait absurde. L’universalité des lois physiques ne tient pas au nombre de personnes qui les connaissent. Le beau pourrait être universel sans que cela se sache. Les querelles d’experts ne constituent pas un argument non plus. Si on examine les résultats du connoisseurship depuis sa naissance, on est forcé d’admettre qu’il s’agit d’une discipline aux résultats largement cumulatifs. Quels que soient les tâtonnements et les erreurs qui en jalonnent l’histoire, il serait ridicule aujourd’hui d’attribuer à Dürer une bonne partie des œuvres qui figuraient à son catalogue vers 1900, pour ne rien dire des attributions plus anciennes. On objectera que le problème posé porte sur le jugement de goût et non sur l’attribution, mais il est difficile de croire que la sensibilité croissante aux différences stylistiques les plus minimes n’entraîne pas une amélioration du jugement esthétique.
Parmi les plus remarquables connaisseurs du siècle passé, il faut citer Roberto Longhi, celui qui a réussi à dégager la personnalité de Caravage qu’on confondait si facilement avec ses imitateurs. De quoi se nourrissait l’acuité de son jugement qui en a faisait aussi le plus heureux des collectionneurs? Il suffit de voir un dessin de lui pour comprendre que rien ne lui échappait. Dans sa manière de procéder, il n’y avait aucun clivage entre le jugement du connaisseur, le talent du dessinateur et le savoir de l’historien, de sorte qu’ils y gagnaient tous trois.
 Et pourtant, le goût du connaisseur n’est pas indépendant de l’esthétique de son temps et il est évident que personne aujourd’hui ne reprendra à son compte les jugements de Vasari sur l’art médiéval ou sur les Vénitiens, ou encore les notes que Roger de Piles distribuait aux peintres comme à des collégiens[16]. Comment alors pourrait-il prétendre à l’universalité?
Et pourtant, le goût du connaisseur n’est pas indépendant de l’esthétique de son temps et il est évident que personne aujourd’hui ne reprendra à son compte les jugements de Vasari sur l’art médiéval ou sur les Vénitiens, ou encore les notes que Roger de Piles distribuait aux peintres comme à des collégiens[16]. Comment alors pourrait-il prétendre à l’universalité?
De l’agréable au beau
Considérons que l’agréable correspond aux jugements subjectifs du type « j’aime ça » ou « je n’aime pas ça » et que le beau est ce sur quoi tout le monde devrait être d’accord dans un monde bien fait. Pour passer de l’un à l’autre, il y a différents obstacles à franchir. Le premier est psychologique. Selon les conditions d’éducation et l’histoire personnelle qui forgent la sensibilité, on aimera ou n’aimera pas la violence dans un roman ou un film. Selon les contradictions qu’elles nous imposent, un effet cathartique se produira ou ne se produira pas. La différence des appréciations dépend aussi du niveau de compétence. Le jugement de l’homme de métier est certainement plus fondé que celui du badaud.
Il y a enfin le jugement de celui qui appartient à la même société et de ceux qui en sont éloignés dans l’espace ou le temps. Il existe une multitude de tableaux peints à la manière des peintres du XVIIIe siècle qui ne donnent ni plus ni moins d’agrément à l’amateur inculte que les œuvres des maîtres anciens, à supposer qu’ils distinguent un tableau peint à l’huile sur toile de sa reproduction photographique. En ce qui concerne le mobilier, rare sont ceux qui font encore la différence entre le bois et l’aggloméré plaqué, à plus forte raison entre le plaquage scié et déroulé. Inversement, aux yeux du connaisseur, le beau et l’agréable tendent à se rejoindre, car il ne trouve guère d’agrément aux feuillages bâclés d’un pastiche de Fragonard et aux meubles dits de style, vernis au pistolet et décorés de faux trous de vers. C’est pourquoi le goût du connaisseur peut rejoindre celui du XVIIIe siècle, comprendre et même partager son jugement sur les œuvres.
Mais cela ne signifie pas du tout que l’agrément soit de même nature pour le connaisseur d’aujourd’hui et le commanditaire d’hier. En l’absence de placage déroulé et d’aggloméré, le commanditaire aurait difficilement pu apprécier qu’on n’y ait pas eu recours. Le connaisseur part forcément de ce qu’il connaît dans son entourage familier, pour aller vers un ailleurs ou un passé qui le séduit entre autres par le fait d’être différent. Il ne peut pas, en tout cas spontanément, ressentir la même chose devant l’objet que ceux pour lesquels il était ou est familier. Ce « regard éloigné », selon l’expression de Claude Lévi-Strauss, peut amener, par exemple, à valoriser les œuvres qui étaient archaïques – et donc les plus éloignées de nous – aux dépends de ce que les contemporains appréciaient comme un renouvellement. Dans la musique de la Renaissance, nous sommes souvent séduits par des restes de modalité, alors que les musiciens s’efforçaient le plus souvent de les corriger à coups d’altérations, conformément à la pratique de la musica ficta. En travaillant sur la sculpture gothique des années 1220, j’ai eu du mal à comprendre pourquoi des sculpteurs de la cathédrale d’Amiens, au style sommaire et rigide, ont plu au point d’être invités sur le chantier de la cathédrale de Reims où travaillaient des artistes bien plus raffinés. Mais une fois remarqué que la combinaison de la grâce rémoise et du style discipliné d’Amiens menait à de nouveaux dépassements, ma perception des sculpteurs amiénois a changé et je pense avoir mieux compris ce que recherchaient à la fois les commanditaires et les artistes.
Bien entendu, comprendre une œuvre n’est pas la même chose que l’apprécier. On peut comprendre parfaitement ce que fait Jeff Koons, n’éprouver aucun plaisir à voir ses œuvres et les trouver laides. Il est aussi possible de trouver agréable une œuvre sans la comprendre ou en la comprenant de travers, mais le beau pourrait bien être ce qui permet au connaisseur appartenant à une autre société de rejoindre l’artiste et son public dans une même appréciation, car si la connaissance n’est pas l’accès au beau, elle l’ouvre. C’est ainsi que la connaissance des autres cultures permet l’universalité – en fait toujours relative – de notre propre jugement.
Cette conclusion est fréquemment évitée aujourd’hui à l’aide de deux sophismes. Le premier consiste à assimiler le jugement de goût à l’impression subjective que produit l’objet. Pour parvenir au même jugement sur les œuvres que les hommes d’une culture passée ou éloignée, il faudrait les ressentir comme eux. Les discussions sur l’interprétation de la musique ancienne donnent de bons exemples de cette attitude. On constate d’abord avec raison que nos orchestres sont généralement plus fournis que ceux du passé et nos instruments plus puissants. On en déduit qu’une reconstitution fidèle des œuvres nous fait un effet différent de ce que ressentaient les Anciens, de sorte qu’il faudrait augmenter les effectifs et « améliorer » les copies d’instruments par rapport aux originaux pour que la musique nous fasse le même effet que sur ses contemporains. Admettons sans y croire que cela nous rapprocherait de leur perception de cette musique: il ne s’agit jamais là que d’apprécier un objet différent et de moindre intérêt. En fait, parmi les nombreuses satisfactions que nous ont apportées les musiciens et les facteurs d’instruments bien informés en permettant la résurrection de ces œuvres dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a la redécouverte de sonorités claires et précises permettant d’entendre les moindres finesses d’une symphonie de Beethoven, naguère noyées dans une patte sonore indistincte et tonitruante. Renoncer à la quête d’authenticité, comme on le fait à nouveau trop souvent aujourd’hui, c’est perdre les fruits de décennies d’efforts récompensés.
C’est aussi face au problème de la musique ancienne qu’on entend le plus souvent un second sophisme: l’authenticité de l’interprétation serait un mythe. Il faudrait se mettre dans les conditions de l’époque, en partager les mœurs, abandonner le chauffage central et ainsi de suite, pour y parvenir vraiment. En fait, les deux sophismes sont apparentés en subordonnant la fidélité à l’œuvre aux conditions subjectives de la réception. Mais surtout, celui-ci confond le relatif et l’absolu. De même qu’on fait une distinction entre un café chaud et un café froid, on constate qu’une interprétation est plus authentique qu’une autre. Il n’y a certainement pas plus d’interprétation totalement authentique que de café totalement chaud. L’authenticité est un horizon, qu’il s’agit d’approcher le plus possible, exactement comme l’objectivité du jugement de goût. Dans la mesure où un café peut être chaud, une interprétation peut être authentique et un jugement objectif[17].
Le goût et le style
Le terme de goût est né au XVIe siècle et joue un rôle important dans l’esthétique de l’époque moderne, mais la réalité qu’il exprime se retrouve facilement à d’autres époques, ainsi chez les commanditaires ecclésiastiques des cathédrales gothiques qui étaient des amateurs éclairés, voire des connaisseurs. Le goût porte plus ou moins sur l’agréable et le beau selon sa propension à l’universalité et, de fait, il est plus ou moins partagé à l’intérieur d’une société. Il s’étend du goût personnel à celui d’une classe sociale, lui servant éventuellement à se distinguer des autres, et même à celui de la société entière par mimétisme.
Le goût s’éduque, ce qui ne veut pas dire qu’il s’inculque, sans quoi on ne comprendrait pas ses transformations et la possibilité d’admirer l’originalité, à dose il est vrai très variable. La seule répétition de l’acquis ne suffit pas à caractériser le goût, sans quoi il se confondrait avec le conformisme et ne varierait pas. Il est plus ou moins ouvert historiquement et géographiquement en fonction de la connaissance du passé et des autres. La référence à l’Antique est permanente dans la culture européenne, ou plutôt elle l’était jusqu’à une époque récente, mais elle ne l’a pas empêchée de s’ouvrir à différent moments à l’art oriental ou extrême-oriental.
Comme le goût, le style se dit d’un individu, d’un milieu ou d’une société entière. Le terme de style s’entend ici au sens actuel du mot et non pas au sens de l’ancienne rhétorique qui en faisait le niveau conventionnel d’expression plus ou moins relevé (stylus humilis, mediocris, grandis) qu’un même auteur choisit en fonction du sujet à traiter. Le style est une contrepartie du goût, son expression artistique par la récurrence des formules appréciées et l’évitement non moins caractéristique de ce qu’on juge de mauvais goût.
Le caractère aussi variable que sélectif du style peut s’illustrer d’un exemple radical: le passage du rococo au néoclassicisme en France. Cela dure à peu près une génération, le temps nécessaire à la relève des artistes. Pratiquement tous les ingrédients du rococo ont été rejetés, comme l’exubérance ornementale, la prédominance des courbes, la thématique galante et frivole, au profit d’un retour à l’Antique, d’un style géométrique et sévère privilégiant les droites, de thèmes héroïques, moralistes et civiques. Au XVe siècle, le passage dans toute l’Europe du style gothique international à un style sobre mis en place simultanément dans les Flandres et à Florence (Robert Campin, Masaccio…) est un phénomène comparable.
Bien entendu, un style regorge de déterminations sociales et idéologiques. Ce n’est pas par hasard que le néoclassicisme repose sur une idéologie qui sera celle de la Révolution. Le changement artistique du XVe siècle n’est certainement pas sans rapport avec le puritanisme croissant dont témoignent les lois somptuaires. On ne s’étonne pas que la tragédie française classique mette en scène des personnages du passé qui ressemblent comme des frères à la noblesse d’Ancien Régime avec les mêmes préoccupations: le pouvoir, l’amour et la guerre. Il n’y a sans doute aucun phénomène stylistique qui ne relève de déterminations comparables, mais cela n’explique pas grand-chose et confine à la lapalissade: l’iconographie religieuse était importante au Moyen Age parce que le clergé était le principal commanditaire; les tombeaux les plus riches sont toujours ceux des chefs, les hommes préhistoriques s’intéressaient aux animaux, et ainsi de suite.
Un style est d’abord une considérable sélection des moyens expressifs. La peinture de l’Egypte ancienne ne connaît pas le choix entre face, trois-quarts et profils: les personnages ont la tête de profil, le torse de face, les bras et les jambes de profil. Le théâtre de Racine utilise en tout trois mille sept cent dix-neuf mots, sur un vocabulaire courant de vingt-cinq mille environ[18]. Il ne s’agit pas d’une excentricité de cet écrivain, mais d’un choix normal dans le théâtre classique français. L’émaillerie romane fait pour l’essentiel alterner un bleu précieux et l’or, les autres teintes, essentiellement le bleu clair, le blanc et le vert, n’étant utilisés qu’avec parcimonie. A partir de la Renaissance, la sculpture jugée artistique ne porte plus de polychromie, contrairement à celle qui est destinée à arracher des larmes aux dévots. On pourrait multiplier les exemples sur des pages entières.
Les causes de ces limitations ne peuvent en aucun cas se réduire à des intérêts idéologiques. Elles sont trop diverses, souvent techniques, comme le choix de couleurs naturelles durables ou le fait que dans la musique de la Renaissance, l’ambitus, c’est-à-dire l’intervalle entre la note la plus basse et la plus haute utilisée dans une composition, ne s’affranchit pas des limites de la voix humaine. Mais il y a aussi de nombreuses causes pratiques: un système relativement simple et conventionnel favorise l’apprentissage du métier, permet une plus grande rapidité de conception et d’exécution, tout en favorisant la compréhension de l’œuvre par son public. Les musiques qui font une place importante à l’improvisation en donnent de bons exemples, comme celle du XVIIIe siècle et à plus forte raison les musiques non écrites, dont le jazz. Les peintures où le contour est un trait visible, des Egyptiens au Moyen Age, exigent une ligne nette, tracée d’un coup sans repentir, ce qui suppose des formes mémorisées et donc une forte conventionnalité. Plus généralement, la rapidité d’exécution du peintre est une qualité artistique encore du temps de Dürer et elle est techniquement indispensable dans la fresque. Or elle suppose des tours de main familiers et donc des conventions.
On ne saurait négliger les raisons esthétiques de ces limitations. Depuis saint Augustin, la réflexion sur le beau met en avant le couple paradoxal de l’unité et de la variété (unitas/varietas). Or l’unité est précisément ce que produisent les limitations stylistiques. Il s’agit en somme de trouver un bon équilibre entre les deux, ainsi en musique où les variations permettent de répéter un thème sans lasser. C’est par exemple le cas des Variations Goldberg. Mais, si le thème est trop long et trop caractérisé, cela peut devenir ennuyeux, comme dans le Boléro de Ravel. De même, les baies des cathédrales gothiques ont longtemps eu toutes le même remplage assez simple, le plus souvent deux lancettes surmontées d’un cercle, ensuite d’une rose ou d’un quadrilobe. Lorsque le remplage s’est complexifié dans la seconde moitié du XIIIe siècle, on a compris que sa répétition entraînerait la lassitude et on s’est mis à le varier d’une fenêtre à l’autre. Enfin, la variété s’obtient dans le temps par le changement stylistique, lui-même porté par le changement du goût. A chaque moment d’une évolution stylistique, des artistes proposent des déviations par rapport aux règles dans les limites du tolérable, suscitant parfois la polémique et finissant par transformer le système artistique. Selon les sociétés et les époques, ces transformations peuvent être plus lentes ou plus rapides. L’art égyptien se caractérise par une grande stabilité, redoublée par le retour à des styles antérieurs, comme celui du Haut Empire à la basse époque, mais il lui est arrivé de connaître un changement radical et momentané avec la brève période amarnienne.
Les limitations des moyens d’expression sont à ce point nécessaire pour donner son unité à un style qu’elles présentent souvent un caractère arbitraire, soit qu’elles l’aient toujours eu, soit que leur raison d’être ait disparu. La musique occidentale en donne de bons exemples. La tierce ne s’est vraiment imposée comme une consonance qu’au XVIe siècle et, à cette époque, les suites de tierces qui passaient jadis pour des fautes ne se comptent plus. Inversement, les suites de quintes courantes au Moyen Age sont progressivement devenues des fautes. On sait bien que Pythagore plaçait la quinte dans les consonances, contrairement à la tierce. Mais les théoriciens médiévaux pouvaient aussi bien accepter la répétition d’un intervalle parce qu’il est consonant ou le refuser parce que sa consonance répétée est banale[19]. L’essentiel est finalement que tout ne soit pas permis.
Quel rapport entre les limitations du style et celles du goût? Bien entendu, celles du goût déterminent celles du style et il est peu probable que le contraire soit vrai, car le style est nettement plus limité que le goût. L’évolution qui a banalisé la tierce, au point d’ailleurs que les suites de tierces soient jugées banales à leur tour, supposait un goût pour les tierces que le style prohibait et a fait évoluer le style. De même, les objets exotiques qu’on importait, comme les porcelaines chinoises à partir du XVIIe siècle, n’obéissaient pas aux règles esthétiques en vigueur, mais la chinoiserie est venue à la mode, a été imitée et a fait évoluer le style. Dès lors que les limitations du style ne se confondent pas avec celles du goût, elles ne sont pas des limitations de l’universalité du beau. Un style demande certes une certaine uniformité, mais l’uniformité du style n’est ni celle du goût, ni une objection à l’université du beau. Chacun peut préférer le rococo au néoclassicisme ou inversement, mais personne n’est obligé de le faire.
Le beau est la complexité intégrée en-dehors ou au-delà de toute fonctionnalité
On comprend pourquoi Kant voulait un jugement de goût désintéressé, car il est vrai que les divergences esthétiques peuvent s’expliquer par les intérêts particuliers ou les conditionnements qui les suscitent. C’est ce que nous avons vu à propos du beau naturel, avec la prise en considération de l’excès et de l’inhumain sous la forme du sublime. C’est vrai du beau artistique: nous avons rappelé les intérêts idéologiques que met en jeu le passage du rococo au néoclassicisme. C’est doublement vrai du beau mimétique où joue, outre le style, le choix des sujets.
Mais pourquoi voulait-il aussi séparer le jugement de goût de la connaissance de l’objet? Parce qu’il était à la recherche d’une subjectivité universelle, ce que Hegel lui a reproché[20]. Ce qui plaît sans concept existe pourtant: nous partageons avec les animaux des instincts qui nous font rechercher la nourriture et le sexe même sans en avoir le concept et nous permettent d’en tirer un plaisir. La recherche du plaisir appartient au sujet et est donc par définition subjective, de sorte qu’il s’agit bien là d’une subjectivité universelle. Mais cela ne signifie pas qu’un jugement objectif contredirait la beauté de son objet. Il s’agit là d’un point fondamental: la beauté d’un objet ou d’une œuvre peut être reconnue à travers une perception différente, comme celle du « regard éloigné ». L’abondante sculpture antique a traversé les siècles, chacun y trouvant ce qu’il voulait, mais provoquant admiration et imitation depuis l’art roman jusqu’à Pablo Picasso. Il ne s’agit plus là d’une subjectivité partagée, mais d’un jugement objectif, car le beau peut être reconnu à partir de sensations, de perceptions et de conceptualisations très différentes. On pourra toujours trouver un excentrique niant l’intérêt de la sculpture antique. Cela n’enlève rien à l’objectivité du jugement, car tout le monde ne partage pas un jugement objectif. Inversement, ce serait une objection si nous parlions d’une subjectivité partagée. Comme on l’a vu à propos de la musique ancienne, notre appréciation subjective ne peut être celle des contemporains, mais nous pouvons aimer les mêmes chefs-d’œuvre sans qu’il soit besoin de les moderniser pour cela. Le succès de la phénoménologie, ou plutôt des applications qu’on en a faites, est largement responsable de la réduction du beau comme de l’art à la perception subjective qu’on en a.
On comprend mieux ainsi le rapport à la connaissance. La connaissance rationnelle n’est pas nécessaire au désir et à l’appréciation de belles choses: elle l’est en revanche pour comprendre qu’elles sont belles, ce à quoi la perception ne suffit pas. Lorsqu’un art nous est étranger, nous pouvons parfois en saisir intuitivement la beauté, mais pas toujours. Le détour par la connaissance, l’observation de particularités qui n’avaient pas immédiatement attiré notre attention, peuvent nous en ouvrir l’accès. C’est par exemple le cas de la compréhension des techniques artistiques ou encore de la fonction des œuvres dans une société.
Cela dit, le plaisir esthétique n’est ni gratuit, ni désintéressé. Il est possible que Kant essaie de saisir autre chose avec ces mots: l’inutile qui est bien un caractère du beau. La sexualité dépasse de loin le besoin de reproduction, pas uniquement chez l’homme, et c’est parce qu’elle est au-delà de l’utilité qu’elle possède une dimension esthétique. Comme beaucoup de choses inutiles sont laides, l’inutilité ne suffit pas à caractériser le beau. En outre, une chose peut être belle et utile, mais elle serait aussi utile si elle était laide et aussi belle inutile. Le beau est en soi inutile: il est un excès par rapport à toute fonction, comme l’est l’érotisme par rapport à la reproduction de l’espèce ou la cuisine par rapport à la nourriture. Ou encore, il ne répond pas au besoin, mais au désir.
La caractérisation du beau en termes d’unité et de variété est évidemment insuffisante, mais elle n’est pas fausse. S’il ne s’agissait que d’unité, un point serait parfaitement beau. S’il ne s’agissait que de variété, le beau serait le désordre. En fait, il faut un ordre pour qu’il y ait variété dans l’unité, ce qui n’exclut pas le beau naturel: le diamètre des branches d’un arbre, par exemple, est ordonné par la croissance. Cela dit, la complexité ordonnée ne suffit pas à définir le beau, sans quoi un Etat ou une machine seraient beaux en soi. Il doit s’agir d’une complexité ordonnée au-delà d’éventuelles fonctions, de l’utilité ou du bien. A première vue, l’œuvre d’un névrosé obsessionnel remplit cette condition, mais en fait, la névrose est une inadaptation fonctionnelle et l’obsessionnel prend pour utiles des tâches qui ne le sont pas. Elle est en-deçà et non au-delà de cette condition. Or, la nature inanimée ignore la fonctionnalité et la nature animée la dépasse. Que l’érosion puisse donner une courbure régulière à un caillou s’explique certainement très bien du point de vue géologique, sans faire appel à une finalité imaginaire. On explique couramment les mimétismes animaux en termes utilitaires, comme des camouflages par exemple, mais on a suffisamment montré, depuis Roger Caillois, que de telles explications ne rendent compte que très partiellement des faits[21].
La complexité est devenue un important thème de recherches depuis un demi-siècle environ, tout en étant difficile à définir[22]. Ces recherches concernent les domaines les plus divers, de la biologie à la sociologie, ce qui ne facilite pas l’entente sur une définition. A défaut, on comprend surtout la complexité négativement, comme l’impossibilité de faire entrer un processus dans un algorithme.
Cela pose le problème des régularités naturelles. On s’émerveille de retrouver la géométrie dans la nature, sous la forme de symétries, comme celles des animaux et des fleurs, ou de courbes régulières, comme la spirale du nautile, sans cesse prise en exemple.  Mais on oublie vite qu’il s’agit d’approximations. Tout n’est pas symétrique dans le corps humain, certains organes, comme le cœur, étant désaxés, tandis que la spirale du nautile n’a pas la rigueur qu’on obtiendrait à l’aide d’une machine. Le visage humain est symétrique, mais une expérience (courante sur internet) consiste à dédoubler l’une des deux moitiés d’un visage régulier pour le rendre rigoureusement symétrique: on s’aperçoit ainsi qu’il l’était bien moins qu’on ne le croyait. Quant au visage obtenu par le report d’un côté, on dira qu’il manque de « naturel ».
Mais on oublie vite qu’il s’agit d’approximations. Tout n’est pas symétrique dans le corps humain, certains organes, comme le cœur, étant désaxés, tandis que la spirale du nautile n’a pas la rigueur qu’on obtiendrait à l’aide d’une machine. Le visage humain est symétrique, mais une expérience (courante sur internet) consiste à dédoubler l’une des deux moitiés d’un visage régulier pour le rendre rigoureusement symétrique: on s’aperçoit ainsi qu’il l’était bien moins qu’on ne le croyait. Quant au visage obtenu par le report d’un côté, on dira qu’il manque de « naturel ».
La régularité géométrique ne suffit donc pas à définir le beau. Une spirale est plus intéressante qu’une simple droite, mais une coquille de nautile est plus intéressante qu’une spirale dessinée à l’ordinateur. A première vue, il y a une contradiction: quelque chose comme une régularité irrégulière semble un trait de la nature. Mais les choses deviennent plus claires si on parle d’une régularité sans exactitude. La nature n’est pas une machine à calculer et tout y interagit. Il serait donc étonnant que sa géométrie soit rigoureuse. Or le processus par lequel les éléments d’un organisme s’y mettent en place est ce que les biologistes appellent l’intégration, un processus non déterministe, mais produisant un tout dont les propriétés dépassent la somme de celles des parties. Et cela pourrait bien être ce que nous appelons le beau.
On comprend mieux en définissant le beau comme une telle complexité intégrée, organisée en-dehors ou au-delà de toute fonctionnalité, en quoi l’art est imitation de la nature, non pas au sens restreint qu’a critiqué Hegel[23], celui de la copie exacte des objets du monde extérieur, mais au sens que le Moyen Age donnait à ce mot: produire à la manière de la nature. Si l’art ne remplissait pas à sa manière une telle exigence, s’il n’était pas une forme d’intégration, il manquerait d’intérêt, car il suffirait de regarder la nature pour le trouver indigent. On comprend aussi pourquoi les Anciens s’extasiaient d’une statue en remarquant qu’on la croirait vivante. Bien sûr, c’est une manière de vanter l’imitation scrupuleuse des apparences, mais c’est aussi reconnaître ce je-ne-sais-quoi qui est plus « vivant » qu’une froide symétrie et qui fait toute la différence entre un visage humain et un visage recomposé en en dédoublant la moitié.
Tel que nous avons l’avons défini, le beau n’a aucun rapport avec la moralité et est même amoral dans son principe, par l’exclusion de la finalité. Le sentiment esthétique peut se soumettre à la moralité, mais c’est un fait qu’il entre facilement en conflit avec elle, comme envers n’importe quelle finalité qui lui est étrangère. L’iconoclasme aveugle de la Réforme, par exemple, est largement dû à un conflit entre esthétique et moralité.
La définition du beau ici proposée permet de résoudre quelques difficultés rencontrées plus haut. En ce qui concerne le beau naturel, on a vu combien la subjectivité était engagée, mais les variations subjectives du goût, par exemple sur la relative sveltesse des corps n’affectent pas la définition: une femme peut être parfaitement proportionnée avec plus ou moins d’embonpoint, selon qu’elle ressemble à une Vénus de Cranach ou de Titien. La même conclusion s’étend évidemment au beau artistique. Les styles entraient constamment en conflit, mais le goût était plus tolérant que le style et, en dehors de l’époque contemporaine, les œuvres d’art les plus diverses répondaient à notre définition du beau. Quant à savoir si l' »art » contemporain y répond, c’est un faux problème dès lors qu’il ne se définit pas par la référence au beau.
La définition du beau que nous proposons donne sens à la notion d’imitation de la nature et même aux variations de cette notion. Nous pouvons désormais étudier la manière dont l’art a satisfait à cette exigence d’intégration d’une époque à l’autre, puis y a renoncé et s’est proprement désintégré.
![]()
L’évolution du système artistique
A partir du Ve siècle avant J.C., la sculpture grecque parvient à représenter le corps humain avec une exactitude mimétique qui dépasse tout ce qui s’était fait auparavant. Ses chefs-d’œuvre ont servi d’idéal artistique dominant dans l’empire romain et, de copies de copies en imitations d’imitations, le sont resté jusqu’au XIXe siècle dans la sculpture, mais aussi dans la peinture. L’emprise des ordres vitruviens sur l’architecture s’y ajoutait pour compléter le modèle. L’art de l’époque industrielle est devenu de plus en plus une réaction contre cet héritage.
Bien sûr, il y avait eu des innovations totalement indépendantes de ce legs, non seulement endogènes comme l’architecture gothique, mais aussi exotiques comme le goût des tissus orientaux au Moyen Age ou des chinoiseries au XVIIIe siècle. Dès l’invention de la polyphonie, la musique n’a plus grand-chose à voir avec la tradition antique. A l’époque industrielle, bien des phénomènes artistiques se situent hors de son emprise sans constituer davantage des réactions contre elles. A partir du milieu du XIXe siècle, l’éveil des nationalismes a conduit nombre de compositeurs à chercher l’inspiration dans les traditions musicales de leurs pays, de Dvorak et Rimski-Korsakov à Bartók, Prokofiev ou Britten. Ces ingrédients de couleur locale ne semblent pas avoir joué un rôle majeur dans l’évolution du langage musical en dehors de la musique de variété. Les références aux cultures traditionnelles sont toujours nombreuses dans l’art contemporain. A celles qui concernent la culture indigène s’ajoutent les recherches d’exotisme, comme le japonisme du XIXe siècle ou le goût de l' »art nègre » au siècle suivant. Mais les expériences de ce genre n’ont pas empêché l’uniformisation progressive du système artistique sur le modèle des pays les plus fortement industrialisés. Il semble donc qu’on peut tracer à grandes lignes l’évolution de ce système sans se soucier beaucoup des arts non occidentaux, ce qui est aussi pratique que regrettable. Si nous ne nous attarderons pas sur l’art chinois ou sur celui de l’Afrique noire, ce n’est pas pour les déprécier, mais parce que cela ne servirait à peu près à rien pour comprendre ce qui s’est passé à l’époque industrielle.
Art et artisanat
Le point de départ antique et médiéval est clair. Les mots technè et ars désignent un travail que n’importe qui ne peut pas réaliser et ne définissent pas une compétence qui serait exclusivement esthétique. Si l’on dresse le catalogue d’un artiste mythique comme Dédale, on y trouve le labyrinthe, les ailes d’Icare, des statues qui semblaient marcher, la vache de bois dans laquelle se cachait Pasiphaé pour s’accoupler avec son taureau, et ainsi de suite. A vrai dire, cela ressemble un peu au catalogue des œuvres et des projets de Léonard de Vinci.
Surtout, malgré l’évolution de la notion d’art qui lui fait désigner ensuite les œuvres dont la principale finalité est esthétique, il en reste quelque chose. Pour le commun des mortels, l’œuvre d’art est toujours un travail que n’importe qui ne pourrait pas réaliser. Lorsqu’elle ne satisfait pas cette condition, il est courant de dire que « ce n’est pas de l’art ».
Une sociologie reposant sur l’idée de Progrès met l’accent, pour l’Antiquité comme pour le Moyen Age, sur l’absence de distinction entre l’artiste et l’artisan afin de pouvoir louer ensuite l’émancipation de l’art à partir de la Renaissance[24]. Le statut des sculpteurs et des peintres de la Grèce antique est complexe et fait l’objet d’un débat après avoir été considéré comme misérable[25]. En tout cas, une riche historiographie et une critique des attributions se sont constituées autour des plus célèbres d’entre eux et de leurs chefs-d’œuvre, sans cesse recopiés à l’époque romaine. L’Histoire naturelle de Pline l’Ancien présente ces artistes comme célèbres et riches de leurs temps, leurs œuvres valant déjà des fortunes. Nous avons perdu les originaux, mais les copies permettent aux historiens de s’en faire une idée assez exacte et de constater qu’il s’agit effectivement d’œuvres décisives. Dès lors, on peut légitimement se demander comment la gloire de ces artistes se serait constituée tardivement, si elle n’était pas apparue de leur vivant.
A Rome, l’accueil enthousiaste de l’art grec est contredit par un idéal républicain de simplicité originaire, assimilant l’amour de l’art à un facteur de décadence. En dehors du genre spécifiquement romain des bustes d’ancêtres, l’essentiel de la production peinte et sculptée est constitué de copies et d’adaptations des originaux grecs d’époque classique ou hellénistique. A quelques exceptions près, cette soumission à des modèles prestigieux réduit les artistes contemporains à un rôle modeste et effacé. Les chefs-d’œuvre appartiennent au passé et, avant même d’être copiés, sont acquis et collectionnés. Comme nous l’apprend Cicéron dans ses discours contre Verrès, ils atteignent des prix vertigineux dans les ventes.
Il y avait dans l’espace publique et les temples une abondance de statues et de tableaux d’une qualité très variable, sans compter les tombeaux au bord des routes. Le tout-venant pouvait consister en statues de dieux sans têtes auxquelles l’acheteur faisait ajouter la sienne ou de sarcophages où un emplacement était réservé pour le buste du défunt, sculpté après l’achat.
Mais il y avait aussi des chefs-d’œuvre achetés ou pillés, en particulier dans les temples. L’Histoire naturelle de Pline l’Ancien ne manque pas d’en signaler la localisation aux amateurs lorsqu’elle les évoque, notant éventuellement qu’ils risquent d’échapper à l’attention du visiteur distrait.
La situation médiévale est tout autre. Si la peinture antique a largement disparu, en dehors de rares manuscrits enluminés, les vestiges sculptés subsistent à profusion et jouent de manière constante un rôle de modèle. Mais la capacité d’en distinguer les chefs-d’œuvre de la production ordinaire a disparu pour longtemps. Il faut attendre la sculpture du XIIIe siècle pour arriver à un niveau de technicité comparable et l’historiographie du XIXe siècle pour qu’on commence à distinguer les originaux des copies.
En dehors des petits objets, la production artistique médiévale est faite de commandes pour une destination particulière. Il n’y a pas de lieux d’exposition, tels que les pinacothèques antiques ou nos musées qui pourraient acquérir des œuvres mobiles dont le sujet iconographique serait indifférent. En outre, les œuvres ne sont pas revendues. Celles qui sont biens d’Eglise sont juridiquement inaliénables, tandis que l’aristocratie laïque ne semble pas remettre les siennes en vente. Les documents ne nous parlent le plus souvent que de dons et de prêts, particulièrement pour les livres enluminés. Faute de second marché, la critique d’art n’a pas de raison d’être, parce que le prix de l’objet a été décidé une fois pour toute entre l’artiste et le commanditaire et qu’il n’y aura plus d’occasion de l’évaluer. Il s’ensuit une conséquence importante: les œuvres ne peuvent pas valoir des fortunes, indépendamment de la richesse du matériau. Un artiste doué est payé sensiblement plus cher qu’un simple artisan, mais dans des proportions peu spectaculaires. L’étude des comptes de chantier de la cathédrale d’Exeter au début du XIIIe siècle a permis de conclure qu’un sculpteur était payé quatre fois plus qu’un tailleur de pierre ordinaire. Comme les sculpteurs de cette cathédrale ne sont pas les meilleurs de la période, on peut imaginer que la proportion était sensiblement supérieure pour les plus grands, mais tout cela reste bien raisonnable à nos yeux.
Le retour du second marché
L’habitude de collectionner se prend dans les cours pendant la seconde moitié du XIVe siècle, à partir de Jean, duc de Berry. Au siècle suivant, les œuvres des plus grands peintres, comme celles de Jan van Eyck, commencent à être recherchées après leur mort, faute de pouvoir encore leur en commander. Un second marché est donc réapparu et se développe rapidement. Il concerne bientôt les peintres vivants: les dessins de Léonard de Vinci sont immédiatement recherchés. Dürer se rend compte que les aquarelles qu’il avait produites comme de simples études étaient commercialisables et leur appose finalement sa signature ou la fait apposer par son élève Hans von Kulmbach. Sur le second marché, la valorisation des grands noms ne fait que croître et le retour à une situation qu’avait connue l’Antiquité fait de Dürer « l’Apelle des lignes noires », compte tenu de sa prédilection pour la gravure. Pour la même raison, la critique d’art refait surface, mettant de plus en plus l’accent sur la main du maître.
Les amateurs médiévaux ne jugeaient pas la qualité des arts à la richesse des matériaux. L’abbé Suger de Saint-Denis cite Lucien: Materiam superabat opus (le travail surpassait le matériau), tandis qu’Henri de Blois, évêque de Winchester faisait graver sur une pièce d’orfèvrerie: Ars auro gemmisque prior (l’art vient avant l’or et les pierreries). En revanche, ils n’auraient certainement pas imaginé une œuvre d’art dans un matériau bon marché. Ce fut pourtant ce qui se produisit dès le XVe siècle, avec l’apparition de la gravure et, au siècle suivant, la valorisation du dessin de maître. Il s’agit d’un phénomène général de relative dématérialisation de l’œuvre. Dans les Flandres, les retables peints et sculptés cèdent la place à des retables totalement peints où la grisaille imite la sculpture et les peintres imitent l’or et les pierreries plutôt que d’utiliser la dorure et l’incrustation. La sculpture non polychrome vient à son tour à la mode en Italie et en Allemagne. Enfin, la toile se substitue de plus en plus souvent au panneau de bois comme support de la peinture.
 La perspective, pratiquée à partir de Giotto sous une forme empirique, puis complètement géométrisée par Brunelleschi un siècle plus tard, assure la domination de la peinture en lui donnant le pouvoir illusionniste de mimer la troisième dimension, non seulement dans la figuration, mais aussi en remplaçant corniches et modillons par des trompe-l’œil, comme c’est déjà le cas dans la basilique d’Assise. La prouesse se substitue au prix du matériau.
La perspective, pratiquée à partir de Giotto sous une forme empirique, puis complètement géométrisée par Brunelleschi un siècle plus tard, assure la domination de la peinture en lui donnant le pouvoir illusionniste de mimer la troisième dimension, non seulement dans la figuration, mais aussi en remplaçant corniches et modillons par des trompe-l’œil, comme c’est déjà le cas dans la basilique d’Assise. La prouesse se substitue au prix du matériau.
Les marchands se mettent au commerce de l’art, en particulier à Anvers au XVIe siècle, diffusant un nouveau type d’œuvre: le tableau. De toile ou de bois, aisément transportable, il peut s’accrocher au mur avec son cadre. En l’absence d’une commande définissant le sujet à peindre, on propose le plus souvent des sujets passe-partout qui trouvent facilement acquéreur et qui, n’étant pas personnalisés, seront faciles à revendre s’il y a lieu, comme les scènes de genre. De l’Italie aux Flandres, le développement du commerce enrichit les marchands qui viennent grossir les rangs des acheteurs. Une production de second rang s’inspire des inventions et des compositions des plus grands, de sorte qu’elle contribue finalement à leur popularité et à leur prestige. C’est ainsi que Jérôme Bosch, mort en 1516, est très imité à Anvers dans les années 1540 et que certains tableaux produits dans ces années pouvaient encore passer pour authentiques il y a quelques décennies[26]. Une autre nouveauté de la période est la citation des gestes et des postures inventées par les peintres célèbres, tel le bras levé et l’index pointé du saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci. Ces références constantes, caractéristiques du maniérisme, contribuent à leur tour à l’apparition d’un culte durable du génie qui se révèle à l’originalité de ses inventions et de ses compositions, sans cesse reproduites ensuite.
Cela dit, la naissance d’un marché plus large n’affecte en rien l’intérêt qu’il y a pour l’artiste à s’assurer le patronage d’une cour. A la fin du Moyen Age déjà, les plus grands étaient appelés à leur service par les princes, ce qui n’empêchait pas la réception de commandes plus modestes. La situation est cependant neuve, car l’apparition d’un véritable marché de l’art et d’écrits sur l’art propagent désormais leur renommée. Il faut néanmoins relativiser un refrain bien connu: au contact de l’humanisme, l’art serait devenu libéral. Il est bien vrai qu’il finit par faire officiellement partie des arts libéraux, mais il ne s’agit guère que d’une différence nominale avec le Moyen Age, où la distinction des arts mécaniques et libéraux était largement théorique et ne concernait plus les artistes depuis le XIIe siècle. En effet, l’importance prise par la géométrie dans leur pratique leur permettait de revendiquer la maîtrise d’un art libéral.
Art et idéologie
La même vision des ténèbres médiévales et de la Renaissance comme aube de temps meilleurs veut que les arts aient progressivement conquis leur autonomie. Mais il faut se demander ce qu’on entend par là. S’agit-il de l’autonomie de l’art quant à sa finalité ou de l’autonomie de l’artiste, de sa liberté en somme?
Si parler d’autonomie de l’art veut dire que l’art a une finalité propre, c’est une tautologie dès lors qu’il se définit par la finalité du beau. Si on veut dire qu’il n’en a aucune autre, c’est sans doute faux à toute époque. L’idée d’une émancipation progressive est largement une erreur due à la polarisation sur l’évolution des rapports entre art et religion en Europe. En dehors de cas limites, comme les œuvres des aliénés qui peuvent avoir une valeur esthétique, l’art a au moins la finalité de faire vivre plus ou moins bien l’artiste. Qu’il orne le corps d’un chef, son palais ou une église, il sert à affirmer un pouvoir. A mesure qu’il entre dans la sphère marchande, il prend une valeur spéculative; il sert aujourd’hui à blanchir l’argent sale. On n’en finirait pas d’énumérer ses finalités qui, du reste, sont parfaitement compatibles avec la sienne propre. Si on parle d’autonomisation de l’art dans un contexte particulier, il importe de dire par rapport à quoi. On parle volontiers d’une autonomisation par rapport aux corporations au début de l’époque moderne, ce qui est exact, mais on oublie volontiers que les corporations n’ont pas toujours existé, que leur tutelle ne caractérise que la fin du Moyen Age et encore pas partout, enfin que cette tutelle était une discipline interne des métiers artistiques comme des autres. Ce n’est pas l’autonomie de l’art qu’elle mettait en cause, mais celle de l’artiste.
L’autonomie de l’artiste est donc une autre histoire, sans être davantage celle d’une émancipation progressive. L’artiste doit satisfaire un public, composé entre autres de commanditaires, de clients, de marchands et de critiques selon l’époque. Il ne peut y parvenir sans partager largement son goût. De ce point de vue plus que de tout autre, la situation de l’époque préindustrielle et celle de l’époque industrielle doivent être distinguées.
Avant la période industrielle, il ne s’agissait guère d’un problème, le goût et le style étant les deux faces d’une même esthétique. L’artiste pouvait être dévergondé et défrayer la chronique, cela ne changeait rien à l’admiration que suscitaient ses œuvres, comme le montre le cas de Caravage. Ce peintre était aussi un audacieux novateur, dont la manière en a choqué plus d’un, mais cela n’empêchait pas les commandes et il s’agit sans doute de l’artiste le plus influent de sa génération.
En effet, l’insertion sociale de l’artiste ne mène pas au conformisme, car le public souhaite l’innovation, en dehors d’une fraction minoritaire. La musique en donne de bons exemples. Contemporain de Caravage, Monteverdi est le plus grand promoteur du nouveau style de mélodie accompagnée sur lequel repose l’opéra. On connaît les critiques qu’il a suscitées de la part du chanoine et musicien bolonais Giovanni Artusi, mais il a fait une carrière enviable à la cour de Mantoue puis à Saint-Marc de Venise, alors qu’Artusi est resté dans l’ombre. Un cas contraire et rare, mais non moins éloquent, est celui de Jean Sébastien Bach. Il n’a pas accepté le style galant qui se mettait en place de son vivant, lui préférant les complexités du contrepoint. Du fait de son conservatisme, sa carrière a été modeste. Il a bien essayé de se faire engager à la cour de Dresde, en envoyant le Kyrie et le Gloria de la Messe en si au prince-électeur, roi de Pologne, mais n’est pas parvenu à quitter Leipzig. Inversement, ses fils, particulièrement Karl Philip Emmanuel et Johann Christian, ont joué un rôle considérable dans le bouleversement stylistique et fait des carrières internationales, alors que la postérité leur a préféré leur père. Il y a une raison à cette préférence: l’amplitude des développements fondés sur la modulation était bien une innovation, mais elle allait à contre-courant pendant plus d’une génération. A partir des dernières œuvres de Mozart, elle est reconnue et devient un modèle. Le cas de la famille Bach, tout comme celui de Monteverdi et d’Artusi, montre que le goût n’est pas le conformisme. Le père reste à l’écart des innovations qui font le succès de ses fils, mais innove d’une autre manière qui sera reconnue dès la fin du siècle.
La notion de génie définit pendant la période moderne l’artiste qui parvient à imposer par la force de ses œuvres le bouleversement du style. La qualité de l’amateur d’art qui lui permet de juger et d’apprécier le génie est le goût, une notion qui prend une grande importance au XVIIIe siècle avec la naissance de l’esthétique comme discipline. A la fin du siècle, on commence sérieusement à opposer le génie et le goût, autrement dit la liberté de l’artiste et l’attente du public, une évolution qui mène au culte du génie romantique et à son corollaire, le mépris des académies, des critiques et des bourgeois qui n’y comprennent rien.
L’apparition simultanée de l’esthétique et de la critique d’art était celle d’un discours sur l’art qui n’était plus celui des artistes eux-mêmes. Il est toujours bien vivant et on peut l’appeler le point de vue du consommateur. Les explications sociologiques données de ce phénomène ne sont pas convaincantes. Il s’agirait de la conséquence d’un élargissement de la clientèle, jadis nobiliaire, de la naissance d’un public vaste et divers à quoi répondrait l’apparition d’une nouvelle forme d’exposition, le Salon. C’est oublier que l’élargissement du marché de l’art est bien antérieur. Depuis le XVe siècle en tout cas, les banquiers et les marchands font partie des acheteurs. Au siècle suivant, une production massive de tableaux se met en place à Anvers, puis en Hollande, la clientèle aristocratique n’en absorbant qu’une faible part. Or l’esthétique et la critique d’art ne sont pas nées dans ce contexte. Jusqu’au XVIIIe siècle, le discours sur l’art est resté pour l’essentiel celui des artistes eux-mêmes, y compris l’historiographie, avec Vasari, Van Mander et Sandrart. Leur jugement critique porte essentiellement sur ce que nous appelons la forme, en particulier dans l’interminable querelle sur l’importance respective du dessin et du coloris. Pour donner des notes aux artistes, Roger de Piles se sert de quatre critères: la composition, le dessin, le coloris et l’expression, tandis que la thématique n’est pas prise en considération. Ces critères ne disparaissent pas, mais il suffit de lire Diderot pour apercevoir le changement d’accent: le choix des sujets et leur signification morale deviennent essentiels avec le rejet du libertinage de Boucher et l’exaltation de la sentimentalité de Greuze.
L’attitude de Diderot n’est pas étrangère à celle des artistes eux-mêmes, car le même moralisme est à l’œuvre chez les novateurs et intrinsèque au néoclassicisme. En fait, le débat idéologique s’est emparé de la scène artistique dans les décennies qui mènent à la Révolution. La nature du débat est au moins aussi neuve que les idées exprimées: des personnes qui n’ont ni autorité, ni compétence artistique se donnent le droit de juger les œuvres et ne font plus confiance pour cela à l’Académie, émanation du pouvoir royal. L’art doit parler au sentiment que chacun de nous possède et qui nous permet de vérifier si nous sommes touchés par ses produits. Ce point de vue optimiste sur la nature humaine est bien dans l’esprit du siècle et trouve sa plus forte expression chez Rousseau. Alors que le dogme du péché originel et de la corruption de la nature humaine justifie la contrainte exercée par le pouvoir, la progression des idées démocratiques repose sur le rejet de ce dogme.
Considérer la critique d’art du XVIIIe siècle comme une activité subversive semble absurde, d’où les explications insuffisantes de son apparition. Et pourtant, il est assez facile de s’apercevoir qu’elle permet une critique à peine indirecte de la situation politique et sociale. Pour revenir à l’opposition entre les bergeries de Boucher et les scènes paysannes de Greuze, il faut noter que le berger qui garde son troupeau, une activité peu laborieuse, symbolise les dominants qui vivent du travail d’autrui et jouissent de l’oisiveté: le clergé et la noblesse. Aussi Marie-Antoinette jouait à la bergère et, bien plus tard encore, le pape Pie XII se faisait photographier entouré de moutons dans les jardins du Vatican.  Le paysan en est l’antithèse exacte, celui qui nourrit les autres de son travail. Avant même la Révolution, il est relayé dans l’iconographie par les vieux Romains, symboles de vertu républicaine et guerrière. L’art est devenu un champ de bataille idéologique, ce qui est une nouveauté. Il pouvait glorifier le pouvoir auparavant, mais cela ne se traduisait pas par des affrontements esthétiques: la diffusion du gothique français, de la Renaissance italienne ou du style versaillais et les résistances à ces styles ne suivaient pas des lignes de démarcation politiques. La Querelle des Anciens et des Modernes, au XVIIe siècle, opposait les inconditionnels de l’imitation de l’Antiquité à ceux qui cherchaient de nouvelles sources d’inspiration, mais il serait difficile de trouver entre les uns et les autres, tous au service du roi, le moindre clivage politique.
Le paysan en est l’antithèse exacte, celui qui nourrit les autres de son travail. Avant même la Révolution, il est relayé dans l’iconographie par les vieux Romains, symboles de vertu républicaine et guerrière. L’art est devenu un champ de bataille idéologique, ce qui est une nouveauté. Il pouvait glorifier le pouvoir auparavant, mais cela ne se traduisait pas par des affrontements esthétiques: la diffusion du gothique français, de la Renaissance italienne ou du style versaillais et les résistances à ces styles ne suivaient pas des lignes de démarcation politiques. La Querelle des Anciens et des Modernes, au XVIIe siècle, opposait les inconditionnels de l’imitation de l’Antiquité à ceux qui cherchaient de nouvelles sources d’inspiration, mais il serait difficile de trouver entre les uns et les autres, tous au service du roi, le moindre clivage politique.
De la Révolution aux Trois Glorieuses, les régimes les plus différents se sont succédé en France à un rythme exceptionnellement rapide: abolition de la monarchie, république, directoire, consulat, empire, restauration de la royauté, monarchie parlementaire, soit en moyenne un bouleversement politique tous les sept ans. Cela fait autant de politiques artistiques différentes, avec des arts officiels successifs et des résistances à chacun d’eux. Cette fois, les esthétiques opposées répondent largement à des idéologies et les chefs-d’œuvre sont souvent des manifestes: mystique révolutionnaire puis impériale chez David, religieuse chez Caspar David Friedrich, pour ne rien dire de la Liberté sur les barricades de Delacroix.
Chaque pouvoir imprimant rapidement sa marque sur le cadre de vie, des styles sont créés à la vitesse des modes, prenant le nom des régimes: Directoire, Consulat, Empire, Restauration, Charles X, Louis-Philippe.  En Allemagne et en Autriche, une rupture se produit avec le goût étranger, menant au style qu’on a nommé Biedermeier par dérision, en fait d’une audace et d’une modernité comparables à celles de la musique de Beethoven, avant qu’il ne finisse dans la mièvrerie. Mais une lassitude envers le présent se fait aussi jour. Les Anglais ont toujours eu à cœur leur architecture gothique et on passe progressivement de l’entretien ou de l’aménagement des monuments à l’imitation du style, en somme au néo-gothique. Les Allemands suivent bien avant les Français, mais la peinture de style Troubadour entre en scène dès l’Empire et des arcatures gothiques commencent à décorer les meubles sous Charles X. L’historicisme est né, formant une composante stylistique durable, souvent associée au catholicisme réactionnaire, mais de loin pas toujours.
En Allemagne et en Autriche, une rupture se produit avec le goût étranger, menant au style qu’on a nommé Biedermeier par dérision, en fait d’une audace et d’une modernité comparables à celles de la musique de Beethoven, avant qu’il ne finisse dans la mièvrerie. Mais une lassitude envers le présent se fait aussi jour. Les Anglais ont toujours eu à cœur leur architecture gothique et on passe progressivement de l’entretien ou de l’aménagement des monuments à l’imitation du style, en somme au néo-gothique. Les Allemands suivent bien avant les Français, mais la peinture de style Troubadour entre en scène dès l’Empire et des arcatures gothiques commencent à décorer les meubles sous Charles X. L’historicisme est né, formant une composante stylistique durable, souvent associée au catholicisme réactionnaire, mais de loin pas toujours.
Dans un tel contexte, le goût est chahuté entre des tendances incompatibles, comme en témoigne la querelle des classiques et des romantiques au théâtre et en peinture. Il ne s’agit pas d’une nouvelle querelle des Anciens et des Modernes, car de partout, le goût est dévalorisé au profit du génie. Face aux censeurs et aux critiques, les artistes, soutenus par leurs alliés, revendiquent l’autonomie qui permet à leur génie de s’exprimer.
L’art à l’époque industrielle
Une transformation bien plus profonde, dont les bouleversements politiques sont en grande partie les contrecoups, est en train de se produire: le développement du capitalisme. En effet, l’abolition de l’Ancien Régime est d’abord la fin d’un système institutionnel peu favorable à l’investissement productif et la Restauration n’est pas revenue sur la saisie des biens du clergé et de la noblesse. Il s’ensuit trois phénomènes dont les conséquences sur l’art furent progressives, mais dépassèrent de loin les changements précédemment analysés.
- Le développement de l’investissement et des moyens de production donne un autre débouché à la richesse que la dépense somptuaire. On construit certes toujours des églises et des palais, mais une part considérable de la fortune est investie, tandis que le paysage commence à se remplir d’usines.
- Le mode de vie aristocratique qui permet de cultiver un amateurisme de haut vol, celui de l' »honnête homme », musicien ou poète à ses heures, devient marginal. Le bourgeois du XIXe siècle a des préoccupations plus sérieuses et laisse l’apprentissage du piano aux jeunes filles.
- Les différents arts sont tous plus ou moins atteints par le mode de production industriel, à l’exception de la littérature (mais ni du papier, ni du livre). Cela est particulièrement sensible dans l’architecture et dans le mobilier; la peinture aussi est atteinte à travers la fabrication des couleurs. En sculpture, la taille directe régresse et la lithographie, peu coûteuse, domine la gravure.
L’interaction de ces trois facteurs est lourde de conséquences. Une évolution se dessine vers le bon marché, favorisée par l’évolution du mode de production. L’ameublement en donne un bon exemple. La qualité des dorures régresse avec l’apparition de succédanés de l’or comme la bronzine. Les épais placages sciés font place autour de 1830 aux placages tranchés, puis déroulés, économisant les bois coûteux, mais leur faisant perdre leur naturel. L’ornementation de plus en plus chargée et tape-à-l’œil se substitue à la qualité artisanale. En fait, le mobilier résiste mieux à la dégradation au fond des provinces, où les artisans continuent plus longtemps à utiliser leurs vieux gabarits et les méthodes traditionnelles qu’ils ont apprises.
La raréfaction de l' »honnête homme » se traduit par le face-à-face de l’artiste et du bourgeois, les artistes se considérant comme une aristocratie de l’esprit, d’où les incompréhensions mutuelles souvent notées par les contemporains. En réalités, les artistes s’adaptent le plus souvent à la nouvelle donne. Elle est évidente dans la mièvrerie croissante de l’art religieux ou encore dans la production tardive de Courbet qui contraste par son manque d’imagination avec les chefs-d’œuvre antérieurs du peintre.
L’évolution de la pratique musicale est à la fois complexe et significative. La virtuosité est de toutes les époques, mais la musique baroque reste pour l’essentiel accessible à un bon amateur, si on excepte des cas très particuliers comme l’art des castrats. Dans le cas du clavecin et du luth français au XVIIe siècle, le renoncement à la virtuosité au profit du raffinement harmonique et rythmique semble supposer que la virtuosité aurait été, de la part du musicien, une forme de pédantisme. L’apparition du concert payant commence en Angleterre, toujours en avance dans l’évolution de la période, au temps de Haendel. Elle entraîne avec le temps des salles toujours plus grandes, comme le montre la comparaison de trois d’entre elles à environ un siècle d’écart l’une de l’autre: l’opéra de Versailles, l’opéra Garnier et l’opéra Bastille. Surtout, la virtuosité devient essentielle dans la mesure où le spectacle se substitue à une pratique partagée et permet d’épater. 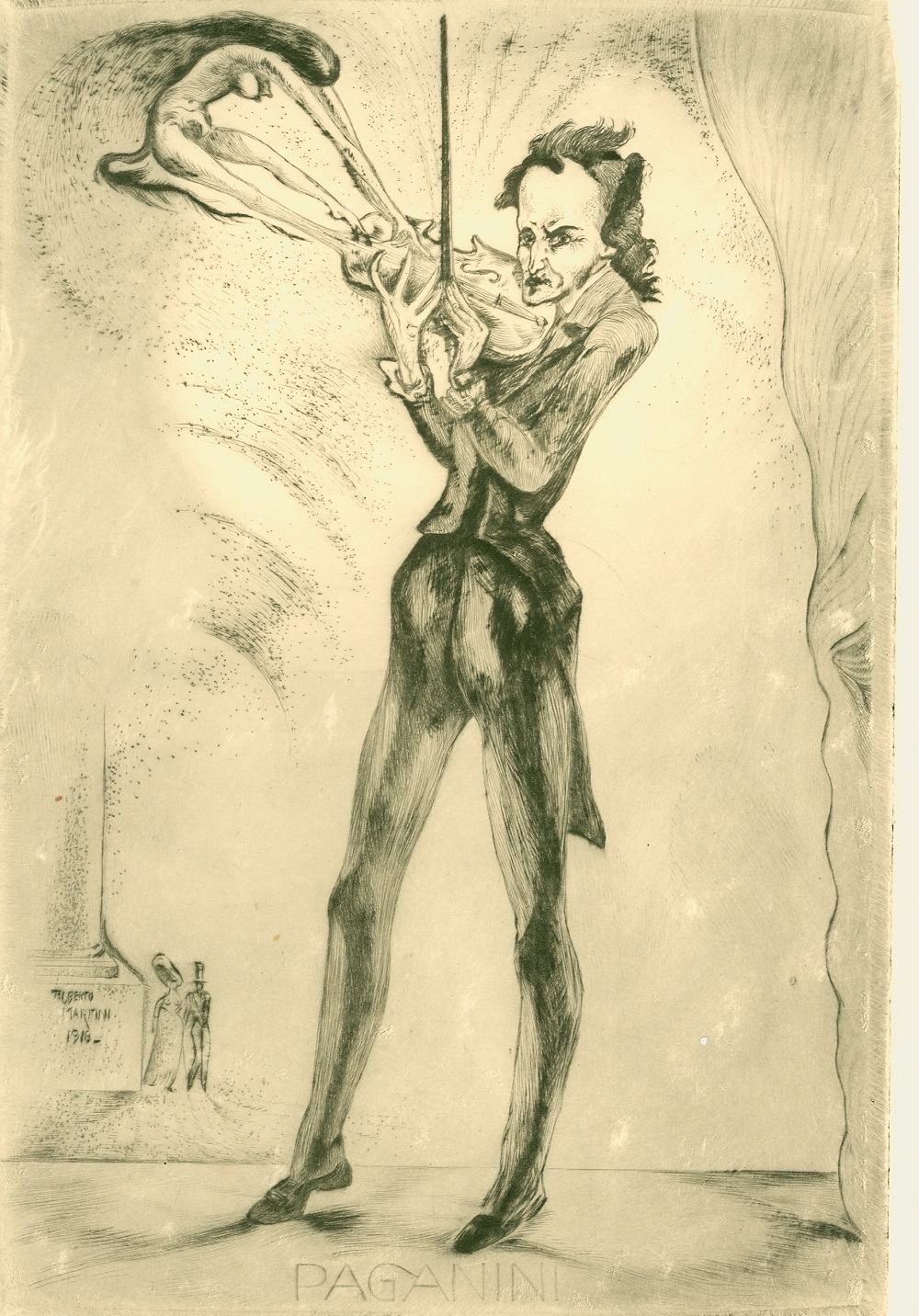 Cela concerne des compositeurs secondaires, comme Paganini, mais aussi les plus grands, à commencer par Beethoven. Enfin, un écart se creuse entre la complexité de la musique professionnelle qui élargit sans cesse son langage harmonique et les œuvres destinées au pianiste ou au guitariste amateur, conventionnelles et pauvres, avec des titres significatifs comme Bagatelles ou Petits riens. De manière générale, on peut parler d’une perte du juste milieu.
Cela concerne des compositeurs secondaires, comme Paganini, mais aussi les plus grands, à commencer par Beethoven. Enfin, un écart se creuse entre la complexité de la musique professionnelle qui élargit sans cesse son langage harmonique et les œuvres destinées au pianiste ou au guitariste amateur, conventionnelles et pauvres, avec des titres significatifs comme Bagatelles ou Petits riens. De manière générale, on peut parler d’une perte du juste milieu.
L’évolution rapide des pratiques artistiques a créé un malaise[27]. Dès qu’on met en rapport les arts et l’industrialisation, c’est ou bien pour affirmer leur incompatibilité de fait, ou bien pour dénoncer le risque d’une industrialisation des arts qui transformerait les œuvres en marchandises. Autour de 1830, ces idées sont devenues courantes et très explicites. Les articles consacrés à l’art dans le Dictionnaire de la conversation en 1833 sont révélateurs. Selon l’archéologue Charles Lenormant (1802-1859), « L’art en lui-même n’a aucun intérêt à reproduire deux ou plusieurs fois le même ouvrage: les procédés de multiplication sont même nuisibles en ce sens, que quelque parfaits qu’on les suppose, ils s’éloignent de plus en plus de l’œuvre qui a reçu directement l’impression de la pensée artistique; à plus forte raison quand le mode de reproduction altère cette pensée. On comprend dès lors quelle sorte de dangers nouveaux fait courir à l’art le progrès constant de l’industrie »[28].
Les choses sont encore plus claires chez Karl Marx, grâce aux notions de travail concret et abstrait. Une marchandise ne pouvant être vendue plus cher qu’une marchandise semblable, les qualités et le temps de travail réel de l’ouvrier qui la produit ne déterminent pas son prix. La valeur d’échange de la marchandise est en fait un temps de travail abstrait, celui d’un ouvrier moyennement qualifié qui ne se confond pas avec le travail concret d’un ouvrier particulier. La marchandise est donc le contraire exact de l’objet d’art, puisque celui-ci vaut par la qualité et la quantité du travail concret produit par un travailleur particulier.
Les textes de cette période montrent donc une intelligence claire des dangers qui menacent l’art, considéré à la suite de Hegel comme une faculté essentielle de l’homme. Le sentiment de l’aliénation est vif dans une génération qui hérite des exigences esthétiques et morales du XVIIIe siècle et qui voudrait encore les conserver et les réaliser. « Ce n’est que dans notre organisation moderne, écrit encore Lenormant, et quand la cohésion toujours croissante du lien social rend de plus en plus possible la division à l’infini des facultés humaines, qu’on comprend qu’il puisse exister des individus étrangers non seulement à la production, mais encore à la perception de l’art »[29].
Les doutes sur la situation des arts se nourrissent d’un intérêt renouvelé pour ceux du passé, avec en premier lieu une nouvelle attention à l’œuvre comme moment irremplaçable: l’accent est mis désormais sur la différence fondamentale entre le génie d’individus, de peuples ou d’époques différentes. L’histoire de l’art se met ainsi en place et rompt l’opposition duelle entre l’Antiquité et le présent. La connaissance de l’Antiquité a été renouvelée par les fouilles d’Herculanum et de Pompéi, puis par les travaux de Winckelmann, tandis que le Moyen Age fait l’objet d’une admiration croissante et que la découverte de l’Egypte pharaonique à travers une expédition militaire suscite un engouement dont le style Retour d’Egypte donne la mesure. Désormais, la critique de la situation artistique se nourrit du savoir historique, comme le montre un texte célèbre de Hegel, souvent édulcoré par l’exégèse philosophique:
A nos besoins spirituels, l’art ne procure plus la satisfaction que d’autres peuples y ont cherchée et trouvée […] C’est pourquoi on est porté de nos jours à se livrer à des réflexions, à des pensées sur l’art. Et l’art lui-même, tel qu’il est de nos jours, n’est que trop fait pour devenir un objet de pensées […] Les beaux jours de l’art grec et l’âge d’or du Moyen Age avancé sont révolus. Les conditions générales du temps présent ne sont guère favorables à l’art. L’artiste lui-même n’est pas seulement dérouté et contaminé par les réflexions qu’il entend formuler de plus en plus hautement autour de lui, par les opinions et jugements courants sur l’art, mais toute notre culture spirituelle est telle qu’il lui est impossible, même par un effort de volonté et de décision, de s’abstraire du monde qui s’agite autour de lui et des conditions où il se trouve engagé, à moins de refaire son éducation et de se retirer de ce monde dans une solitude où il puisse retrouver son paradis perdu.
Sous tous ces rapports, l’art reste pour nous, quant à sa suprême destination, une chose du passé. De ce fait, il a perdu pour nous tout ce qu’il avait d’authentiquement vrai et vivant, sa réalité et sa nécessité de jadis, et se trouve désormais relégué dans notre représentation[30].
Le chapitre de Hegel dont nous tirons ces passages pose des problèmes d’interprétation complexes. D’une part, l’Esthétique est une œuvre posthume, fondée sur des notes de cours. D’autre part, il faudrait se défaire de l’interprétation littérale et eschatologique des sentences hégéliennes sur la fin de ceci ou de cela et surtout sur la fin de l’histoire. Le philosophe ne s’imaginait certainement pas dans la situation du Juge divin à la fin des temps. Mais inversement, il ne nous semble pas possible de réduire le texte à une exagération polémique dont le seul but serait de pourfendre les romantiques.
Il est bien évident que Hegel ne proclame pas ici la fin objective de la production artistique. Il ne nous dit pas dans quel sens évoluera la production des objets. En disant que l’art est pour nous quelque chose du passé, Hegel constate un changement sémantique capital. Il ne s’agit pas d’une tentative philosophique pour définir l’art, mais de la prise en compte d’un fait.
La pensée de Hegel est historique. En l’occurrence, l’art n’y apparaît pas comme le produit d’une définition arbitraire par rapport à laquelle le devenir historique serait second, mais il est indissociable du concept qu’on s’en fait. Cette attitude lui permet de saisir l’évidence que nous qualifions d’art d’abord et essentiellement un legs du passé, celui-là même qu’on s’est mis à préserver dans les musées. Hegel aurait pu croire que le culte nostalgique du passé était un accident provoqué par un romantisme passager, mais il a compris qu’il était essentiel à la modernité. Le lien qui apparaît à l’aube de l’époque industrielle entre l’art et le passé n’a fait que se renforcer depuis. Déjà le romantisme, en forgeant la notion d' »art populaire », dépassait le concept hégélien de l’art. C’était désormais la totalité des objets légués par le passé, jusqu’aux plus modestes, qui s’offraient à l’admiration esthétique et dénonçaient le vide bruyant de la modernité.
Faute de prendre totalement en compte le romantisme, Hegel néglige un fait important: bien qu’on valorise l’art du passé, on utilise sans distinction le mot « art » en relation avec les œuvres du passé et du présent. C’est des hommes de la génération suivante, essayant d’échapper au romantisme, qui parviennent momentanément à dénoncer l’imposture. Ce que dit Champfleury de la poésie est une réponse cynique à Hegel qui apparaît soudain comme indulgent:
Ils sont deux ou trois cents qui tous les ans poussent régulièrement le même cri: La poésie est morte! « Allons, tant mieux », se dit l’honnête homme; mais ce n’est qu’une feinte: à la suite de ce cri tombe dans votre cabinet un volume gris, bleu ciel ou lilas, qui prouve que la poésie vit encore, qu’il y a encore des poètes et qu’il y en aura toujours. Non seulement les poètes ne diminuent pas, mais ils augmentent dans une progression effrayante: un statisticien avait calculé, d’après les tables mortuaires du Journal de la librairie, qu’en alignant les uns à côté des autres les feuillets des volumes de vers publiés depuis un demi-siècle, on obtiendrait une bande qui tiendrait l’Europe dans toute sa longueur.
La poésie ne peut mourir, trop de gens ont intérêt à la conserver. Qui chanterait l’avènement des rois, si le vers disparaissait? les prosateurs ne sont pas assez courtisans pour remplir ce métier. Qui ferait des cantates, aujourd’hui en faveur de la paix, demain en faveur de la guerre? qui acclamerait le roi, puis la république, puis l’empire? qui flatterait le peuple pour l’appeler roi? et qui le dirait esclave le jour suivant? personne, sinon les poètes[31].
Sur un ton badin, Champfleury met le doigt sur un fait irréductible et aussi actuel pour nous que le verdict hégélien: l' »art » pullule dans la société industrielle. On n’en a jamais fait autant.
L’adaptation immédiate, spontanée et simple à la réalité paradoxale que l’art est mort et qu’on n’arrête pas d’en produire est l’historicisme, un type d’imitation du passé qui diffère des pratiques antérieures, car il ne vise pas tant à reproduire ce qui, dans les œuvres du passé, serait le modèle d’une beauté immuable, qu’à faire revivre les beautés diverses et particulières des siècles révolus et à se donner l’illusion qu’on vit une époque plus belle, par exemple celle des chevaliers, des troubadours et des nobles dames. Le romantisme ainsi conçu peut passer pour une mode éphémère comme l’a peut-être cru Hegel, mais on montrerait facilement qu’il reste au centre de notre sensibilité esthétique, à condition toutefois de prendre en compte les formes artistiques moins prétentieuses que l’art des galeries, par exemple le cinéma et la bande dessinée. De surcroît, le poncif de l’artiste créateur en butte à l’incompréhension de ses contemporains nous fait oublier combien les plus grands romantiques sont historicistes et passéistes, ainsi Delacroix dont l’œuvre n’est pas moins tournée vers le passé que celle des Nazaréens ou des Préraphaélites. « Je n’ai nulle sympathie pour le temps présent, écrivait-il; les idées qui passionnent mes contemporains me laissent absolument froid: mes souvenirs et toutes mes prédilections sont pour le passé, et toutes mes études se tournent vers les chefs-d’œuvre des siècles écoulés »[32].
On a remarqué très tôt que cette nostalgie du passé, loin de faire revivre les grands moments de l’art, était une limite de leur imitation. Les artistes du passé ont vécu en leur temps et produit pour leur temps; il faudrait donc devenir moderne à son tour pour les imiter vraiment. Chez Stendhal[33], l’argument est dirigé contre le classicisme français et vise à justifier un théâtre qui met en scène des événements historiques susceptibles de toucher le spectateur moderne, mais chez Baudelaire, il est clairement dirigé contre l’historicisme. Baudelaire demande au peintre de représenter la beauté moderne comme on l’a toujours fait.
Cette exigence de modernité fait certainement partie de la notion d’art à l’époque industrielle, mais elle crée l’aporie: les œuvres contemporaines se détournent des modèles anciens, soit en se réduisant à des pastiches, soit en renonçant à la beauté par modernisme. Une lecture tant soit peu attentive de Baudelaire montre qu’il voyait les choses ainsi et que l’éloge qu’il fait de la modernité résonne d’un rire satanique. Le Salon de 1846 se termine par une péroraison sur « l’héroïsme de la vie moderne » que le peintre est invité à représenter, mais il succède à un chapitre qui dénonce la décadence des ateliers: « Là des écoles, ici des ouvriers émancipés »35. Surtout, il est de part en part sarcastique et va jusqu’à louer la beauté et l’héroïsme… des hommes politiques. Citons la conclusion qui ne laisse aucun doute sur l’intention du propos: « Car les héros de l’Iliade ne vont qu’à votre cheville, ô Vautrin, ô Rastignac, ô Birotteau, – et vous, ô Fontanarès, qui n’avez pas osé raconter au public vos douleurs sous le frac funèbre et convulsionné que nous endossons tous, – et vous, ô Honoré de Balzac, vous le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein! »[34].
En prenant comme cible Balzac dont il reconnaît par ailleurs le génie, Baudelaire veut signifier que l’aporie n’épargne personne, pas même les plus grands. En effet, l’artiste est lui-même un personnage moderne, l’un de ses propres personnages, et il l’est même lorsqu’il cherche à peindre autre chose que la vie moderne. Autant dire que les objectifs de grandeur et de noblesse, indissociables de la conception du beau, sont désormais hors d’atteinte. Plus profondément, il y a une contradiction entre le sentiment esthétique et la vérité (nous dirions aujourd’hui l’authenticité) à partir du courant réaliste, ce qui a conduit le philosophe Karl Rosenkranz à écrire son Esthétique du laid.
D’une part, une description impitoyable de la modernité de Balzac à Zola, d’autre part la fuite dans un passé moyenâgeux de chevaliers, de nobles dames, d’églises et de demeures néogothiques. Faire comme si tout cela n’était qu’une erreur subjective du XIXe siècle, ce serait faire passer à pertes et profits les ravages du capitalisme industriel.
La désintégration des éléments constitutifs de l’œuvre d’art
Dans la première partie de cet essai, nous avons défini le beau comme le produit d’une intégration. C’est désormais de désintégration qu’il s’agit. A partir du milieu du XIXe siècle, les éléments qui étaient constitutifs de l’œuvre d’art se mettent à se dissocier, laissant souvent le public perplexe. Le cas de la musique est exemplaire. La tonalité n’est pas un système universel, mais le produit d’une évolution de la modalité médiévale qui commence au début du XVIe siècle. Les modes se réduisent finalement à deux, le majeur et le mineur, les différentes gammes de chacun possédant la même succession de tons et de demi-tons. C’est Jean-Philippe Rameau qui a définitivement codifié le nouveau système, lequel s’est figé et n’a plus évolué depuis. La recherche postromantique du pathos s’en est accommodée, de Wagner à Mahler, en explorant ses limites par la multiplication des chromatismes et des dissonances. A partir du début du XXe siècle, Arnold Schönberg rompt avec la tonalité, puis adopte un nouveau système fondé sur la série des douze tons chromatiques, non hiérarchisés mais ordonnés en séries. Il s’agit en somme d’un langage musical totalement artificiel qui abolit l’alternance de tensions et de détentes par laquelle la musique engendrait des émotions. Il s’est maintenu avec des variantes dans un cercle étroit jusqu’aux années 1970 où le président Pompidou a vainement essayé de l’imposer en France à l’aide de la radio d’Etat, comme gage de modernité. Finalement, la musique de consommation courante repose toujours sur l’harmonie de Rameau, comme la musique dite classique sur laquelle il faudra revenir, la « création contemporaine » n’ayant cessé de perdre des adeptes.
Face à l’immobilisme tonal et à l’invention de systèmes sans rapport avec les attentes de l’auditeur, il y a eu des tentatives pour faire évoluer la tonalité, à l’aide d’emprunts au passé ou aux autres sociétés. On pense par exemple au Stravinsky de l’Entre-deux-guerres dont la Messe emprunte à la polyphonie modale du Moyen Age. Mais il s’agit toujours d’entreprises individuelles qui restent isolées, alors que les emprunts qui permettaient l’évolution musicale auparavant affectaient le style de nations entières, ainsi les échanges à l’intérieur de l’Europe à la Renaissance et à l’époque baroque, même lorsqu’ils procédaient au départ d’un individu, comme le florentin Lully à Versailles.
La peinture était moins codifiée que la musique, mais un certain nombre de consensus régnait, en particulier sur la perspective et sur la relative discrétion de la touche. Sur ce dernier point, on note un écart important entre la technique picturale de Delacroix et celle d’Ingres, mais tout cela reste dans des limites fixées par la tradition, la touche de Delacroix n’étant pas plus excentrique et même moins que celle de Giambattista Tiepolo au XVIIIe siècle. On observe ensuite un jeu incessant avec les limites, comme en musique.  Cela concerne les sujets chez Manet, la mise en cause de l’espace perspectif dans le japonisme, le grossissement de la touche qui devient une marque de fabrique chez Van Gogh et Cézanne, ou l’application d’une théorie optique discutable chez les pointillistes. Le cubisme qui prétend présenter les objets sous plusieurs points de vue à la fois, mais se contente de les disloquer est sans doute le point ultime de ce jeu.
Cela concerne les sujets chez Manet, la mise en cause de l’espace perspectif dans le japonisme, le grossissement de la touche qui devient une marque de fabrique chez Van Gogh et Cézanne, ou l’application d’une théorie optique discutable chez les pointillistes. Le cubisme qui prétend présenter les objets sous plusieurs points de vue à la fois, mais se contente de les disloquer est sans doute le point ultime de ce jeu.
L’étape suivante, comparable au sérialisme en musique, est l’abstraction, la fin de l’articulation de la peinture sur une réalité extérieure. Certes, comme on l’a vu, l’abstraction a toujours existé. L’ornement est fréquemment abstrait dans les cultures les plus diverses: l’architecture est abstraite en soi et loin d’avoir toujours eu un décor figuratif, tandis que la musique imitative est un phénomène secondaire. Ce qui est nouveau, c’est le rejet de la figuration sur des supports qui ont été inventés pour elle, à commencer par le tableau de chevalet. Or, la peinture figurative possède une composante irréductible à la figuration: la composition qui doit régler la disposition des formes et des couleurs, sans nuire à la vraisemblance mimétique. La composition est donc à la fois dissociée d’un contenu et libérée de la contrainte, commune à la toile figurative et aux arts appliqués, de s’articuler sur autre chose.
Une dissociation du même type apparaît progressivement entre recherche formelle et iconographie, comme si elles étaient incompatibles. Le cubisme, par exemple, recycle les ingrédients de la nature morte sans se préoccuper de renouveler l’iconographie du genre, puis le surréalisme mise sur le caractère surprenant des sujets oniriques en cherchant la neutralité de la touche et plus généralement de la forme, ainsi chez Delvaux ou Dali. Au contraire, Miró qui appartient au même mouvement conduit une recherche formelle jusqu’à l’abstraction. Enfin, l’hyperréalisme va jusqu’au bout de l’exactitude mimétique en s’aidant de la photographie, pour ne représenter que la banalité du quotidien.
Deux contraintes qui pesaient sur l’œuvre disparaissent à leur tour. L’une est l’exigence de convenance. Il y avait une hiérarchie des genres picturaux, de la peinture d’histoire à la nature morte, qui s’articulait sur celle des espaces d’accrochage, du bâtiment public au domicile privé, du salon à la chambre à coucher. En outre, qu’il s’agisse du sujet ou de son traitement, le goût exigeait d’éviter les choses déplaisantes, une exigence définitivement abandonnée avec l’expressionnisme. L’autre, à laquelle on a déjà fait allusion, est la qualité des matériaux. A mesure qu’on avance dans le temps, la tendance à la négliger devient sinon générale, du moins très fréquente, depuis les couleurs fabriquées industriellement jusqu’au dessin au stylo à bille sur papier acide. Les restaurateurs ne s’en plaignent pas, car il s’agit pour eux d’un débouché considérable.
Aucun des éléments constitutifs de l’œuvre d’art n’a disparu. Certains ont continué à pratiquer la perspective, comme De Chirico, la touche est loin d’être toujours insistante, la peinture figurative côtoie l’abstraction où les recherches formelles sont nombreuses, la convenance n’est plus une contrainte mais n’est pas interdite, les sculpteurs, contrairement aux peintres, peuvent être très exigeants sur le matériau. Il est donc impossible de définir l’art du XXe siècle par une caractéristique négative qui serait générale. Plus exactement, la seule caractéristique négative générale est la dissociation de ces éléments, comme s’ils s’excluaient mutuellement. Il y a donc une perte évidente du tout intégré que constitue l’œuvre d’art, une forme de désintégration de ce qui était reconnu comme le beau et qui l’est toujours par le commun des mortels. Que le constat en ait parfois été fait par les propagandistes des pires régimes politiques n’y change rien.
L’art contemporain
L’histoire de l’art fait débuter l’art contemporain vers 1800, tandis que les marchands, les critiques et les journalistes tendent à se fixer sur la fin de la seconde guerre mondiale. Les deux périodisations sont complètement décalées, la notion d’art moderne couvrant dans le premier cas la période 1500-1800, dans le second la période 1850-1945, en excluant la peinture dite académique. Il y a même actuellement une tendance à distinguer l’art de l’après-guerre de l’art contemporain, faisant débuter ce dernier vers 1980. En bonne logique, il faut bien définir comme contemporain l’art produit à partir d’une certaine date, mais, quelle que soit la date choisie, il s’agit d’un ensemble complètement hétérogène. 
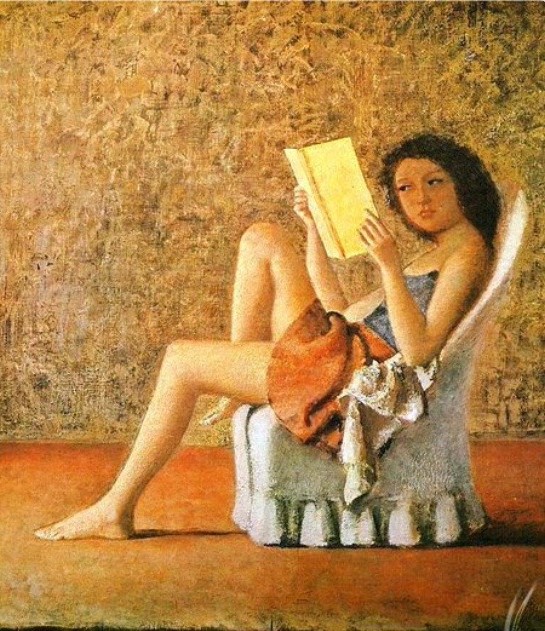 Songeons que la Fontaine de Duchamp est contemporaine des dernières œuvre de Jean-Paul Laurens et que, dans la seconde moitié du XXe siècle, Balthus produisait une peinture figurative encore proche de celle des Nabis, voire de Courbet. La disparition des critères de goût et des styles qui les satisfaisaient a en effet interdit toute évolution artistique collective et régulière, de sorte que la recherche de l’originalité et la répétition lassante des mêmes postures font bon ménage. Les tentatives de créer un nouveau langage, comme l’abstraction, ont fait leur temps, mais la provocation à la limite de la blague, telle que la pratiquait Duchamp, semble devenue constitutive de la notion d’art contemporain. Surtout, la référence au beau a disparu du discours des artistes, des critiques et finalement des historiens de l’art. Même pour les arts du passé, ils la considèrent implicitement comme subjective, désuète et inutile.
Songeons que la Fontaine de Duchamp est contemporaine des dernières œuvre de Jean-Paul Laurens et que, dans la seconde moitié du XXe siècle, Balthus produisait une peinture figurative encore proche de celle des Nabis, voire de Courbet. La disparition des critères de goût et des styles qui les satisfaisaient a en effet interdit toute évolution artistique collective et régulière, de sorte que la recherche de l’originalité et la répétition lassante des mêmes postures font bon ménage. Les tentatives de créer un nouveau langage, comme l’abstraction, ont fait leur temps, mais la provocation à la limite de la blague, telle que la pratiquait Duchamp, semble devenue constitutive de la notion d’art contemporain. Surtout, la référence au beau a disparu du discours des artistes, des critiques et finalement des historiens de l’art. Même pour les arts du passé, ils la considèrent implicitement comme subjective, désuète et inutile.
Il y a un contraste entre la place que l’art contemporain occupe dans les médias et la quantité de dépense publique ou privée qu’il représente. La presse met souvent l’accent sur les sommes fabuleuses atteintes en vente par certaines pièces, mais, malgré son augmentation ces dernières décennies, le marché de l’art a été évalué à 51,3 milliards d’euros en 2018, soit 12% du budget militaire américain de 2016, 10% du budget publicitaire mondial de 2017. L’art contemporain (depuis 1945) est supposé faire 31 % de ce montant, soit environ 16 milliards, nettement moins que l’art de la première moitié du siècle. Si l’on soustrait le coût certainement considérable du blanchiment d’argent sale, il s’agit d’un épiphénomène économiquement négligeable. Il faut donc essayer de rendre compte d’un emballement médiatique disproportionné.
 Bien sûr, il y a des causes évidentes: les acheteurs les plus en vue sont des milliardaires et leur mode de vie passionne le public. En outre, le prix atteint par des œuvres que les non-initiés considèrent le plus souvent comme des stupidités sans valeur attise la curiosité, ainsi que le scandale provoqué par l’exposition de ce genre de choses dans des lieux vénérables, comme le château de Versailles. Il y a deux siècles que les scandales artistiques se multiplient, de plus en plus codifiés, et qu’on ne s’en lasse pas.
Bien sûr, il y a des causes évidentes: les acheteurs les plus en vue sont des milliardaires et leur mode de vie passionne le public. En outre, le prix atteint par des œuvres que les non-initiés considèrent le plus souvent comme des stupidités sans valeur attise la curiosité, ainsi que le scandale provoqué par l’exposition de ce genre de choses dans des lieux vénérables, comme le château de Versailles. Il y a deux siècles que les scandales artistiques se multiplient, de plus en plus codifiés, et qu’on ne s’en lasse pas.
A l’époque de l’industrialisation, l’opposition était totale entre l’art, jugé inestimable, et la marchandise, faite pour l’échange, entre le mode de production artisanal de l’artiste et le travail mécanique d’un ouvrier aisément remplaçable. L’art prétendait surplomber le monde industriel et pouvait le mettre en accusation. Or l’évolution artistique de l’après-guerre accompagne la montée en puissance du capitalisme financier aux dépends du capitalisme industriel et l’opposition perd progressivement son sens. Les artistes l’ont compris, de sorte que certains ont imité l’objet industriel et que d’autres se sont mis à produire sur le mode industriel. En même temps, l’art s’est progressivement moulé sur le modèle financier, sa valeur d’échange dépendant de sa cote sur un marché, le modèle suivi étant celui des avoirs spéculatifs où un milieu d’initiés est à lui-même sa référence. Or les acteurs financiers sont les mêmes sur les deux marchés, de sorte que le marché de l’art dépend des aléas du marché financier et suit la même courbe, comme on l’a vu clairement en 2008.
Le phénomène a été assez bien perçu: il suffit de chercher sur l’internet les nombreux articles consacrés à la financiarisation de l’art pour s’en convaincre. Mais toutes ses implications ne semblent pas avoir été comprises. Comme le gain de l’artiste ne répond plus à la quantité ou à la qualité de sa production, mais est totalement spéculatif, le parallèle est évident entre d’une part la fixation arbitraire de la valeur et la création monétaire incontrôlée qui caractérisent le capitalisme financier et d’autre part, le rejet du beau comme critère de l’œuvre d’art qui mène à son tour la valeur artistique dans arbitraire. Le parallèle peut s’étendre à d’autres domaines: les épistémologues n’ont plus guère de critères de scientificité depuis qu’ils ont rejeté le dernier en date, celui de Popper, et ils tendent à se débarrasser du souci de définir la science en disant que c’est ce que font les scientifiques. Quant au droit, il suffit de voir l’état du droit international et des régimes fiscaux pour se convaincre qu’il n’est plus que celui du plus fort.
A partir du moment où la disparition des critères va de soi, l’art contemporain peut apparaître comme légitime.
Et, bien sûr, la légitimation est réciproque. L’achat d’art contemporain et la construction de musées privés ouverts au public permettent au milliardaire de se donner une allure de mécène aux dépens du fisc. L’adhésion sentimentale, voire religieuse, à l’art contemporain des gens « cultivés » les familiarise au rejet des critères de valeur, indispensable au fonctionnement d’un système social à la dérive et surtout à l’indifférence envers l’écologie. Enfin, en mettant sous le nom d’œuvres d’art des objets qui n’en ont plus les propriétés, on se rassure à bon compte: notre art est différent de ceux du passé, mais pas davantage que ceux du passé entre eux; ceux qui le contestent ne sont que des réactionnaires incultes; notre société vaut celles qui nous ont précédés et même bien plus grâce au progrès technique. Il est pénible d’entendre autour de soi un tel déni, y compris chez ceux qui se croient écologistes.
D’après Nathalie Heinrich, l’artiste contemporain est invité à transgresser, mais pas à faire n’importe quoi, contrairement à une opinion courante[35]. Il lui faut se distinguer de ce qui l’a précédé, c’est-à-dire maîtriser la culture complexe d’un milieu qui est à lui-même sa référence, ce qui peut l’amener à prendre sa tâche au sérieux. C’est certainement vrai des quelques centaines d’artistes qui réussissent, mais c’est oublier l’énorme prolétariat laborieux qui ne réussira jamais et la quantité de personnel dévoué à la cause et loin de faire fortune: les universitaires, les professeurs du secondaire, les instituteurs, les conservateurs de petits musées, les galeristes de petites villes et les « médiateurs culturels » qui pullulent. Grand nombre d’entre eux cumulent ces professions pour survivre. Eux aussi prennent leurs tâches au sérieux et sont sûrs de ne pas faire n’importe quoi, alors qu’ils ne maîtrisent pas le savoir des happy few. Que dire des pédagogues qui encouragent les enfants à « créer » au lieu d’apprendre à dessiner?
A la dissociation des éléments constitutifs de l’œuvre d’art s’est finalement ajouté un facteur nouveau: la négation du travail. Il est fondamental, car l’appréciation vulgaire de l’art est principalement celle du travail accompli. Certes, les critiques autorisés parlent fréquemment de travail à propos de l’œuvre d’art, mais il s’agit d’un emploi métaphorique. Cela recouvre principalement la recherche d’originalité, la réflexion sur les moyens d’étonner ou de scandaliser à peu de frais et d’autres spéculations de ce genre. Il est difficile d’imaginer un critique jugeant une œuvre sur la difficulté du travail accompli. Ce qu’on appelle normalement le travail est remplacé par une activité mystérieuse, la création.
La disparition du dessin, spécialement du dessin d’après nature, est caractéristique. Le dessin est sorti de l’apprentissage artistique et ne semble guère avoir droit de cité dans les expositions d’art contemporain. Cela ne s’explique pas par une disparition de la mimésis qui n’a jamais eu lieu. Le XXe siècle a produit beaucoup d’œuvres non mimétiques, mais il est probable qu’elles ne sont pas la majorité. En fait le dessin d’après nature était une discipline très exigeante, car la ressemblance implique l’exactitude. Il faut une parfaite maîtrise de la main pour réaliser un portrait ressemblant: il faut que le geste soit modulé pour produire exactement le tracé voulu. Dessiner, c’est faire ses gammes. Seul le dessin maîtrisé peut coucher une idée sur le papier sans la déformer. Cela vaut pour le dessin d’observation, pour le dessin d’imagination et non moins pour le dessin technique.
Ces remarques ne visent pas à rallumer la vieille querelle du dessin et du coloris, car la maîtrise de la touche colorée relève d’un apprentissage semblable. A la limite, la peinture est un dessin couvrant, différent du trait et qui complique la tâche en introduisant la composante chromatique. Cela explique le caractère propédeutique qu’on reconnaissait traditionnellement à l’apprentissage du dessin. Celui qui n’a pas appris à dessiner est incapable de s’exprimer visuellement et son œuvre ne peut exprimer une pensée s’il en a une. Autant l’introduction du dessin dans les programmes scolaires du XIXe siècle était un progrès de l’éducation, autant sa suppression au profit du barbouillage créatif fut un acte de barbarie.
L’esthétique industrielle
Loin des galeries d’art contemporain, il y a un domaine qui rappelle davantage l’ancienne conception de l’art: le design. En effet, on y retrouve le dessin, comme son nom l’indique, mais aussi le critère esthétique: il n’est pas déplacé de parler d’un beau design. La tâche du designer est assez comparable à celle d’un architecte ou d’un peintre confiant son dessin au graveur. Le principal changement par rapport au passé se produit ensuite, puisque la tâche suivante est industrialisée, qu’il s’agisse de matériaux préfabriqués dans la construction ou de la fabrication en série des automobiles. L’exigence de réduction des coûts entraîne à ce stade deux conséquences: l’utilisation du moins possible de travail humain, à plus forte raison spécialisé, et le choix des matériaux les moins coûteux, comme le béton et le plastique. Parler de fonctionnalisme est inadéquat, car l’adéquation fonctionnelle passe après le bon marché, tandis que le dépouillement stylistique simplifie le travail.
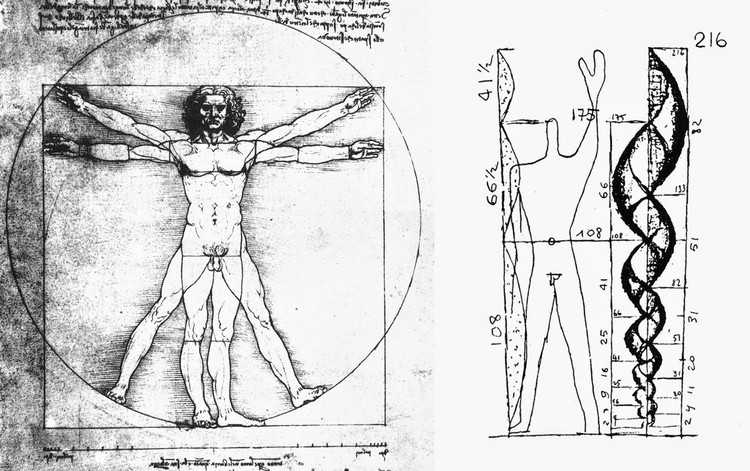 S’il suffisait de l’uniformité pour définir un style, notre habitat en aurait un. Il se caractérise depuis la première moitié du XXe siècle par la disparition de la pierre et du bois, le refus de l’ornement, la parcimonie des espaces, éventuellement légitimée par le modulor ésotérique du Corbusier, l’absence de toute hiérarchie des parties. Les portes sont des panneaux rectangulaires tous identiques, qu’elles ouvrent sur le salon, les toilettes ou la cuisine, lorsque la cuisine n’est pas dans le salon. Les murs sont blancs, ce que compense parfois le plastique du mobilier par des couleurs criardes.
S’il suffisait de l’uniformité pour définir un style, notre habitat en aurait un. Il se caractérise depuis la première moitié du XXe siècle par la disparition de la pierre et du bois, le refus de l’ornement, la parcimonie des espaces, éventuellement légitimée par le modulor ésotérique du Corbusier, l’absence de toute hiérarchie des parties. Les portes sont des panneaux rectangulaires tous identiques, qu’elles ouvrent sur le salon, les toilettes ou la cuisine, lorsque la cuisine n’est pas dans le salon. Les murs sont blancs, ce que compense parfois le plastique du mobilier par des couleurs criardes.
Le choix du moindre coût réagit en amont en maintenant le projet de l’architecte ou du designer dans d’étroites contraintes, mais il y a pire: l’obsolescence. Faire un produit peu durable oblige le consommateur à le renouveler souvent et est donc une source de profit pour l’industriel. Dans certains cas, il s’agit d’une simple conséquence de l’économie des coûts de production, mais cette obsolescence est souvent programmée pour que l’espérance de vie du produit ne dépasse pas sa garantie. A l’obsolescence technique s’ajoute une obsolescence esthétique. Le designer crée des modes très passagères pour que le produit devienne rapidement vieux jeu. Le phénomène est particulièrement évident dans la mode vestimentaire qui change chaque année et même chaque saison. Comme l’imagination des couturiers n’est pas infinie, il s’agit largement du recyclage des modes de la génération précédente, parfois d’un simple jeu de va-et-vient, les vestes rallongeant, puis raccourcissant. Compte tenu de la faible qualité des matériaux qui exclut les remplois, il n’est pas excessif de dire que le designer travaille pour remplir les poubelles.
Internationale Küche
Les règles d’aucune cuisine n’ont de justification absolue, pas plus que celles des styles artistiques. Les Chinois mêlent le sucré et le salé et se passent de dessert, tandis que nous n’utilisons l’aigre-doux qu’exceptionnellement, par exemple pour le gibier, et terminons le repas sur du sucré. Leur principal condiment est la sauce de soja, alors que c’est au Vietnam le nuoc-mâm, sans doute proche du garum des anciens Romains. Leur cuisine excluait et exclut encore largement les produits lactés. Comme les Italiens, ils utilisent le bouillon dans les sauces, alors que les Français préparent des fonds. On pourrait remplir des pages de ces différences qui ne sont pas forcément arbitraires au départ, mais le deviennent de toute manière lorsque leurs raisons d’être disparaissent.
Dans les décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale, la cuisine allemande était dévastée et s’est relevée moins vite que les villes. Beaucoup de restaurants se vantaient de faire de la cuisine internationale, Internationale Küche. C’était un mélange peu ragoûtant de traditions gastronomiques appauvries et incompatibles. De plus en plus aujourd’hui, en France comme ailleurs, des chefs étoilés mélangent allègrement les traditions culinaires et trouvent des clients enthousiastes. Il se produit ainsi une mondialisation de la cuisine qui trouve des équivalents dans les autres domaines artistiques. Cela mène à vive allure à une cuisine unique, sans principes, sans style et sans alternative. New York est le creuset où se retrouve et se diffuse une peinture mondialisée dans les mêmes conditions, tandis que l’architecture est depuis longtemps en tête de la course à la banalité prétentieuse. En somme, le métissage culturel fait bon ménage avec une xénophobie croissante. Dès lors, seul le passé pourrait encore servir de levier pour critiquer le présent et nous donner l’envie d’alternatives. Encore faudrait-il qu’il ne soit pas neutralisé.
![]()
L’art au passé
La valorisation de l’art ancien n’est pas un phénomène nouveau. Les Romains valorisaient l’art grec de l’époque classique, le Moyen Age admirait l’art antique, la Renaissance l’a pris comme modèle insurpassable et le néo-classicisme l’a revisité. Puis ce sont progressivement tous les arts anciens qui sont devenus source d’inspiration, à commencer par l’art médiéval. Les contemporains ont souvent reproché à leur art d’être inférieur ou insuffisamment fidèle à celui du passé: c’est la querelle des Anciens et des Modernes. Aussi, l’hostilité à l’art contemporain dans notre société apparaît-elle à un observateur superficiel comme une simple répétition de cette querelle par ceux pour qui c’était toujours mieux avant. On peut montrer facilement qu’il n’en est rien.
En effet, la querelle n’opposait pas des artistes du passé aux artistes vivants, mais les artistes contemporains entre eux, les uns reprochant aux autres de ne pas être suffisamment fidèles au modèle antique, ces derniers leur reprochant de ne pas voir qu’ils vivent dans un grand siècle. Il y a probablement ça ou là un artiste d’aujourd’hui qui prétend imiter les anciens, mais certainement pas un tel courant, la notion même d’imitation étant discréditée, qu’il s’agisse d’imiter la nature ou l’art. Le problème est principalement posé de l’extérieur de la sphère artistique: peut-on appeler « art » ce qui se fait aujourd’hui?
La notion d’art subsume aujourd’hui deux ensembles bien distincts, d’une part des œuvres du passé qui obéissaient à la finalité du beau, d’autre part des œuvres que cette finalité ne définit plus, mais qui prétendent au même statut. Pourquoi donc appeler du même nom d’œuvres d’art des objets qui sont la négation les uns des autres? Comme on l’a laissé entendre, il s’agit d’égaler le présent au passé, de nous persuader que nous vivons une époque civilisée et heureuse, de valoriser des produits qui se transformeront vite en déchets, y compris nos habitacles de béton pourrissant. Mais il y a un aspect de la situation que nous n’avons pas encore abordé: comment traitons-nous les œuvres du passé, lorsque nous prétendons les conserver?
Les tribulations de l’art fossile
En dehors de quelques provocateurs, personne ne met en doute la nécessité de conserver les œuvres d’art. On leur a appliqué la notion de patrimoine, car c’est bien d’un patrimoine qu’il s’agit, tantôt public, tantôt privé. En 1980, dans un essai fondateur, Jean-Pierre Babelon et André Chastel ont retracé l’évolution historique du choix des biens jugés dignes d’être conservés, jusqu’à la notion contemporaine de patrimoine[36]. Ils tentent de définir ainsi cette dernière: « Le patrimoine, au sens où on l’entend aujourd’hui dans le langage officiel et dans l’usage commun, est une notion toute récente, qui couvre de façon nécessairement vague, tous les biens, tous les ‘trésors’ du passé ». Cela paraît exact et, quoi qu’on en ait dit, n’exclut en rien le « patrimoine immatériel » qui est à la mode. Tout le problème est dans le « nécessairement vague ». On comprend bien sa raison d’être: le choix des objets à conserver et à transmettre a tant changé au cours des temps qu’il serait présomptueux de vouloir le fixer. Mais l’impossibilité de le faire ne serait pas un problème si l’on faisait des choix. Or, depuis cet essai, on a assisté à une extension de la notion de patrimoine qui conduit à vouloir conserver tout et n’importe quoi. Parmi les exemples de classement au titre des Monuments historiques en France, un article récent énumère les halles en béton de Reims, l’Arche de la Défense, un puits de mine semblable au décor d’un film tiré de Germinal, le voilier d’Eric Tabarly et la tauromachie camarguaise. « En revanche, la protection des grands sites historiques a cessé d’être prioritaire et le ministère toléra, voire encouragea, des projets de construction dans les abords de Chambord et de Versailles »[37].
Tout n’est sans doute pas à rejeter dans l’extension de la notion de patrimoine, y compris au patrimoine immatériel qui en fait ricaner plus d’un: la protection des savoir-faire est-elle moins importante que celle des œuvres? Mais il est sûr que vouloir trop protéger, c’est s’interdire de protéger sérieusement. Il faudrait donc des critères et on constate aisément que ceux-là même qui critiquent avec raison l’extension ne le font jamais avec les mêmes critères explicites ou implicites. Il y a pourtant, en dehors du critère esthétique sur lequel aucun accord ne se fera, une règle très simple qui serait assez facile à mettre en œuvre: conserver systématiquement ce qui n’est pas reproductible, le produit de savoir-faire disparus, en somme le préindustriel. Pour le reste, la protection ne peut être que sélective vu l’abondance et on laissera à ceux qui s’y intéressent le soin d’en fournir les critères. On peut objecter qu’un produit industriel qu’on ne fabrique plus est à son tour irremplaçable, mais cela paraît un sophisme. En remettre en route la production pour sauver des œuvres qui en sont jugées dignes a un coût, mais il n’est certainement pas comparable à la difficulté de restaurer et de conserver un savoir-faire artisanal dépourvu de rentabilité.
Le préindustriel est devenu beaucoup plus rare qu’on ne le croit. Un exemple suffira. Depuis plusieurs décennies on a détruit pour les remplacer les fenêtres de pratiquement tous les immeubles préindustriels dans l’indifférence générale, en tout cas de tous ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un classement: il suffit de se promener dans le quartier ancien d’une ville pour constater le massacre et découvrir de temps en temps une façade qui y a échappé, probablement grâce à la négligence de son propriétaire. L’isolation thermique est évidemment une nécessité écologique, mais il suffit de constater la proportion des immeubles préindustriels conservés, même quant aux seules façades, par rapport aux immeubles de béton, pour comprendre que le coût écologique de la préservation de leurs fenêtres n’aurait pas été considérable. Il l’aurait été d’autant moins lorsqu’il est possible de doubler discrètement le vitrage à l’extérieur en conservant la fenêtre. Avec des doubles fenêtres, il aurait été nul. Plus généralement, les destructions ont été telles que la protection de l’ensemble du patrimoine préindustriel bien conservé ne paraît plus hors de portée.
Quel que soit le sort qu’on réserve aux façades, il est admis en principe que le propriétaire d’un immeuble ne peut pas en faire ce qu’il veut: elles appartiennent aussi au public. Pour les intérieurs, c’est différent: en dehors des rares immeubles classés, le vandalisme est autorisé. Il l’est aussi d’ailleurs trop souvent pour les immeubles classés. Parmi les cas récents, le dépeçage déjà bien entamé du château de Pontchartrain, l’autorisation d’y lotir quatre-vingts appartements dans des conditions fiscalement avantageuses en est un bon exemple[38]: une mesure destinée à sauver des monuments est détournée pour en faciliter le saccage.
Du fait des intérêts financiers en jeu, à commencer par la spéculation sur le prix du mètre carré dans les centres urbains, le patrimoine immobilier est certainement le plus exposé. Sa visibilité peut contribuer à le protéger, faisant entrer en scène l’opinion publique, mais elle est aussi une cause de dégradation, car elle l’expose à un « geste architectural », destiné à montrer combien l’esthétique contemporaine entre en harmonie avec celles du passé, comme celui auquel semble avoir échappé la flèche de Notre-Dame de Paris, mais pas l’intérieur du monument. Dans l’ensemble, le patrimoine mobilier est davantage à l’abri. Il est en effet peu probable qu’une commode Louis XV soit restaurée avec des éléments de matière plastique ou qu’un tableau de la même époque le soit en couleurs fluorescentes. Il est de bon ton, depuis des décennies, de mêler le mobilier ancien et contemporain dans les appartements et de détruire la présentation chronologique des musées, mais ces pratiques ne semblent pas affecter la conservation des objets. En revanche, elles ont d’intéressantes déterminations idéologiques.
Vivre dans les meubles et les tableaux anciens, c’est forcément réactionnaire; vivre dans le contemporain, c’est ignorer le passé. Il y a quelques décennies, le bon goût consistait à couper la poire en deux soit avec des tableaux anciens et un mobilier contemporain, soit en faisant le contraire ou encore en mélangeant tout. Il s’agissait en somme de dire que, chez un esprit ouvert, la mémoire historique et la confiance dans le présent faisaient bon ménage. Aujourd’hui, il suffit de feuilleter dans une salle d’attente une revue de décoration et d’ameublement pour s’apercevoir qu’au moins 90% des modèles proposés sont radicalement contemporains, depuis la villa de béton avec cuisine dans le salon et piscine dans le jardin jusqu’au moindre meuble. C’est d’ailleurs aussi l’idéal que proposent les séries télévisées[39]. Quant à eux, les musées continuent à détruire l’ordre chronologique et ses subdivisions par écoles qui étaient certainement la présentation la plus sensée, en tout cas celle qui offrait à un visiteur de bonne volonté la possibilité de s’instruire. Ils ne peuvent pas s’affranchir de la présentation des œuvres anciennes les plus renommées: quelle serait la fréquentation du Louvre sans la Joconde? En revanche, les moins célèbres tendent à partir dans les réserves au profit d’expositions temporaires, d’espaces pédagogiques plus puérils qu’instructifs et bien sûr de chefs-d’œuvre contemporains. C’est ainsi que le Musée d’Art et d’Histoire de Genève avait pendant plusieurs années fait disparaître des cimaises la plupart des tableaux de l’intéressante école locale du début du XIXe siècle.
C’est dire que le moment où il s’agissait de mettre sur le même plan l’art préindustriel et l’art contemporain est sans doute dépassé, que le contemporain est devenu la référence. En témoigne l’évolution du marché des antiquités où le passé le plus proche fait recette, tandis que les antiquaires proprement dit se raréfient et que le cours de l’ancien s’effondre, en dehors de l’intérêt spéculatif pour les signatures prestigieuses. La presque totalité de ce qui est antérieur aux impressionnistes semble se perdre dans la préhistoire.
La musique et les arts du spectacle ont eu une évolution très différentes pour un résultat néanmoins comparable. Dès le XIXe siècle est apparue une nouvelle forme de musique, la musique « classique ». En fait les œuvres composées de Jean Sébastien Bach à Rossini sont restées au programme des concerts et ont fini par y prendre plus de place que les nouveautés qui déconcertaient de plus en plus les auditeurs. Au théâtre, celles de Corneille, de Molière et de Racine sont également restées en concurrence avec les auteurs contemporains et le restent aujourd’hui. Bien entendu, on ne jouait plus Bach sur les mêmes instruments, mais avec un orchestre romantique, puis post-romantique, qui l’adaptait au goût du jour, en modifiant profondément la sonorité et les phrasés. De manière peut-être moins sensible, les œuvres théâtrales se modernisaient. Aussi apparut une nouvelle notion du traitement des œuvres: l’interprétation. Le mot est encore considéré comme un néologisme par Littré qui cite l’Opinion nationale du 16 octobre 1874: « À chaque génération d’artistes, les œuvres de Corneille, de Racine, de Glück, de Mozart, se sont en quelque sorte renouvelées, transfigurées par une interprétation nouvelle, répondant aux idées et aux aspirations de chaque époque ». Au cours du XIXe siècle apparaît progressivement au théâtre et à l’opéra la mise en scène qui régit le jeu des acteurs au lieu de leur en laisser l’initiative dans les limites fixées par les didascalies de l’auteur. C’est probablement dû à la disparition des conventions stylistiques qui permettaient à un acteur de savoir ce qu’il avait à faire.
Depuis un demi-siècle, la mise en scène dénature de plus en plus les œuvres du passé dans deux directions. La première, prenant à tort ou à raison le spectateur comme inculte consiste à visualiser le sens du texte. Les élans amoureux que les auteurs classiques traduisaient par les mots donnent lieu à des pelotages au sol sur scène et, il y a quelques années, dans la bacchanale du Venusberg de Tannhäuser, un acteur pornographique avait été engagé au Grand Théâtre de Genève pour exhiber son érection parmi les nudités. La seconde consiste à actualiser l’œuvre en donnant à l’auteur des préoccupations les plus éloignées possibles des siennes. Le metteur en scène de Tannhäuser a fait depuis de Aïda une dénonciation précoce du colonialisme, tandis qu’un de ses collègues présentait une Carmen où l’héroïne, devenue féministe, tuait Don José. La musique est également affectée par ces excentricités. Dans une représentation du Platée de Rameau, j’ai entendu une charmante musette transformée en une espèce de danse macabre, jouée à une lenteur aussi sinistre que l’éclairage. Plus souvent, le remplacement de danses bien rythmées par des slows alanguis ramollit le coup d’archet et enlève toute leur vivacité aux chacones de l’opéra baroque. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas tant de conservation que d’une résurrection ratée.
La « démocratisation » de la culture
Du patrimoine architectural à l’opéra baroque, les problèmes semblent différents, mais la neutralisation du passé se nourrit des mêmes causes. Outre l’ignorance, qui en est aussi une conséquence, il y a la prétendue démocratisation de la culture. Du Front Populaire à André Malraux, nos dirigeants pensaient savoir ce qui était culture et ce qui ne l’était pas. Il s’agissait alors de faire partager la connaissance et la jouissance des œuvres jugées importantes au plus grand nombre. Mais le contenu de la notion de culture commençait à poser problème. Il y a avait bien sûr la difficulté d’y faire entrer l’art contemporain, mais sans doute plus profondément un impact de la notion anthropologique anglo-saxonne de culture, désignant la réalité des pratiques sans les hiérarchiser, de sorte que tout ce qui se fait est culture. Ce qui était la culture est donc devenu la culture bourgeoise à laquelle il fallait trouver des alternatives. Le maoïsme occidental rêva de révolution culturelle et les provocations de l’art contemporain devinrent des exploits révolutionnaires. Puis tout rentra dans l’ordre, l’adjectif « révolutionnaire » ne désignant plus guère que les méthodes permettant de « maximiser » les profits. Le legs du patrimoine se divisa en deux parts, celle qui était jugée rentable y trouva une nouvelle vocation, celle qui ne l’était pas ne fut plus entretenue que de manière aléatoire. A partir de là, on comprend facilement que les frontières du patrimoine soient devenues mouvantes.
Il n’est pas toujours facile de prévoir la rentabilité d’un objet patrimonial. Les musées exposent de préférence ce qui est censé plaire au public, pas forcément ce qui lui plaît. Les mises en scène ridicules d’opéras se font régulièrement siffler. Pour pallier ces inconvénients, il faut éduquer le public. C’est en partie le rôle de la presse qui défend très majoritairement les muséologies et les mises en scène d’avant-garde en dénonçant les mécontents comme autant de réactionnaires incultes. Dans le cas des musées, on les ouvre gratuitement à une clientèle captive, les classes d’écoliers, auxquelles on tente d’inculquer le goût de l’art contemporain par la médiation culturelle.
Tous ces efforts n’aboutissent guère qu’à retrouver la même classe sociale à l’opéra qu’il y a cinquante ans (mais avec une moyenne d’âge nettement plus élevée) et un afflux croissant de touristes au Louvre, à Versailles et au Mont-Saint-Michel. La concentration des touristes en quelques points a aussi du bon. Pour l’instant on peut visiter presque toutes les cathédrales gothiques françaises sans faire la queue. Dans les vieux musées de province, on est presque trop tranquille, car ils sont étrangement vides. Le problème ne concerne pas que la France. Il faut du courage pour visiter le Vatican ou la Villa Borghèse, mais on peut avoir la surprise à Vienne, pleine de touristes, de trouver une paix royale au Kunsthistorisches Museum, pourtant l’un des plus beaux musées du monde. Il doit y manquer de distractions.
Il y a donc lieu de s’interroger sur la notion de « démocratisation ». En remontant à la Révolution française, on lui trouve clairement un contenu: le transfert de la richesse foncière de l’Eglise et de la noblesse au Tiers Etat. Au siècle suivant, il y a l’école publique, gratuite et obligatoire, un transfert considérable de la richesse nationale vers les démunis. En 1945, nouveau transfert de richesse, la Sécurité sociale, mais c’est le dernier. Au lendemain de 1968 vient la prétendue démocratisation de l’enseignement, consistant à abaisser progressivement les exigences et à multiplier les universités surpeuplées et sans ressources. Un phénomène comparable accompagne le déploiement des supermarchés: le poulet, qu’on mangeait le dimanche, est désormais quotidien, grâce aux miracles de l’élevage industriel. La prétendue démocratisation de la culture n’est qu’une application parmi d’autres de la même recette, cuisinée par les didacticiens.
L’historien face à l’art
Les historiens de l’art n’ont pas vocation à résoudre les problèmes de notre société, mais la moindre des choses serait qu’ils ne passent pas à côté de leur objet sans le voir. Or, c’est bien ce que fait aujourd’hui une grande partie d’entre eux. Il y a plusieurs manières d’en arriver là, que nous avons évoquées par moment, mais qui demandent une analyse plus méthodique.
La première est le subjectivisme. On n’en convaincra que les convaincus, mais il importe de préciser que l’œuvre d’art existe en soi, avec ou sans spectateur. Les trésors de la tombe de Toutankhamon ne se sont pas envolés entre son enterrement et leur découverte en 1922. La négation de cette évidence est typique du point de vue du consommateur qui en a été privé entretemps. Plus sérieusement, on fait appel à la phénoménologie pour évacuer toute approche objective de l’œuvre, réputée impossible. La perception de chacun serait un filtre transformant l’œuvre dans son esprit et seul ce double mental de l’œuvre serait l’objet d’étude. La Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty (1944) est largement à l’origine de ce dogme en France. Elle a fini par conquérir les Etats-Unis, d’où elle est revenue en Europe il y a quelques années comme le dernier cri.
Qu’une personne âgée ait du mal à distinguer le bleu marine du noir est bien un problème de perception. En revanche, le fait que red en anglais ne soit pas la même couleur que « rouge » en français n’implique pas que les Anglais aient du mal à distinguer le rouge du jaune, car il ne s’agit plus d’un problème de perception, mais d’un fait de langage. En croyant nécessaire d’appréhender l’œuvre en termes de perception et en mettant n’importe quoi sur le compte de la perception, l’étude des œuvres s’efface pour dériver vers ce qu’en pense ou plutôt ce qu’est supposé en penser le spectateur. Il y a quelques décennies, une question assez courante portait sur ce qu’en pensait un prétendu spectateur moyen, mais maintenant, il s’agit de savoir ce qu’en pensaient des catégories de spectateurs: les paysans, les femmes ou les homosexuels. Passe encore qu’on se pose ces questions sur des œuvres récentes, mais elles sont à la mode chez les médiévistes, alors que le discours sur l’art est trop rare au Moyen Age pour qu’on puisse faire autre chose que l’inventer.
La seconde est fortement apparentée, car elle consiste à remplacer l’œuvre par sa réception. A moins que l’artiste ou son commanditaire soit un spécialiste en communication, la réception de l’œuvre ne détermine ni sa forme, ni son contenu. L’une et l’autre dérivent au contraire d’une volonté, de ce qu’Aloïs Riegl a appelé le Kunstwollen, laquelle peut être comprise ou non, approuvée ou contredite. Or cette volonté peut se déduire de l’œuvre dans toute la mesure où elle parvient à y répondre, autrement dit dans la mesure où elle est faite avec art et mérite le nom d’œuvre d’art. L’histoire de la réception des œuvres est évidemment indispensable, dès lors que nous devons comprendre comment elles ont survécu ou péri. Mais elle ne nous apprend rien sur leur essence, contrairement à leur étude matérielle qui permet de comprendre les modifications qu’elles ont subies et donc d’avoir une idée de leur aspect original.
La notion de Kunstwollen permet d’échapper au jugement spontané sur les œuvres, de saisir à quel idéal esthétique elles répondent au lieu de les confronter à d’autres exigences. Elle aide à comprendre les arts des autres sociétés, car elle nous en donne une approche bienveillante que le passé n’a pas toujours eue. Mais elle peut entraîner deux dérives solidaires: un relativisme pour lequel tout se vaut et un idéalisme qui ignore les aléas qu’affronte toute pratique.
Le relativisme égalitaire est à la mode et il suffit d’attribuer toute différence de qualité entre deux œuvres à un Kunstwollen différent pour la nier. Tel que l’a instauré la Révolution, l’égalitarisme supprimait les privilèges de la noblesse et du clergé, afin que chaque citoyen ait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ainsi conçu, il est toujours d’actualité à un moment où les plus riches échappent à l’impôt comme ils le faisaient sous l’Ancien Régime. Mais un autre égalitarisme est né, celui selon lequel les œuvres des uns et des autres se valent. Or, que l’on attribue le talent à des facteurs innés ou à une situation sociale, cela reste faux. Il est de bon ton d’interdire aux historiens les jugements de valeur, explicites ou implicites, et beaucoup prétendent ne pas en faire. En réalité, s’ils étaient conséquents, ils étudieraient pêle-mêle les œuvres des artistes renommés, des peintres du dimanche et des enfants. Mais comment se fait-il qu’ils confondent rarement un tableau célèbre avec l’une ou l’autre de ses nombreuses copies? C’est très simple: les connaisseurs qui, eux, ne se privent pas de jugements de valeur ont fait le tri et il suffit le plus souvent de reprendre la légende d’une photographie dans un ouvrage spécialisé pour savoir où est l’original.
Comprenons-nous bien: il n’est pas question de promouvoir une histoire de l’art qui consisterait à manifester son admiration pour les grands artistes avec le lyrisme qui était à la mode naguère, en réaction contre l’iconoclasme soixante-huitard. Mais on ne peut faire abstraction de la hiérarchie des œuvres. Le goût de l’Entre-deux-guerres s’est volontiers porté sur la nature morte de l’époque moderne. C’est un choix parfaitement respectable, à condition de garder à l’esprit que le peintre de natures mortes était le plus souvent celui qui ne parvenait pas à s’imposer dans les genres majeurs, comme la peinture d’histoire.  A la fin de la vie de Bernard Buffet, la côte de ses œuvres s’est effondrée. On peut supposer qu’il s’agissait d’un grand artiste, victime d’une évolution de la mode ou d’un faiseur, ce dont le public aurait fini par se rendre compte. On peut encore renvoyer le peintre et son public dos-à-dos en considérant que la nullité de l’un n’a d’égale que la versatilité de l’autre. Le choix de l’un ou de l’autre de ces jugements de valeur est inévitable, à moins de renoncer à comprendre ce qui s’est passé.
A la fin de la vie de Bernard Buffet, la côte de ses œuvres s’est effondrée. On peut supposer qu’il s’agissait d’un grand artiste, victime d’une évolution de la mode ou d’un faiseur, ce dont le public aurait fini par se rendre compte. On peut encore renvoyer le peintre et son public dos-à-dos en considérant que la nullité de l’un n’a d’égale que la versatilité de l’autre. Le choix de l’un ou de l’autre de ces jugements de valeur est inévitable, à moins de renoncer à comprendre ce qui s’est passé.
Pour prendre encore un exemple, l’histoire des arts européens du Moyen Age et de l’époque moderne est caractérisée par des transferts massifs d’artistes et de styles d’un pays à l’autre, comme la diffusion de l’architecture gothique hors de France, le succès international des musiciens franco-flamands, celui de l’art italien de la Renaissance, du modèle architectural de Versailles et ainsi de suite. Il y a aussi les résistances, comme celle de l’opéra lullyste au XVIIIe siècle face aux nouveautés venues d’Italie. Chacun de ces phénomènes est susceptible d’une analyse en termes socio-politiques, comme traduction d’alliances entre pouvoirs ou simplement du prestige d’un régime, voire même en termes d’effets de mode. Mais de telles analyses sont toujours biaisées lorsqu’elles ne prennent pas en considération la valeur des artistes, car seule cette prise en considération permet de pondérer les autres facteurs.
Il s’agit bien sûr ici de la valeur que leurs contemporains leur conféraient et qu’on peut déduire aisément des commandes qu’ils recevaient et des protections dont ils jouissaient. Il est donc facile d’objecter que cette valeur est aléatoire, en rappelant l’exemple de Bernard Buffet. Mais l’expérience montre que, pour l’art préindustriel, l’objection est assez vaine. L’artiste maudit est une création du XIXe siècle. On a parfois voulu voir Jérôme Bosch ainsi, mais il recevait les commandes de princes. Nous avons fait état de la carrière modeste de Jean-Sébastien Bach, due à son refus du style galant, mais c’est une attitude rare qui n’empêchait pas l’admiration de ses contemporains, à commencer par celle du roi de Prusse. Les artistes célèbres de leur temps sont généralement ceux que nous préférons encore aujourd’hui: personne ne contesterait le choix des frères Limbourg par le duc de Berry et celui de Michel Ange par les papes. On ne saurait y voir un simple mimétisme, sans quoi nous reproduirions toujours le jugement des contemporains: nos appréciations sur l’art de l’époque industrielle ne correspondent guère aux leurs et ne cessent de fluctuer, ainsi quant aux peintres dits « pompiers ».
Concevoir l’œuvre comme le produit d’un Kunstwollen peut mener à une seconde impasse, souvent solidaire du relativisme, une vision idéaliste de l’œuvre, négligeant la difficulté du métier et les contingences matérielles. Que l’œuvre soit le produit d’une volonté artistique ne veut pas dire qu’elle en soit le reflet. Elle peut l’être si l’exécution est parfaite ou si cette volonté n’est pas ambitieuse (il n’est pas trop difficile de réussir un monochrome et le projet de l’art conceptuel est effectivement transparent). Mais, entre le dessein d’un commanditaire et sa réalisation s’interposent sa compréhension par l’artiste, les moyens humains et matériels de le réaliser, souvent aussi des obstacles imprévus. Le Kunstwollen peut se déduire de l’œuvre, à condition d’avoir pris en considération ces facteurs, inévitables, par exemple, sur de longs chantiers architecturaux. Mais ils sont trop souvent négligés, en particulier par la recherche iconographique qui parvient toujours à trouver un programme unitaire lorsqu’il n’y en a pas.
L’interdit sur les jugements de valeur et la négligence de l’aspect technique ne sont pas caractéristiques de la conception actuelle de l’art par hasard. L’un et l’autre empêchent tout questionnement sur le niveau artistique de l’art contemporain. Mais ils affectent toute l’histoire de l’art. Un bon exemple en est fourni par le passage de l’art roman à l’art gothique. Il serait absurde de nier le progrès technique de l’architecture dans cette période et personne ne le fait. Mais cela n’affecte en rien l’appréciation esthétique, parce que l’art est implicitement défini aujourd’hui comme indépendant de la technique. Une véritable révolution de l’art figuratif a eu lieu vers 1200, le retour du dessin d’après nature qui avait disparu à la fin de l’Antiquité. On constatera aisément qu’on peut écrire des synthèses sur l’art médiéval en l’ignorant ou, pire encore, en le retardant de deux siècles. Dire qu’il s’agit d’un progrès artistique scandalise, ce qui se comprend facilement: l’art roman a suscité un véritable engouement dans la seconde moitié du XXe siècle. En témoigne par exemple la popularité de la collection Zodiaque dont il n’existe aucun véritable équivalent pour l’art gothique. Il faudrait être bien naïf pour ne pas mettre cet intérêt en rapport avec le succès populaire assez tardif de l’expressionnisme et du cubisme. Il s’agit là d’un phénomène que nous avons déjà relevé, par exemple entre avoirs spéculatifs et cote des artistes: la légitimation réciproque.
![]()
Conclusion
L’idéologie du Progrès qui a survécu aux deux guerres mondiales et s’est encore renforcée pendant les « trente glorieuses » qui ont suivi la seconde, est aujourd’hui mise à mal, car le prétendu Progrès était gagé sur la destruction de l’écosystème. Elle n’est pas pour autant à terre. On continue de mesurer avec satisfaction toute croissance de la production et des échanges et d’en déplorer toute décroissance.
Aucun esprit auquel il reste un minimum de raison ne peut accepter le développement incontrôlé d’un capitalisme financier autonome qui dicte ses volontés aux Etats. Ce capitalisme est aujourd’hui sclérosé. Captif d’actionnaires exigeant des gains immédiats, il ne peu se permettre aucun plan à long terme et les gouvernements qu’il contrôle à son tour repoussent aux lendemains les mesures écologiques les plus urgentes. Mais aucune alternative crédible au capitalisme, susceptible de mobiliser les esprits dans un projet révolutionnaire, n’a été pensée depuis Marx, qui n’est plus à jour. Le mécontentement est mondial, peut déboucher sur des révoltes comme en France depuis quelques années, mais sans aucune idéologie de substitution susceptible de transformer une révolte en révolution. Au contraire, plusieurs pays importants ont aujourd’hui mis à leur tête des clowns irresponsables.
La science a longtemps servi de démarcation entre la vérité et l’imposture, mais elle est de plus en plus incapable de le faire. La confusion s’est en effet installée progressivement entre science et technologie, menant à un pragmatisme effréné. Il ne s’agit plus tant d’un savoir que d’un moyen de faire vendre. Elle s’est largement privatisée: les Etats finançant les groupes industriels pour la produire conforme à leurs intérêts commerciaux, au lieu d’en assurer la neutralité. Au début de ce siècle, on en est arrivé à la non-reproductibilité d’environ 70% des expériences scientifiques, ce qui n’est certainement pas sans rapport avec la privatisation croissante, sans que ce rapport se réduise à une relation de cause à effet[40]. Le mode de financement de la recherche, privilégiant les résultats rapides à tout prix, suscite déjà à lui seul un travail bâclé ou malhonnête. Quant aux experts « scientifiques » chargés d’évaluer l’innocuité ou la toxicité d’un produit, ils appartiennent la plupart du temps aux entreprises qui l’ont mis sur le marché. Il s’ensuit un scepticisme de principe envers des « scientifiques » qui ne sont plus des savants, mais se présentent comme des oracles et fustigent toute critique comme irrationaliste et superstitieuse. Le débat sur la vaccination en est un bon exemple, car toutes les objections, de la plus loufoque à la plus sérieuse, sont traitées ainsi.
La philosophie et les sciences humaines ne sont pas d’un grand secours dans cette situation. Le complexe d’infériorité face aux « sciences dures » les rend crédules envers elles, mais surtout, elles ont de moins en moins la possibilité de remplir leur tâche. Ma génération est la dernière à avoir connu de vraies carrières d’enseignants chercheurs. Celle d’aujourd’hui passe son temps dans des commissions pour se disputer quelques demi-postes de vacataires et appliquer tous les six mois une nouvelle réforme de l’enseignement, inventée par des didacticiens managériaux. Le seul moyen pour les plus habiles d’échapper à la prolétarisation est de pratiquer le vedettariat sous prétexte de vulgarisation, en laissant s’effondrer l’Université.
Si l’économie consistait à l’origine à bien gérer les ressources, si la science cherchait à connaître l’homme et le monde et non à les manipuler, nous avons vu que l’art a lui aussi perdu sa finalité qui était le beau. Qu’il soit au service des coteries de dominants, comme on le souligne souvent, n’est pas le problème: il en a toujours été ainsi. Qu’il joue par conséquent un rôle idéologique au profit des mêmes dominants ne l’est pas davantage. Imagine-t-on un art médiéval qui ne serait pas largement celui de l’Eglise ou un art du Grand Siècle qui ne ferait pas l’apologie de Louis XIV? Le vrai problème est qu’aucune classe dominante n’a été aussi nocive que la nôtre et que son art sert à cautionner le pire. Nous savons que les orientations dans lesquelles elle nous a engagés au nom d’un prétendu progrès nous ont menés à la catastrophe, mais nous n’élevons que des protestations timides et partielles contre l’esthétique qui en est issue et les cautionne.
« On peut toujours rêver », disent parfois les étudiants confrontés à des propos pessimistes. Alors, faisons un rêve! Face aux phénomènes climatiques extrêmes, à la désertification, aux famines, aux épidémies qui font le tour de monde en quelques jours et aux accidents nucléaires, les Etats changent de politique, brident les multinationales, cessent les jeux militaires aussi sanguinaires que coûteux et décident de s’entendre pour financer la transition écologique. L’humanité est sauvée de justesse. On essaie de rendre à la science sa dignité et de restaurer l’éducation. Disposant désormais d’une véritable information, les citoyens ont compris que le prétendu progrès était une lente plongée dans la barbarie et recommencent à s’intéresser au passé, non pas pour le dénaturer, mais pour redécouvrir ce qu’il avait d’admirable. Dans ces conditions, un peu semblables à celles du monde 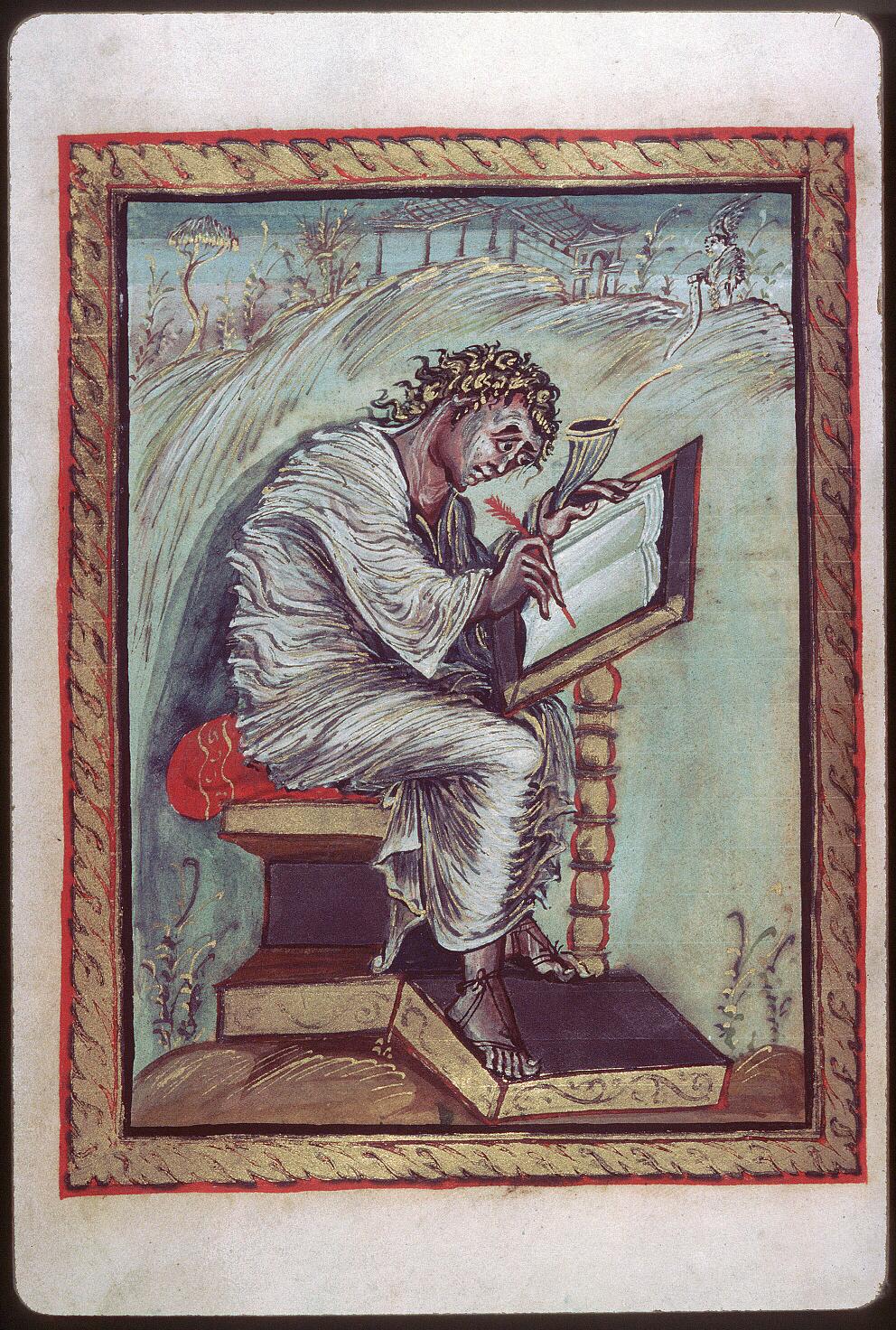
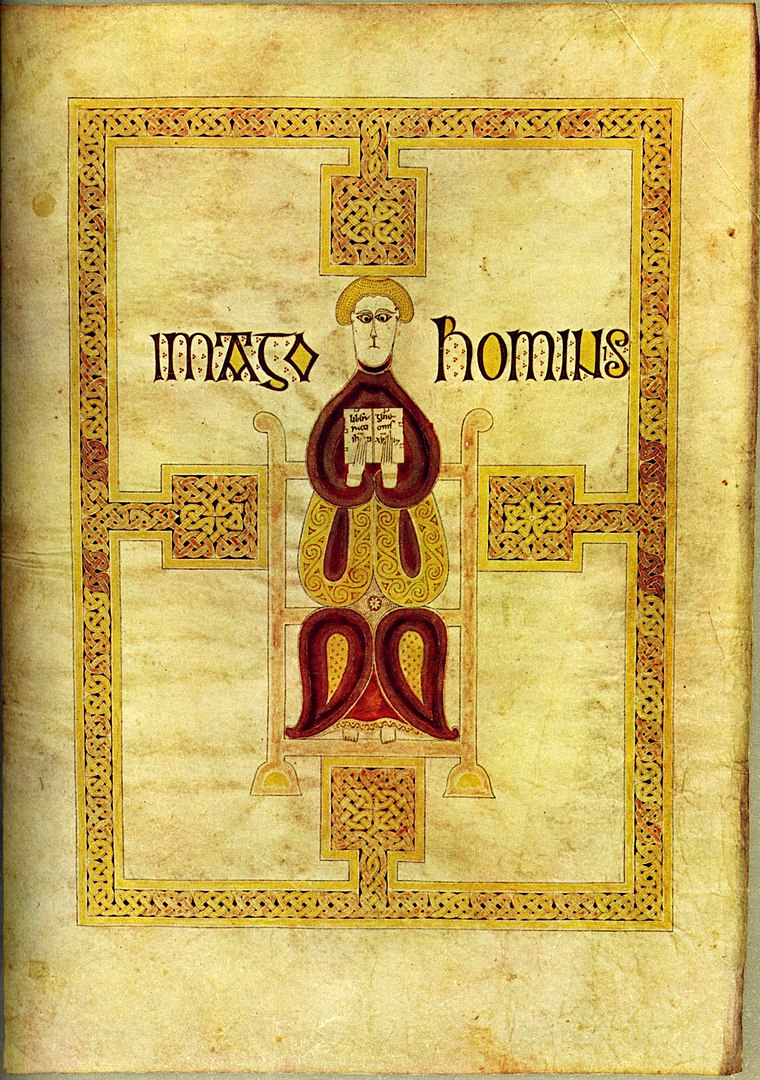 mérovingien, le passé devient synonyme de grandeur et on en imite les arts comme on peut. A mesure que les choses progressent – cette fois-ci pour de bon, comme à l’époque carolingienne – une nouvelle culture et des productions artistiques de haut niveau, originales sans chercher l’originalité, récompensent l’humilité et l’effort…
mérovingien, le passé devient synonyme de grandeur et on en imite les arts comme on peut. A mesure que les choses progressent – cette fois-ci pour de bon, comme à l’époque carolingienne – une nouvelle culture et des productions artistiques de haut niveau, originales sans chercher l’originalité, récompensent l’humilité et l’effort…
![]()
Notes
- Karl Rosenkranz, Die Ästhetik des Hässlichen, 1853 (trad. Esthétique du laid, Belval, 2004). ↑
- Albert le Grand, De animalibus, l. 1, tract. 3, c. 1. ↑
- Jean Wirth, Qu’est-ce qu’une image?, Genève, Droz, 2013. ↑
- Saint Bernard, Apologia ad Guillelmum, c. 12 (Opera, éd. Jean Leclercq, Charles Hugh Talbot, Henri Rochais, Rome, 1957-1977, t. 3, p. 106). ↑
- Saint Bonaventure, Commentaria in quatuor libros Sententiarum, l. 1, dist. 31, p. 2, a. 1, q. 3. ↑
- Alexandre de Hales, Summa theologica, l. 2, pars 1, inq. 4, tract. 2, sect. 2, q. 1, tit. 1, c. 3. ↑
- Emmanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790; traduction de Jacques Auxenfants, Critique du jugement, Chicoutimi, 2019, § 53, p. 330. ↑
- Saint Thomas, Somme théologique, l. 1, q. 5, a. 4, ad 1. ↑
- On peut renvoyer aux excellentes pages d’Edgar De Bruyne, Etudes d’esthétique médiévale, rééd. Paris, 1998, t. 2, p. 281 et ss. 10 Id. 291-293. ↑
- Aristote, Poétique, 1448b (trad. Joseph Hardy). ↑
- Id., 1449b et 1453b. ↑
- Jan Lavićka, Anthologie hussite de la scholastique à la Réforme, Paris, 1985, p. 122. ↑
- Stendhal, Racine et Shakespeare. Etudes sur le romantisme, éd. Roger Fayolle, Paris, 1970, p. 58. ↑
- Jean Wirth, L’image à l’époque gothique (1140-1280), Paris, 2008, p. 117 et ss. ↑
- Kant op. cit., § 2, p. 204 et s. Le mot traduit ici par « représentation » est Vorstellung. Il s’agit de la perception que l’on a de l’objet et non pas d’une description de l’objet par des mots ou des images, pour laquelle le mot allemand est Darstellung. ↑
- Roger de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, 1708, p. 489 et ss. ↑
- Notons au passage que le même type de raisonnement vaut pour la restauration d’une peinture ou d’une sculpture, mais le cas est déontologiquement complexe lorsqu’il s’agit d’une intervention irréversible. ↑
- Charles Bernet, Le Vocabulaire des tragédies de Jean Racine. Analyse statistique, Paris, 1983. ↑
- Serge Gut, « La notion de consonance chez les théoriciens du Moyen Age », Acta Musicologica, t. 48 (1976), p. 20-44. ↑
- Carole Guibet-Lafaye; « Le dépassement du jugement de goût », Philosophique, t. 7 (2004), p. 47-61. ↑
- Roger Caillois, Le mimétisme animal, Paris, 1963. ↑
- Les théories de la complexité. Autour de l’œuvre d’Henri Atlan, dir. Françoise Fogelman Soulié, Paris, 1991. ↑
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique, trad. Samuel Jankélévitch, Paris, 1979, t. 1, p. 34 et ss. ↑
- Jean Wirth, « Sur le statut de l’objet d’art au Moyen Age », repris dans: Art et image au Moyen Age, Genève, 2022, p. 15-32. ↑
- Marion Muller-Dufeu, « Créer du vivant », Sculpteurs et artistes dans l’Antiquité grecque, Villeneuve-d’Ascq, 2011. ↑
- Frédéric Elsig, Jheronimus Bosch. La question de la chronologie, Genève, 2004. ↑
- Les pages qui suivent reprennent partiellement: « L’ʻartʼ, une notion contradictoire », in: Mort de Dieu. Fin de l’art, éd. Daniel Payot, Paris, Cerf, 1991, p. 109-129. ↑
- Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Paris, 1832-1851, t. 3, p. 191. ↑
- Id., t. 3, p. 188. ↑
- Hegel, op. cit., t. 1, p. 27, 33 et s. ↑
- Champfleury, Le réalisme, Paris, 1857 (reprint Genève, 1967), p. 18 et s. ↑
- Eugène Delacroix, Journal, éd. Paul Fiat et René Piot, Paris, 1893, t. 1, p. 151 (lundi 28 mars 1853). ↑
- Stendhal, Racine et Shakespeare, éd. Roger Fayolle, Paris, 1970, en particulier chap. 3, p. 71 et ss. 35 Charles Baudelaire, Salon de 1846, chap. 17 (Œuvres complètes, éd. Yves-Gérard Le Dantec, rééd. Paris, 1966, p. 946 et ss). ↑
- Id., chap. 18 (op. cit., p. 952). ↑
- Nathalie Heinrich, Le triple jeu de l’art contemporain, Paris, 1998. ↑
- Jean-Pierre Babelon et André Chastel, La notion de patrimoine, rééd. Paris, 1994. ↑
- Maryvone de Saint-Pulgent, « Le patrimoine au risque de l’instant », Cahiers de médiologie, t. 11 (2001), p. 303-309. ↑
- Voir les deux articles de Julien Lacaze, le 25 et le 28 février 2020 dans la Tribune de l’art: https://www.latribunedelart.com/chateau-de-pontchartrain (consulté le 17 août 2020). ↑
- Ne regardant pas la télévision, je ne m’en serais pas aperçu sans une remarque amicale et éclairante de Marc Schurr. ↑
- Le problème a été révélé en 2005 par l’article désormais célèbre de John P. A. Ioannidis, « Why Most Published Research Findings Are False », PLoS Med 2(8): https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124 (consulté le 20 août 2020). Bon état de la question dans: EPRIST, « La recherche en crise de reproductibilité? », Analyse I/IST n° 30 (avril 2020). ↑


 2. Saint Louis, église de Mainneville (Thierry Leroy/Inventaire)
2. Saint Louis, église de Mainneville (Thierry Leroy/Inventaire) 3. Vierge à l’Enfant, église d’Écouis (S.W.)
3. Vierge à l’Enfant, église d’Écouis (S.W.) 4. Vierge de Mainneville (détail, S.W.)
4. Vierge de Mainneville (détail, S.W.) 5. Saint Louis de Mainneville (détail, S.W.)
5. Saint Louis de Mainneville (détail, S.W.)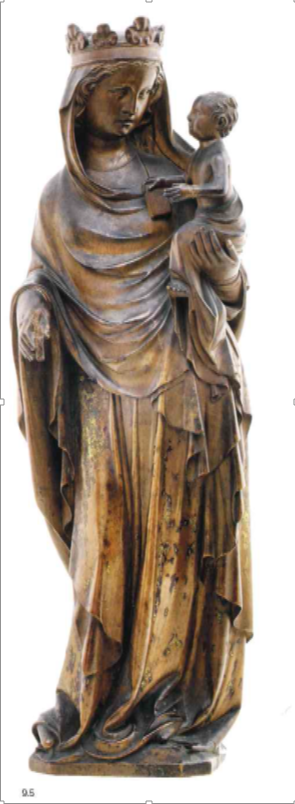 6. Vierge à l’Enfant, Anvers, Musée Mayer van den Bergh (musée)
6. Vierge à l’Enfant, Anvers, Musée Mayer van den Bergh (musée) 7. Vierge à l’Enfant Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée)
7. Vierge à l’Enfant Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée) 8. Vierge de Meulan, Baltimore, Walters Art Gallery (musée)
8. Vierge de Meulan, Baltimore, Walters Art Gallery (musée) 9. Vierge de Montmerrei, Sées, Musée d’art religieux (S.W.)
9. Vierge de Montmerrei, Sées, Musée d’art religieux (S.W.)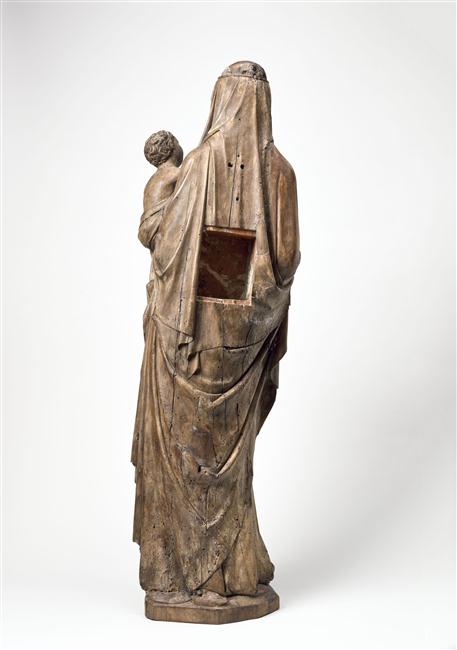 10. Vierge Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée)
10. Vierge Cl. 10839, Paris, Musée de Cluny (musée) 11. Vierge de Mainneville (archives départementales de l’Eure)
11. Vierge de Mainneville (archives départementales de l’Eure) 12. Vierge du portail nord du transept, Paris, Notre-Dame (J.W.)
12. Vierge du portail nord du transept, Paris, Notre-Dame (J.W.) 13. Vierge du portail Saint-Honoré, Amiens, cathédrale (Thomon)
13. Vierge du portail Saint-Honoré, Amiens, cathédrale (Thomon) 15. Vierge de Jeanne d’Évreux, Paris, Louvre (Shonagon)
15. Vierge de Jeanne d’Évreux, Paris, Louvre (Shonagon) 16. Vierge de l’église de Lisors (médiathèque de patrimoine)
16. Vierge de l’église de Lisors (médiathèque de patrimoine)

 19. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée)
19. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée) 20. Vierge, Paris, Musée de Cluny cl. 3270 (musée)
20. Vierge, Paris, Musée de Cluny cl. 3270 (musée)






 28. Vierge de l’église de Varennes-sir-Seine (tous droits réservés)
28. Vierge de l’église de Varennes-sir-Seine (tous droits réservés) 29. Vierge de l’église d’Esmans (médiathèque du patrimoine)
29. Vierge de l’église d’Esmans (médiathèque du patrimoine) 30. Vierge de l’église de Bornel (Poschadel)
30. Vierge de l’église de Bornel (Poschadel)
 32. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée)
32. Vierge de Blanchelande, Paris, Louvre (musée) 33. Vierge de Fontenay (Daniel Villafruela)
33. Vierge de Fontenay (Daniel Villafruela) 34. Vierge de l’église d’Omerville (Poschadel)
34. Vierge de l’église d’Omerville (Poschadel) 35. Vierge de l’église de Brignancourt (J.W.)
35. Vierge de l’église de Brignancourt (J.W.) 36. Vierge de l’église de Champdeuil (S.W.)
36. Vierge de l’église de Champdeuil (S.W.) 37. Vierge de la Porte de l’Horloge, Amboise, musée Morin (J.W.)
37. Vierge de la Porte de l’Horloge, Amboise, musée Morin (J.W.)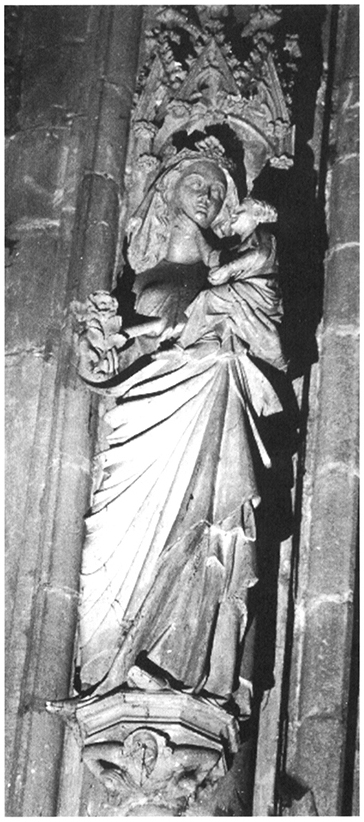 38. Vierge à l’Enfant, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés)
38. Vierge à l’Enfant, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés)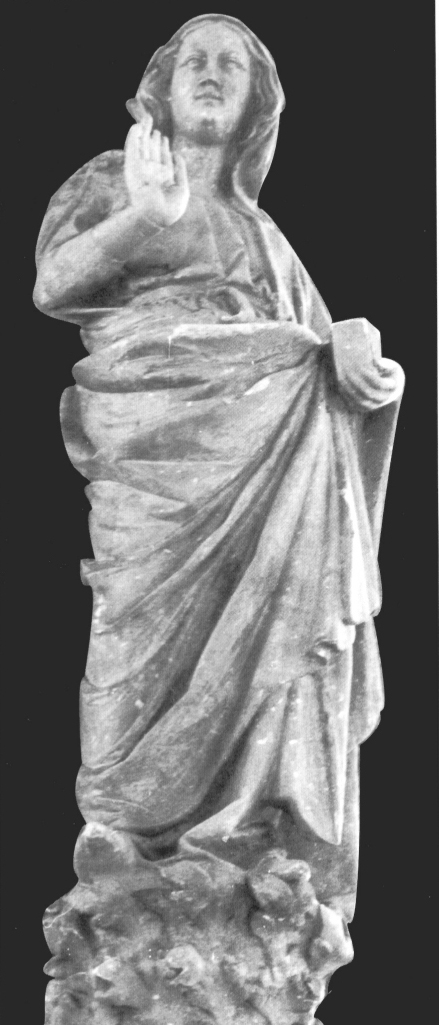 39. Vierge de l’Annonciation, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés)
39. Vierge de l’Annonciation, chœur de la cathédrale de Carcassonne (tous droits réservés) 40. Apôtre de la chapelle de Rieux, Toulouse, musée des Augustins (musée/Daniel Martin)
40. Apôtre de la chapelle de Rieux, Toulouse, musée des Augustins (musée/Daniel Martin) 41. Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles, Toulouse, musée des Augustins (musée)
41. Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles, Toulouse, musée des Augustins (musée)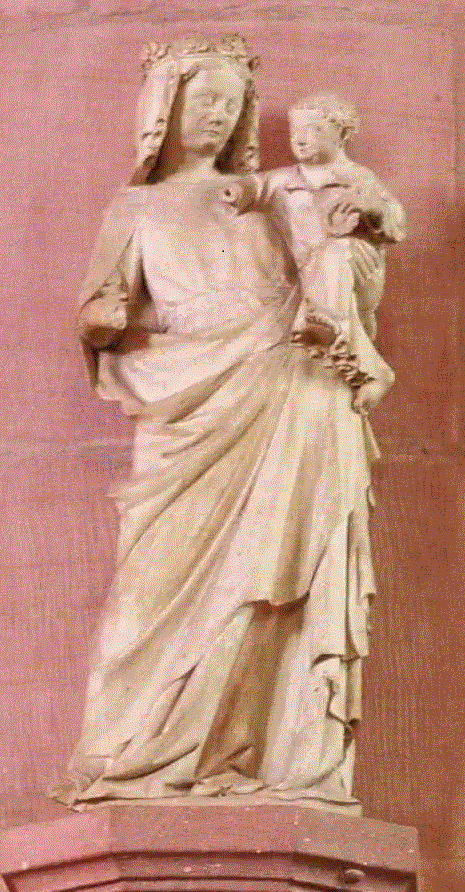 42. Vierge du cloître de la cathédrale de Saint-Dié (tous droits réservés)
42. Vierge du cloître de la cathédrale de Saint-Dié (tous droits réservés) 43. Vierge de Châtenois, New York, Metropolitan Museum (musée)
43. Vierge de Châtenois, New York, Metropolitan Museum (musée)
 45. Vierge à l’Enfant, église de Mussy-sur-Seine (médiathèque du patrimoine)
45. Vierge à l’Enfant, église de Mussy-sur-Seine (médiathèque du patrimoine) 46. Vierge à l’Enfant, église de Chamant (Poschadel)
46. Vierge à l’Enfant, église de Chamant (Poschadel) 47. Vierge de l’église de Bayel (GO69)
47. Vierge de l’église de Bayel (GO69) 48. Vierge provenant d’Ubexy (Olivier Petit, tous droits réservés)
48. Vierge provenant d’Ubexy (Olivier Petit, tous droits réservés)
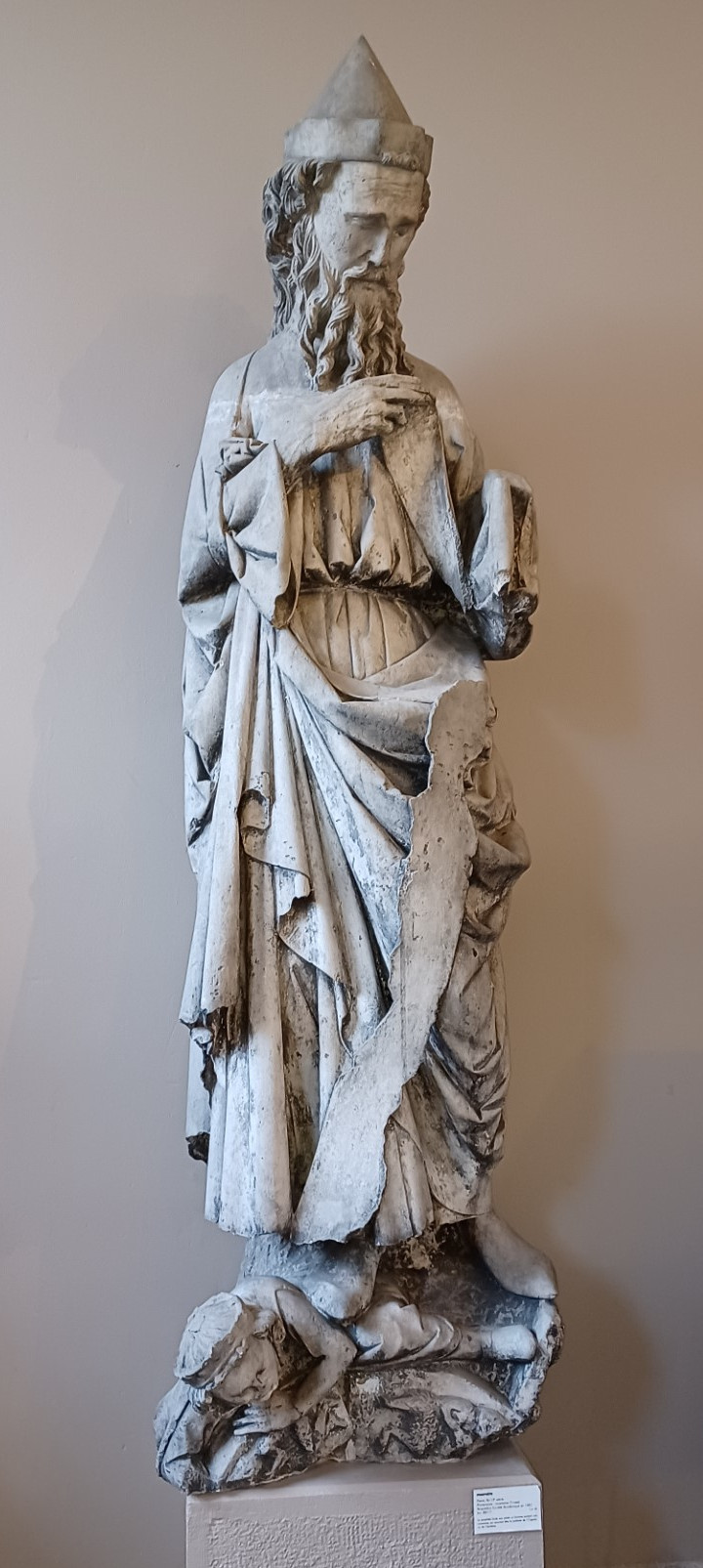 50. Prophète, Troyes, musée des Beaux-Arts (S.W.)
50. Prophète, Troyes, musée des Beaux-Arts (S.W.) 51. Vierge à l’Enfant, basilique Saint-Nicolas-de-Port (G. Garitan)
51. Vierge à l’Enfant, basilique Saint-Nicolas-de-Port (G. Garitan)
 53. Vierge de la cathédrale d’Anvers (S.W.)
53. Vierge de la cathédrale d’Anvers (S.W.) 54. Vierge de Diest New York, Metropolitan Museum (musée)
54. Vierge de Diest New York, Metropolitan Museum (musée) 55. Vierge de l’église de Villers-Saint-Frambourg (Poschadel)
55. Vierge de l’église de Villers-Saint-Frambourg (Poschadel) 56. Vierge mosane, Lille, musée des Beaux-Arts (S.W.)
56. Vierge mosane, Lille, musée des Beaux-Arts (S.W.)
 58. Retable de Maubuisson, l’ange aux burettes, Paris, Louvre (Langopaso)
58. Retable de Maubuisson, l’ange aux burettes, Paris, Louvre (Langopaso) 59. Groupe sculpté mosan en l’église Notre-Dame de Louviers (médiathèque du patrimoine)
59. Groupe sculpté mosan en l’église Notre-Dame de Louviers (médiathèque du patrimoine) 60. Vierge de l’église de Muneville (médiathèque du patrimoine)
60. Vierge de l’église de Muneville (médiathèque du patrimoine) 61. Vierge à l’Enfant, Lisbonne, fondation Gulbenkian (musée)
61. Vierge à l’Enfant, Lisbonne, fondation Gulbenkian (musée)
 63. Vierge de l’église Saint-Just d’Arbois (médiathèque du patrimoine)
63. Vierge de l’église Saint-Just d’Arbois (médiathèque du patrimoine) 64. Vierge des malades de la cathédrale de Tournai (Institut du patrimoine)
64. Vierge des malades de la cathédrale de Tournai (Institut du patrimoine)
 Adoration des Mages
Adoration des Mages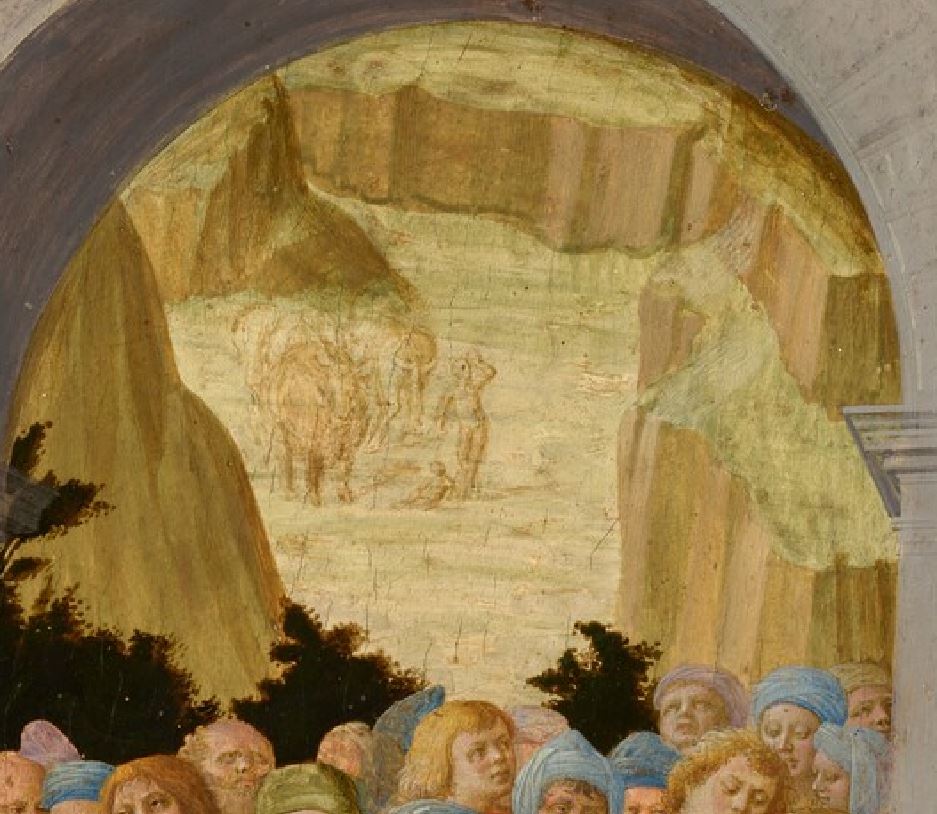
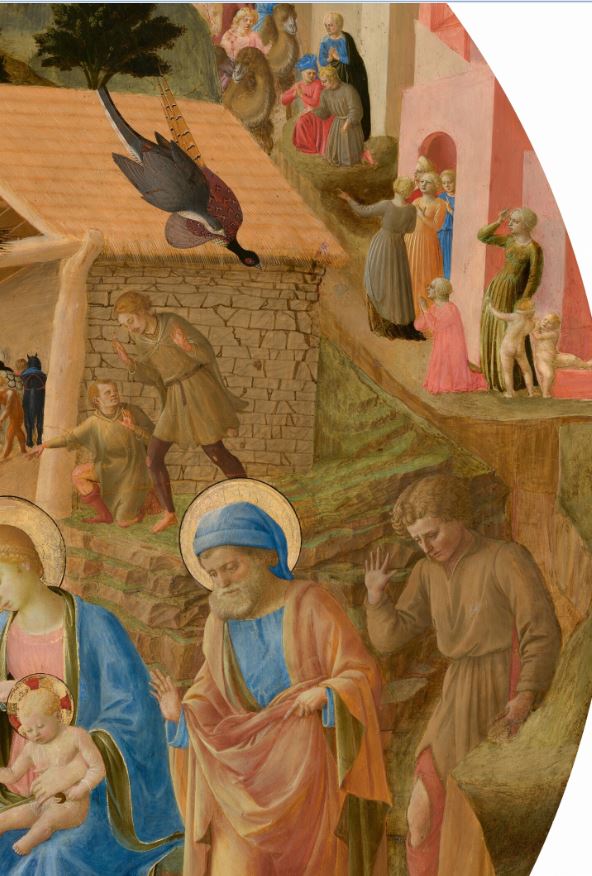




 Panneau du retable de Thomas Beckett
Panneau du retable de Thomas Beckett
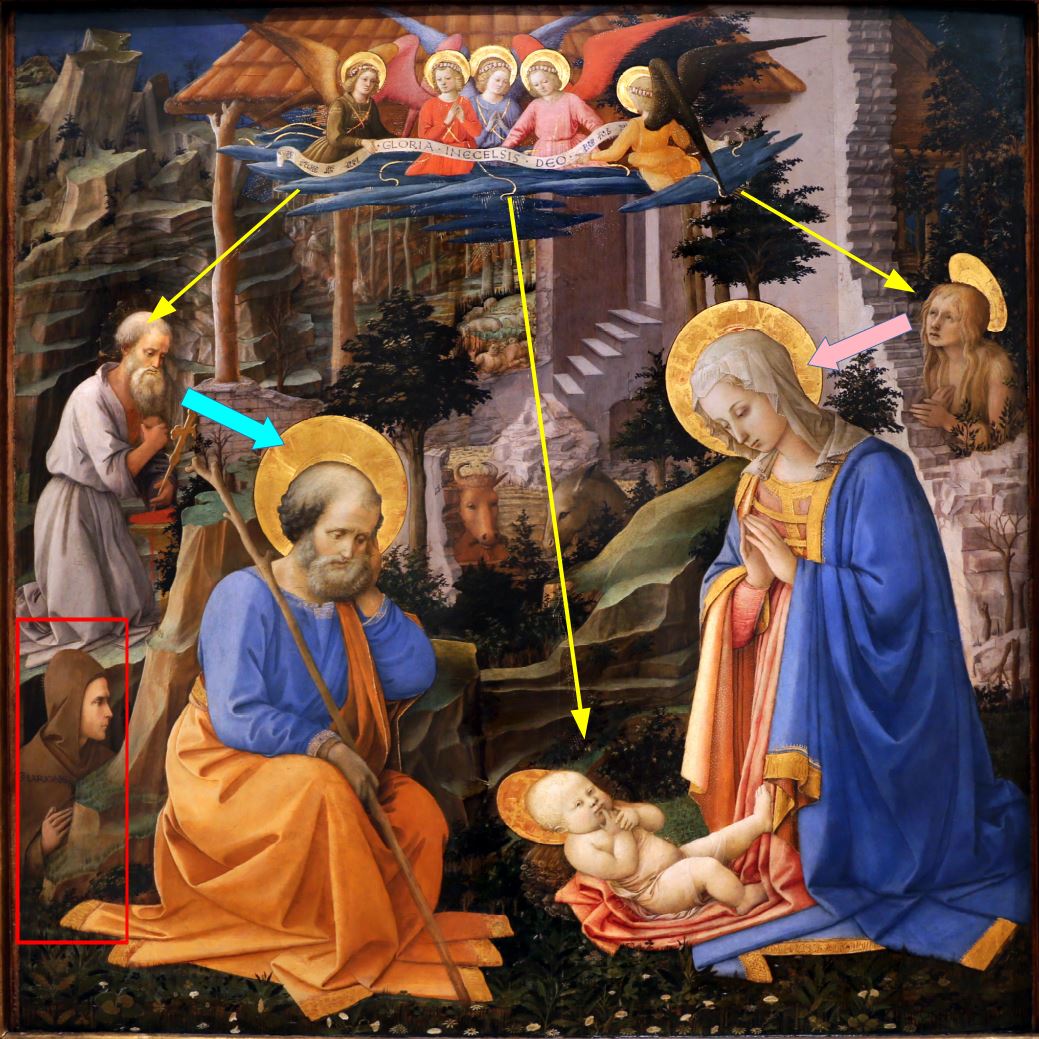



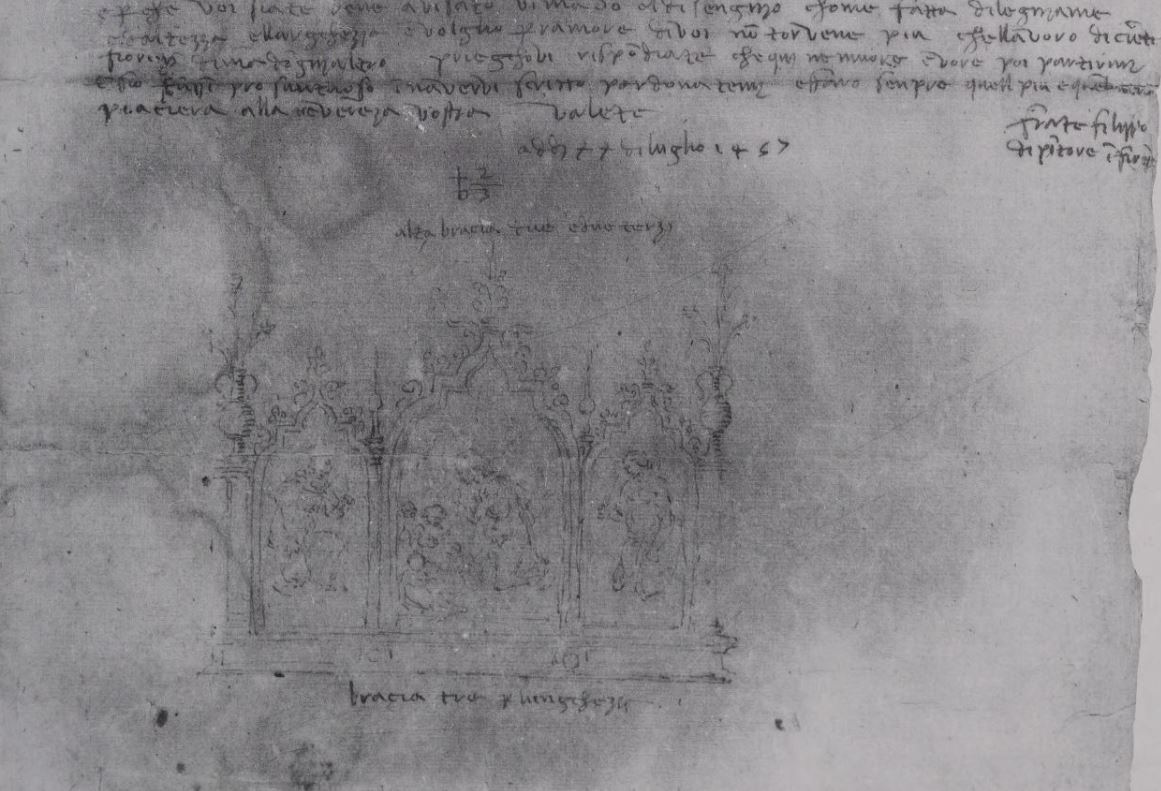 Lettre du 20 Juillet 1457 à Giovanni di Cosimo de Medici ( [1] p 36)
Lettre du 20 Juillet 1457 à Giovanni di Cosimo de Medici ( [1] p 36) Reconstitution du triptyque pour Alphonse V d’Aragon, Musée de Cleveland
Reconstitution du triptyque pour Alphonse V d’Aragon, Musée de Cleveland Adoration dans la Forêt
Adoration dans la Forêt


 Icone signée Angelos Akotantos, 1400-25, Byzantine museum, Athènes
Icone signée Angelos Akotantos, 1400-25, Byzantine museum, Athènes

 Vers 1480, NGA
Vers 1480, NGA Vers 1485, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest
Vers 1485, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest


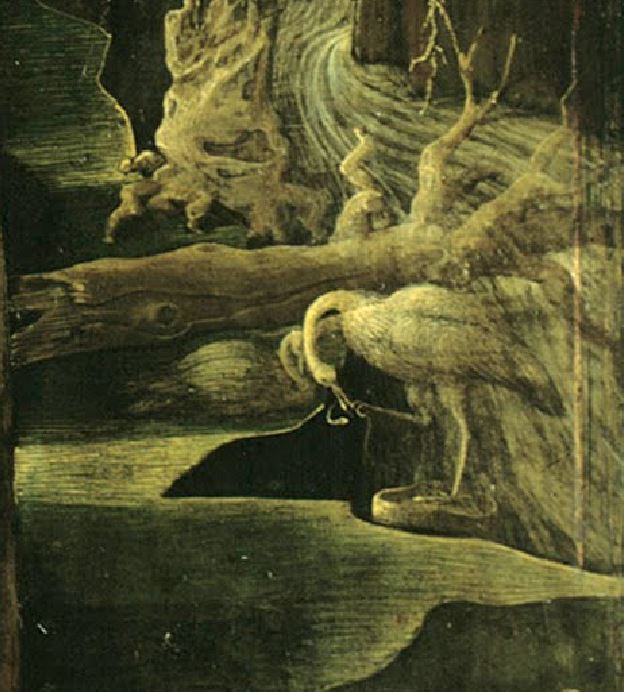



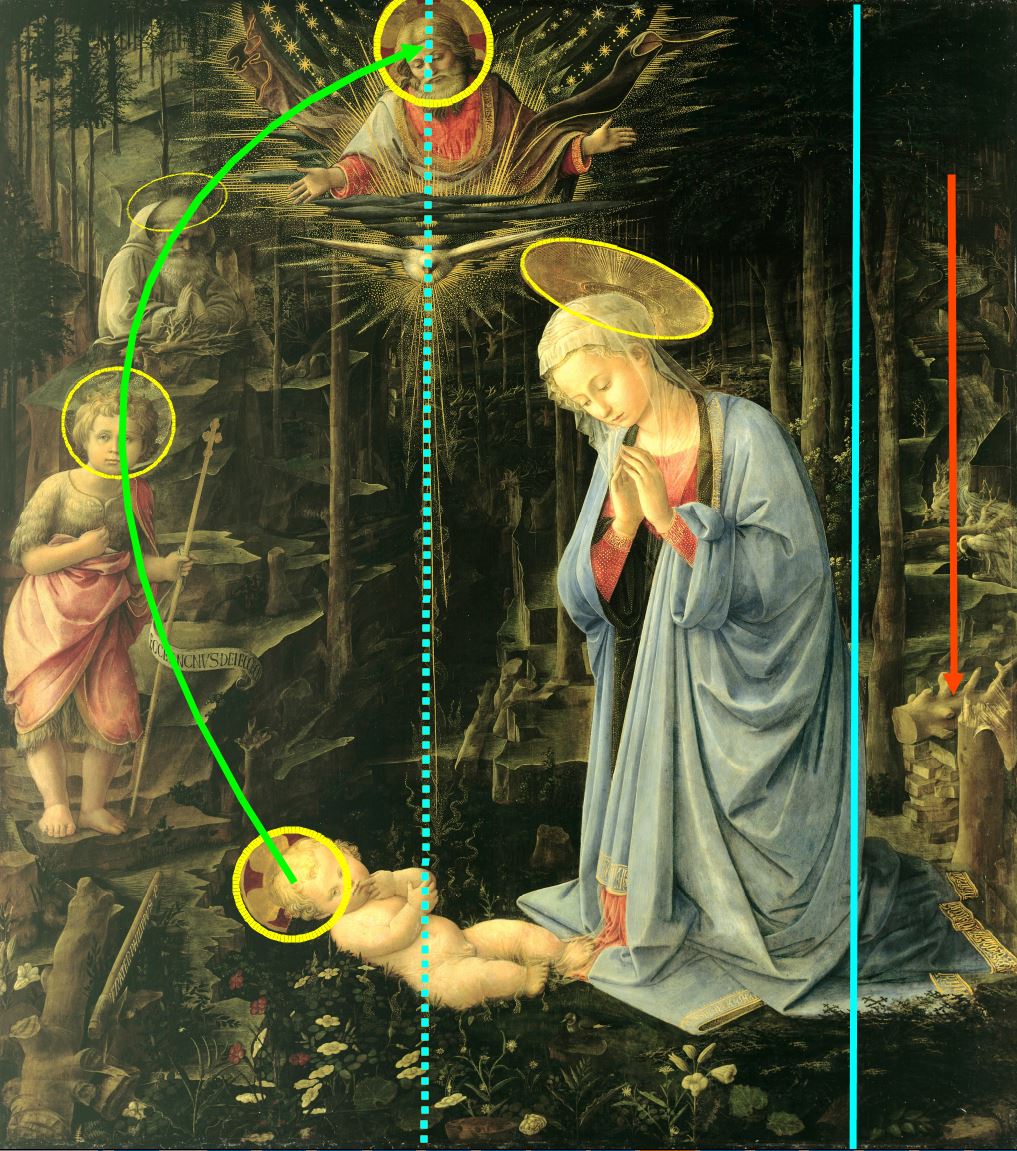

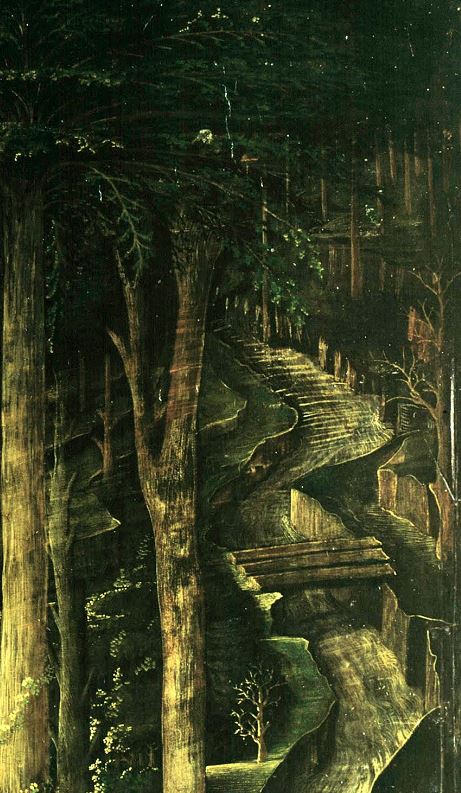
 Modèle 3D ZeuxisVR [9]
Modèle 3D ZeuxisVR [9]
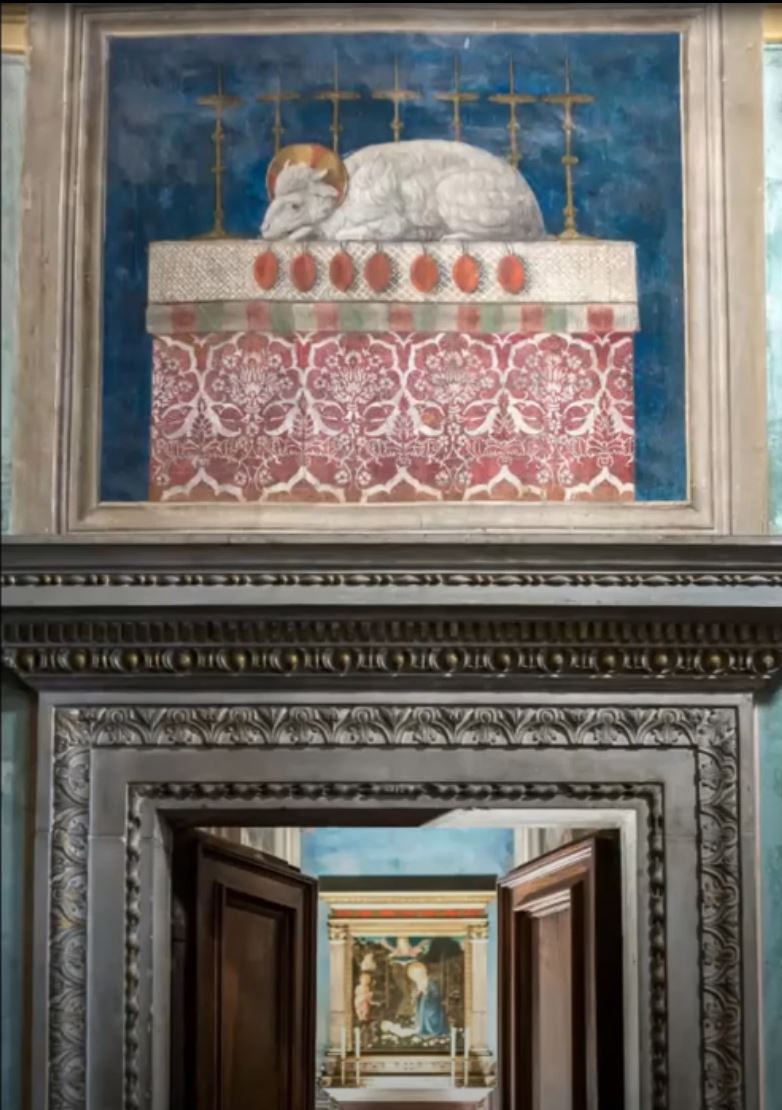

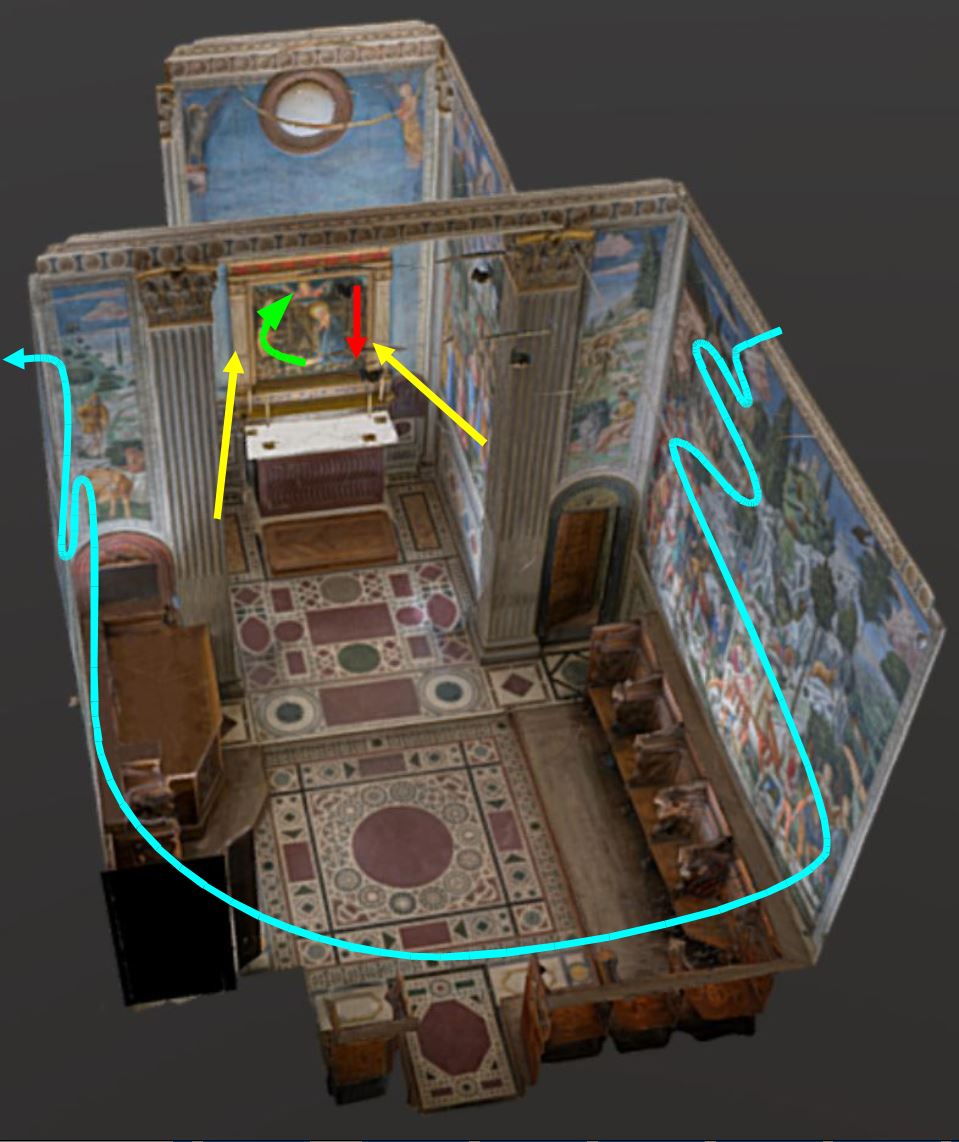
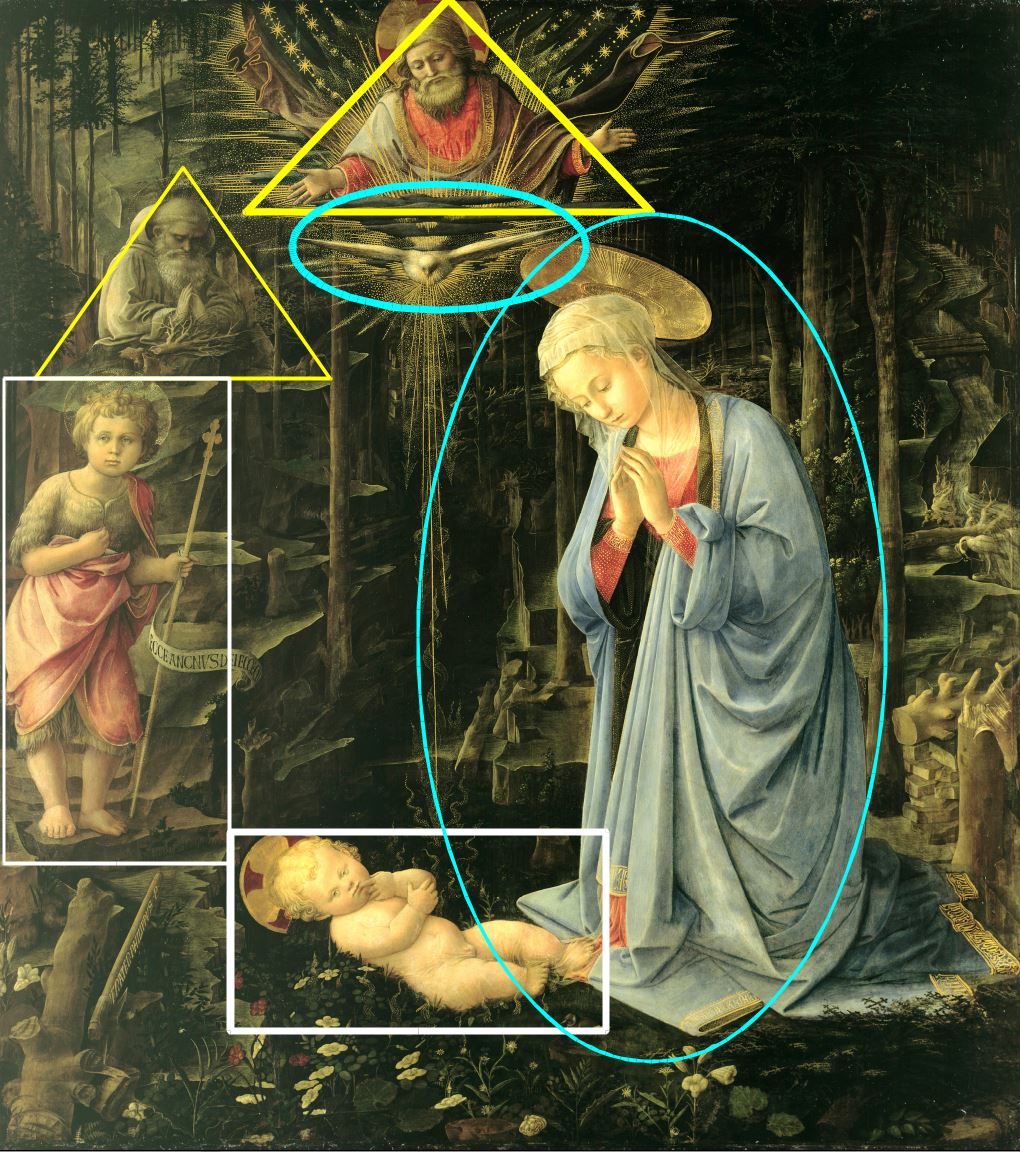

 Adoration de Camaldoli, avec Saint Jean Baptiste Enfant de Saint Romuald
Adoration de Camaldoli, avec Saint Jean Baptiste Enfant de Saint Romuald


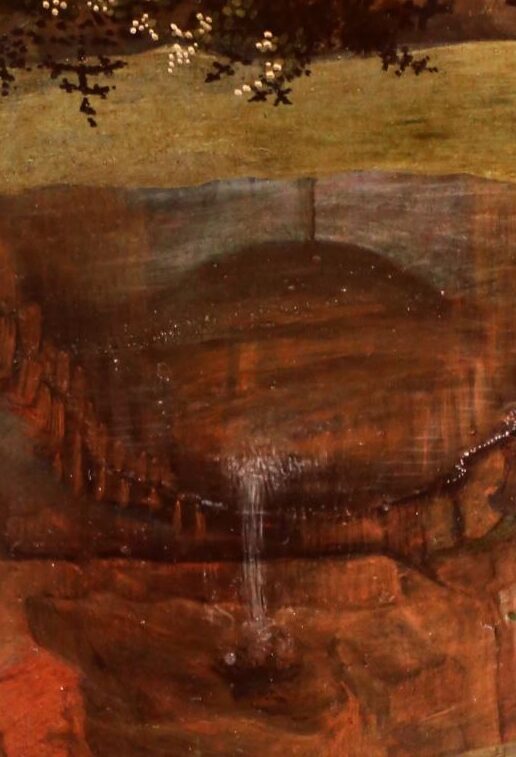
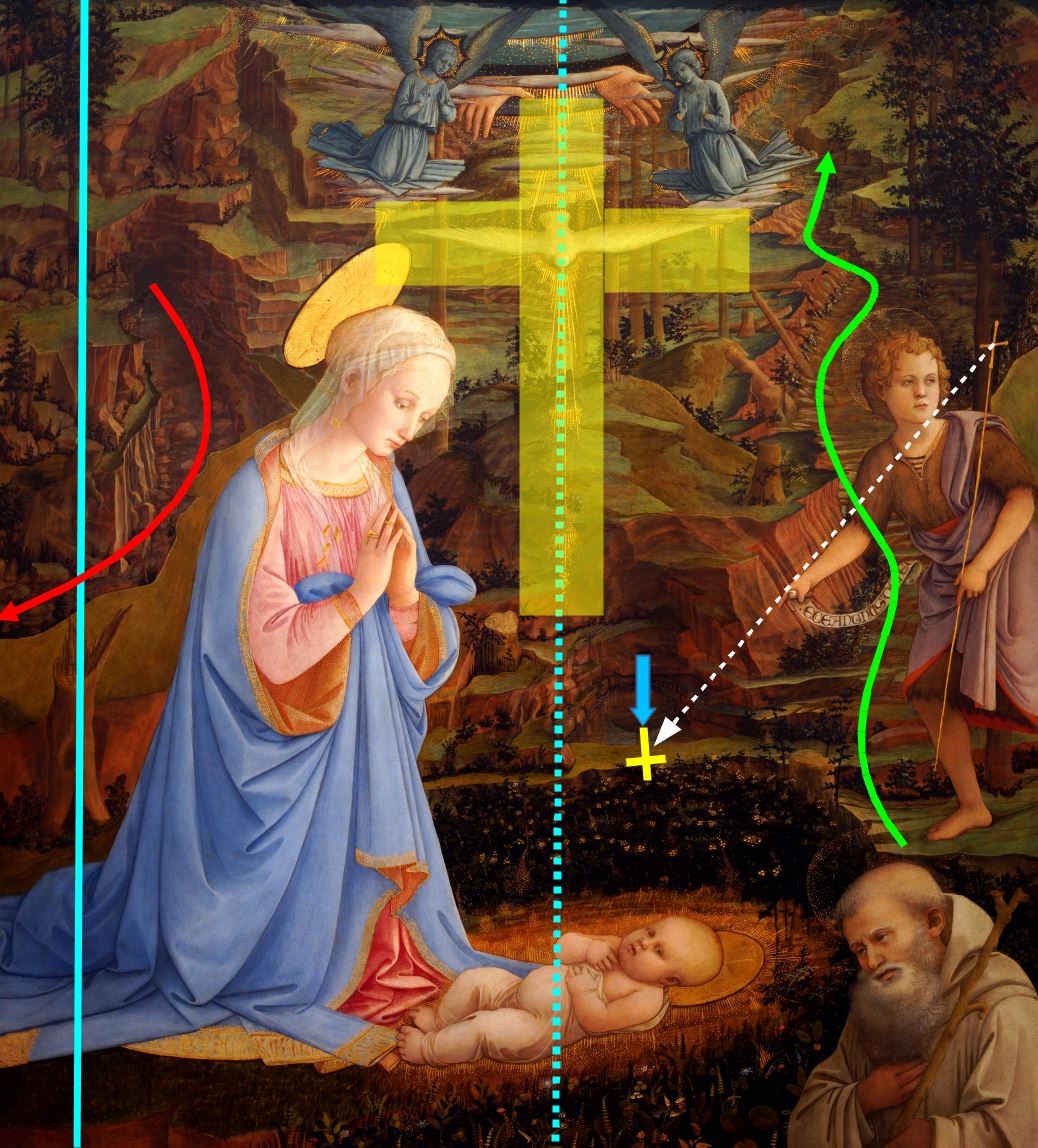

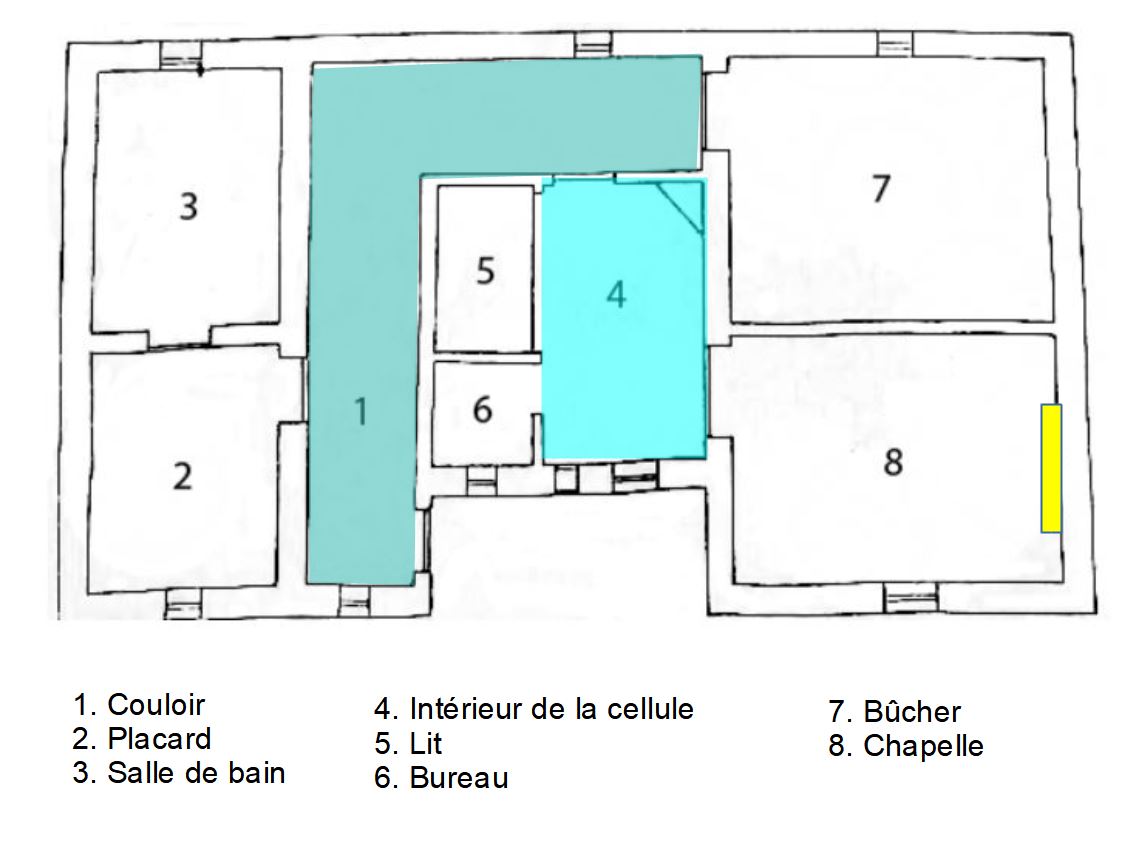
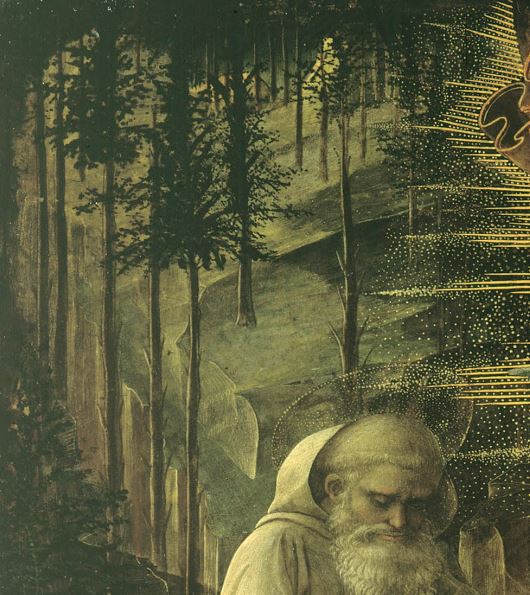
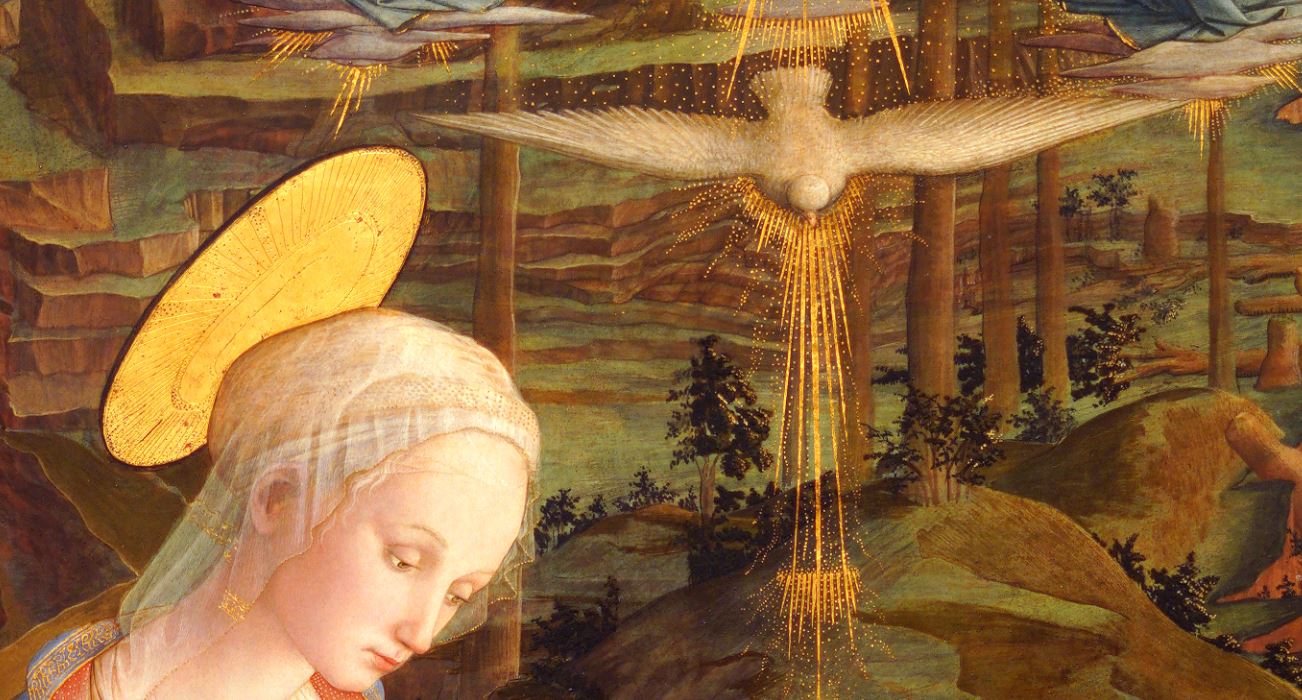
 Reconstitution P.Bousquet (cellule dite de Saint Romuald, eremo di Camaldoli)
Reconstitution P.Bousquet (cellule dite de Saint Romuald, eremo di Camaldoli)
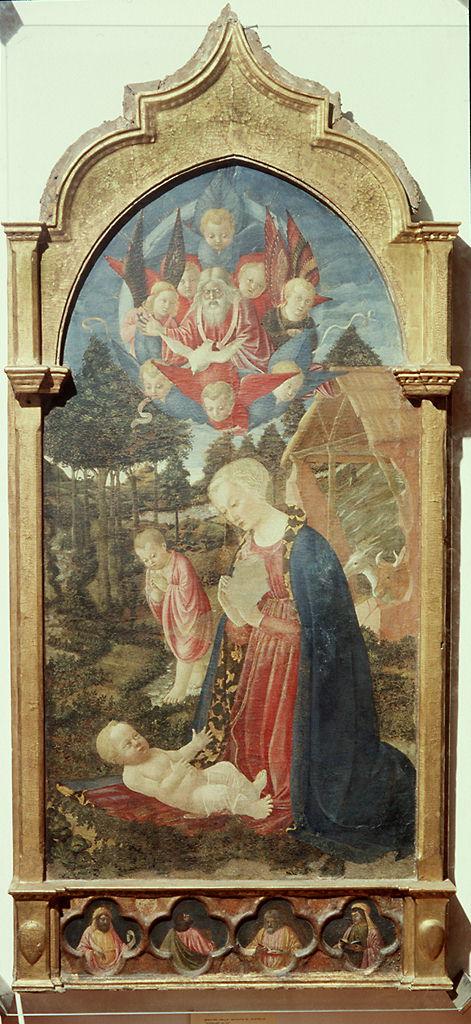

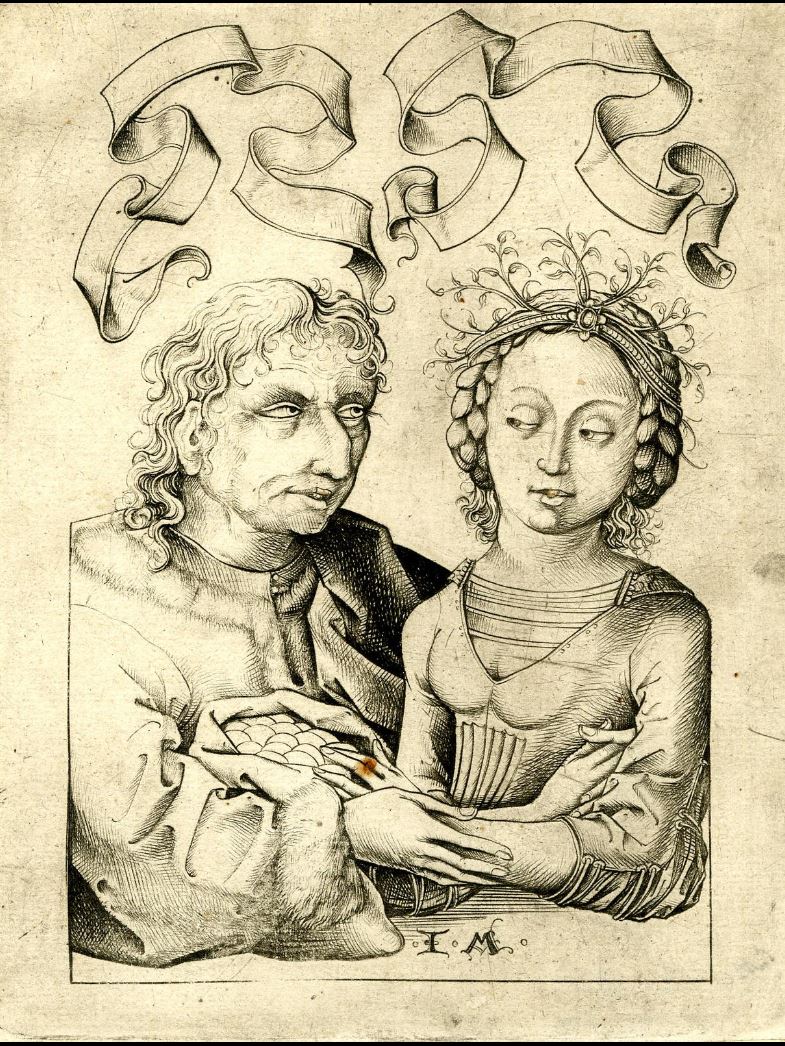
 Le Couple mal assorti , Dürer, vers 1495, MET
Le Couple mal assorti , Dürer, vers 1495, MET
 Le Couple mal assorti, Bernhard Strigel, 1502-03, Kupferstichkabinett, Berlin
Le Couple mal assorti, Bernhard Strigel, 1502-03, Kupferstichkabinett, Berlin 1520-22
1520-22 1522
1522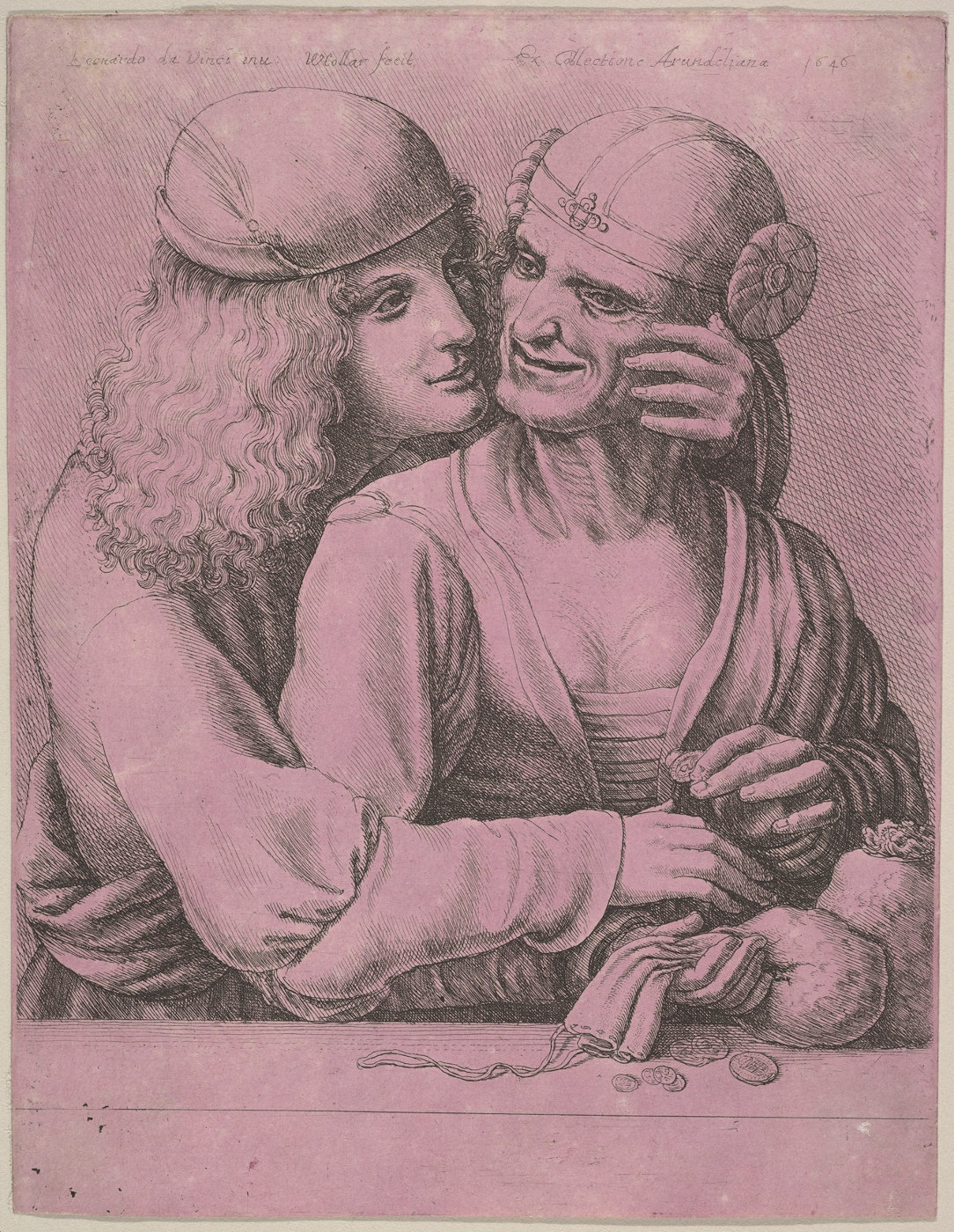 Le Couple mal assorti , Gravure de Hollar d’après un dessin de Léonard de Vinci, 1646
Le Couple mal assorti , Gravure de Hollar d’après un dessin de Léonard de Vinci, 1646 Le mariage inégal, Suiveur de Quentin Metsys, 1525-30, Museu de Arte, Sao Paulo
Le mariage inégal, Suiveur de Quentin Metsys, 1525-30, Museu de Arte, Sao Paulo Judith, Jan Sanders van Hemessen, 1540, Chicago Art Institute
Judith, Jan Sanders van Hemessen, 1540, Chicago Art Institute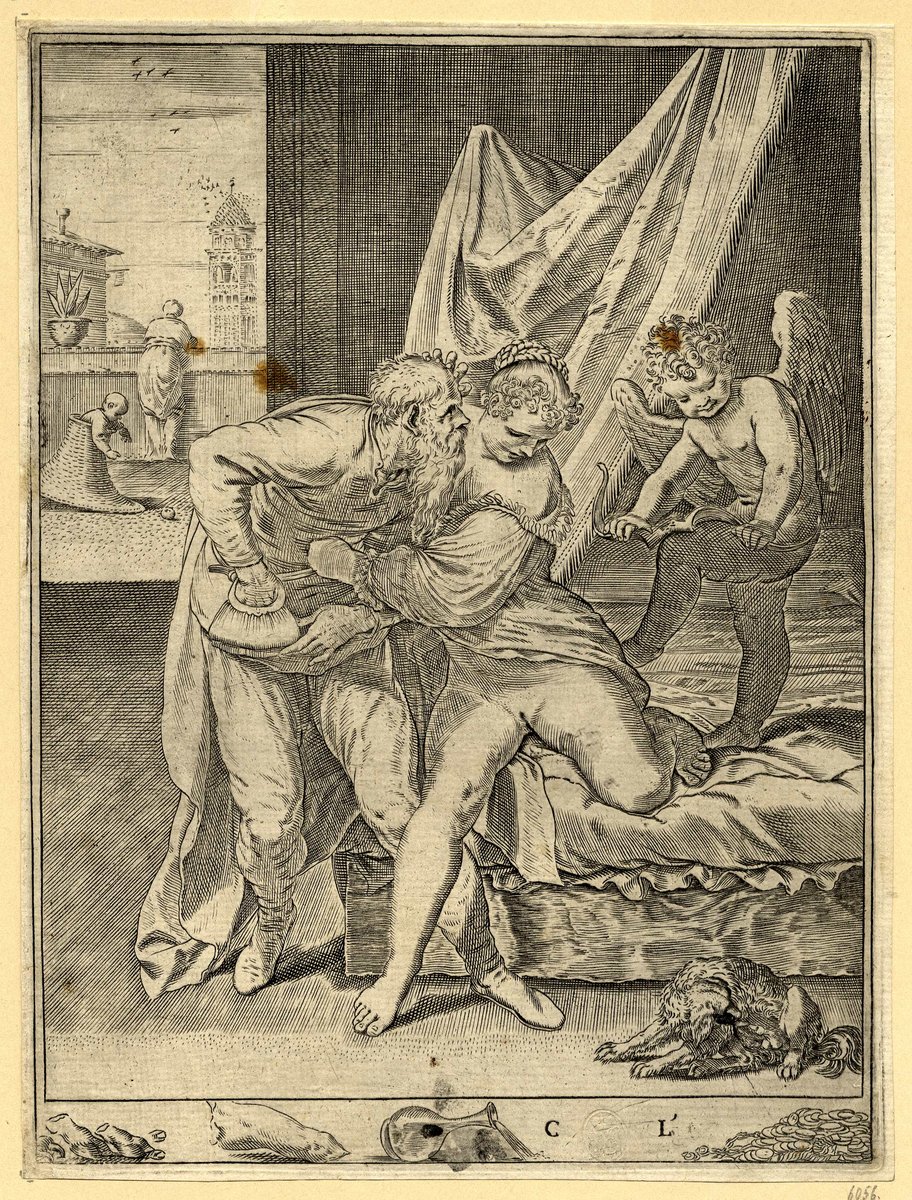 L’or est vainqueur de toute chose, 1590–95, Carrache, Musée des Beaux Arts, Budapest
L’or est vainqueur de toute chose, 1590–95, Carrache, Musée des Beaux Arts, Budapest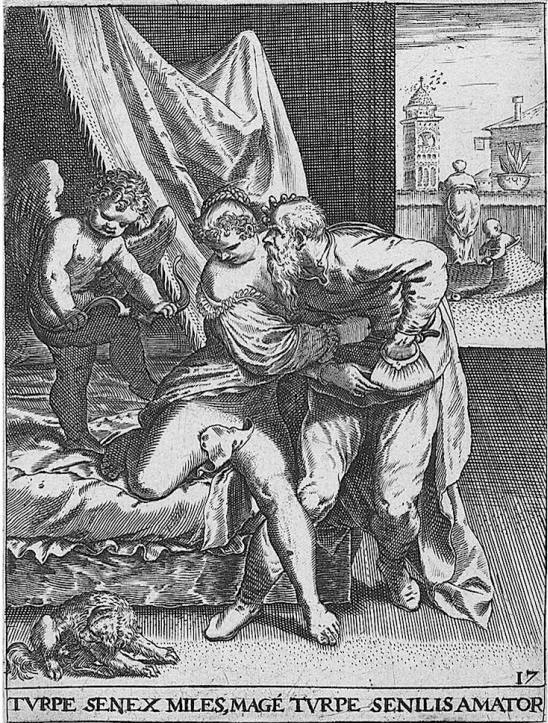 Malheur au vieux soldat, malheur au vieil amant (Turpe senex miles, mage turpe senilis amator)
Malheur au vieux soldat, malheur au vieil amant (Turpe senex miles, mage turpe senilis amator) Omnia vincit amor, Carrache, 1599, MET
Omnia vincit amor, Carrache, 1599, MET Omnia vincit amor, Dessin à la plume, 1598-99, Städel Museum, Frankfurt am Main
Omnia vincit amor, Dessin à la plume, 1598-99, Städel Museum, Frankfurt am Main Paysans au marché, Bueckelaer, 1567, Kunsthistorisches Museum, Vienne
Paysans au marché, Bueckelaer, 1567, Kunsthistorisches Museum, Vienne Le mari attrapé, Gillis van Breen, 1601
Le mari attrapé, Gillis van Breen, 1601 Le Dieu Terme et la Quiétude, Goltzius, 1582
Le Dieu Terme et la Quiétude, Goltzius, 1582 Le mariage pour les richesses (série Trilogie du mariage)
Le mariage pour les richesses (série Trilogie du mariage) Vieille femme avec un jeune couple
Vieille femme avec un jeune couple Vieil homme avec un jeune couple
Vieil homme avec un jeune couple Danaé recevant Jupiter sous la forme d’une pluie d’or
Danaé recevant Jupiter sous la forme d’une pluie d’or Danaé recevant la pluie d’or
Danaé recevant la pluie d’or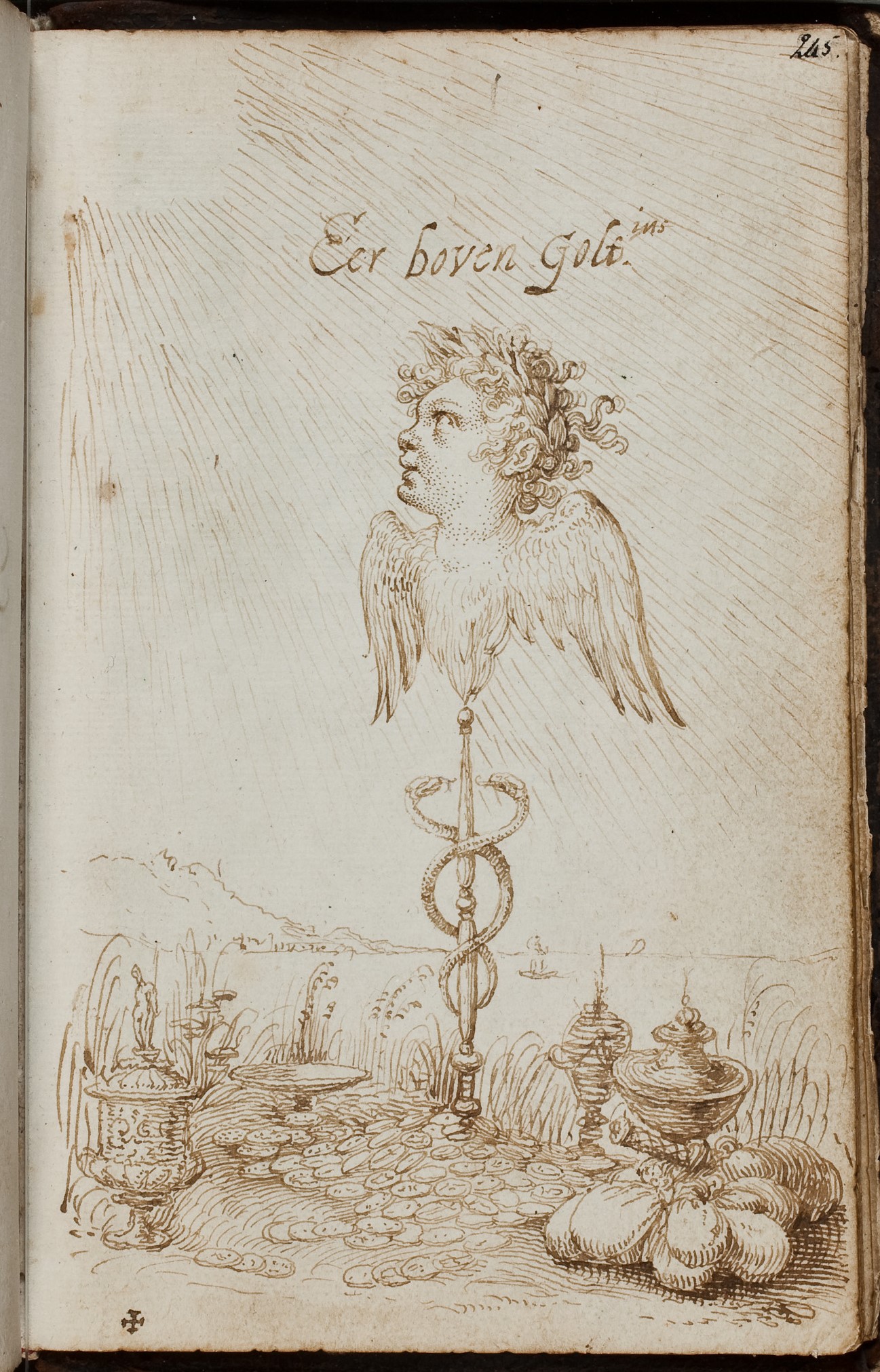 L’honneur au dessus de l’or – Err hoven golt((zius)
L’honneur au dessus de l’or – Err hoven golt((zius)
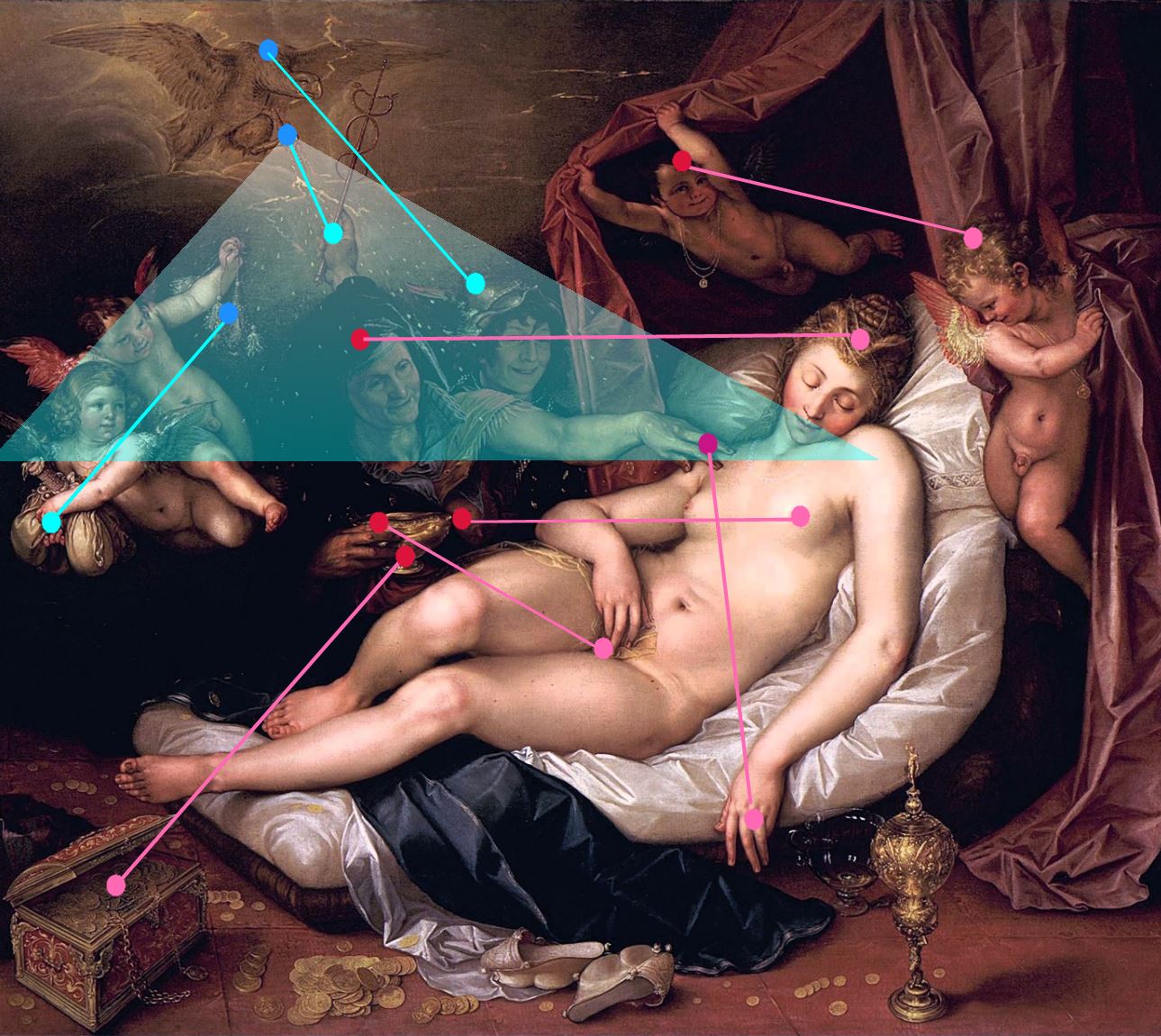

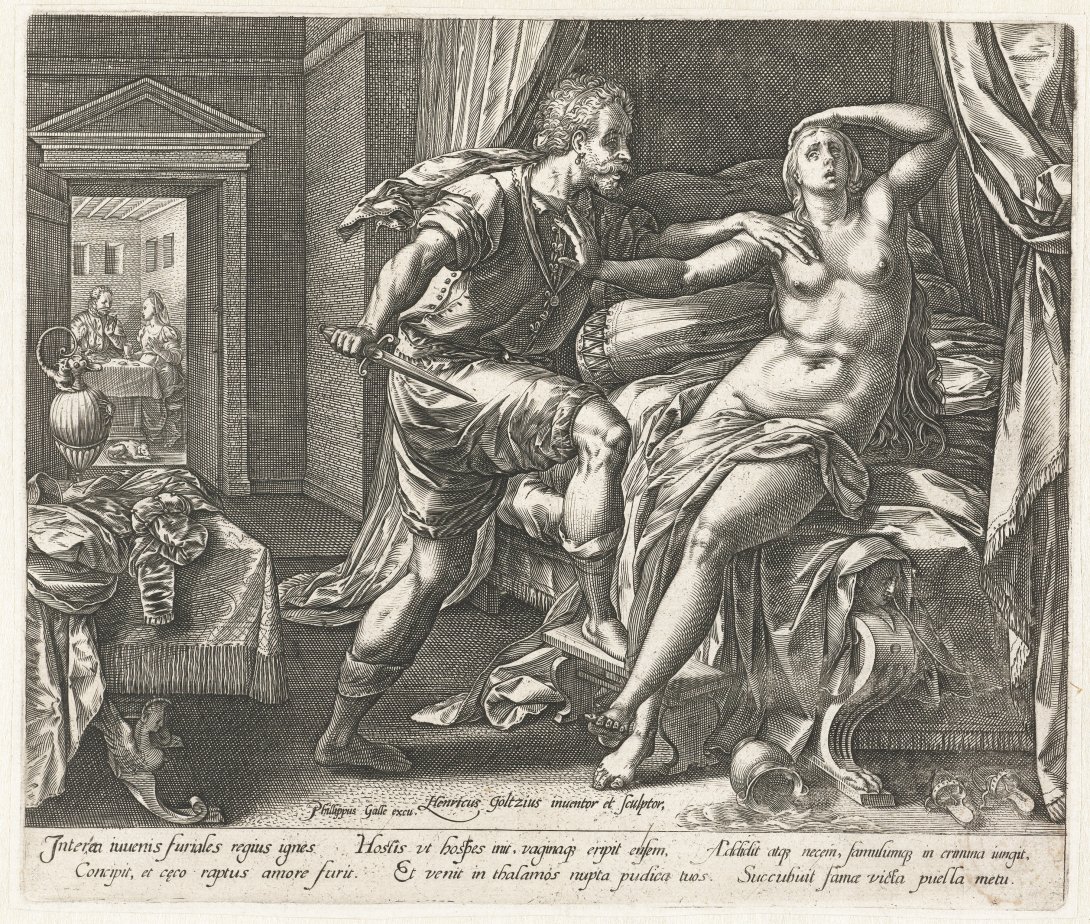 Le viol de Lucrèce, gravure de Goltzius, série Histoire de Lucrèce, éditée par Philippe Galle, 1578-79
Le viol de Lucrèce, gravure de Goltzius, série Histoire de Lucrèce, éditée par Philippe Galle, 1578-79
 Le jeune homme et la vieille, 1614, Hendrick Goltzius, Musée de la Chartreuse, Douai
Le jeune homme et la vieille, 1614, Hendrick Goltzius, Musée de la Chartreuse, Douai Le couple dépareillé
Le couple dépareillé Couple jouant au tric-trac
Couple jouant au tric-trac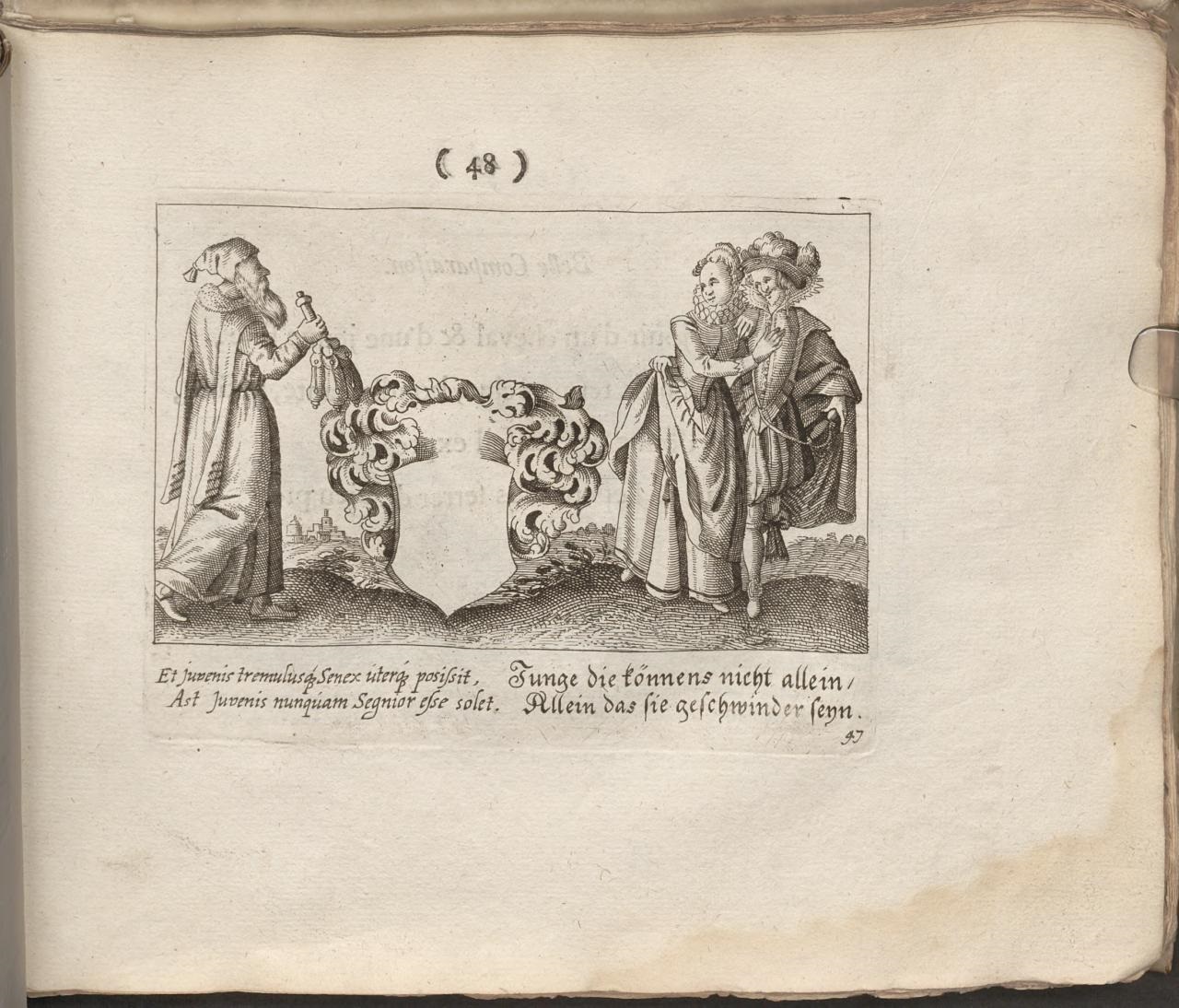 Gravure de Peter Rollos, Euterpae suboles, 1608
Gravure de Peter Rollos, Euterpae suboles, 1608 Le vieillard cupide
Le vieillard cupide 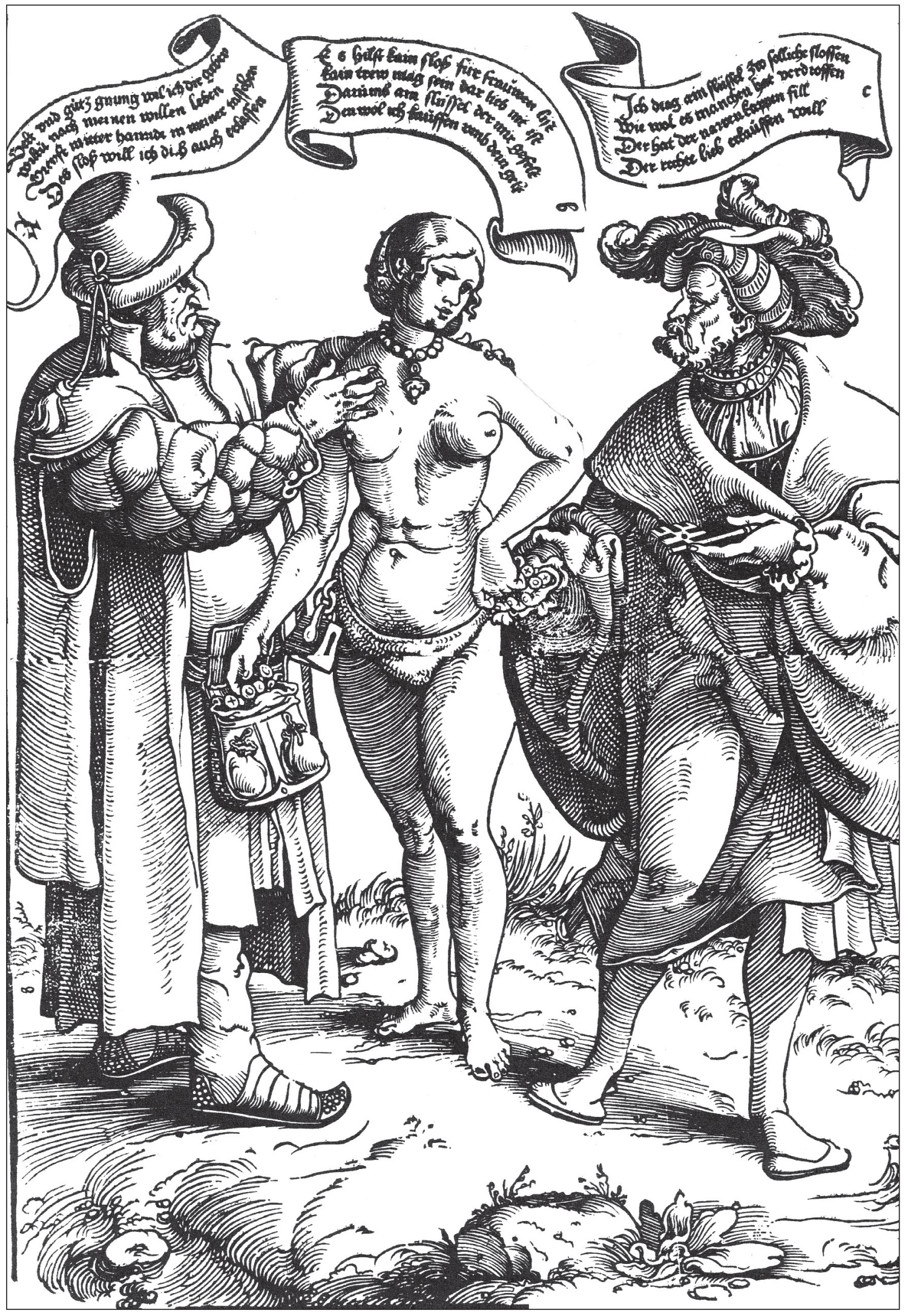 Triangle amoureux avec ceinture de chasteté et clé, Nuremberg, vers 1525-30
Triangle amoureux avec ceinture de chasteté et clé, Nuremberg, vers 1525-30 Blason avec cornemuse et trompettes,
Blason avec cornemuse et trompettes, Occupations variées (Various Occupations)
Occupations variées (Various Occupations) Le cornemuseux
Le cornemuseux Couple mal assorti
Couple mal assorti La jeune femme et le joueur de cornemuse
La jeune femme et le joueur de cornemuse Le joueur de cornemuse et la joyeuse commère Jan van Hemessen, vers 1540, coll part
Le joueur de cornemuse et la joyeuse commère Jan van Hemessen, vers 1540, coll part Le soir des noces, Peeter Baltens, 1598
Le soir des noces, Peeter Baltens, 1598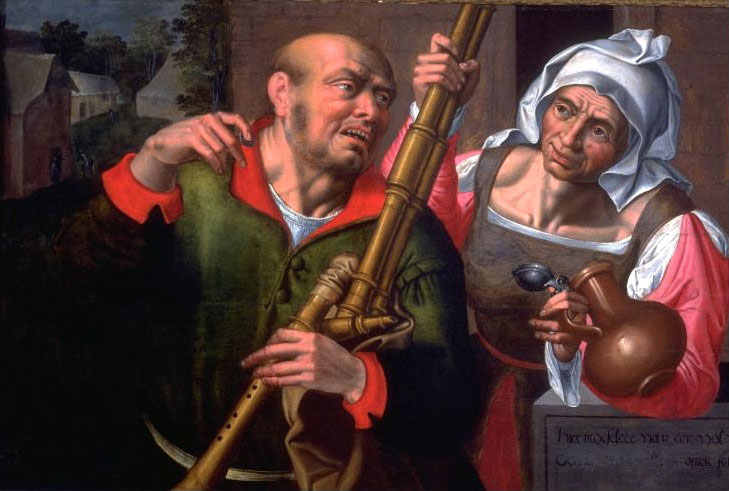 Le joueur de cornemuse et la vieille
Le joueur de cornemuse et la vieille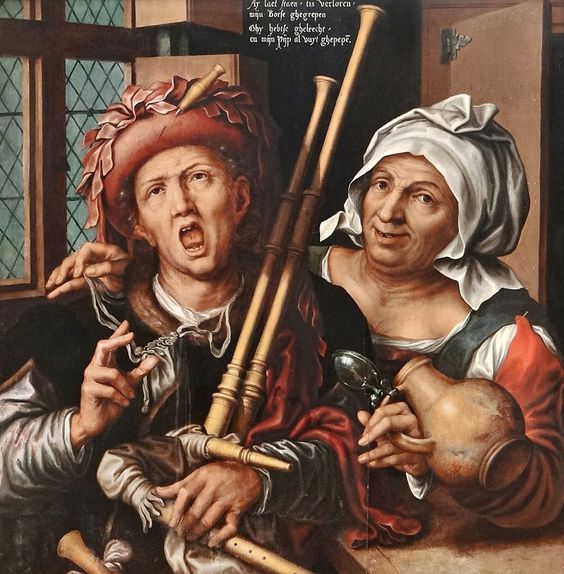 Le joueur de cornemuse et la vieille
Le joueur de cornemuse et la vieille Les Fabricants de saucisses, Le Joueur de cornemuse
Les Fabricants de saucisses, Le Joueur de cornemuse Gravure de Peter Rollos, Euterpae suboles, 1608
Gravure de Peter Rollos, Euterpae suboles, 1608 Les fêtards au Mardi Gras (Merrymakers at Shrovetide)
Les fêtards au Mardi Gras (Merrymakers at Shrovetide) Le joueur de rommelpot
Le joueur de rommelpot Le cornemuseux
Le cornemuseux Le castrat Marcantonio Pasqualini couronné par Apollon
Le castrat Marcantonio Pasqualini couronné par Apollon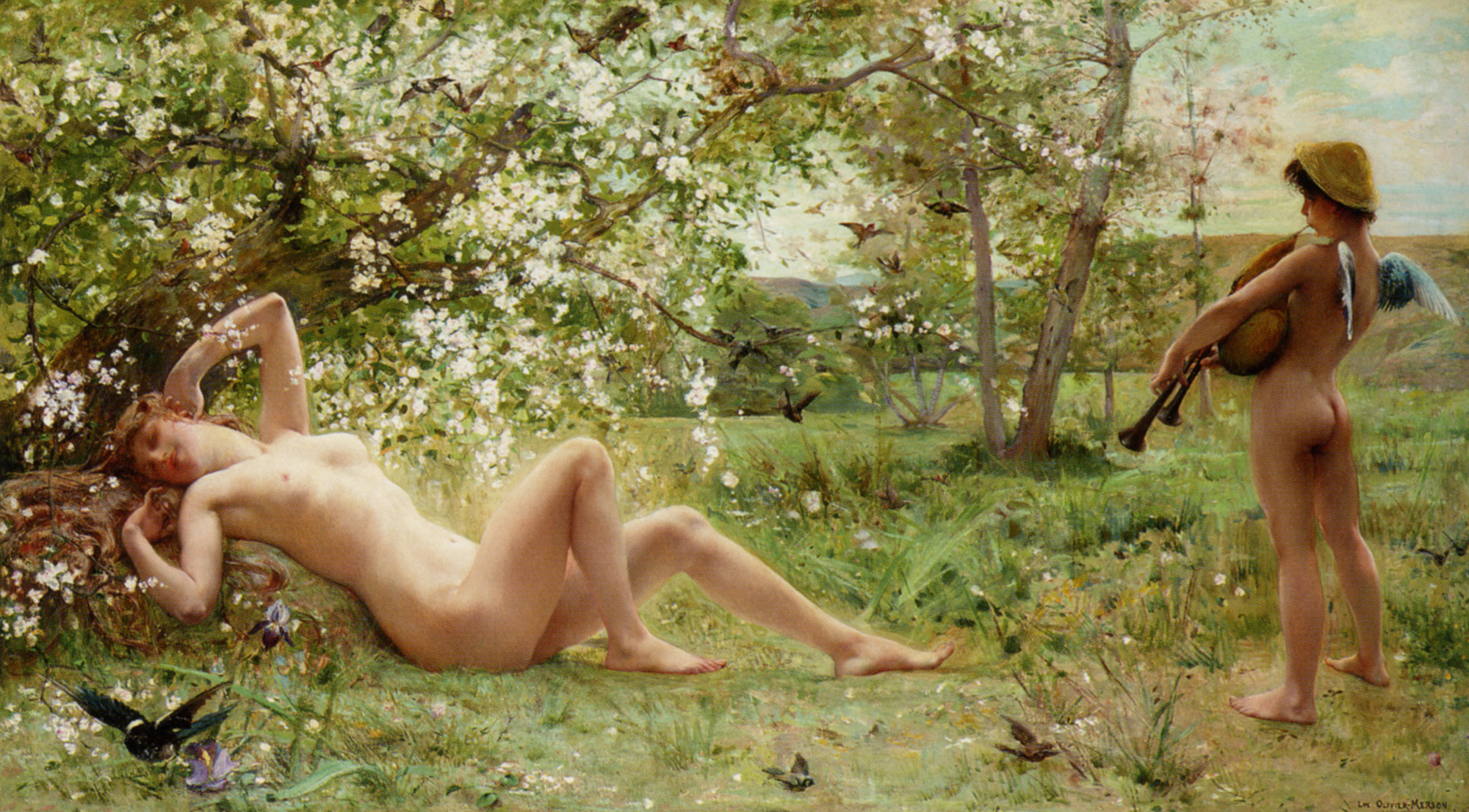 L’éveil du printemps, Luc Olivier Merson, 1884, collection particulière
L’éveil du printemps, Luc Olivier Merson, 1884, collection particulière Lutte pour la culotte
Lutte pour la culotte
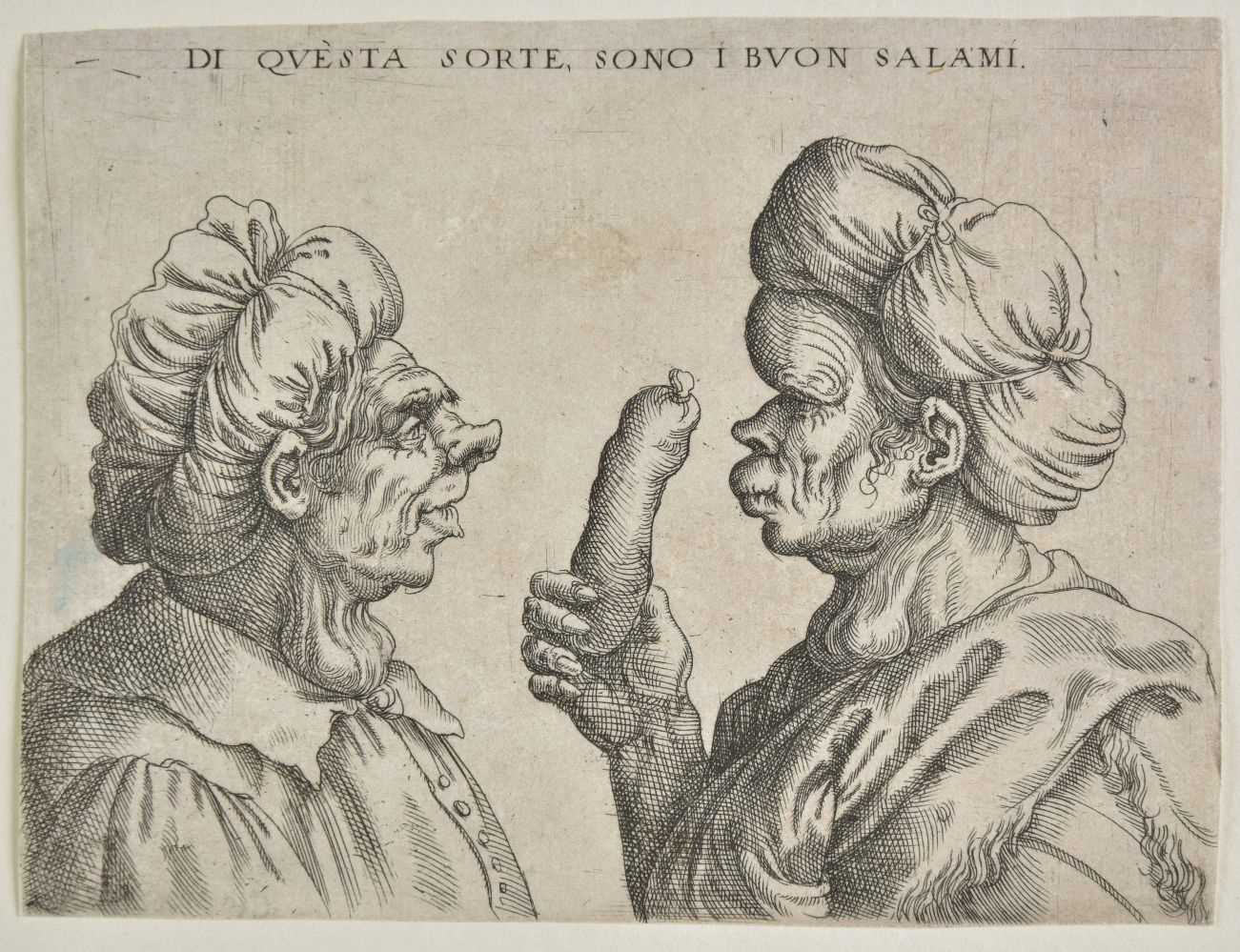 De cette sorte sont les bons salamis (Da questa sorte sono I buon salami)
De cette sorte sont les bons salamis (Da questa sorte sono I buon salami) Le fou et les jeunes femmes
Le fou et les jeunes femmes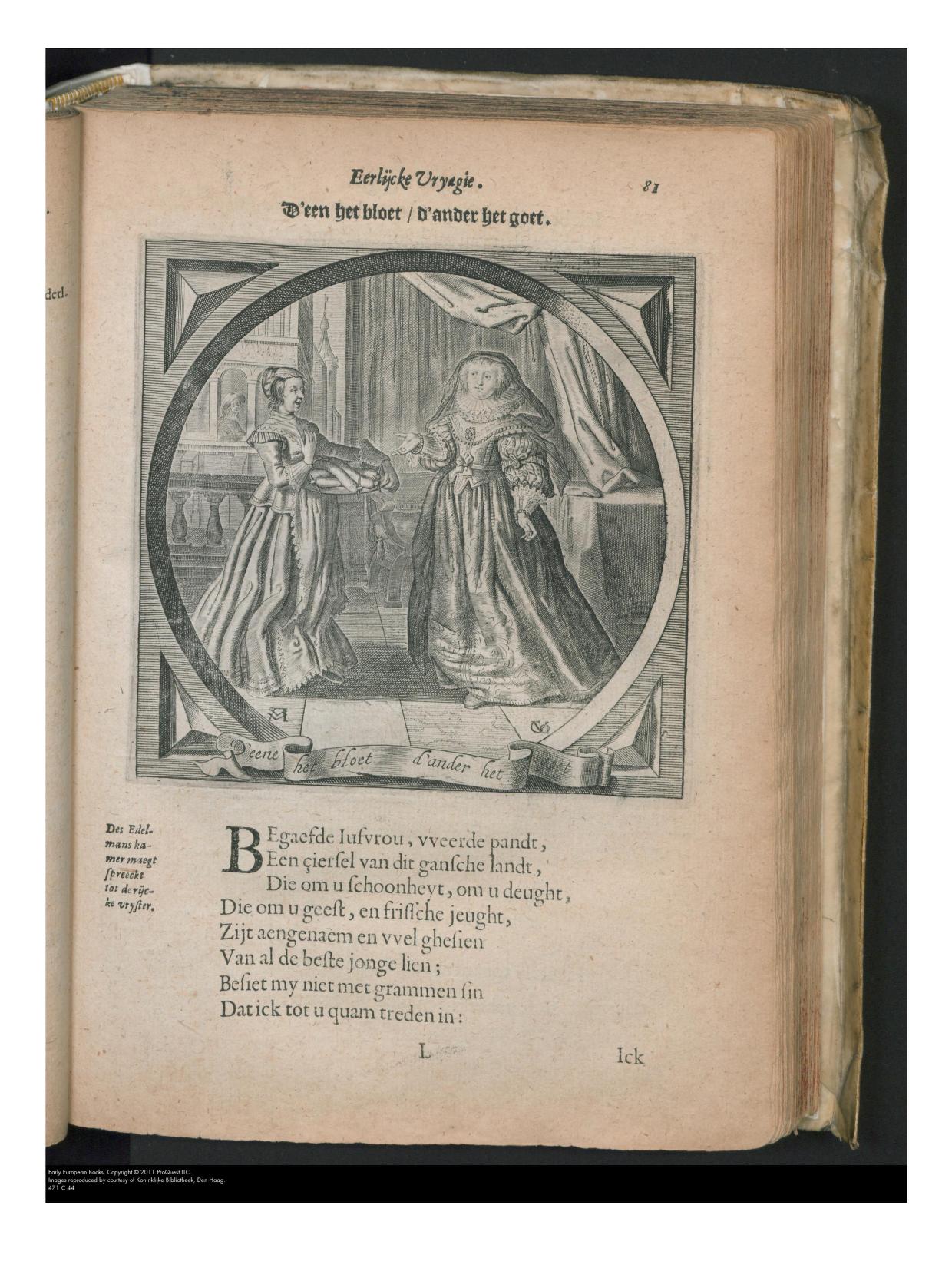 D’een het bloet d’ander het goet (D’un homme le sang, d’un autre la richesse)
D’een het bloet d’ander het goet (D’un homme le sang, d’un autre la richesse) Une plaisanterie masquée (Ein Maskenscherz)
Une plaisanterie masquée (Ein Maskenscherz) L’Adieu (dessin), 1513-15, Kupferstich-Kabinett, Dresde
L’Adieu (dessin), 1513-15, Kupferstich-Kabinett, Dresde Guerrier et prostituée dans un paysage (gravure), 1500-28, Rijksmuseum
Guerrier et prostituée dans un paysage (gravure), 1500-28, Rijksmuseum Guerrier à la lance avec une prostituée
Guerrier à la lance avec une prostituée Guerrier et prostituée dans un paysage
Guerrier et prostituée dans un paysage Vénus et Vulcain
Vénus et Vulcain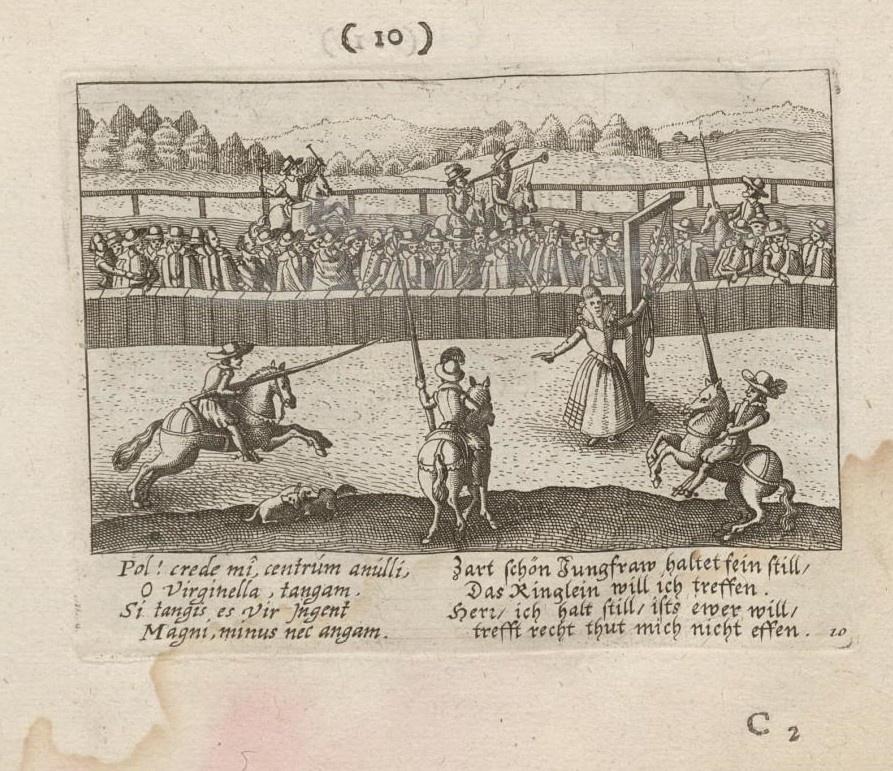 Gravure de Peter Rollos, 1608, Euterpae suboles, N°10 (édition française de 1648)
Gravure de Peter Rollos, 1608, Euterpae suboles, N°10 (édition française de 1648) Honor et Opulentia, série La Fortune
Honor et Opulentia, série La Fortune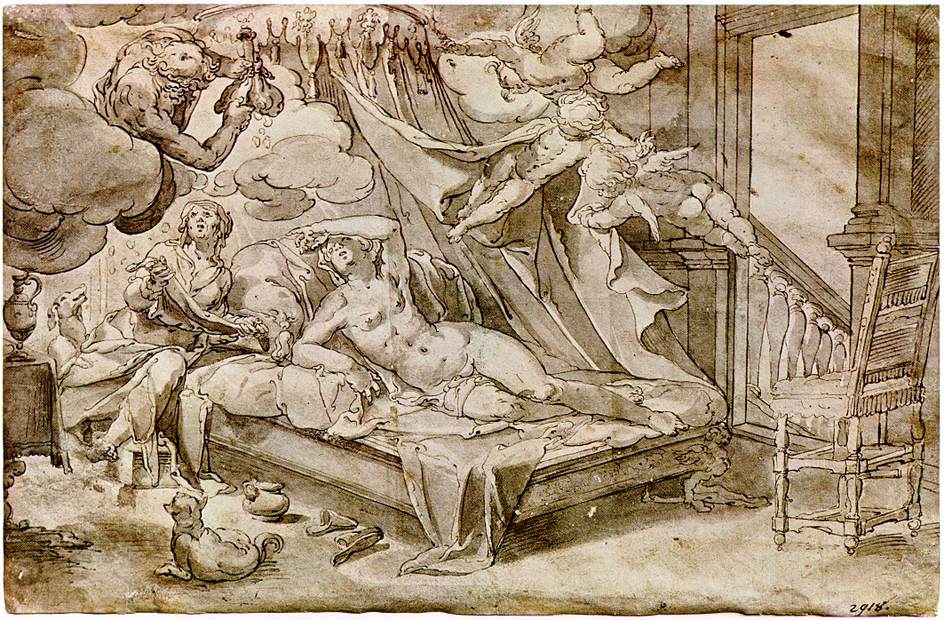 Joachim Wtewael 1600-38 Danae Staatliche Graphische Sammlung München
Joachim Wtewael 1600-38 Danae Staatliche Graphische Sammlung München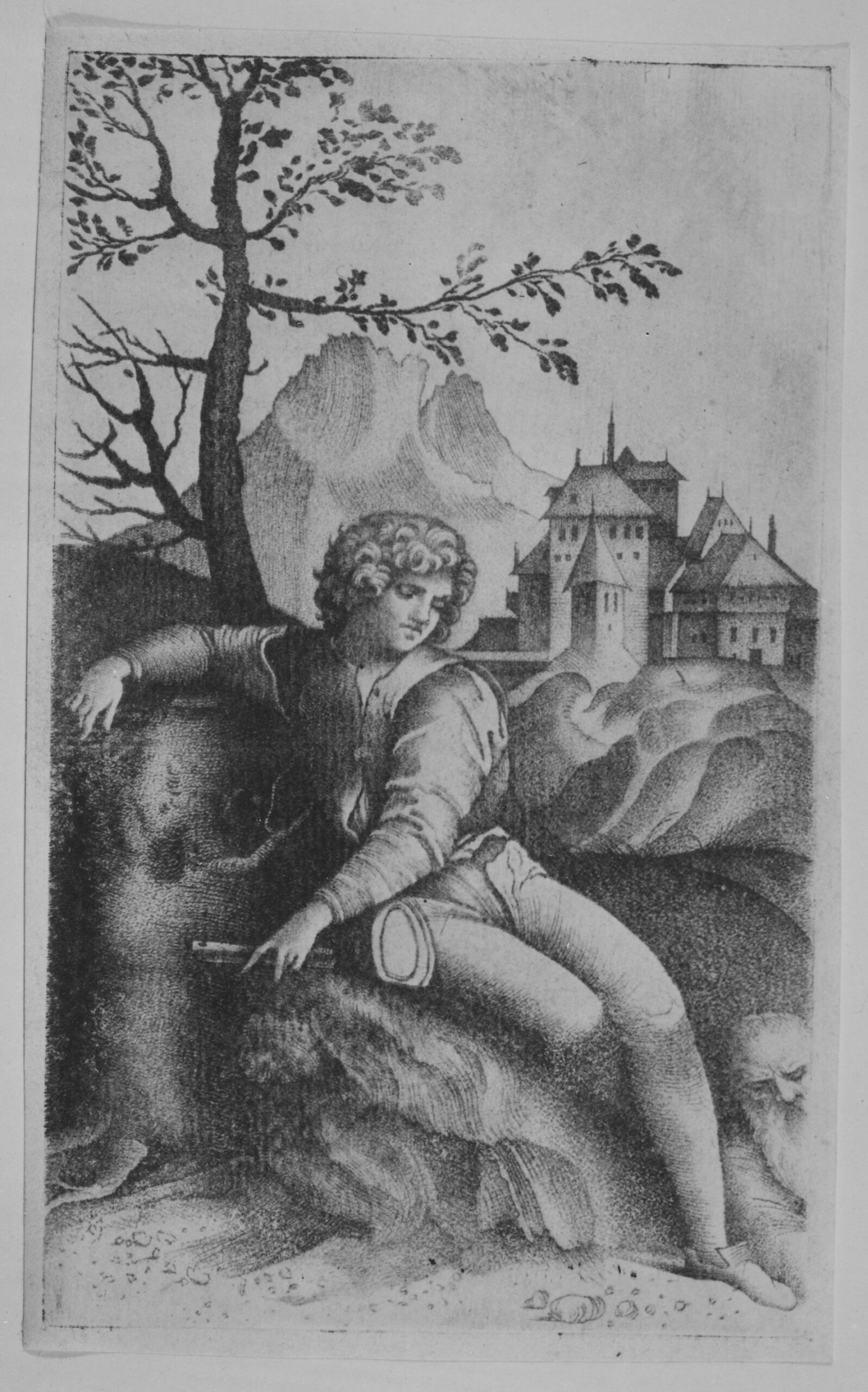 Le jeune berger et le vieillard, Campagnola, 1509–12, MET
Le jeune berger et le vieillard, Campagnola, 1509–12, MET Les trois âges de l’homme, Titien, 1512-14, Galerie nationale d’Écosse, Édimbourg
Les trois âges de l’homme, Titien, 1512-14, Galerie nationale d’Écosse, Édimbourg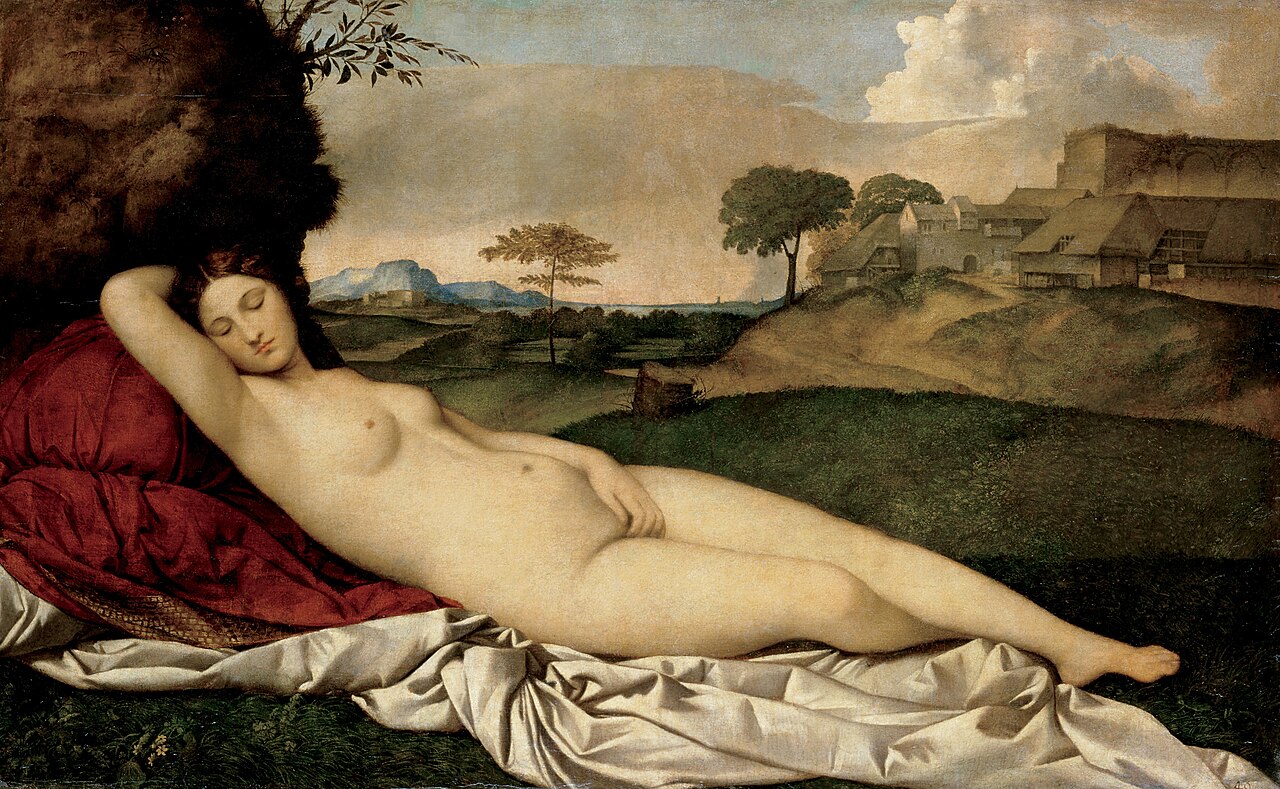 Vénus endormie, Giorgione et Titien, 1510-11, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde
Vénus endormie, Giorgione et Titien, 1510-11, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde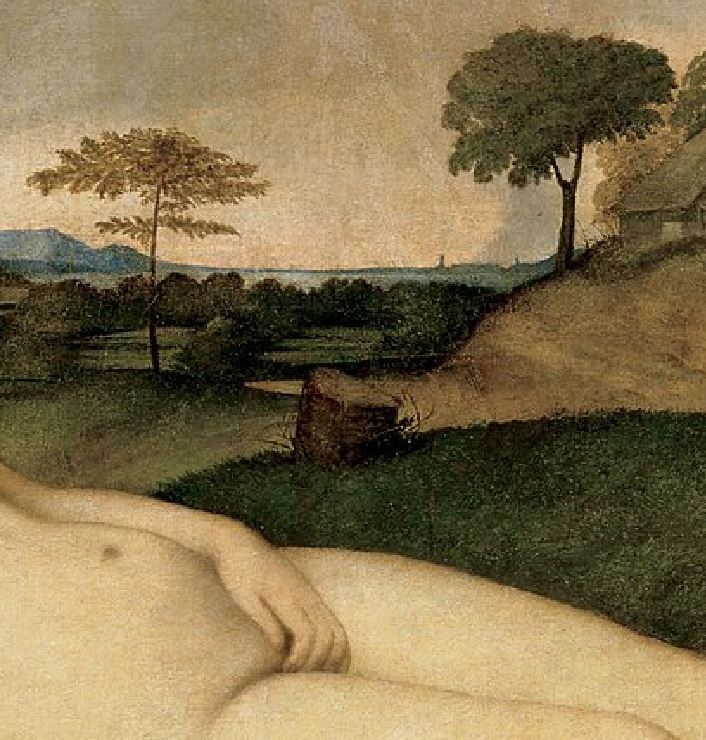

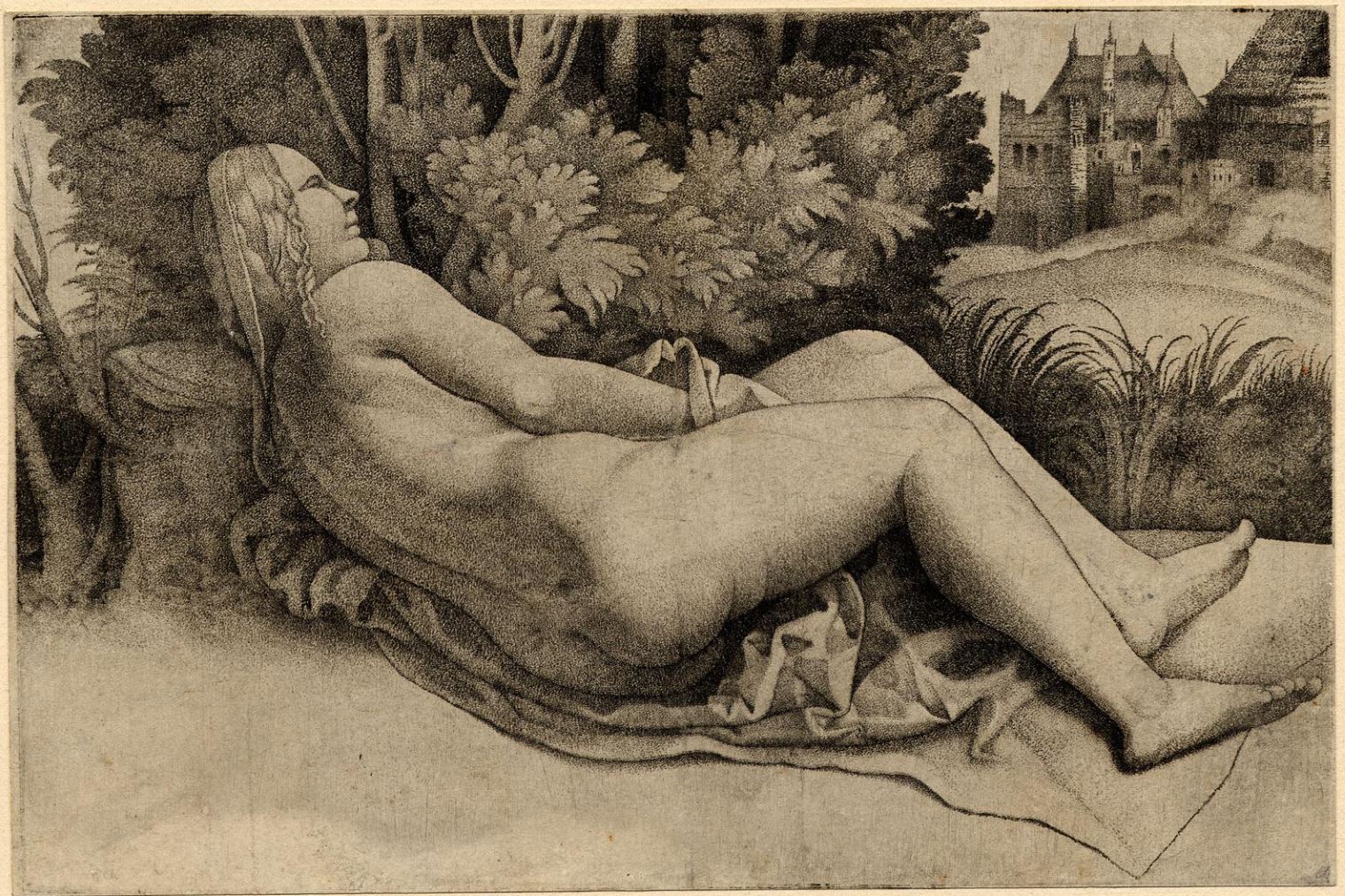 Femme allongée dans un paysage, Campagnola, 1510-15, British Museum 1846,0509.136
Femme allongée dans un paysage, Campagnola, 1510-15, British Museum 1846,0509.136 Giovanni Martini da Udine, fresques de la villa Farnésine
Giovanni Martini da Udine, fresques de la villa Farnésine Cartouche avec une maxime d’Epictète, Frans Huys, d’après Hans Vredeman de Vries, 1555, série Variarum protractionum, Rijksmuseum
Cartouche avec une maxime d’Epictète, Frans Huys, d’après Hans Vredeman de Vries, 1555, série Variarum protractionum, Rijksmuseum Sentence d’Horace, série Varii generis partitionum, 1556, Herzog Anton Ulrich-Museum
Sentence d’Horace, série Varii generis partitionum, 1556, Herzog Anton Ulrich-Museum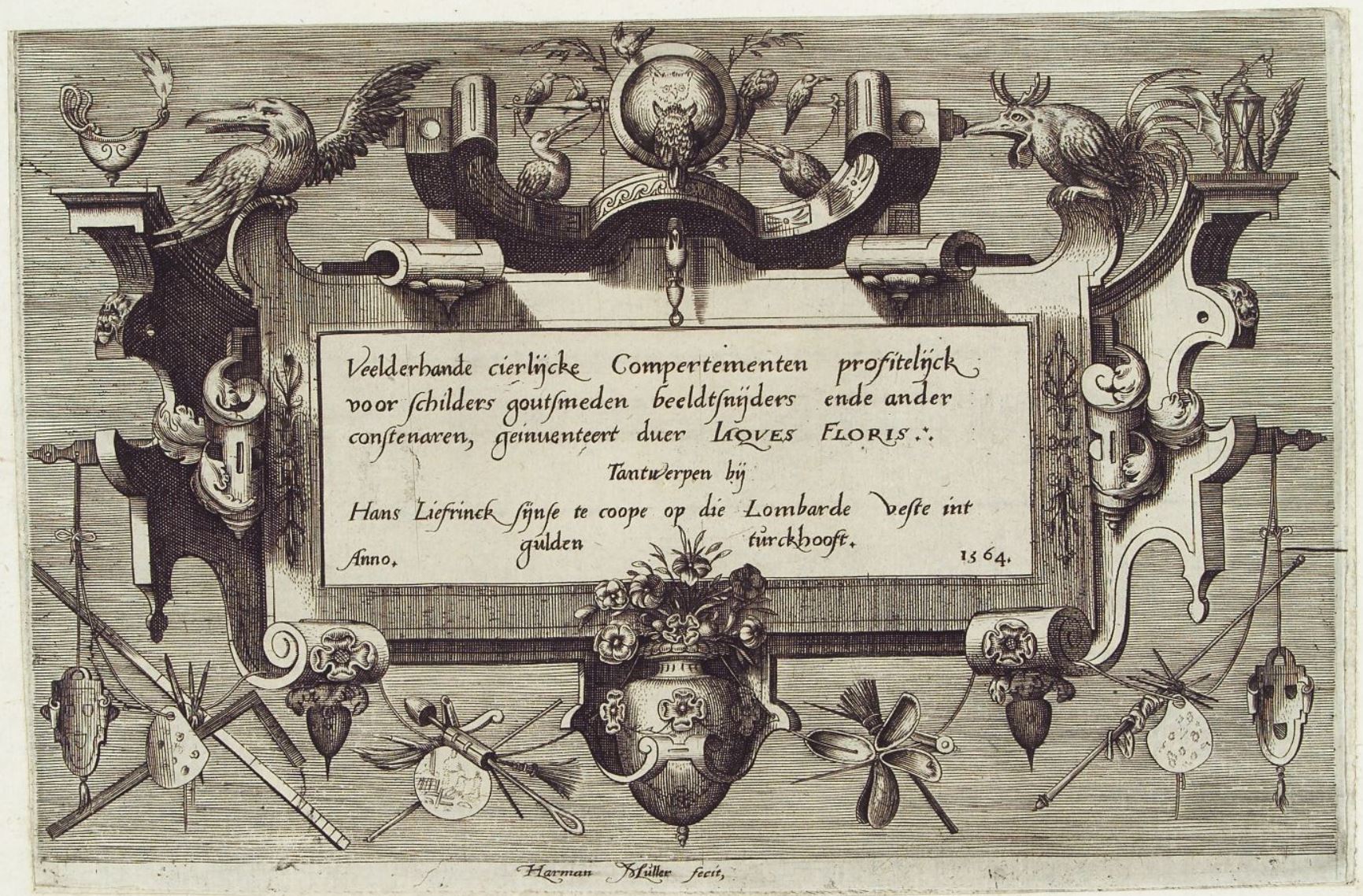 Frontispice, série Veelderhande cierlijcke Compertementen profitelijck, 1564
Frontispice, série Veelderhande cierlijcke Compertementen profitelijck, 1564 Les volaillières
Les volaillières Deux marchandes et un garçon avec de la volaille et des légumes
Deux marchandes et un garçon avec de la volaille et des légumes
 Le magasin de poissons
Le magasin de poissons


 La cuisine
La cuisine Les vendeurs de poissons
Les vendeurs de poissons
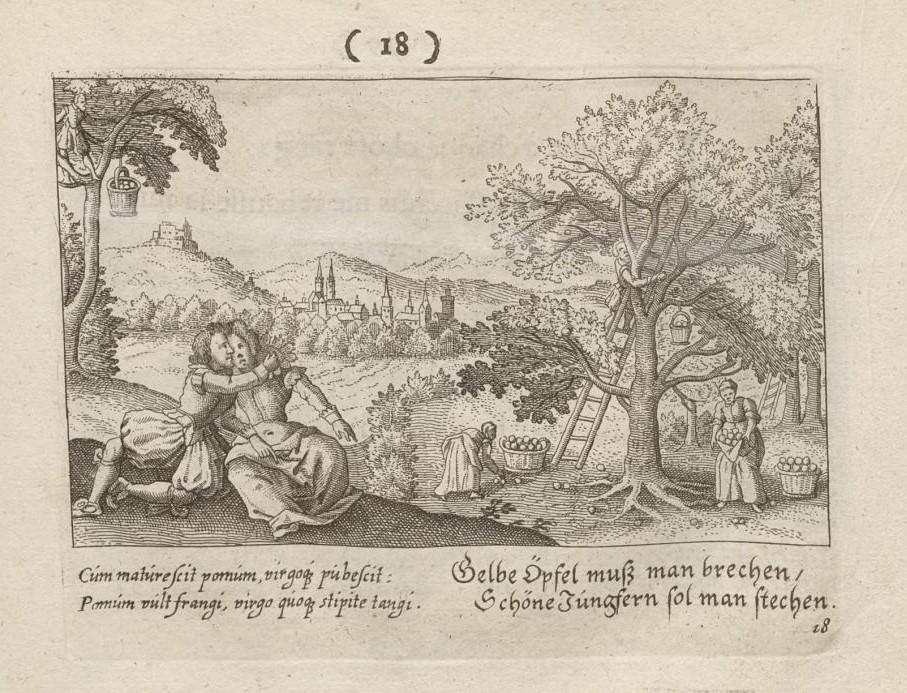 Gravure de Peter Rollos, 1608, Euterpae suboles, N°18
Gravure de Peter Rollos, 1608, Euterpae suboles, N°18
 La vendeuse de fruits (fruttivendola), Campi, 1583, collection privée
La vendeuse de fruits (fruttivendola), Campi, 1583, collection privée
 Satire d’un concert de madrigal
Satire d’un concert de madrigal
 Comte F. de Liederkecke, Château de Leefdael
Comte F. de Liederkecke, Château de Leefdael Collection particulière, vendue par Christies en 2015
Collection particulière, vendue par Christies en 2015 Nature morte aux fruits sur une dalle de pierre
Nature morte aux fruits sur une dalle de pierre Nature morte avec un röhmer, un bretzel, des noix et des amandes.
Nature morte avec un röhmer, un bretzel, des noix et des amandes. L’amateur de cactus
L’amateur de cactus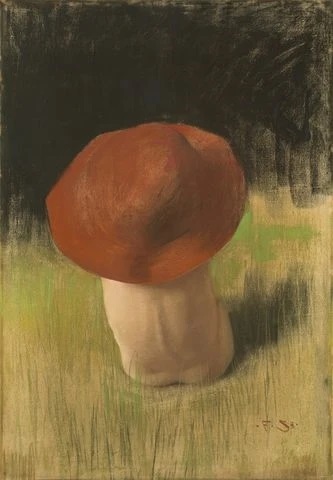


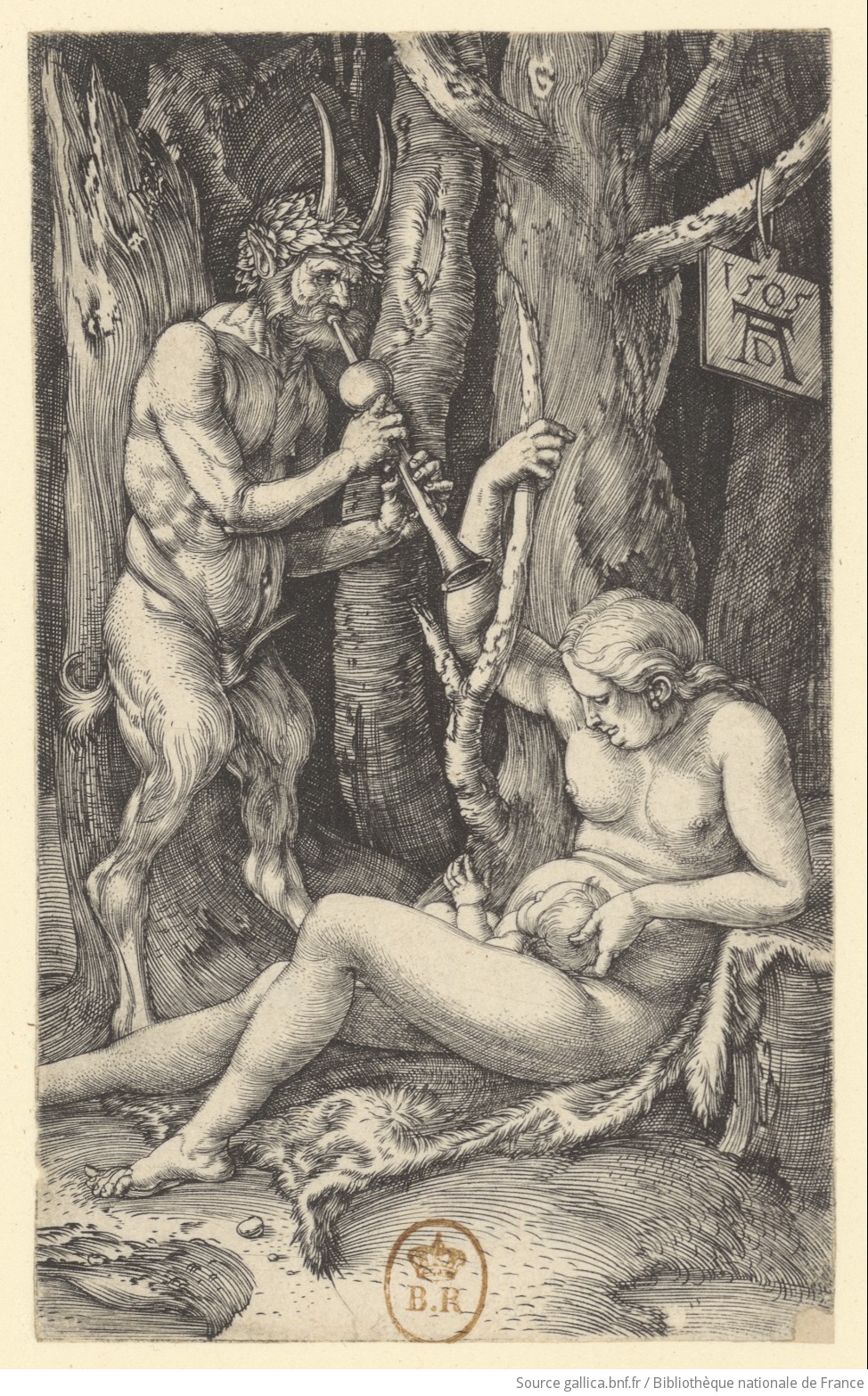 La Famille du Satyre, Dürer, 1505
La Famille du Satyre, Dürer, 1505 Musidora (The Bather At the Doubtful Breeze Alarmed)
Musidora (The Bather At the Doubtful Breeze Alarmed) La nymphe de l’amour
La nymphe de l’amour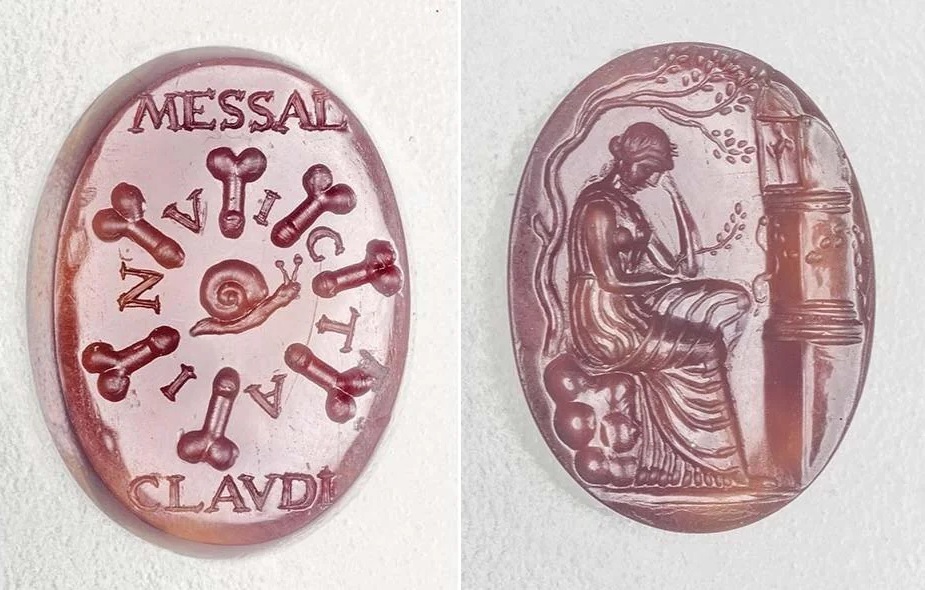 Messal invicta Claudi, Antikensammlung Berlin
Messal invicta Claudi, Antikensammlung Berlin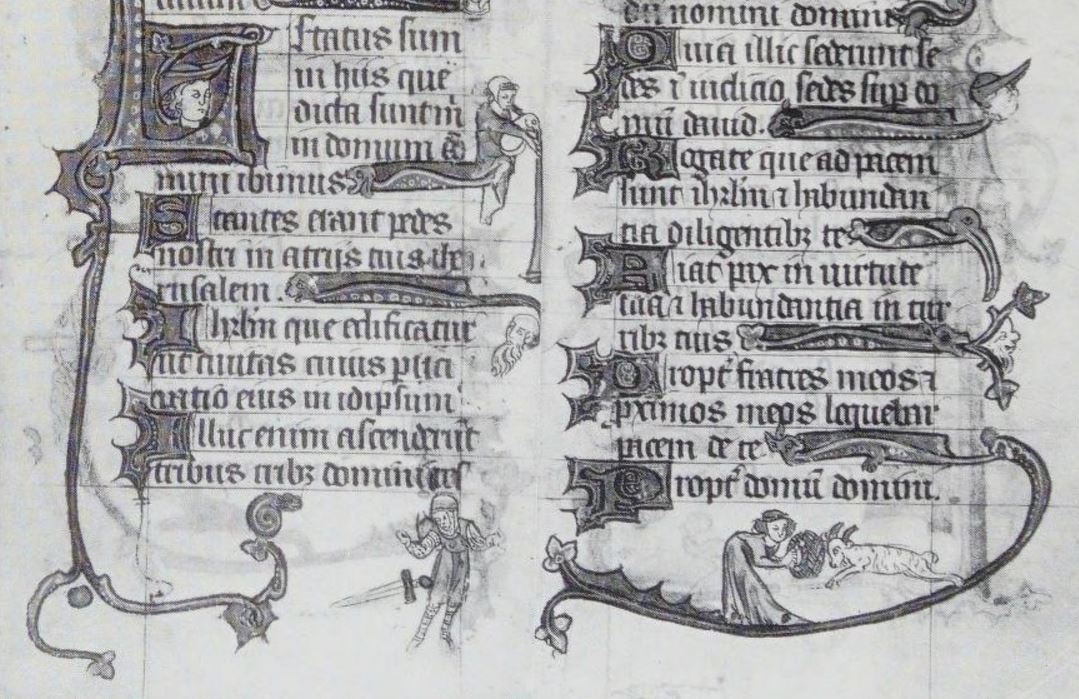 Psautier KB MS GKS 3384 fol 160v-161r (Camille fig 13)
Psautier KB MS GKS 3384 fol 160v-161r (Camille fig 13) Missel festif (Amiens), 1323, KBH, Ms. 78 D 40, fol 177
Missel festif (Amiens), 1323, KBH, Ms. 78 D 40, fol 177 Cupidon et Vénus sur un escargot
Cupidon et Vénus sur un escargot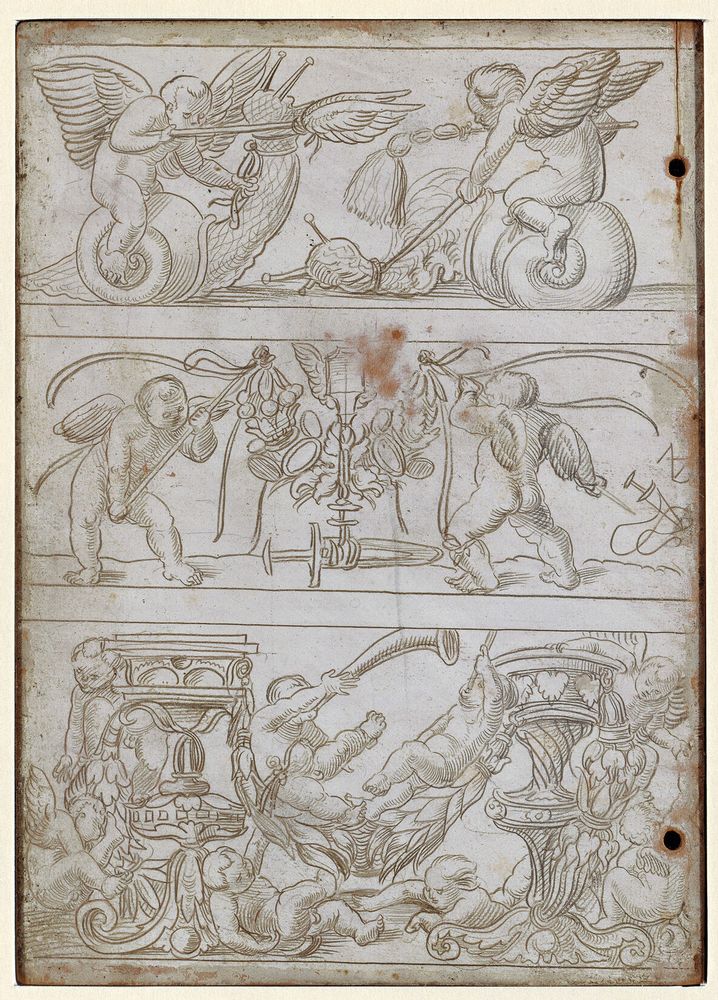 Niklaus Manuel Deutsch, vers 1517, Schreibbüchlein, Kunstmuseum Basel (photo Martin P. Bühler)
Niklaus Manuel Deutsch, vers 1517, Schreibbüchlein, Kunstmuseum Basel (photo Martin P. Bühler) Cupidon en équilibre sur une boule
Cupidon en équilibre sur une boule Cupidon chevauchant un escargot sur un tapis de champignons
Cupidon chevauchant un escargot sur un tapis de champignons

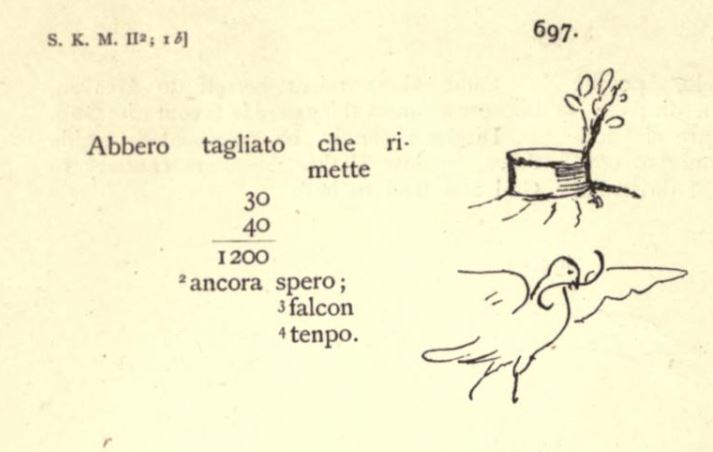 Leonard de Vinci Richter The literary works of Leonardo da Vinci 1883 Vol 1 No 697
Leonard de Vinci Richter The literary works of Leonardo da Vinci 1883 Vol 1 No 697 Jeune homme avec un arc et un grand carquois et un ami avec un bouclier, Tiepolo, 1730-50, Rijksmuseum
Jeune homme avec un arc et un grand carquois et un ami avec un bouclier, Tiepolo, 1730-50, Rijksmuseum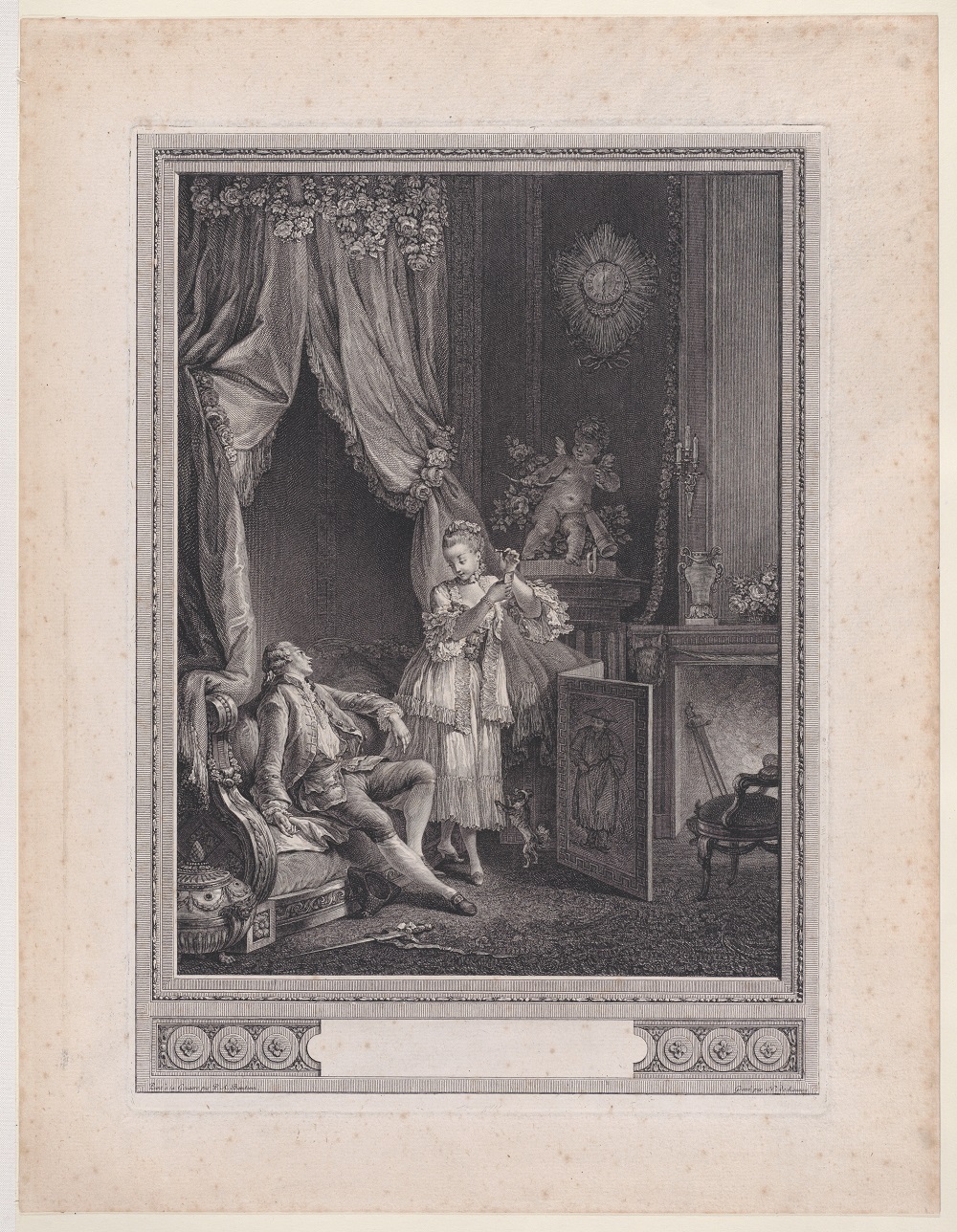 Le carquois épuisé
Le carquois épuisé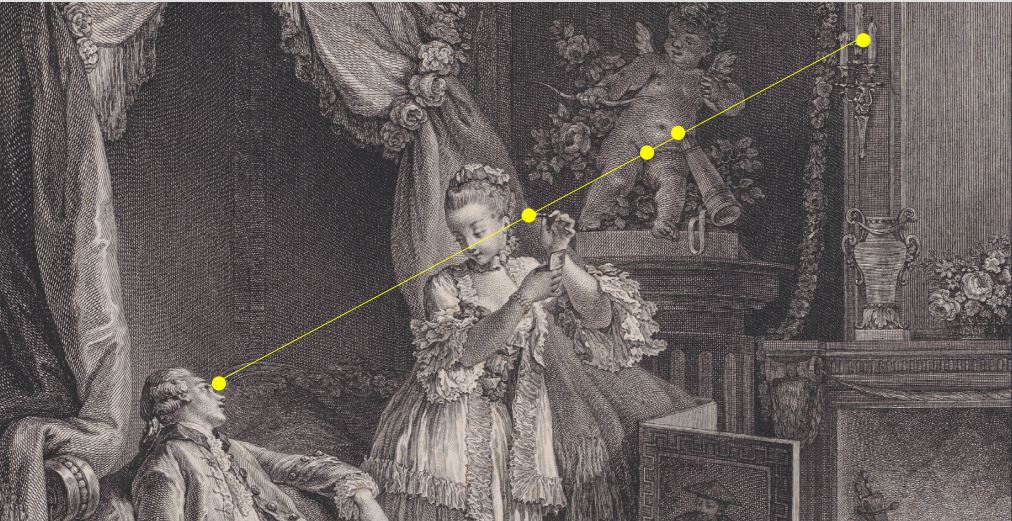
 Amor Imperator, 1887, Museum Villa Stuck
Amor Imperator, 1887, Museum Villa Stuck Cupidon au bal masqué, collection particulière
Cupidon au bal masqué, collection particulière Une inutile leçon de morale
Une inutile leçon de morale L’examen du docteur
L’examen du docteur La Grande Bacchanale (détail), Gérard de Lairesse, vers 1675
La Grande Bacchanale (détail), Gérard de Lairesse, vers 1675 Rêverie
Rêverie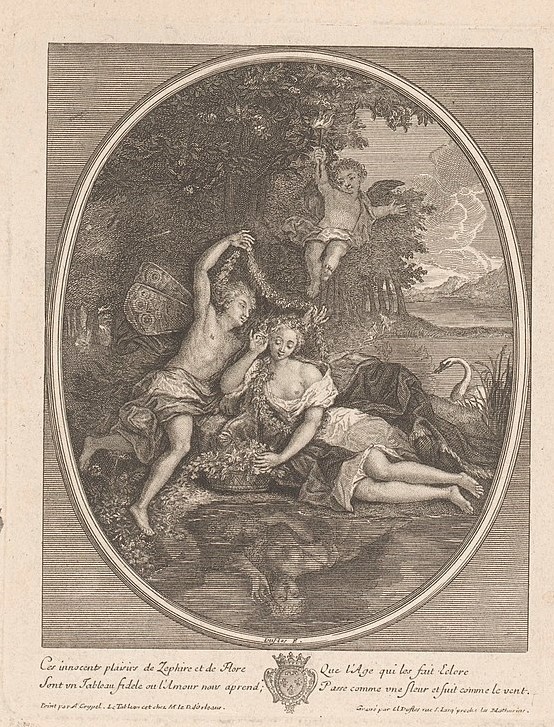 Gravure de Claude I Duflos d’après Antoine Coypel, 1675-1721
Gravure de Claude I Duflos d’après Antoine Coypel, 1675-1721 Francois Gaspard Adam Gruft, 1749, Château de Sanssouci
Francois Gaspard Adam Gruft, 1749, Château de Sanssouci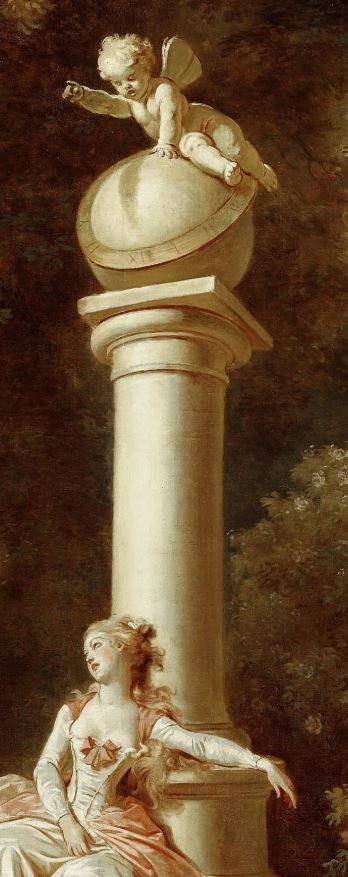
 Spranger, vers 1585, Kusthistorisches Museum Wien
Spranger, vers 1585, Kusthistorisches Museum Wien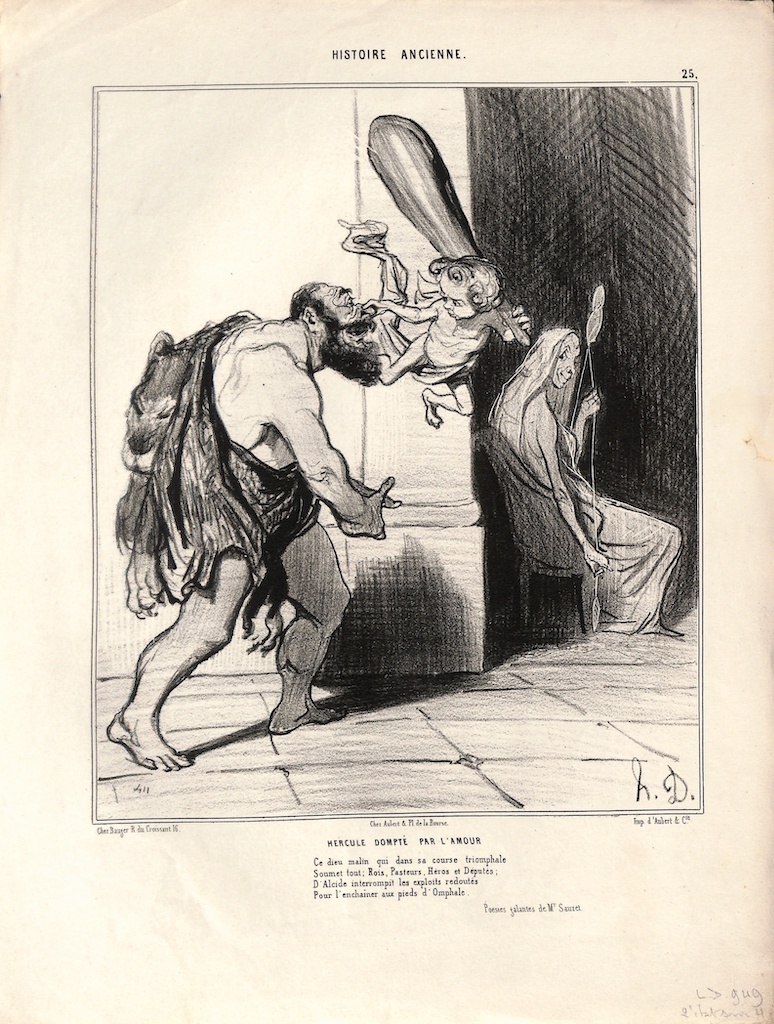 Daumier, 1842
Daumier, 1842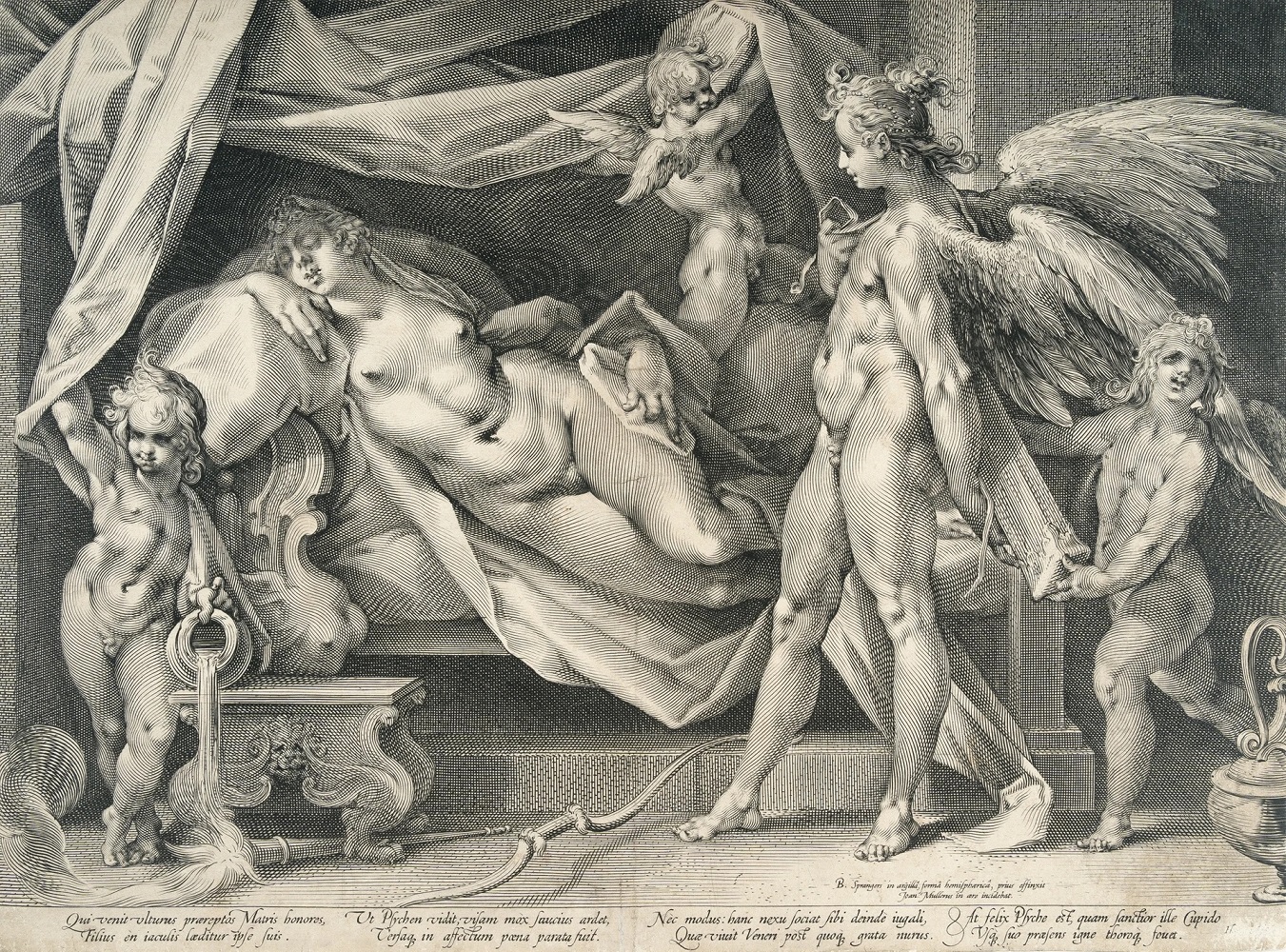 Cupidon découvre Psyché dans son lit
Cupidon découvre Psyché dans son lit
 Cupidon volant avec sa torche
Cupidon volant avec sa torche Vénus entourée d’une ronde d’amours
Vénus entourée d’une ronde d’amours Cupidon comme « Link Boy », Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
Cupidon comme « Link Boy », Albright-Knox Art Gallery, Buffalo Mercure comme coupe-bourse, Faringdon Collection Trust.
Mercure comme coupe-bourse, Faringdon Collection Trust. Priape et Lotis (détail du Festin des Dieux)
Priape et Lotis (détail du Festin des Dieux)
 Allégorie de la Nature en nourrice des Arts
Allégorie de la Nature en nourrice des Arts Allégorie de l’Amour et de la Musique
Allégorie de l’Amour et de la Musique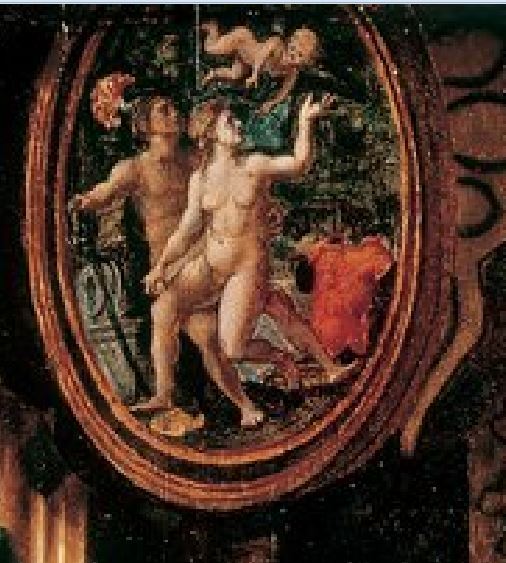

 Beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen
Beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen


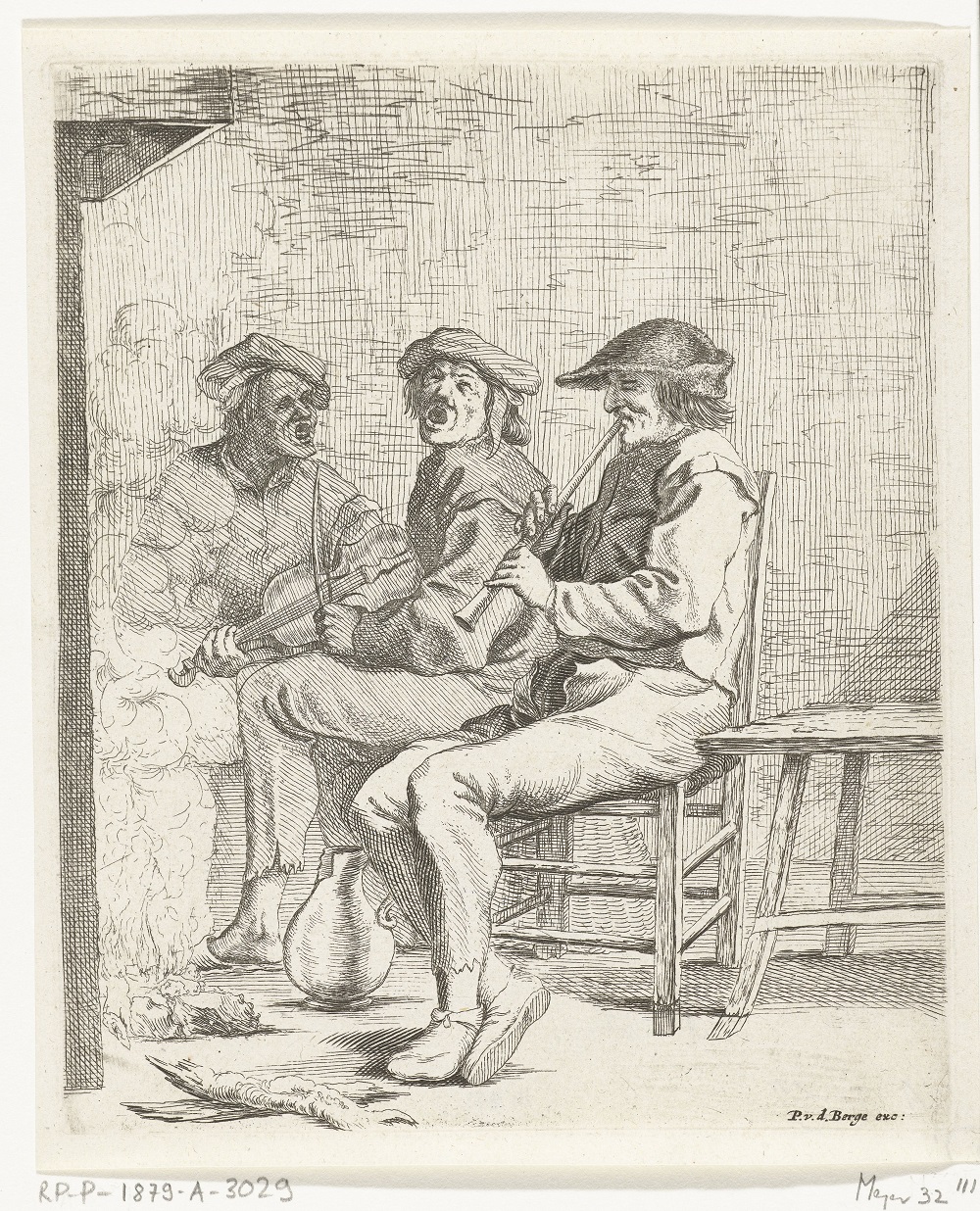 Les trois musiciens, 1633-72, gravure de Willem Basse, d’après Adriaen Brouwer, Rijksmuseum
Les trois musiciens, 1633-72, gravure de Willem Basse, d’après Adriaen Brouwer, Rijksmuseum Un garçon et une fille jouant de la musique à la lueur d’une bougie
Un garçon et une fille jouant de la musique à la lueur d’une bougie
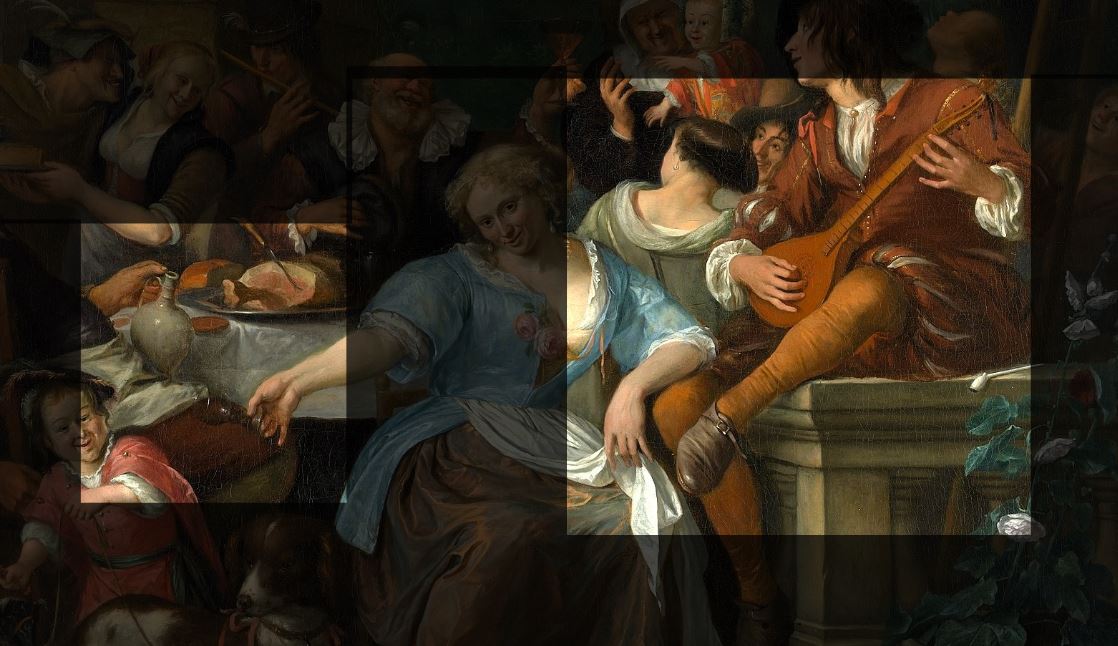
 L’enchanteur
L’enchanteur Pantalone
Pantalone

 Autoportrait en Zeuxis
Autoportrait en Zeuxis Salon de 1879, collection particulière
Salon de 1879, collection particulière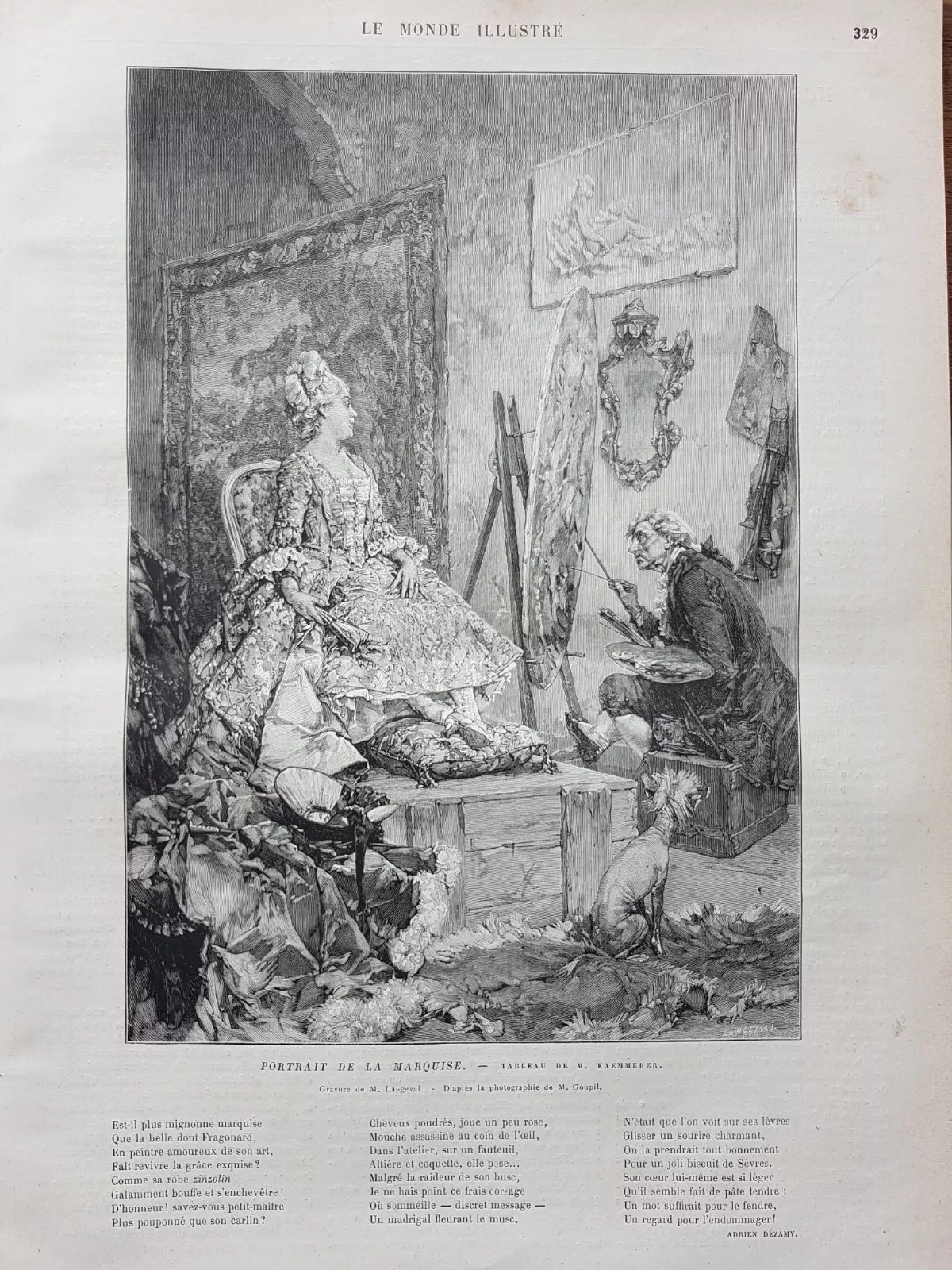 Le monde illustré, 22 novembre 1879
Le monde illustré, 22 novembre 1879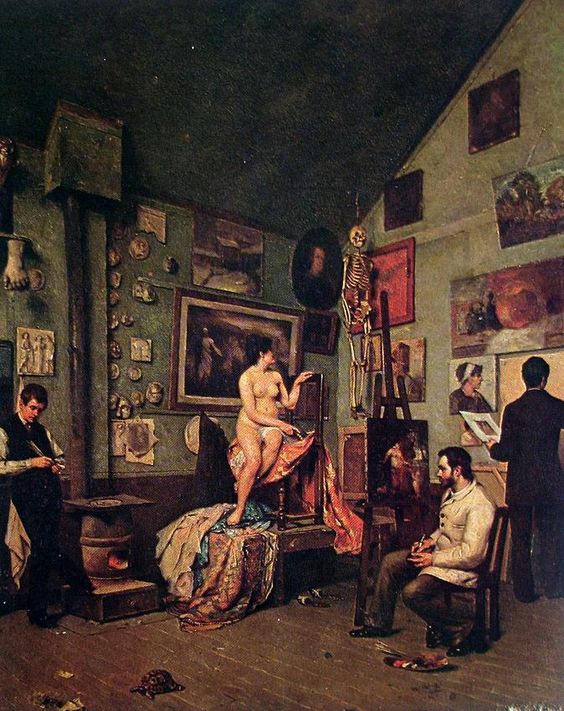
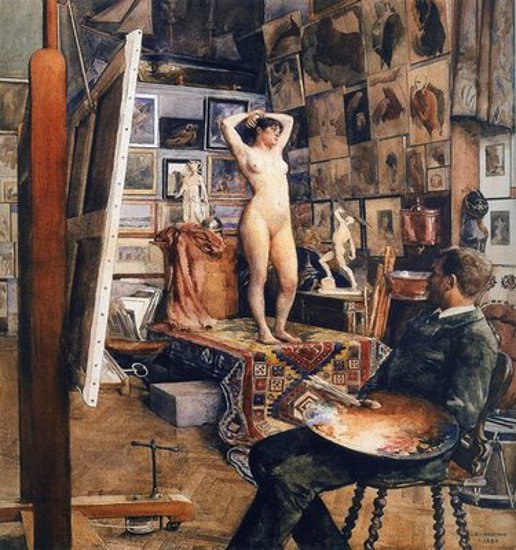 La séance du modèle, janvier 1881, collection particulière
La séance du modèle, janvier 1881, collection particulière Moine sculptant un Christ en bois, Salon de 1874, Musée de Nantes
Moine sculptant un Christ en bois, Salon de 1874, Musée de Nantes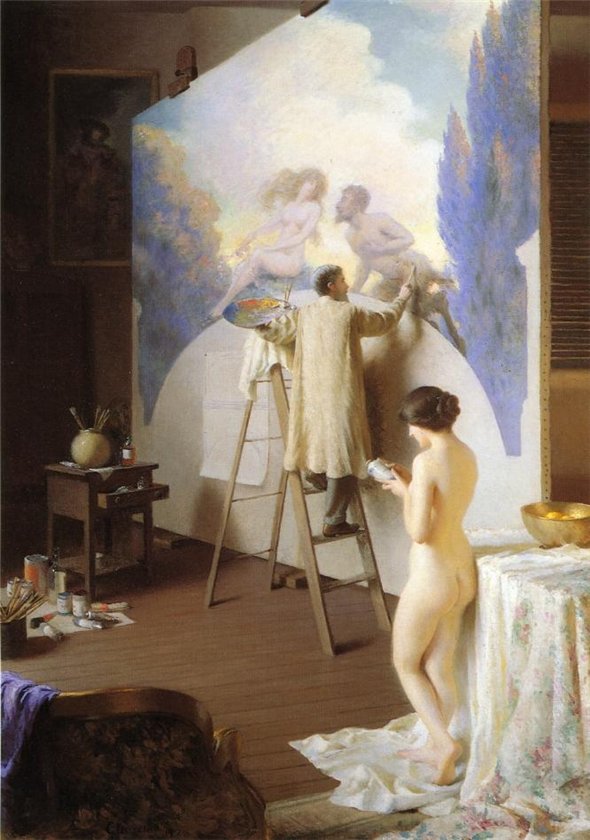
 Danaé
Danaé Les progrès de la galanterie ou Les baisers volés sont les plus doux
Les progrès de la galanterie ou Les baisers volés sont les plus doux Les observateurs d’étoiles (the star gazers)
Les observateurs d’étoiles (the star gazers)
 Deux cordes à son arc
Deux cordes à son arc La promenade en traîneau
La promenade en traîneau Une après-midi de pêche
Une après-midi de pêche A la plage, 1870
A la plage, 1870 Le peintre Frederik Hendrik Kaemmerer à l’oeuvre à Oosterbeek
Le peintre Frederik Hendrik Kaemmerer à l’oeuvre à Oosterbeek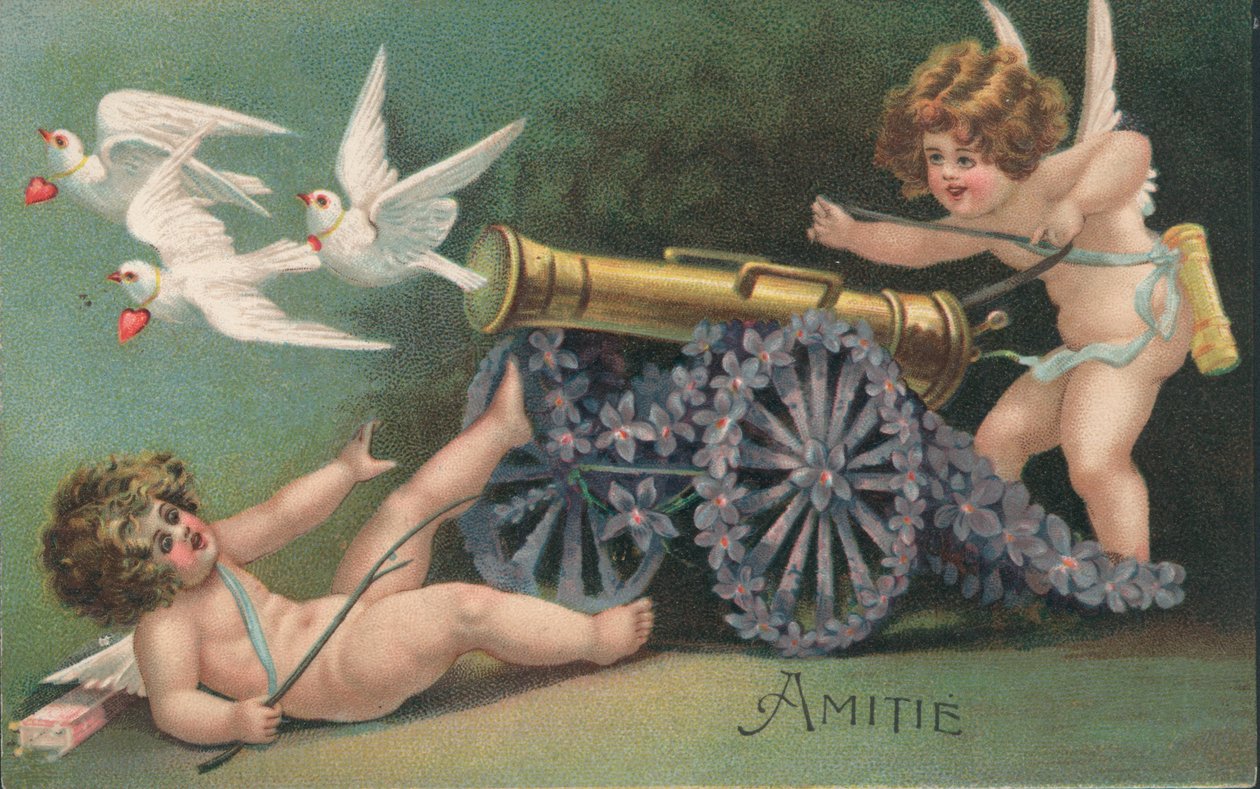

 Carte postale anglaise, 1915
Carte postale anglaise, 1915 Carte postale française, 1914-18
Carte postale française, 1914-18 Les Jets d’eau, vers 1765–70, Clark Institute
Les Jets d’eau, vers 1765–70, Clark Institute Les Pétards, 1763-5, Museum of Fine Arts, Boston.
Les Pétards, 1763-5, Museum of Fine Arts, Boston.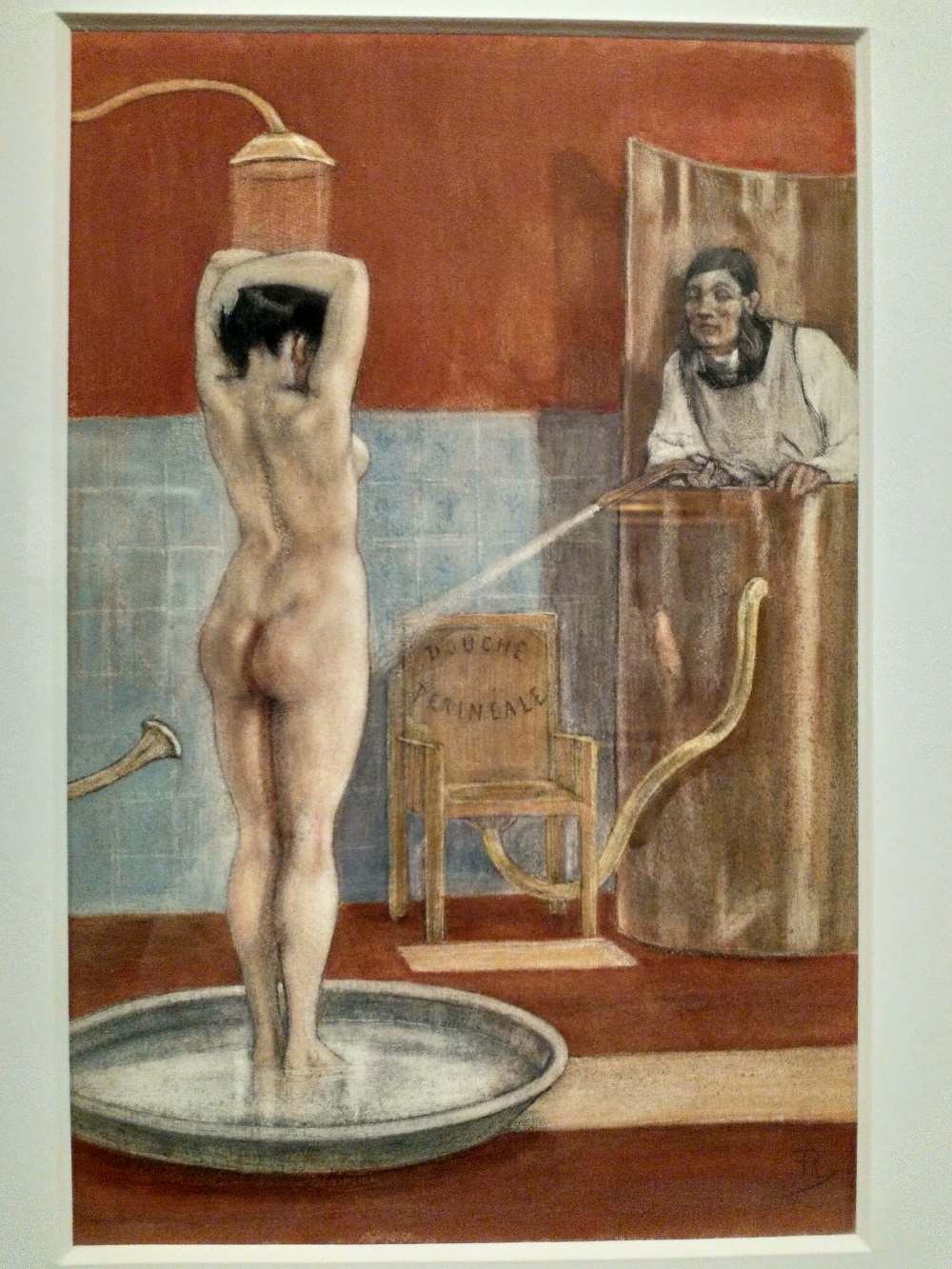 La Douche, Rops, 1878-81, pastel et gouache, Musée Rops Namur
La Douche, Rops, 1878-81, pastel et gouache, Musée Rops Namur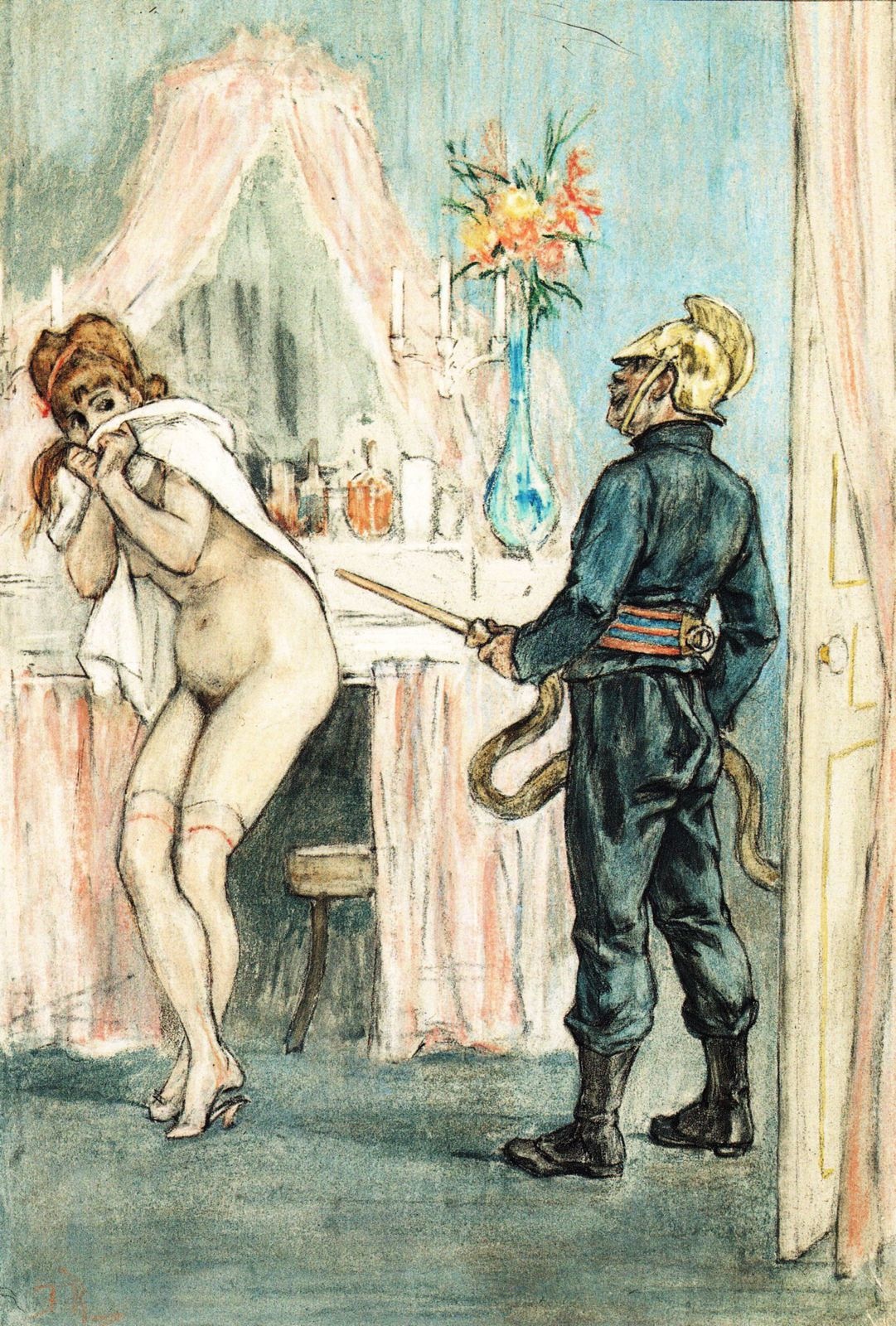 Où est le feu !, Rops, 1878-81, pastel et aquarelle, collection particulière
Où est le feu !, Rops, 1878-81, pastel et aquarelle, collection particulière Isabella
Isabella
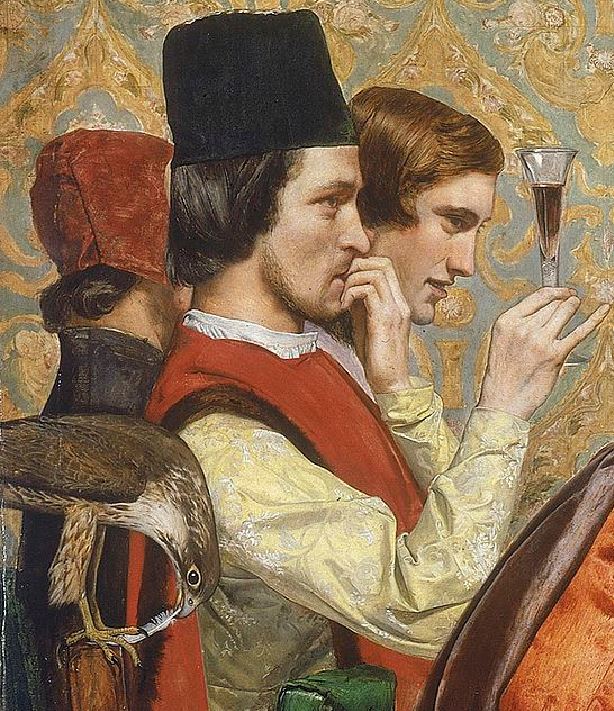 Frederic George Stephens
Frederic George Stephens

 La demoiselle d’honneur
La demoiselle d’honneur
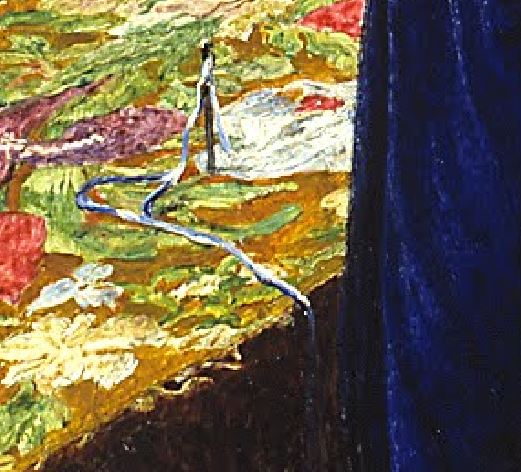
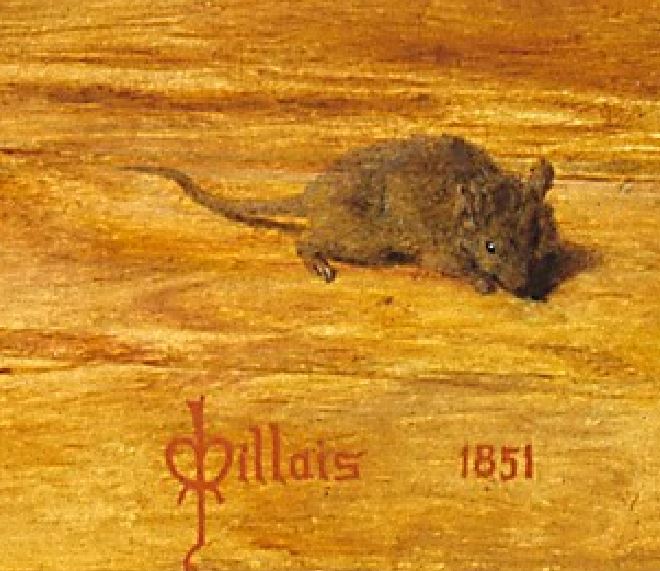
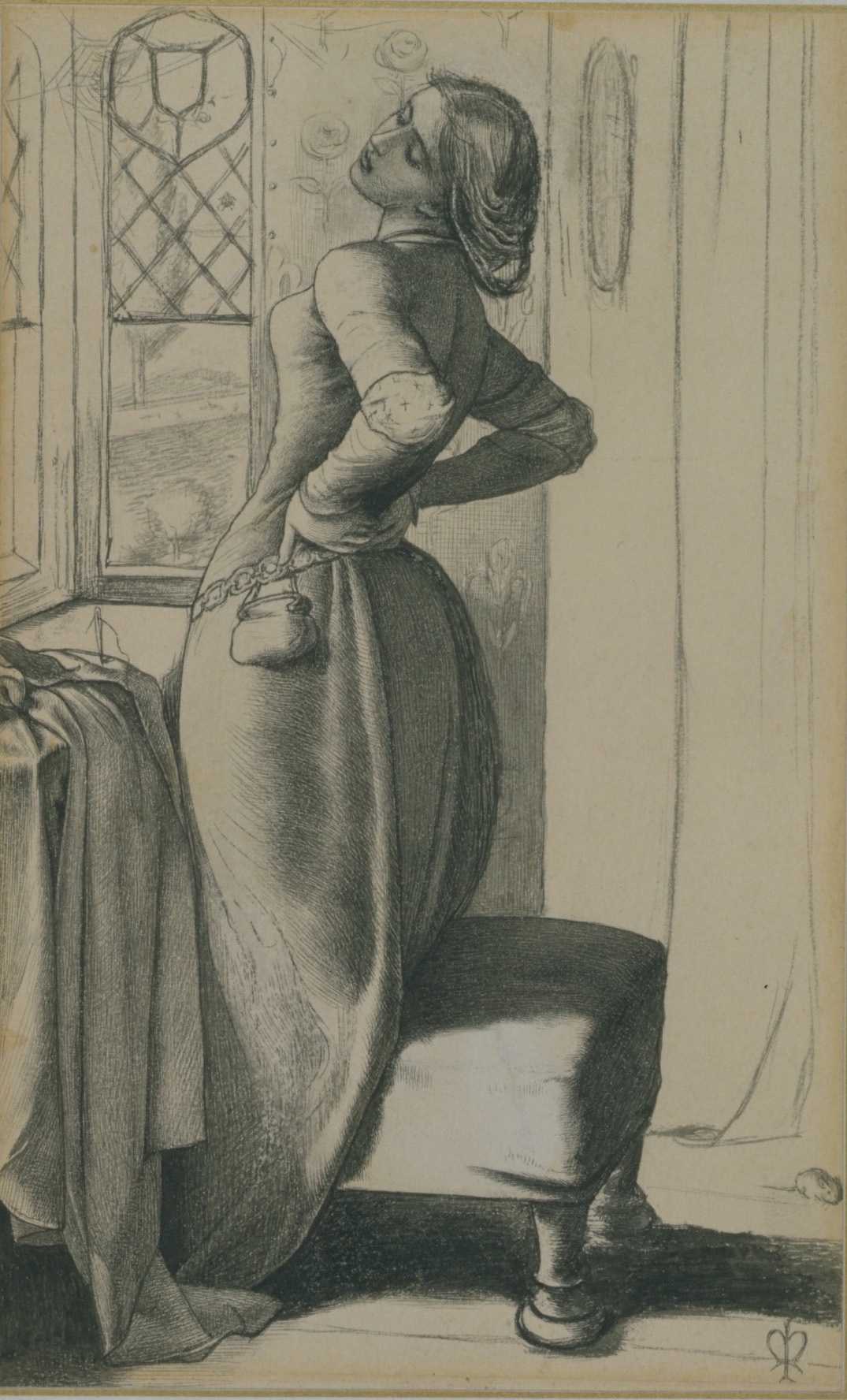

 Garden Study of the Vickers Children, 1884 , Flint Institute of Arts
Garden Study of the Vickers Children, 1884 , Flint Institute of Arts Carnation, Lily, Lily, Rose, 1885-86, Tate Britain
Carnation, Lily, Lily, Rose, 1885-86, Tate Britain Priape et Lotis
Priape et Lotis Un putto ailé fouettant un satyre attaché à un arbre
Un putto ailé fouettant un satyre attaché à un arbre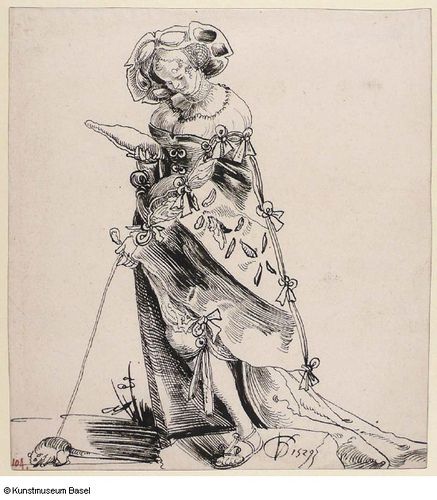

 Gentilhomme au clairon, 1874, collection particulière
Gentilhomme au clairon, 1874, collection particulière La sentinelle endormie, 1875, collection particulière
La sentinelle endormie, 1875, collection particulière Jeune page en costume florentin, Cabanel, 1881, collection particulière
Jeune page en costume florentin, Cabanel, 1881, collection particulière Mousquetaire, Antonio Fabres, 1902, Musée national d’Art de Catalogne
Mousquetaire, Antonio Fabres, 1902, Musée national d’Art de Catalogne
 La Mandragorine (crème de menthe glaciale), 1898
La Mandragorine (crème de menthe glaciale), 1898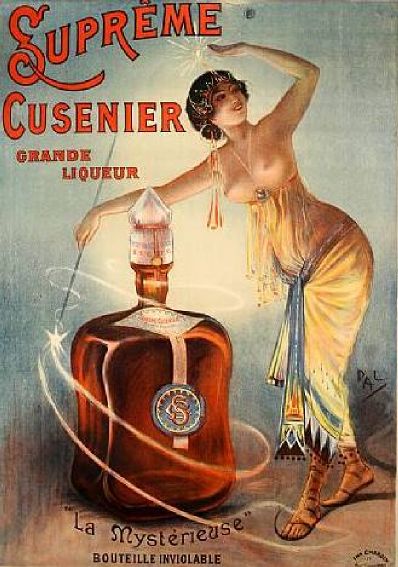 La Suprême (grande liqueur), 1901
La Suprême (grande liqueur), 1901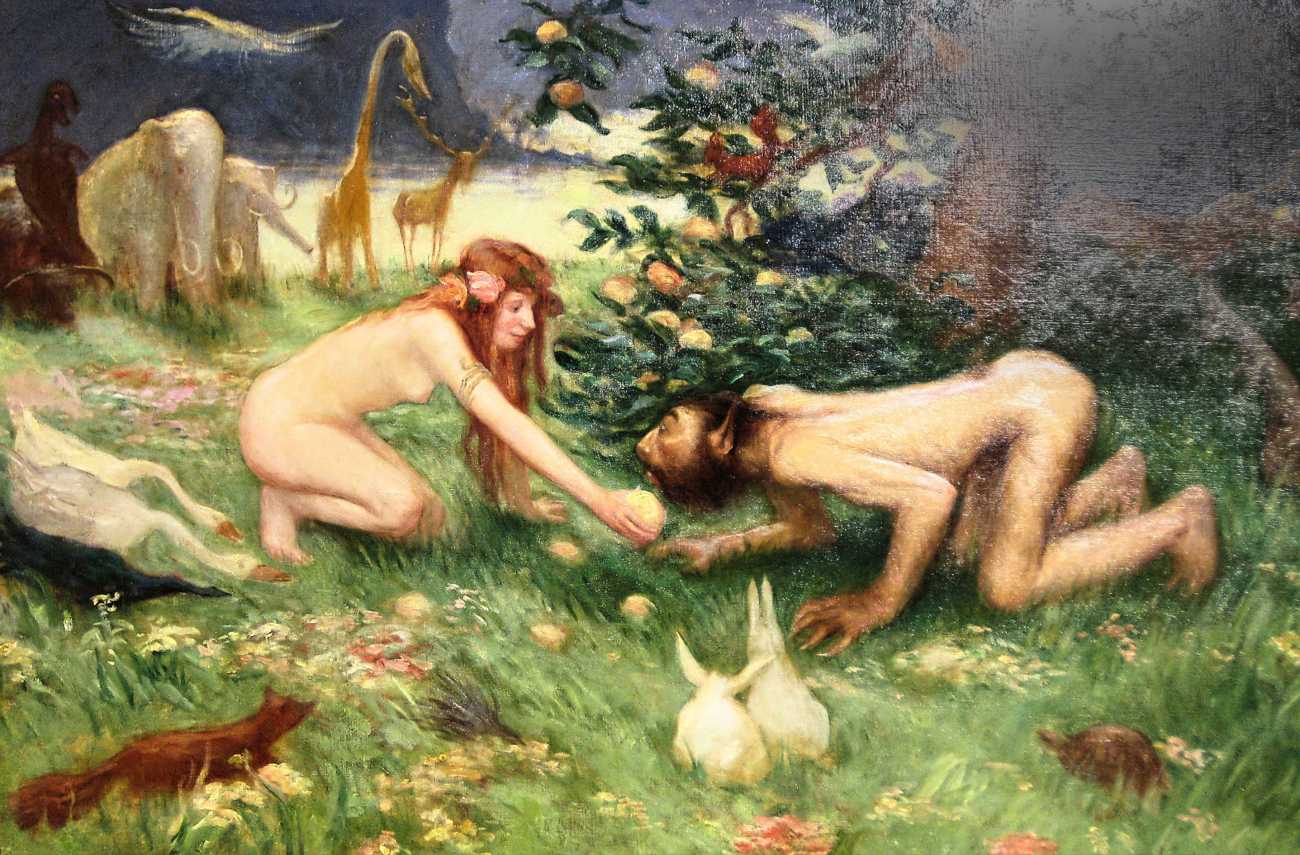 Adam et Eve
Adam et Eve La bricoleuse (wrench wench)
La bricoleuse (wrench wench) Ça colle (Good match)
Ça colle (Good match)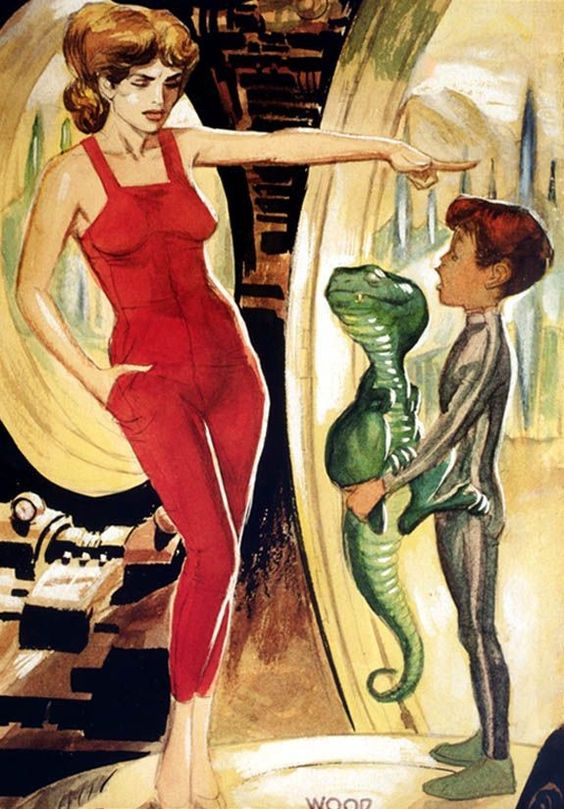 Proposition de couverture pour Galaxy
Proposition de couverture pour Galaxy Fou et folle, Beham, 1531-50
Fou et folle, Beham, 1531-50 La demoiselle et le chevalier
La demoiselle et le chevalier

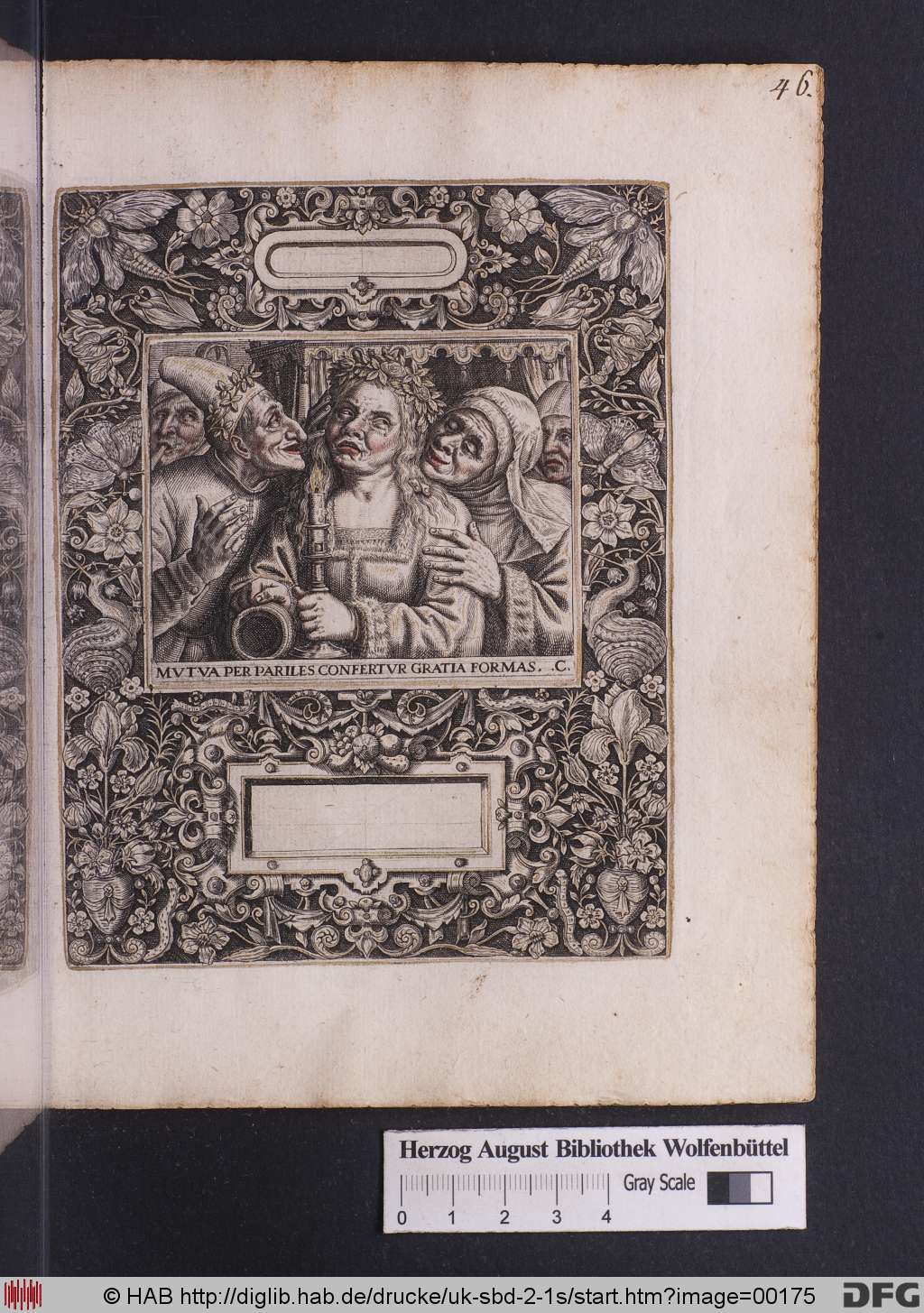 Emblème B, p 46
Emblème B, p 46 Scène de taverne
Scène de taverne
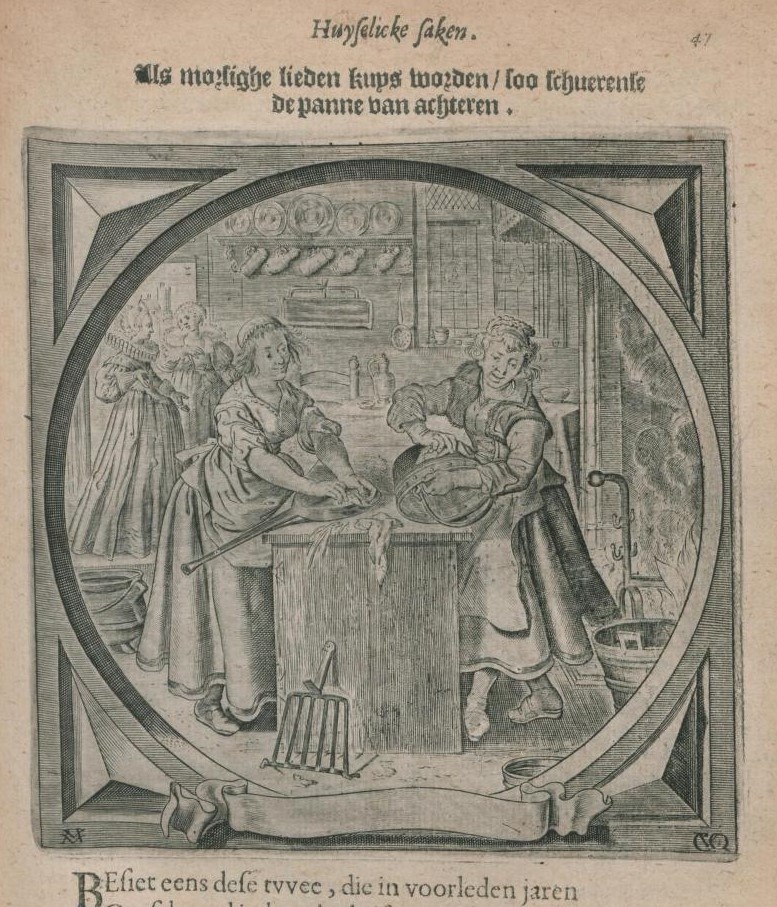
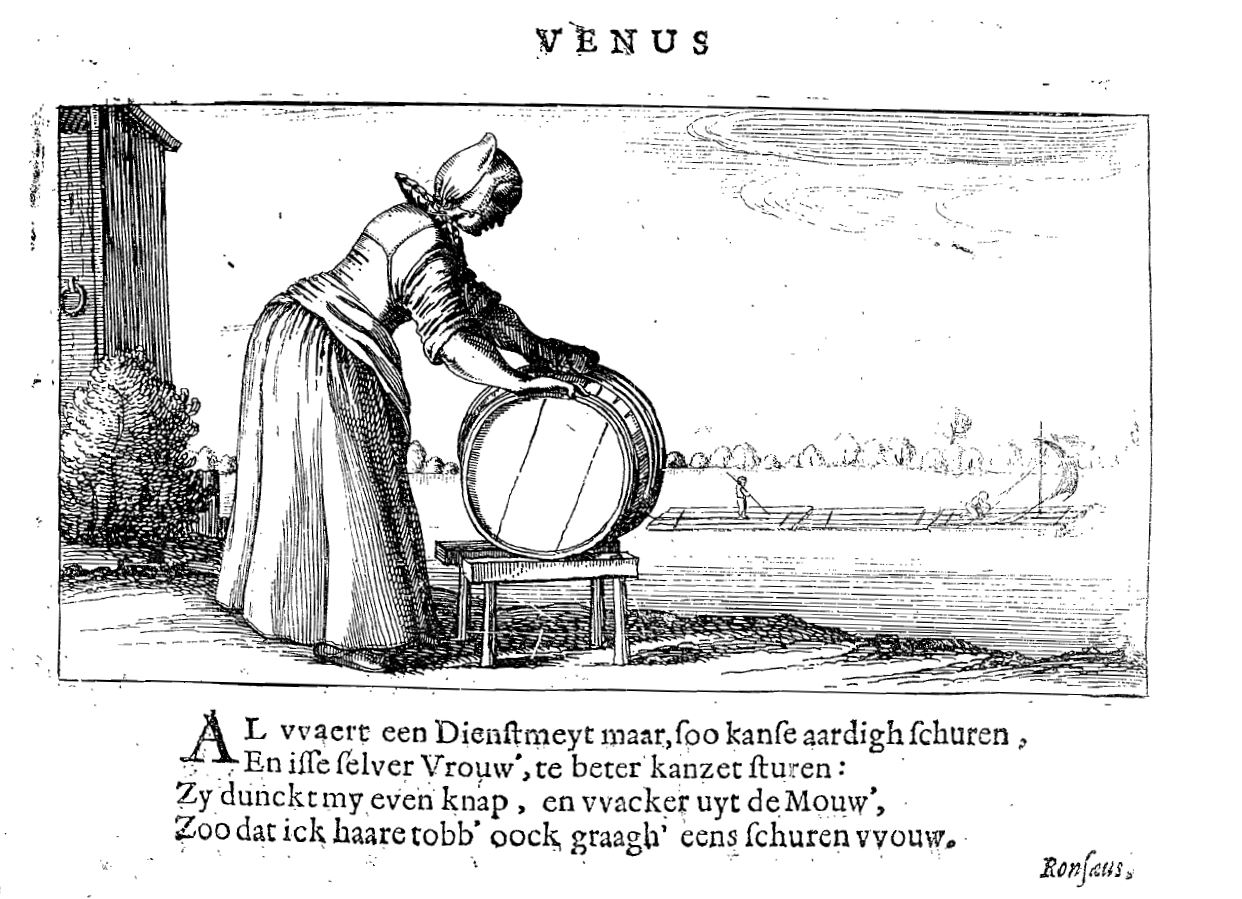 Recueil de chansons Venus minne giftjen 1622, p 30 [51b]
Recueil de chansons Venus minne giftjen 1622, p 30 [51b] Couple mal assorti
Couple mal assorti Arlequin et Pierrette
Arlequin et Pierrette Homme et femme en train de filer
Homme et femme en train de filer
 La fileuse endormie, Courbet, 1853, Musée Fabre, Montpellier
La fileuse endormie, Courbet, 1853, Musée Fabre, Montpellier
 Couple d’amoureux dans une auberge
Couple d’amoureux dans une auberge
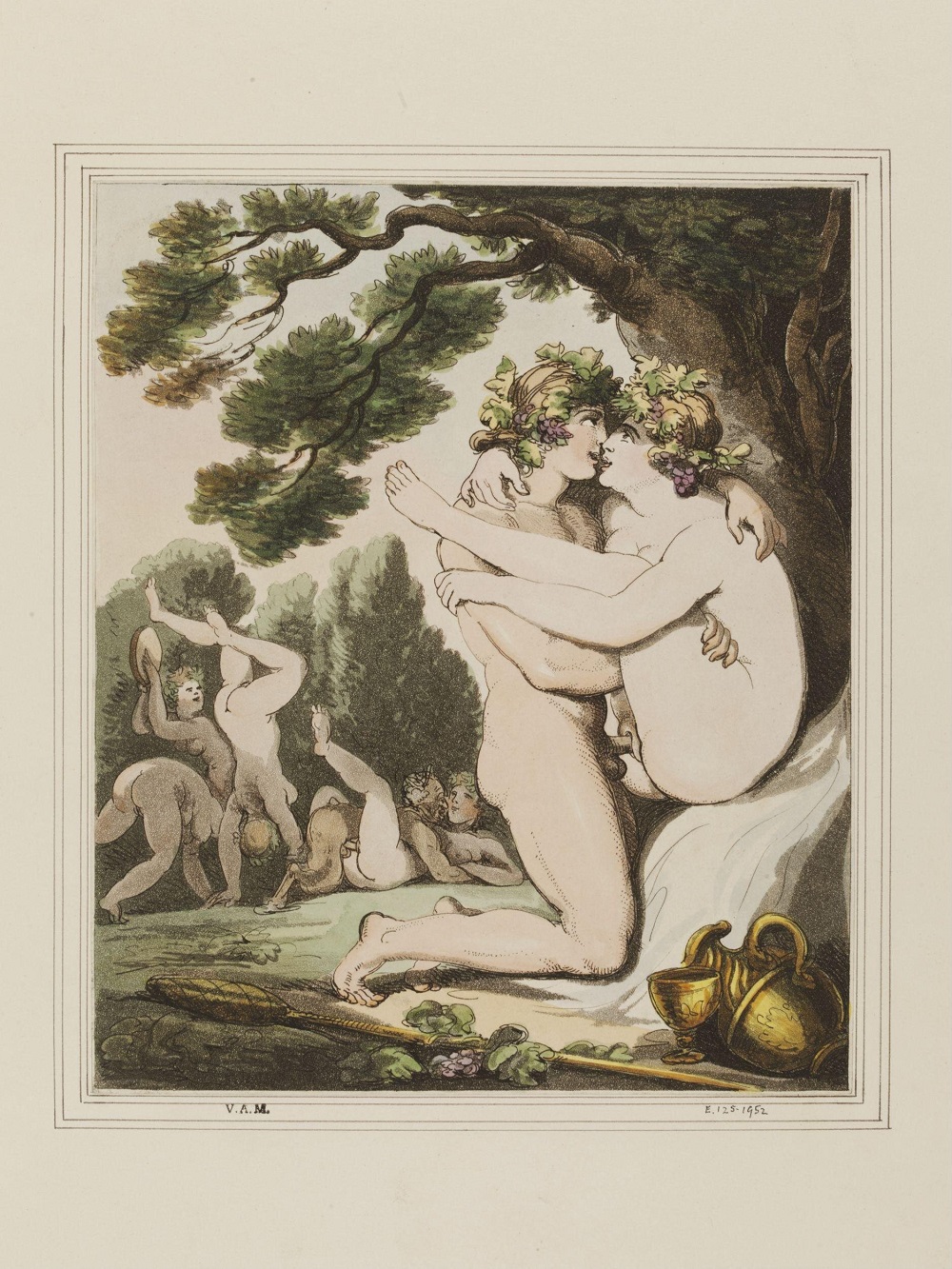 Rowlandson, vers 1815, Victoria and Albert Museum (E.125-1952)
Rowlandson, vers 1815, Victoria and Albert Museum (E.125-1952)
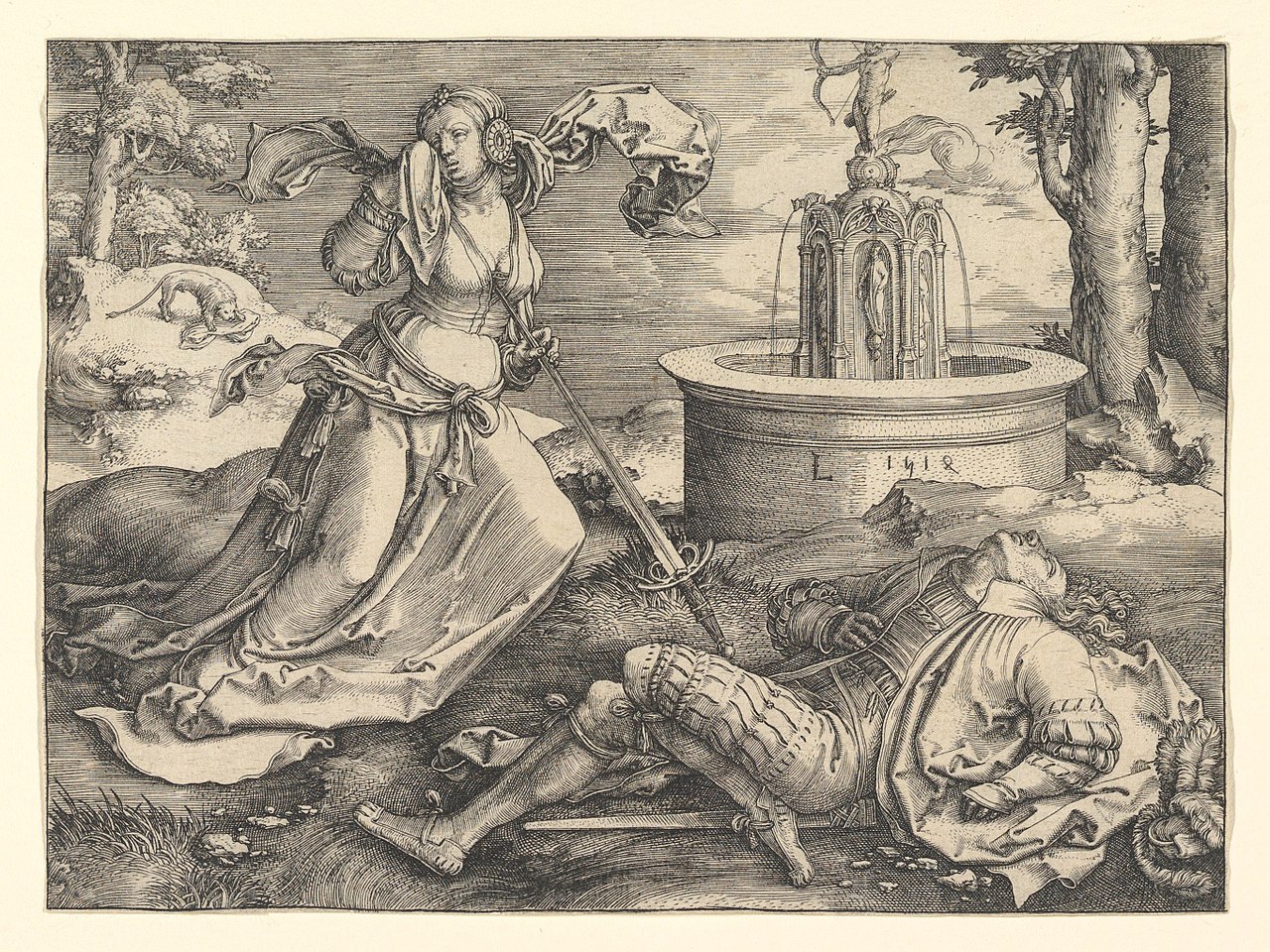 Pyrame et Thisbé
Pyrame et Thisbé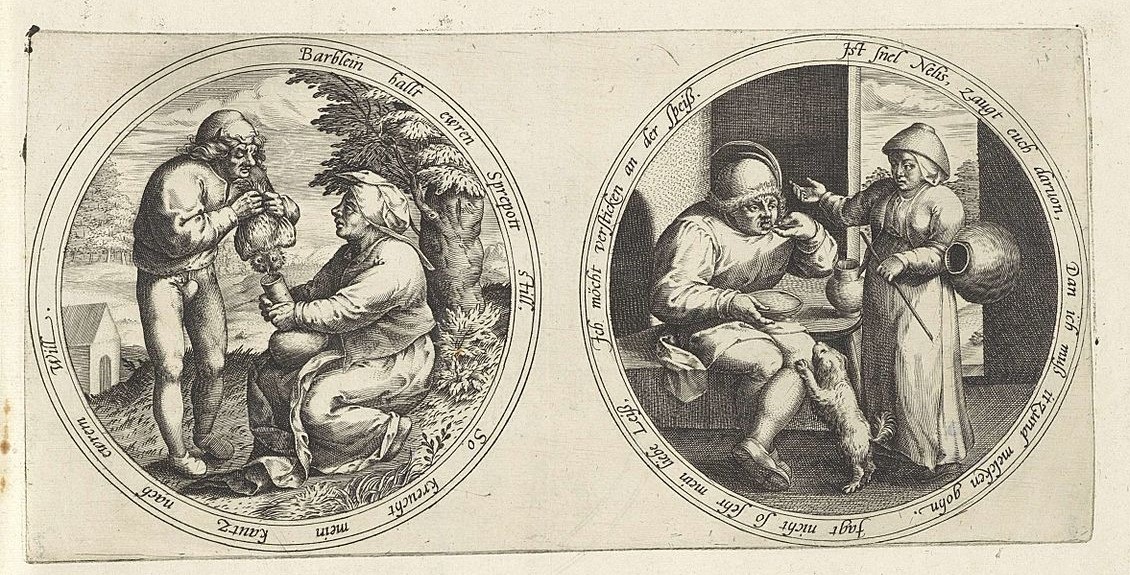 Le Pot à étourneau et La Laitière énervée
Le Pot à étourneau et La Laitière énervée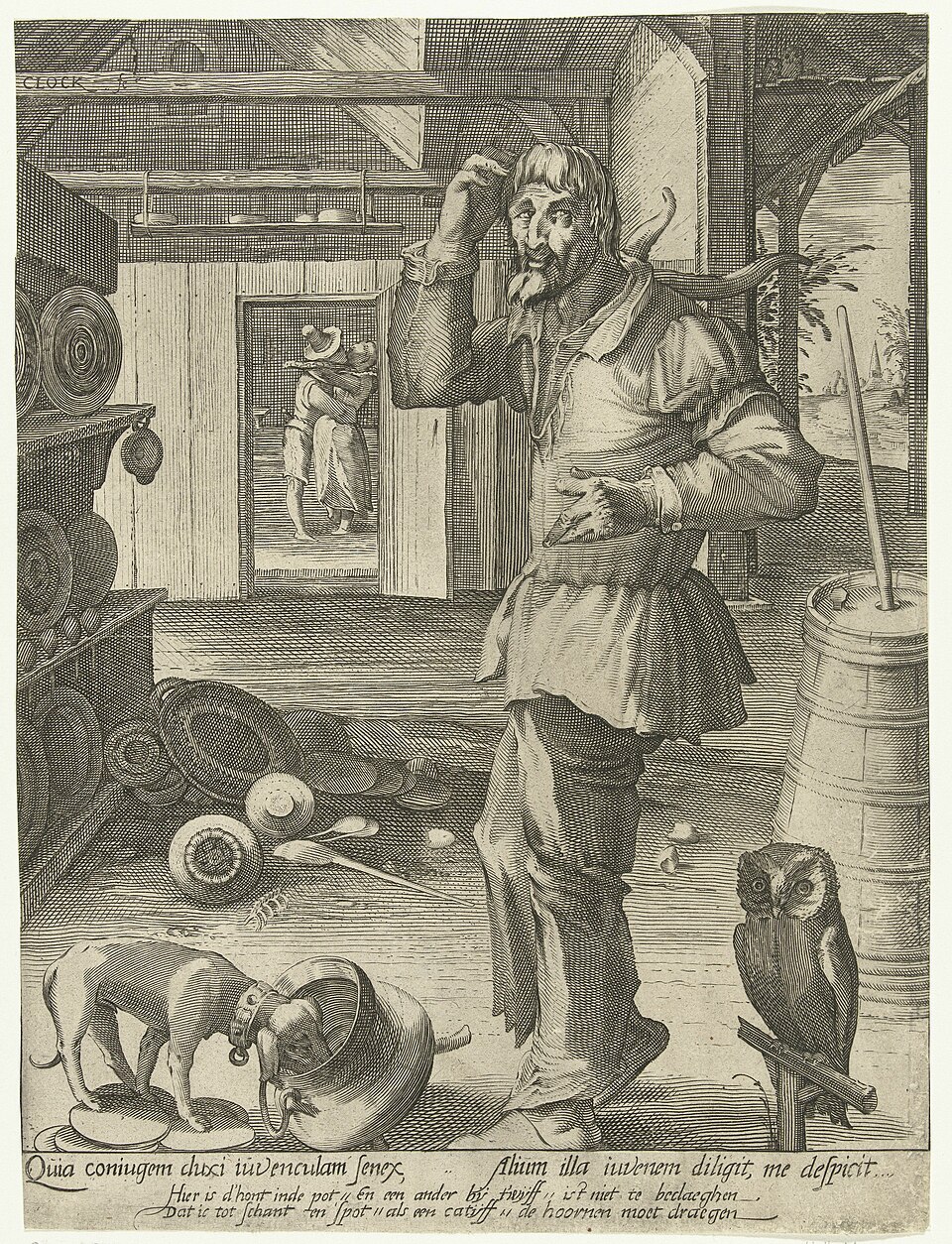

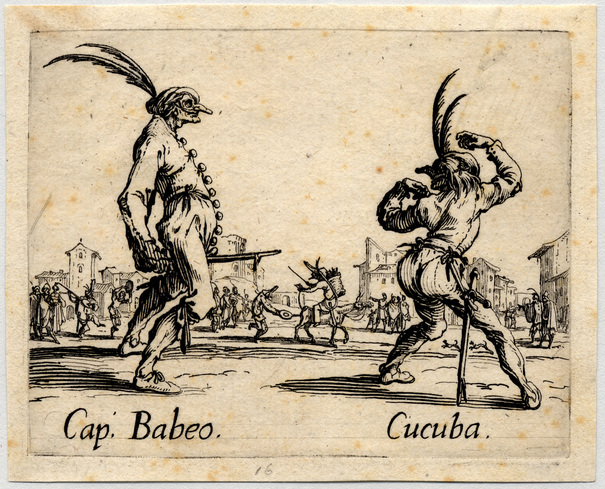 N°16
N°16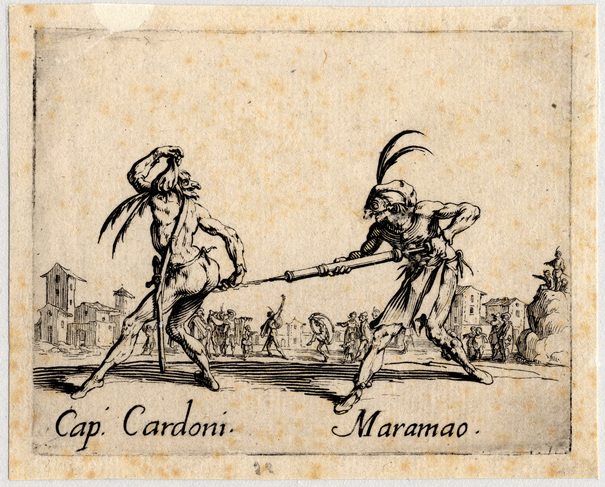 N°22
N°22 Scène de cuisine
Scène de cuisine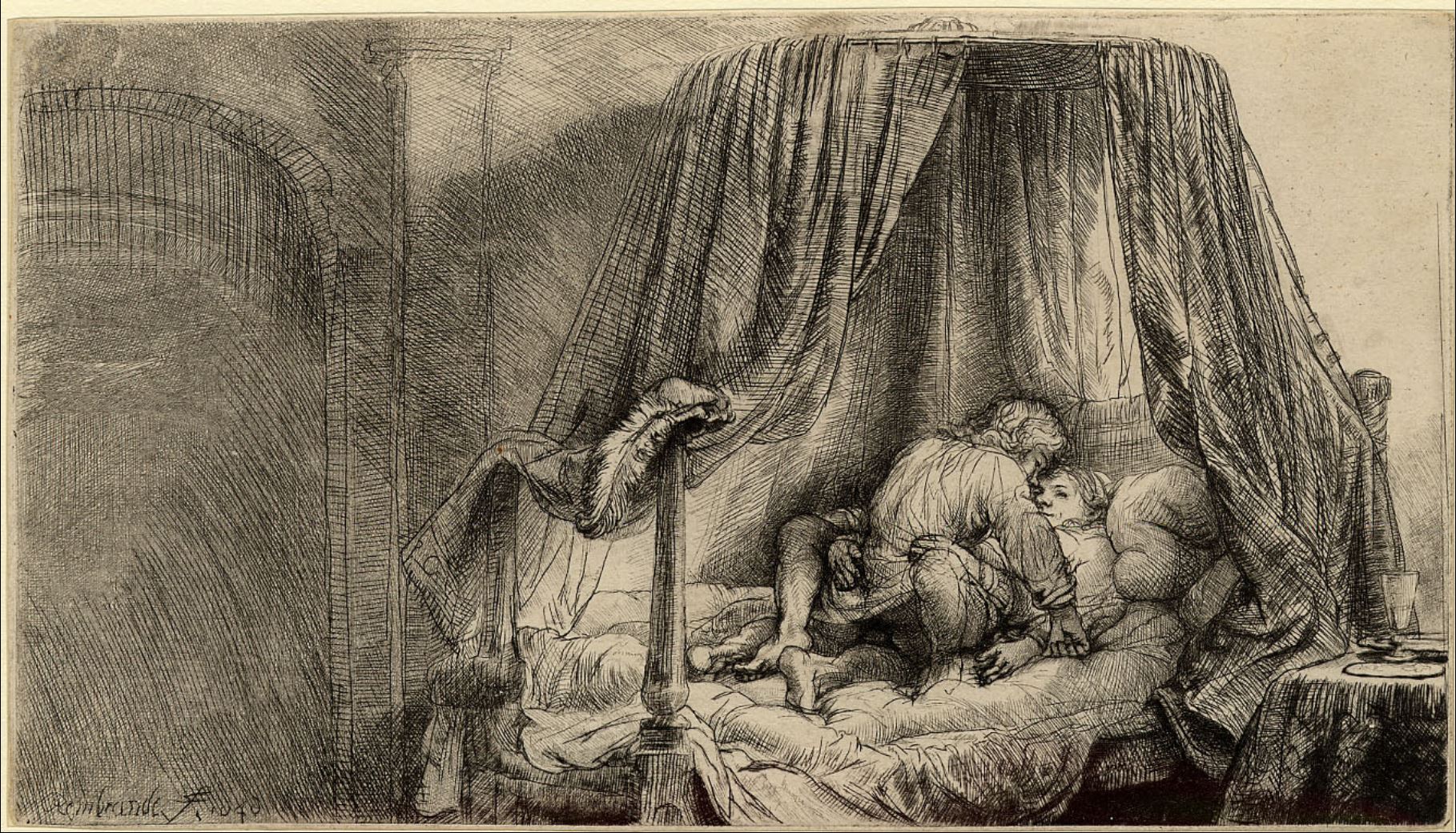
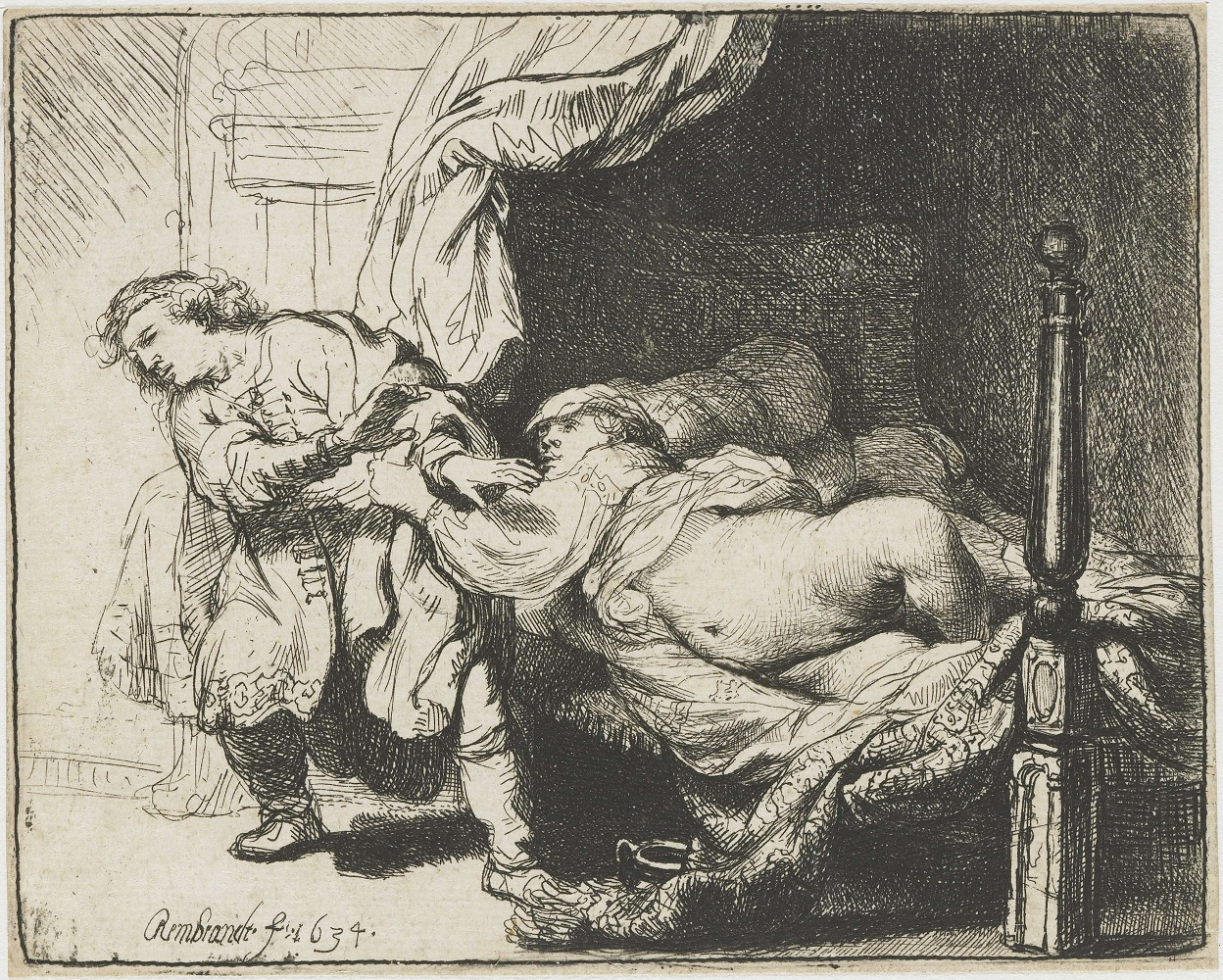 Joseph et la femme de Putiphar, Rembrandt, 1634
Joseph et la femme de Putiphar, Rembrandt, 1634 Scène de bordel
Scène de bordel
 Plus philosophique qu’on ne pense
Plus philosophique qu’on ne pense Une embuscade
Une embuscade

 La Brillante Toilette de la Déesse du Goût
La Brillante Toilette de la Déesse du Goût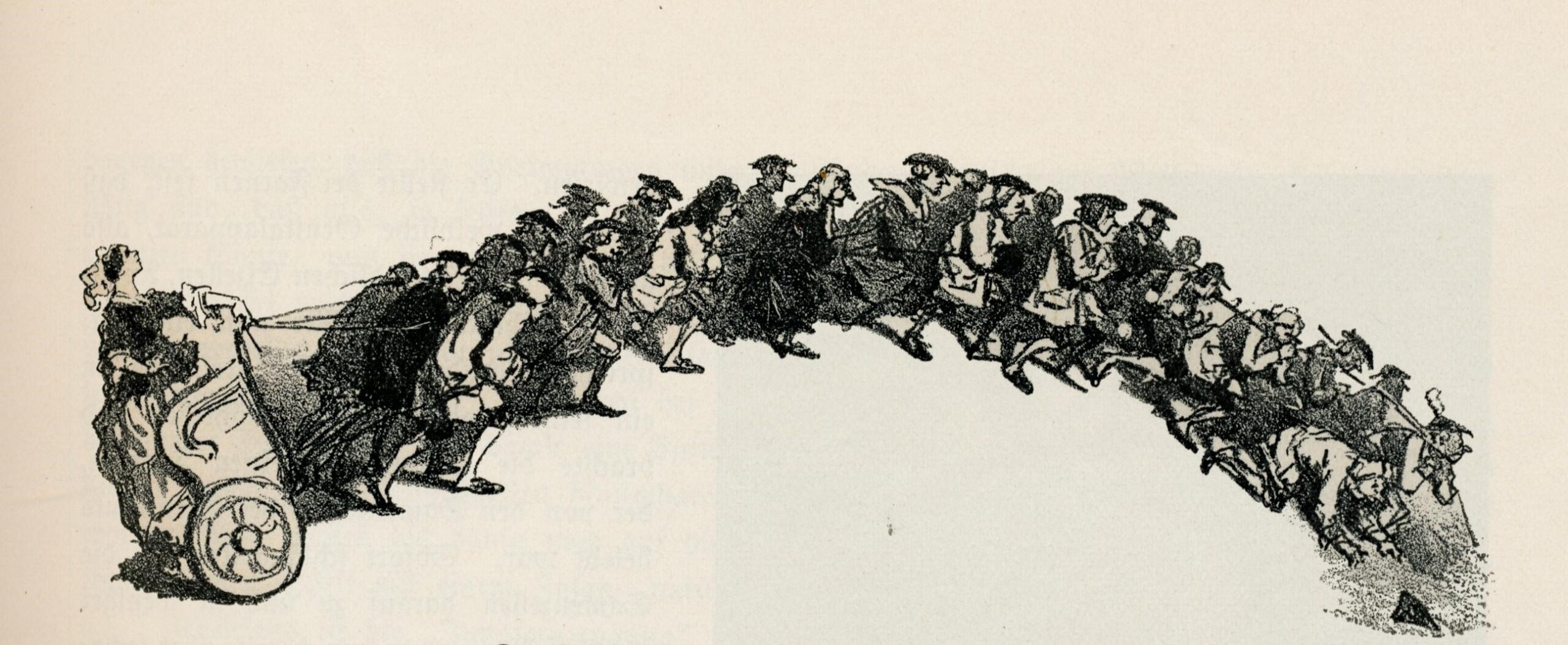
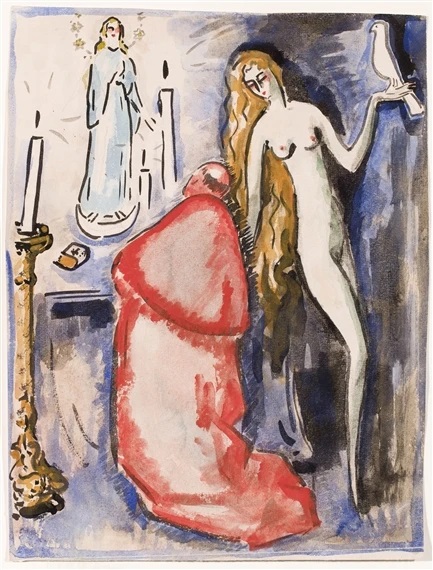 La prière
La prière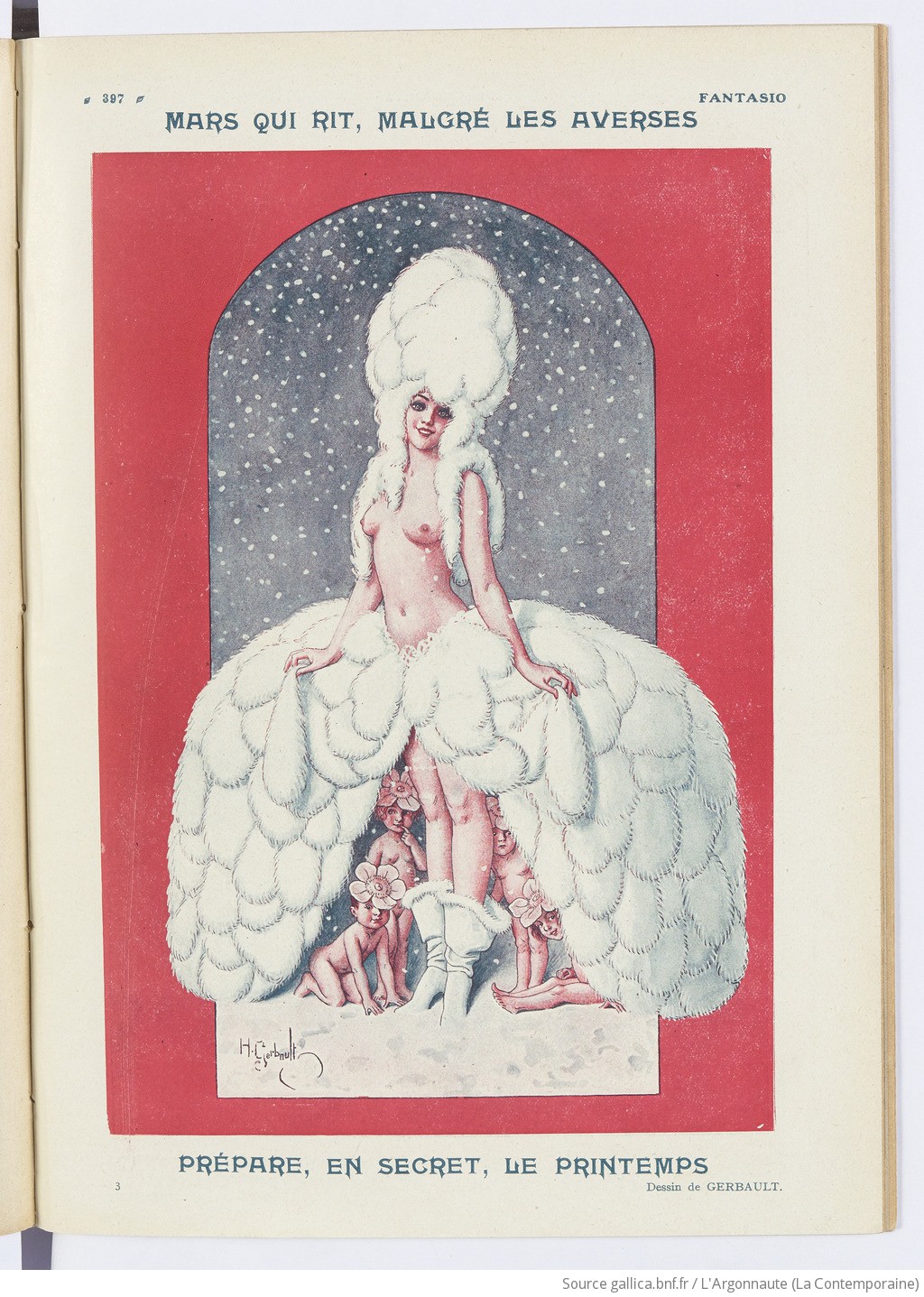

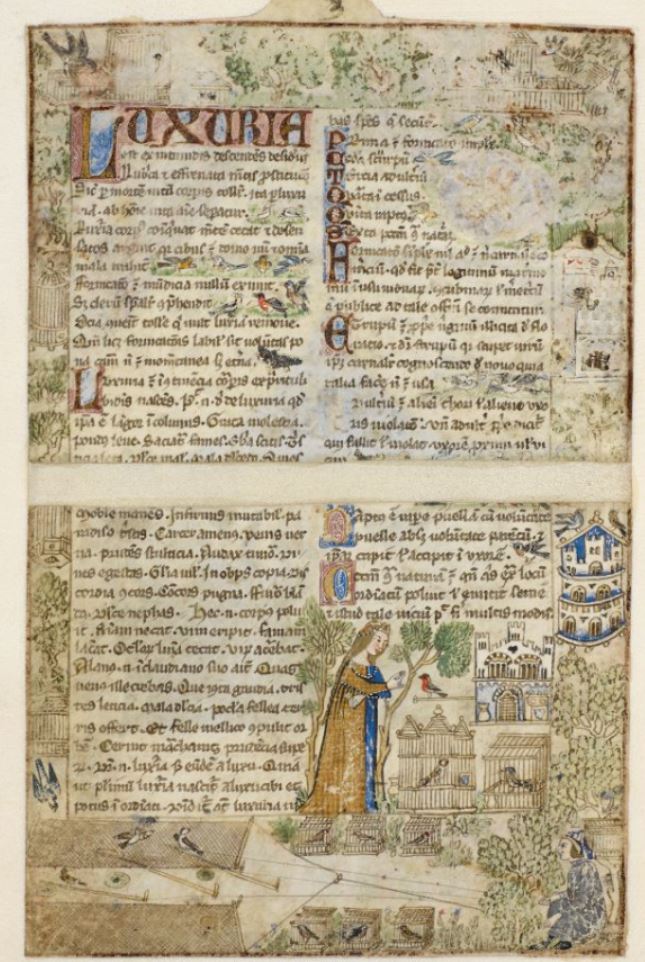
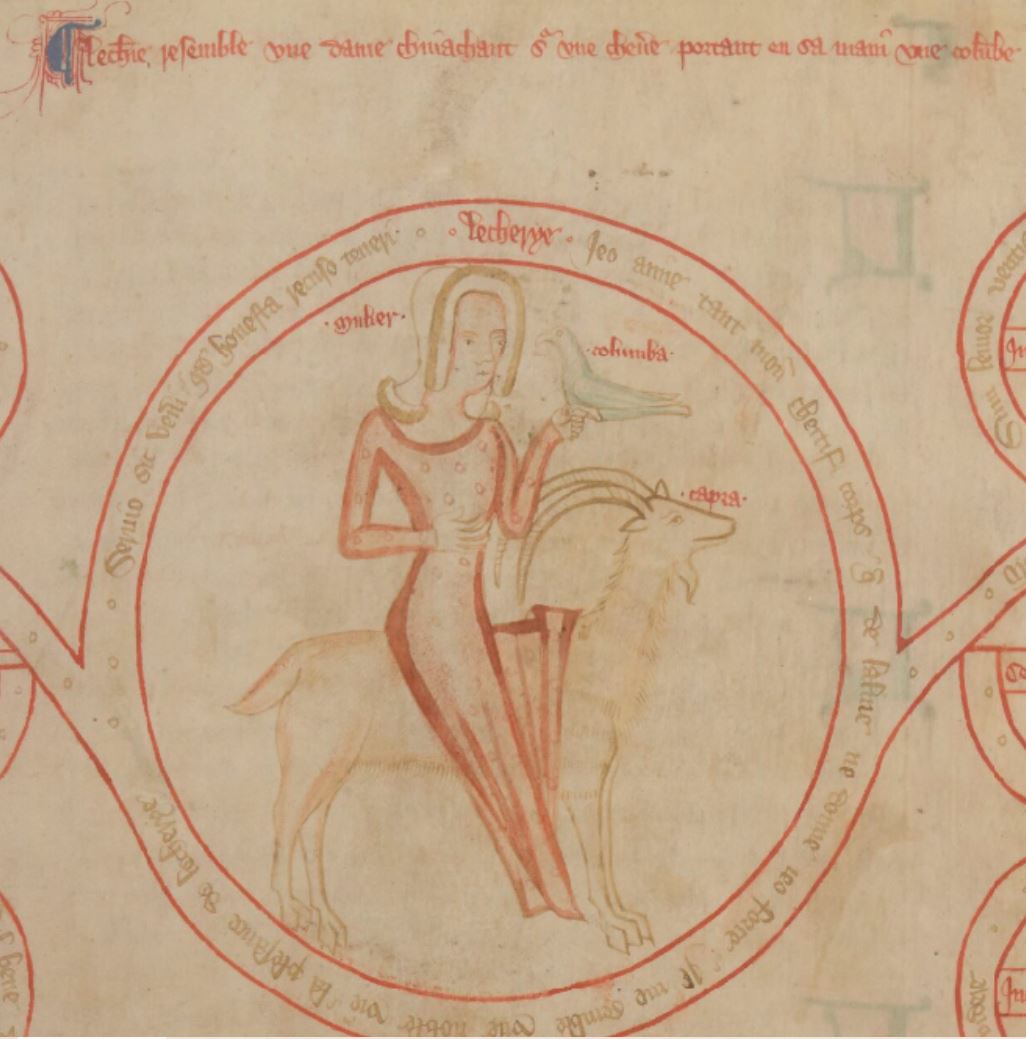



 Plat de cuivre, vers 1520, RDK II, 159, Abb. 6, Berlin, Schlossmuseum
Plat de cuivre, vers 1520, RDK II, 159, Abb. 6, Berlin, Schlossmuseum La Luxure, Robinet Testard, Livre d’Heures (Poitiers), vers 1475, MS M.1001 fol 98r
La Luxure, Robinet Testard, Livre d’Heures (Poitiers), vers 1475, MS M.1001 fol 98r Luxuria, 1585-89, gravé par Jacob Matham, dessin Hendrick Goltzius, Rijksmuseum
Luxuria, 1585-89, gravé par Jacob Matham, dessin Hendrick Goltzius, Rijksmuseum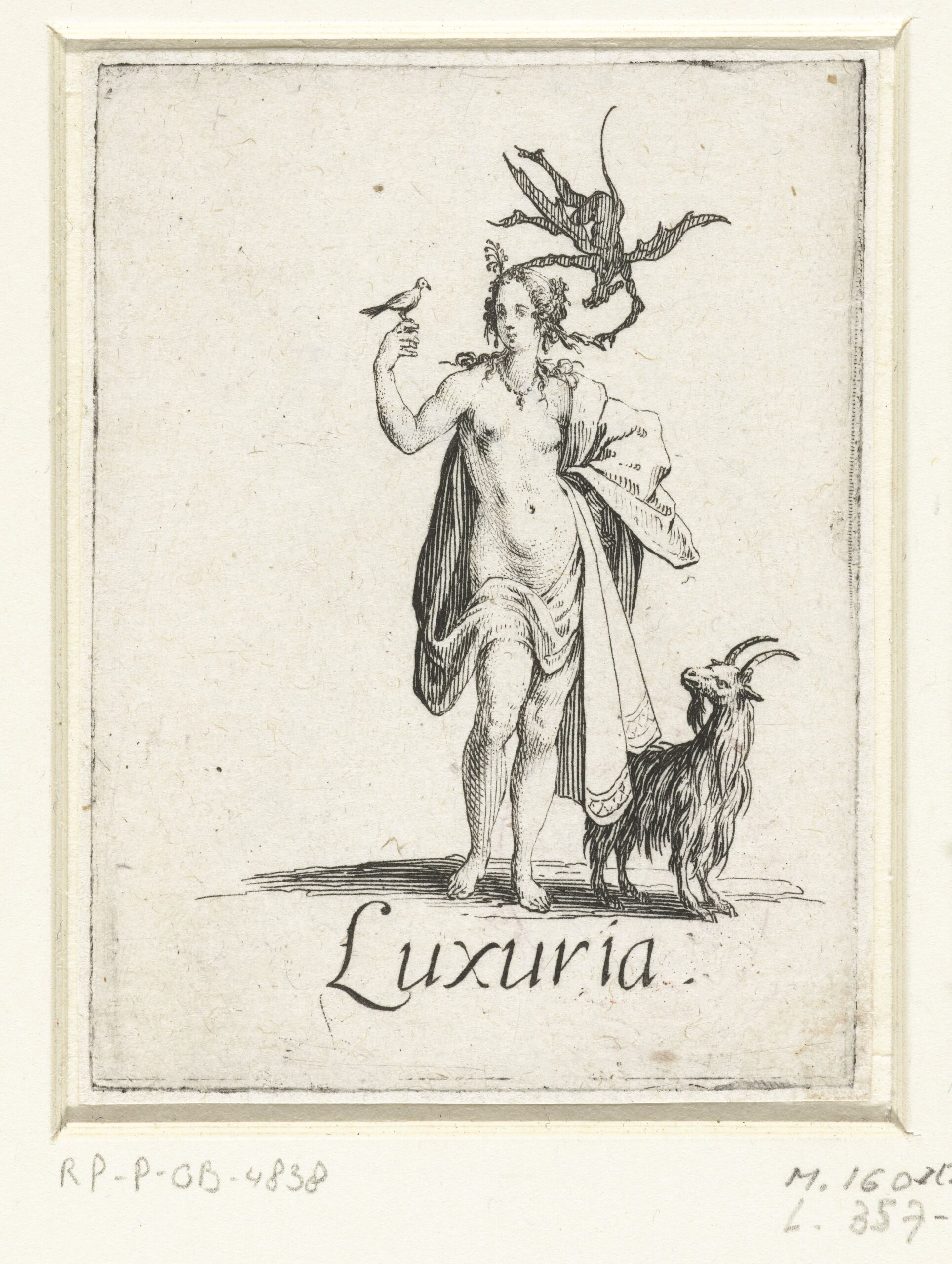 Luxuria, 1618-25. Jacques Callot, Rijksmuseum
Luxuria, 1618-25. Jacques Callot, Rijksmuseum
 Catulle et Lesbie pleurant sur la mort de son passereau
Catulle et Lesbie pleurant sur la mort de son passereau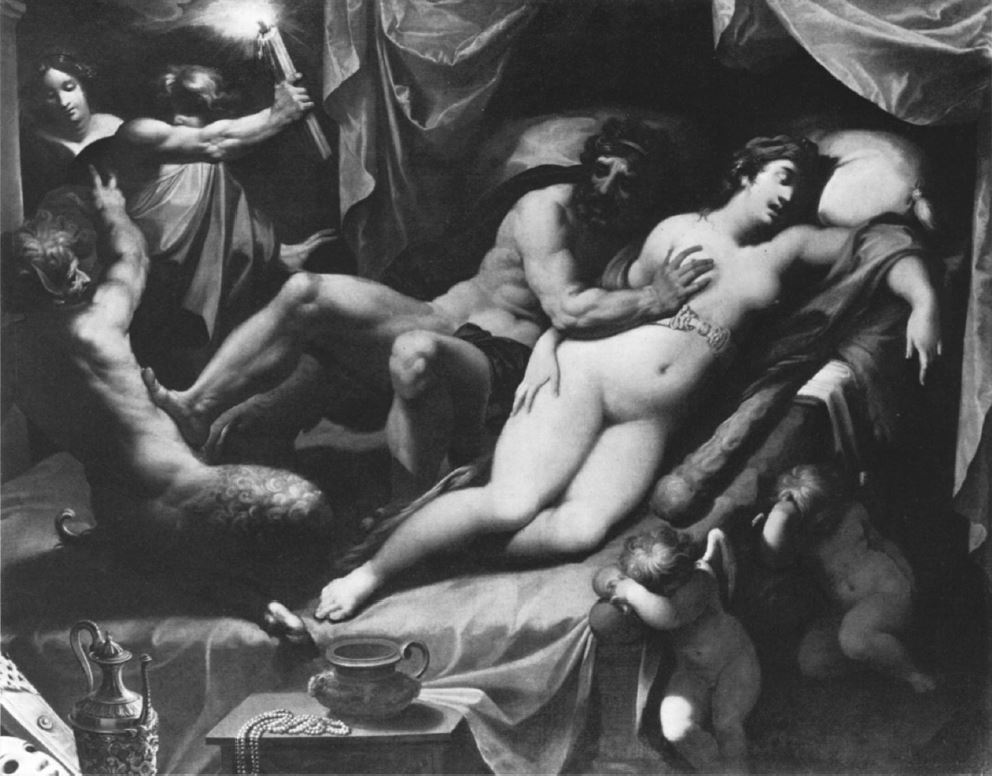 Hercule chassant Pan du lit d’Omphale,
Hercule chassant Pan du lit d’Omphale, 1585 Tintoret, Musée des Beaux Arts, Budapest (inversé).
1585 Tintoret, Musée des Beaux Arts, Budapest (inversé).

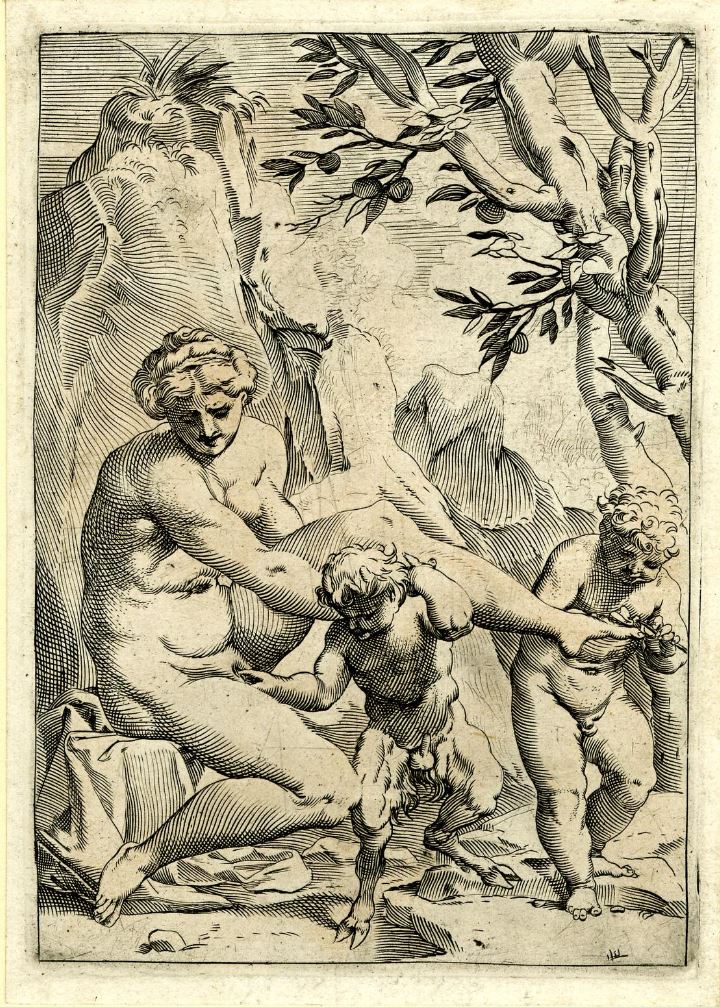 Nymphe, putto et petit satyre (série des Lascivie )
Nymphe, putto et petit satyre (série des Lascivie )
 Sine Cerere et Baccho friget Venus
Sine Cerere et Baccho friget Venus Diane et ses Nymphes
Diane et ses Nymphes Nature morte avec volaille et gibier, Wallraf-Richartz museum, Cologne
Nature morte avec volaille et gibier, Wallraf-Richartz museum, Cologne Nature morte avec chasseur, Mauritshuis, La Haye
Nature morte avec chasseur, Mauritshuis, La Haye Sine Cerere et Baccho friget Venus (inversé)
Sine Cerere et Baccho friget Venus (inversé) Naïades remplissant une corne d’abondance
Naïades remplissant une corne d’abondance L’origine de la corne d’abondance
L’origine de la corne d’abondance


 Le Conseil des Dieux (inversé)
Le Conseil des Dieux (inversé)

 Sainte Agathe
Sainte Agathe Véronèse, 1582, Joslyn Museum, Omaha
Véronèse, 1582, Joslyn Museum, Omaha Rubens, 1614-15, Palais Liechtenstein, Vienne
Rubens, 1614-15, Palais Liechtenstein, Vienne
 Abraham Janssens, 1619-20, collection particulière
Abraham Janssens, 1619-20, collection particulière Jordaens, 1620, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles
Jordaens, 1620, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles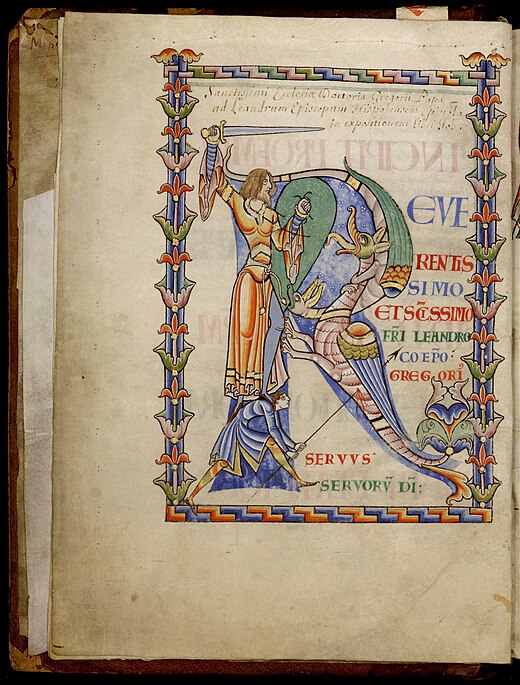 Lettrine synthétique, Saint Michel, 1109-11 Morales sur Job, Dijon BM Ms.168 f.4v
Lettrine synthétique, Saint Michel, 1109-11 Morales sur Job, Dijon BM Ms.168 f.4v Lettrine historiée, Saint Jérôme, 1405-15 Royal 1 E. IX, f.101r
Lettrine historiée, Saint Jérôme, 1405-15 Royal 1 E. IX, f.101r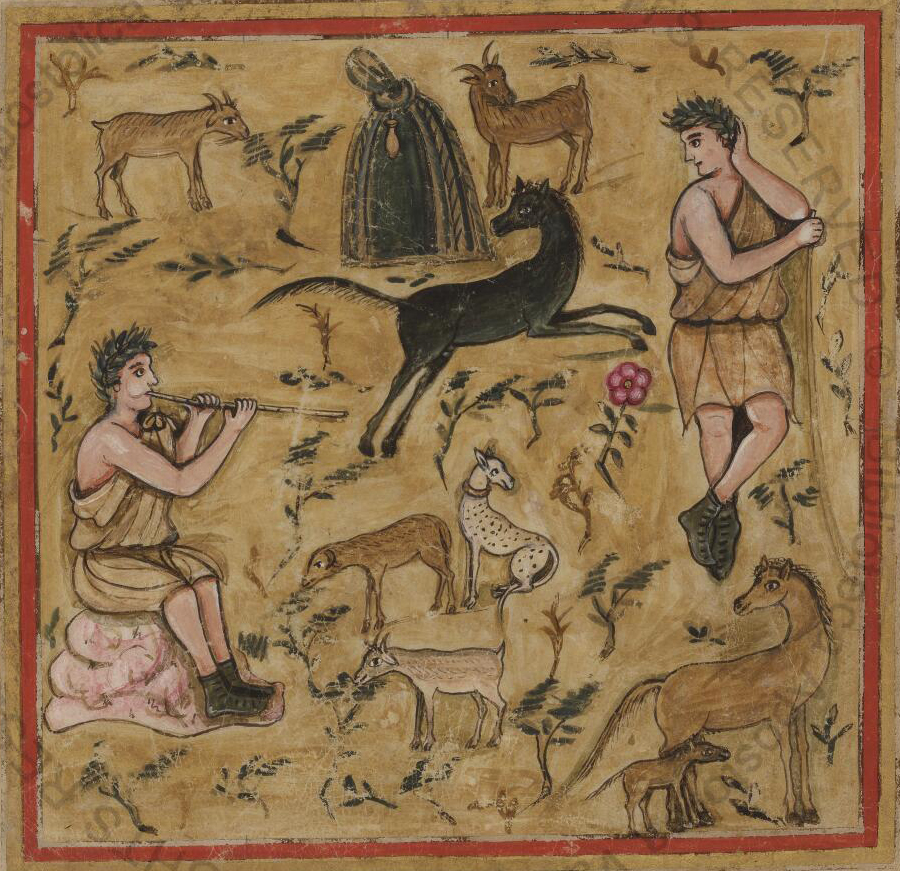 Fol 44v
Fol 44v Fol 45r
Fol 45r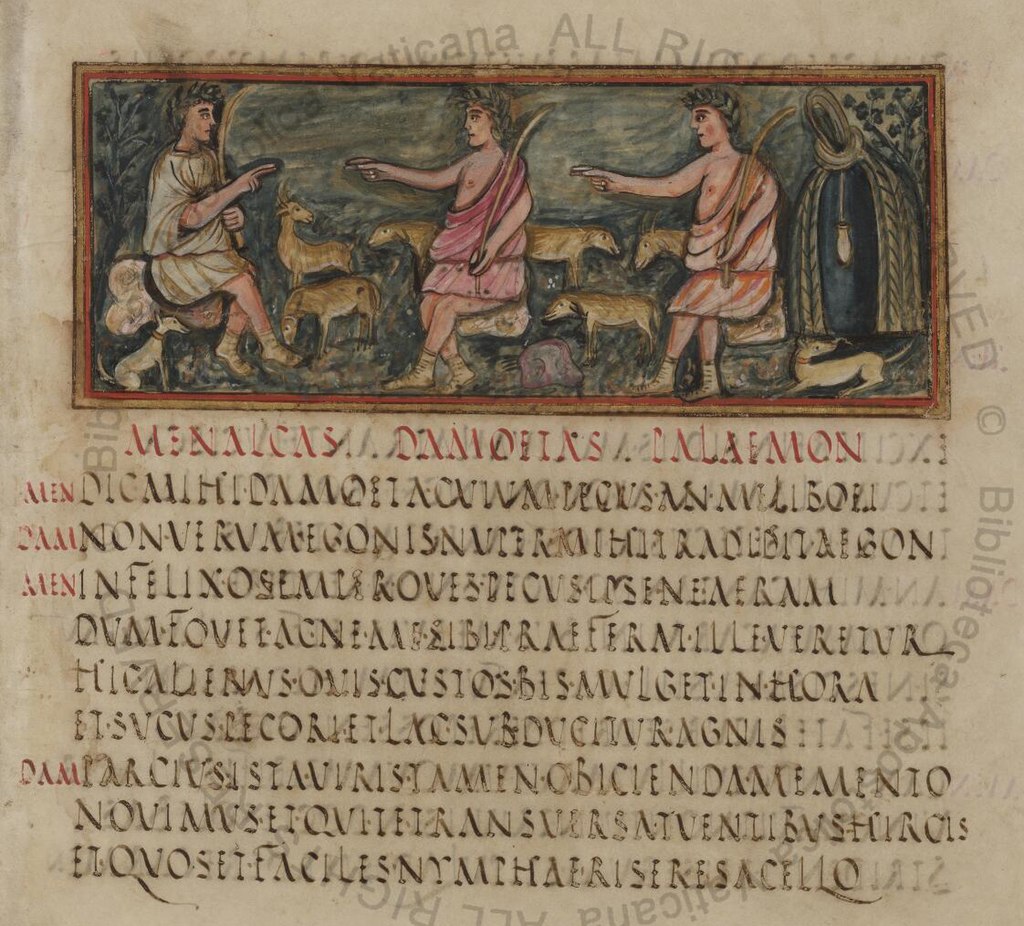 Eglogue 3 : Ménalque et Damète s’affrontent devant Palémon, fol 6r (c) Biblioteca Vaticana
Eglogue 3 : Ménalque et Damète s’affrontent devant Palémon, fol 6r (c) Biblioteca Vaticana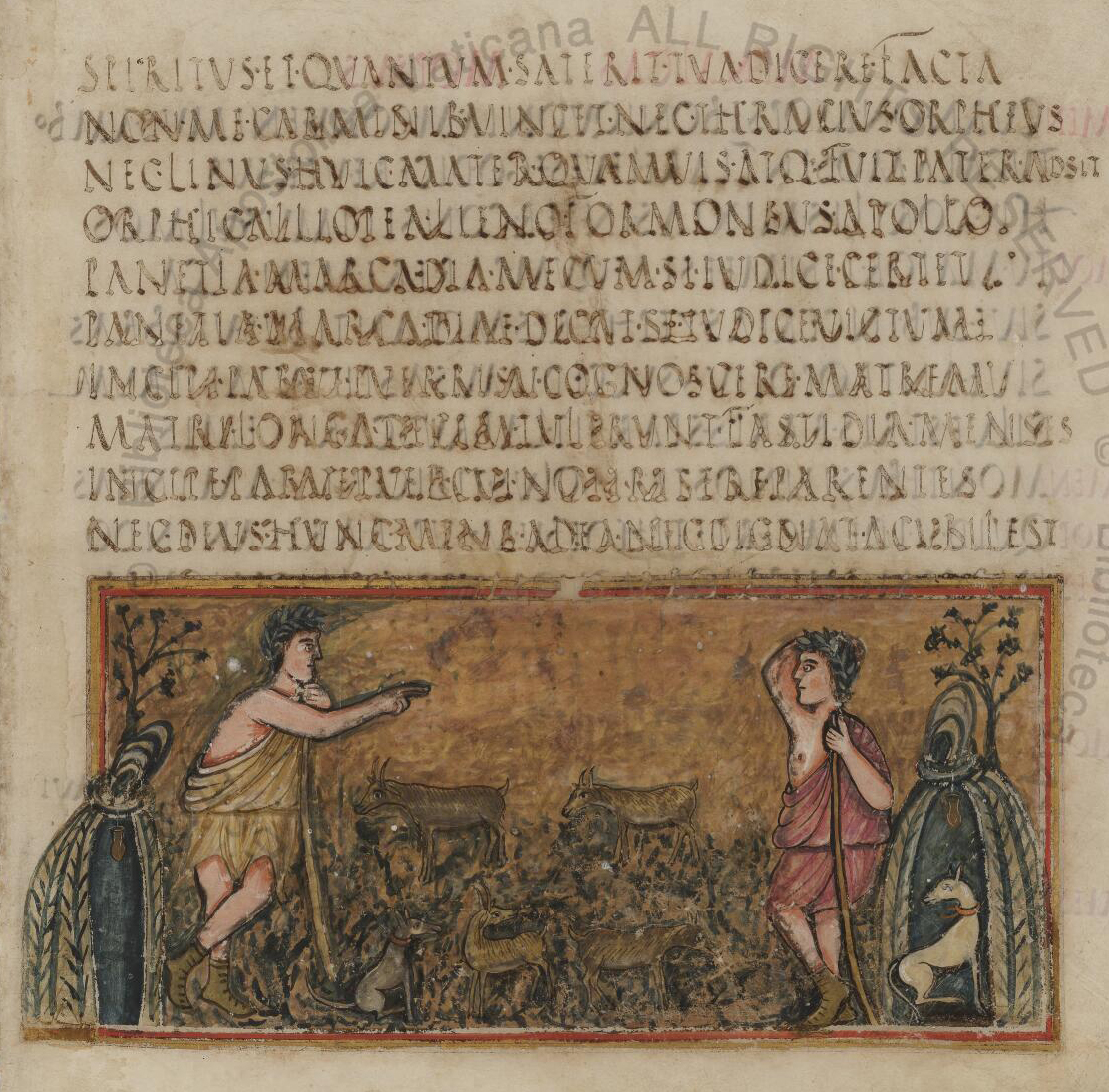 Eglogue 5 : Concours entre Ménalque et Mopsus, fol 11r (c) Biblioteca Vaticana
Eglogue 5 : Concours entre Ménalque et Mopsus, fol 11r (c) Biblioteca Vaticana Eglogue 7 : Concours entre Corydon et Thyrsis sous l’arbitrage de Mélibée, fol 16v (c) Biblioteca Vaticana
Eglogue 7 : Concours entre Corydon et Thyrsis sous l’arbitrage de Mélibée, fol 16v (c) Biblioteca Vaticana Eglogue 2 (Corydon), fol 3v
Eglogue 2 (Corydon), fol 3v Eglogue 6 (Silène) fol 14r
Eglogue 6 (Silène) fol 14r Fresque de la Casa della Farnesina, Rome, vers 20 av JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome
Fresque de la Casa della Farnesina, Rome, vers 20 av JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome Mosaïque de la Maison du Faune, Pompéi, Musée national de Naples
Mosaïque de la Maison du Faune, Pompéi, Musée national de Naples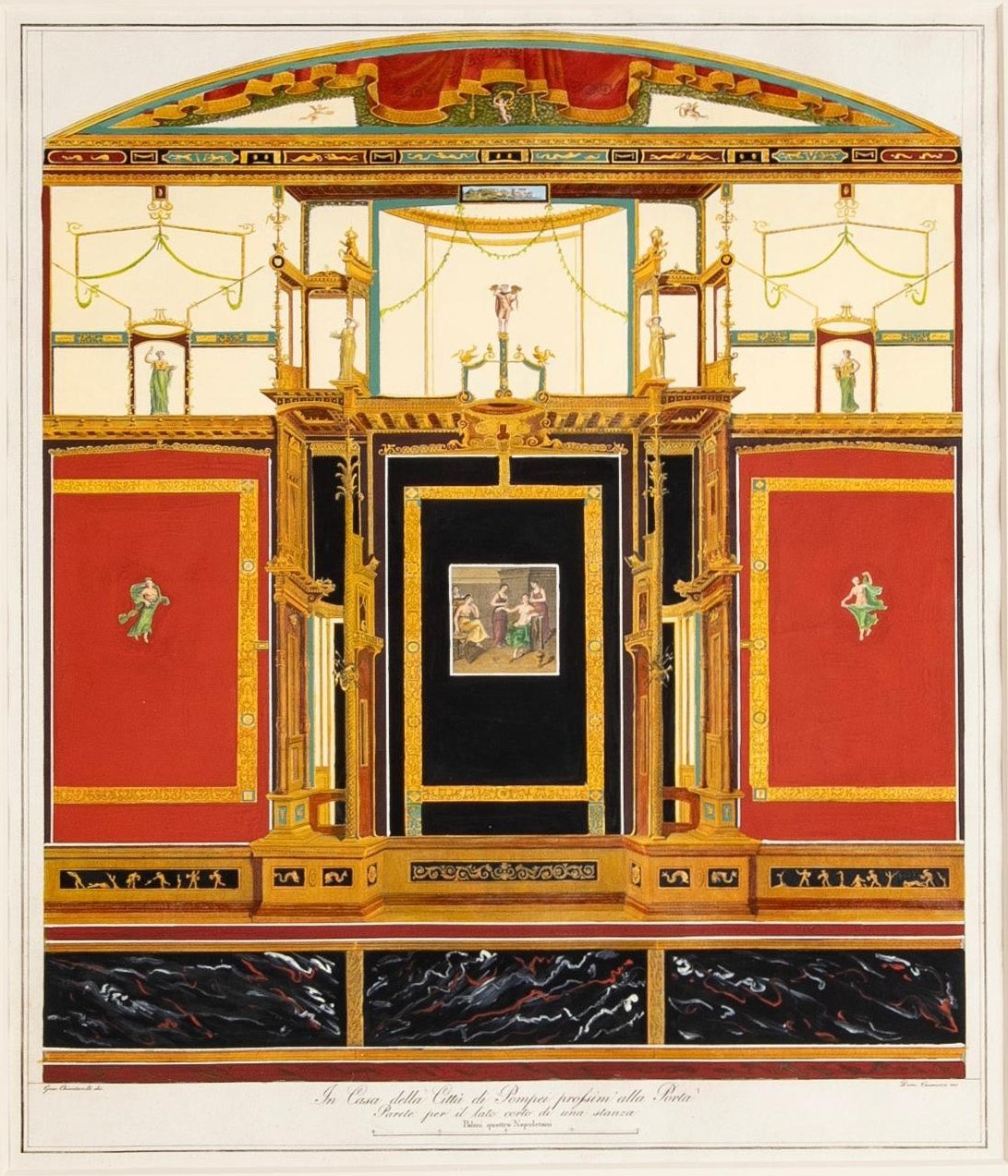 Fresque de Pompéi (lithographie italienne)
Fresque de Pompéi (lithographie italienne) Pierre et Paul autour d’une colonne , fin 4ème siècle, MET
Pierre et Paul autour d’une colonne , fin 4ème siècle, MET
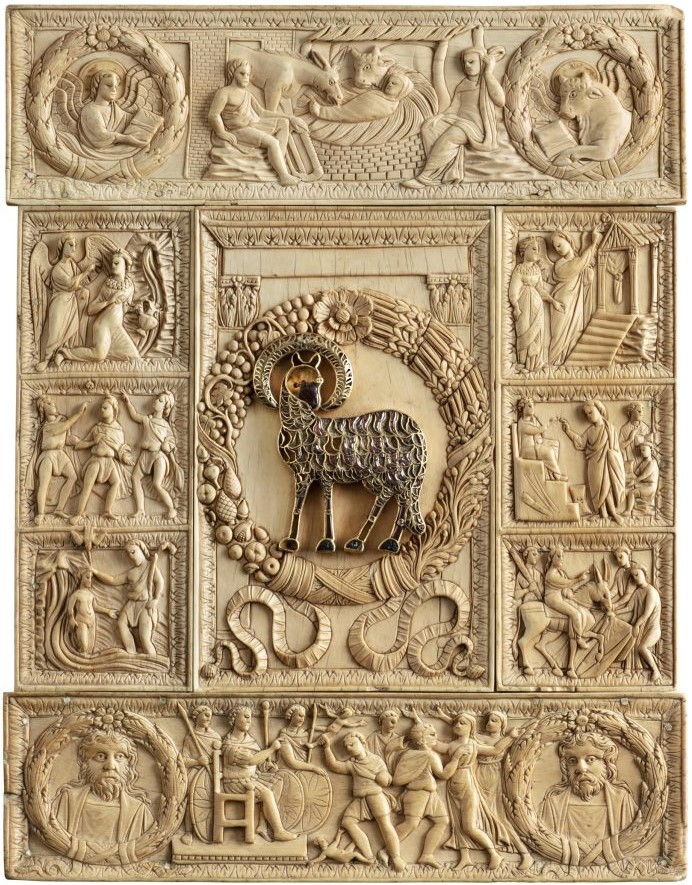


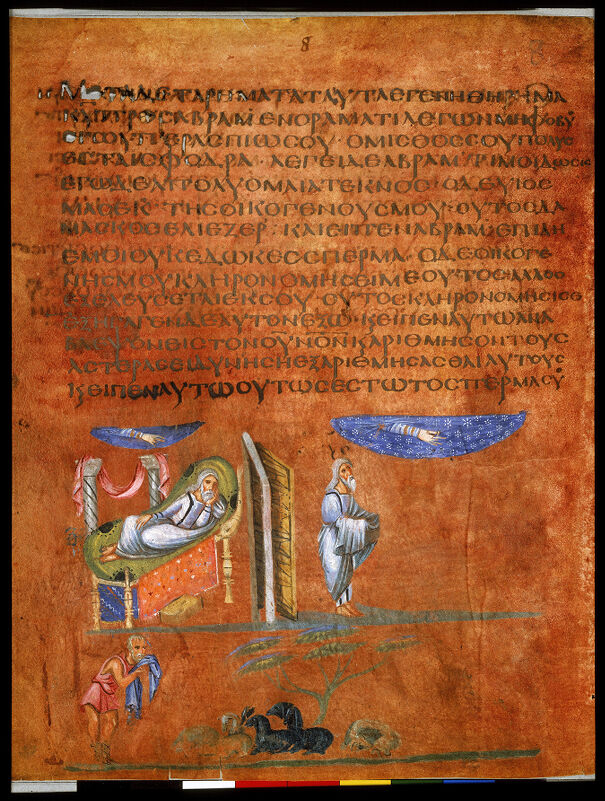 Dieu promet à Abraham une progéniture nombreuse
Dieu promet à Abraham une progéniture nombreuse Le déluge, fol 2r
Le déluge, fol 2r Alliance entre Dieu et Noé, fol. 3r
Alliance entre Dieu et Noé, fol. 3r
 La Chute
La Chute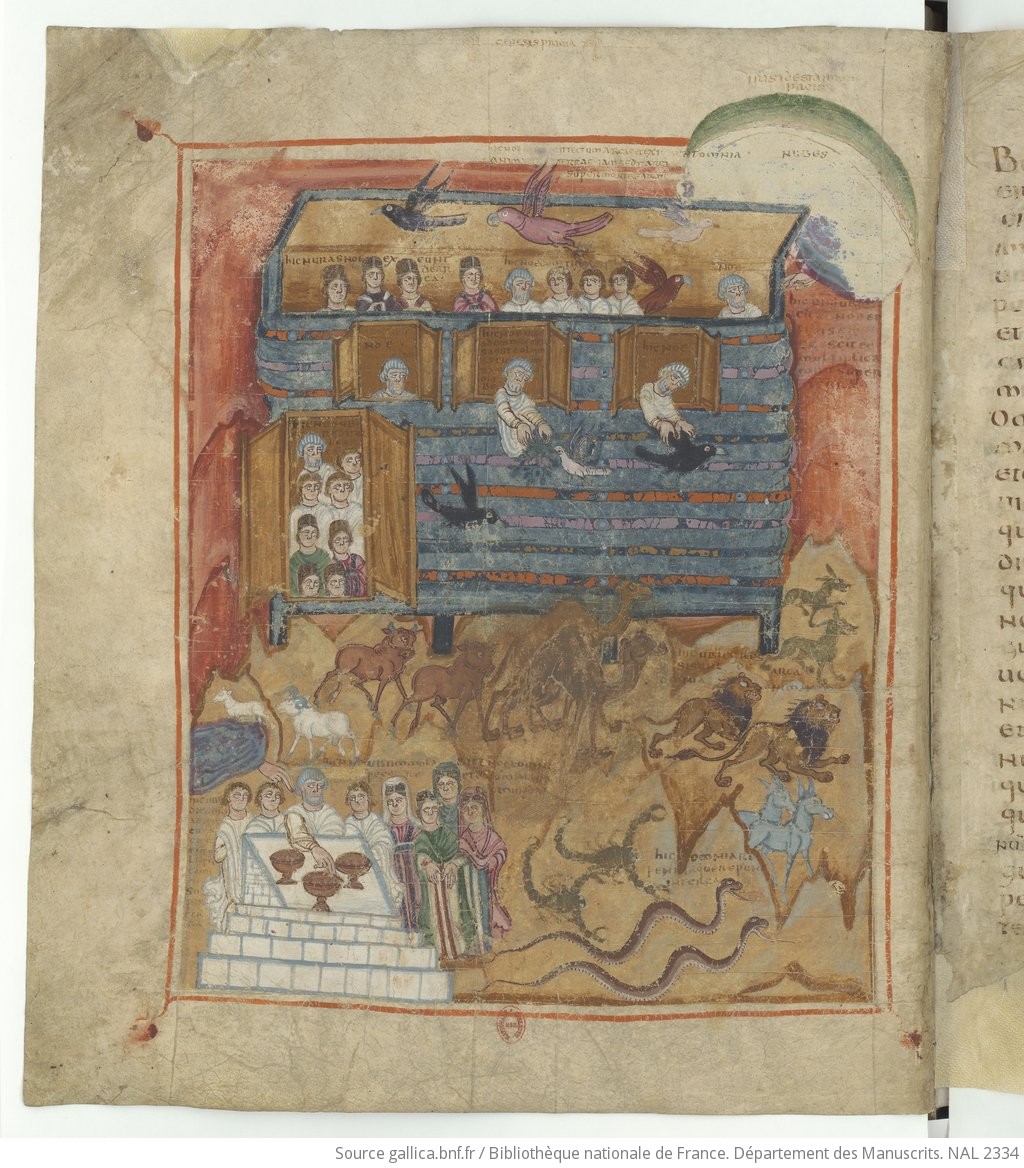 La fin du Déluge, fol 10v
La fin du Déluge, fol 10v Moïse reçoit les commandements de Dieu, fol 76r
Moïse reçoit les commandements de Dieu, fol 76r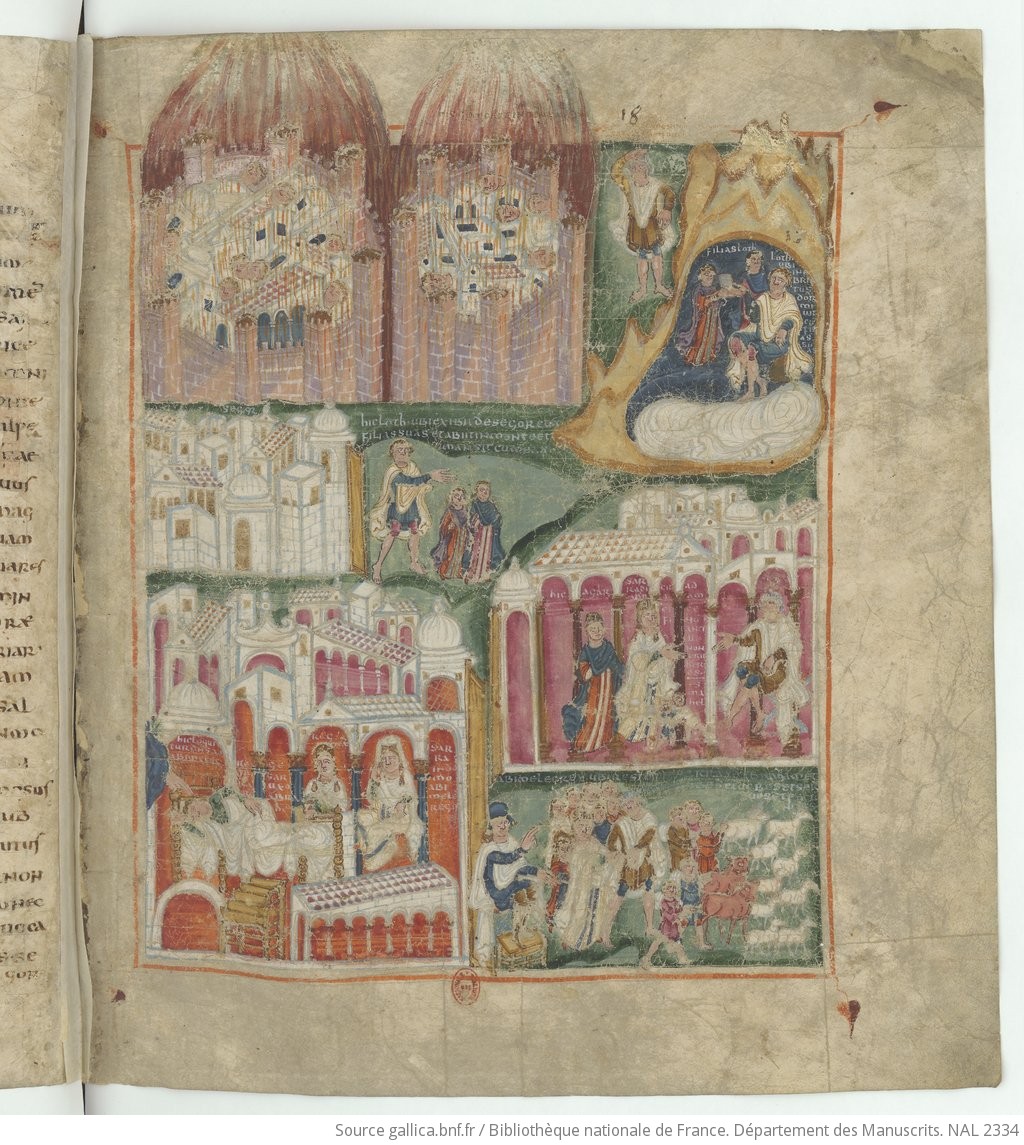 Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334, fol 18r, gallica
Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334, fol 18r, gallica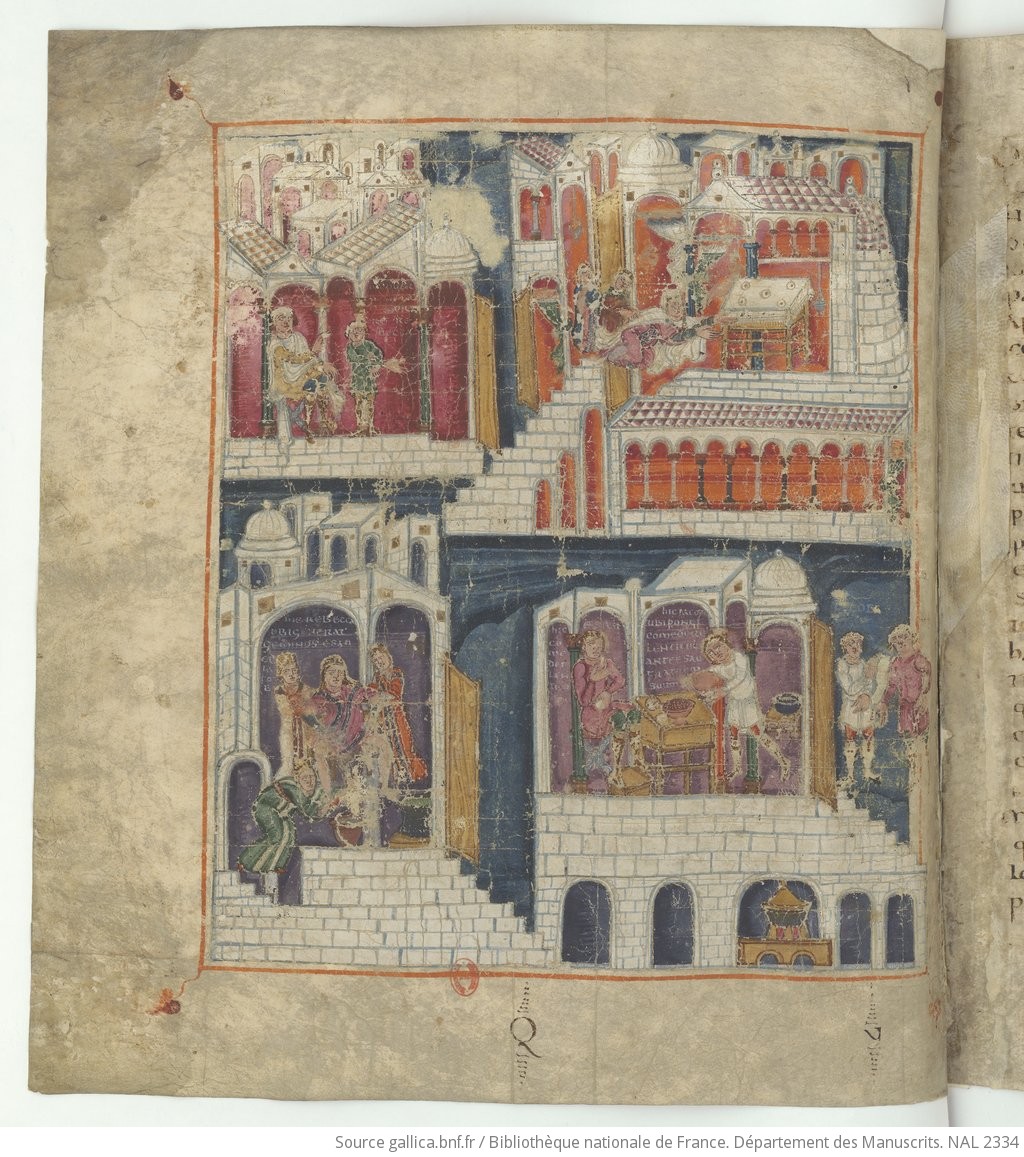 Esaü rentre bredouille et Jacob lui vend ses lentilles (fol 22v)
Esaü rentre bredouille et Jacob lui vend ses lentilles (fol 22v)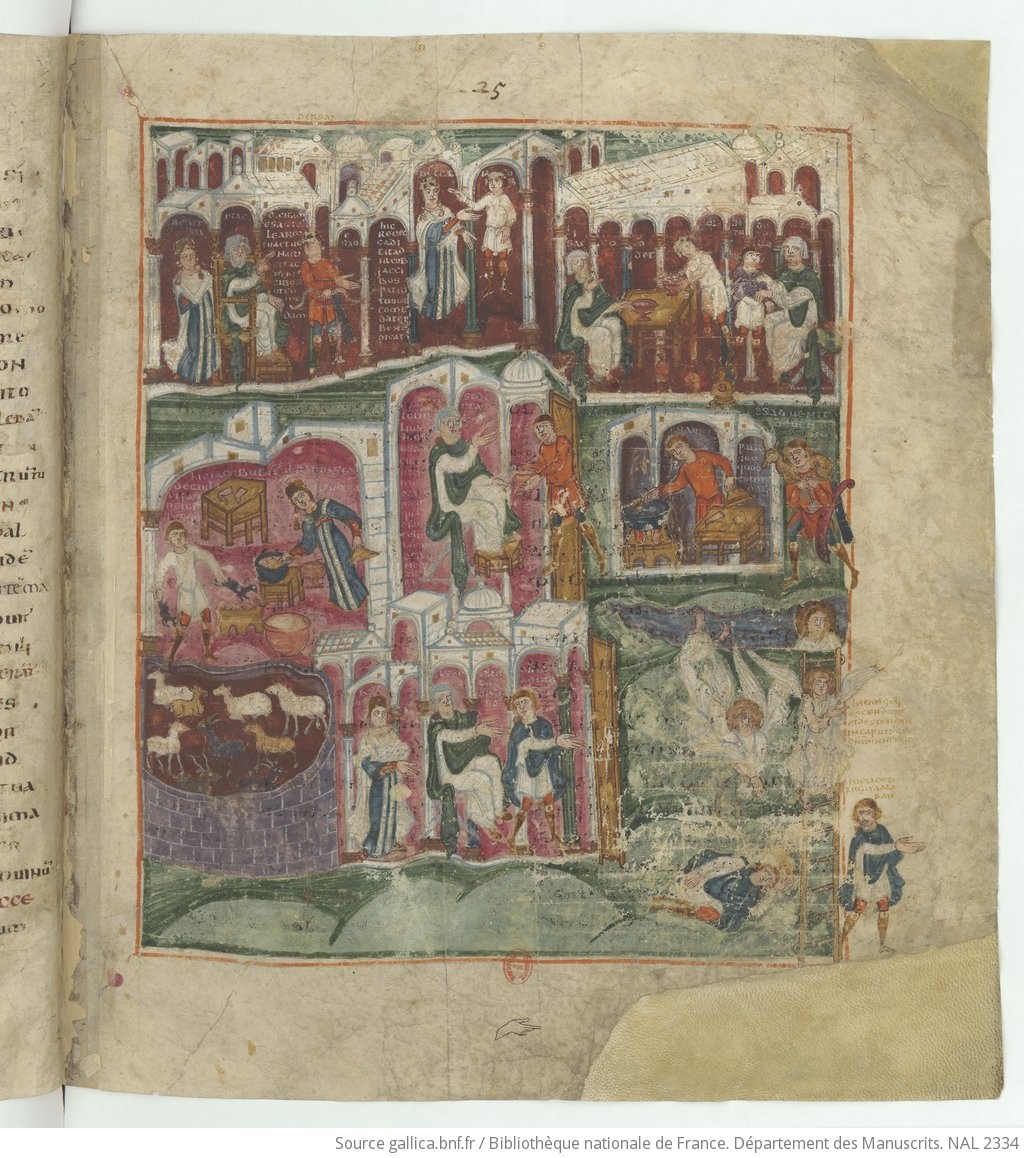 Jacob s’enfuit chez Laban (Gen 27,44), fol 25r
Jacob s’enfuit chez Laban (Gen 27,44), fol 25r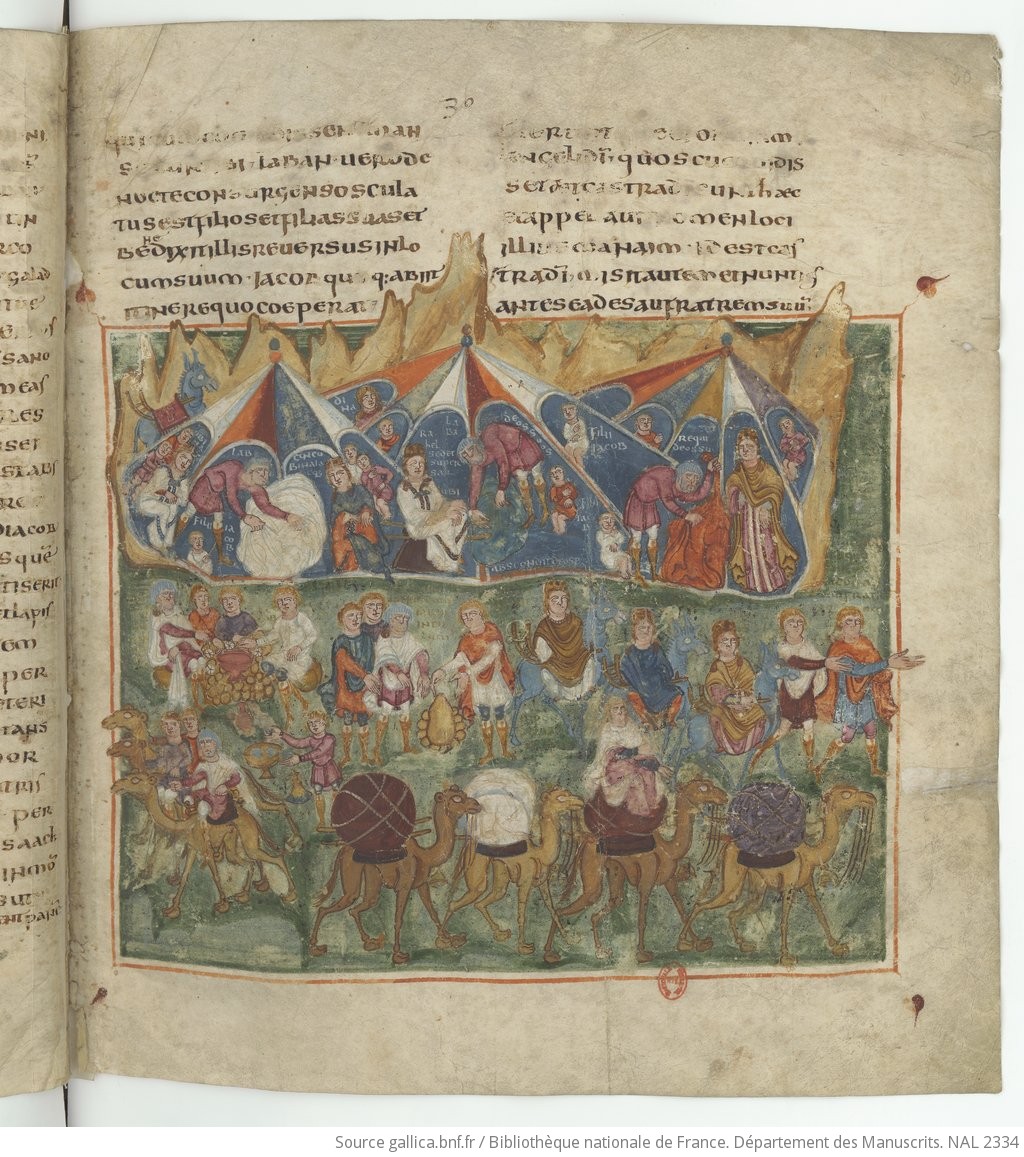
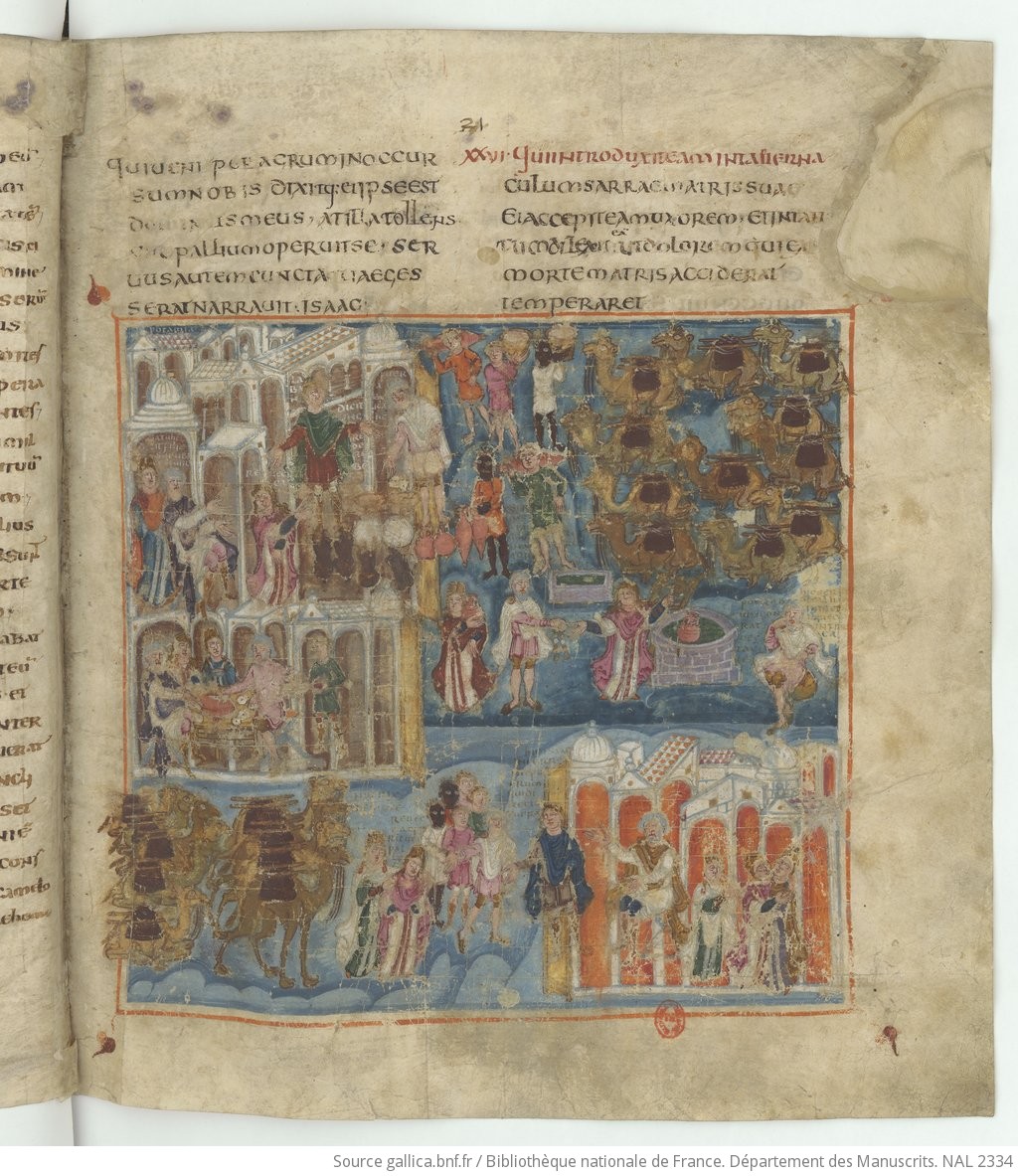 Histoire de Rebecca,
Histoire de Rebecca, Présentation au temple
Présentation au temple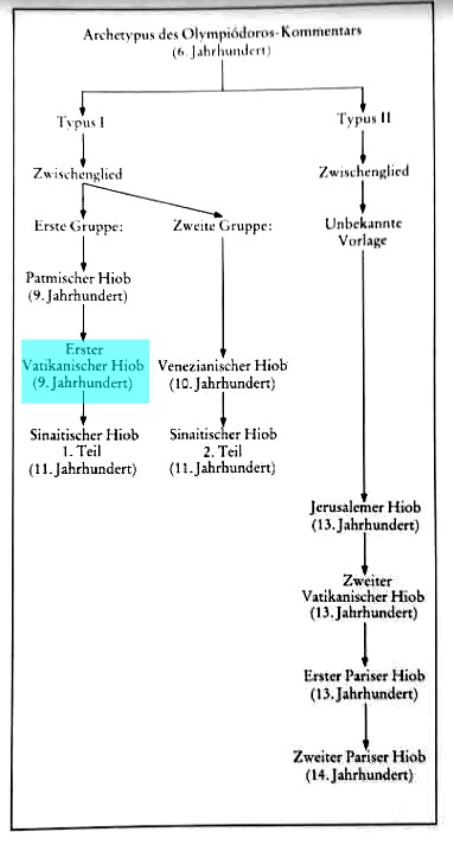 Chronologie de Paul Huber [9]
Chronologie de Paul Huber [9]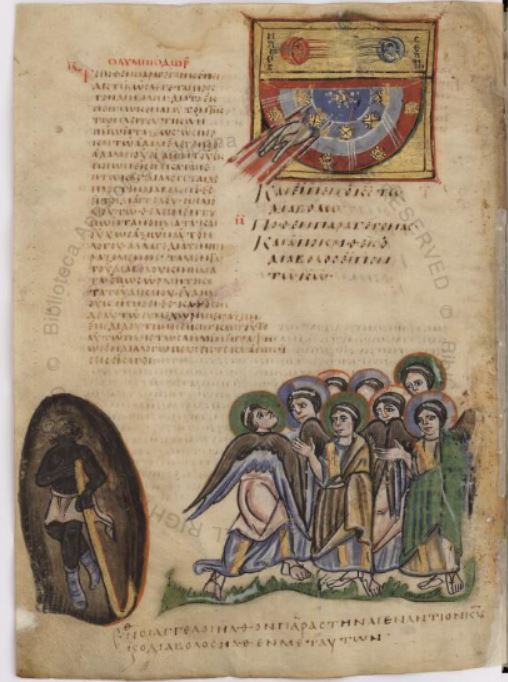 Le diable et les anges devant Dieu, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 12v (c) Biblioteca Vaticana
Le diable et les anges devant Dieu, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 12v (c) Biblioteca Vaticana Job et sa femme devant leur palais, fol 6r
Job et sa femme devant leur palais, fol 6r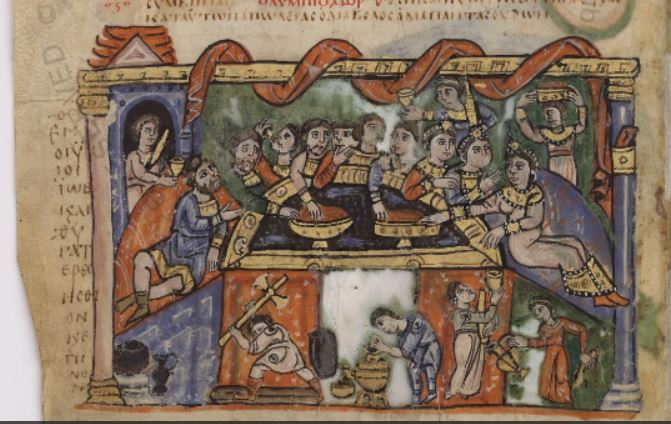 Le banquet des enfants de Job, fol 16v
Le banquet des enfants de Job, fol 16v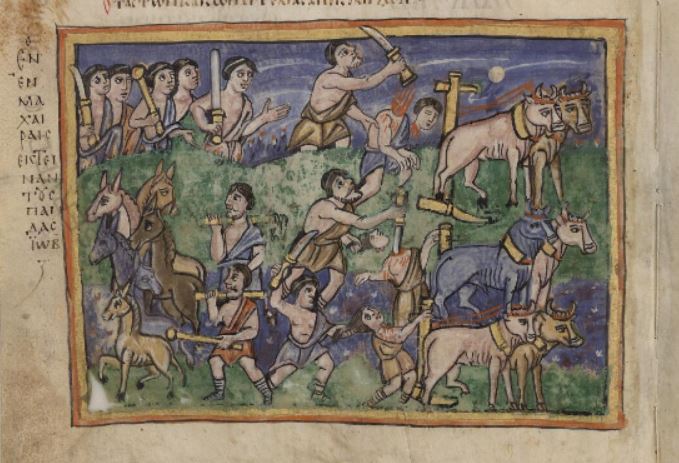 Première épreuve : la perte des ânes et des vaches, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 17v (c) Biblioteca Vaticana
Première épreuve : la perte des ânes et des vaches, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 17v (c) Biblioteca Vaticana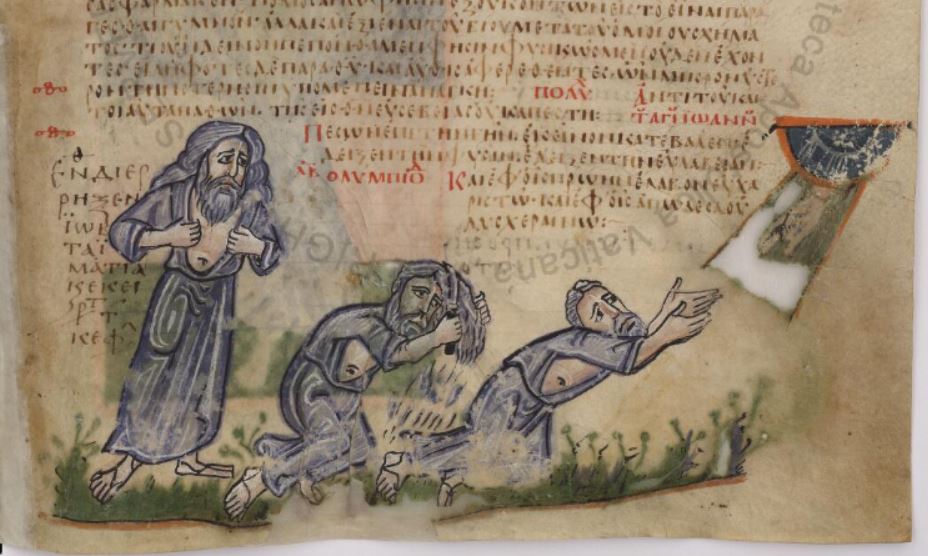 La douleur de Job, fol 21r
La douleur de Job, fol 21r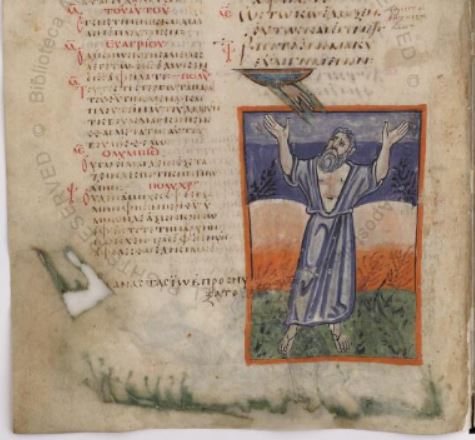 Dieu bénit Job, fol 21v
Dieu bénit Job, fol 21v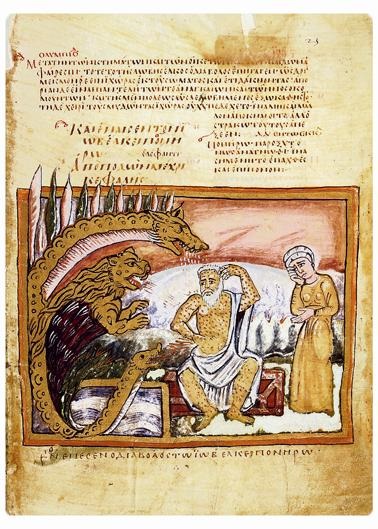
 Job quitte sa maison pour s’installer sur son tas de fumier, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 25v-26r (c) Biblioteca Vaticana
Job quitte sa maison pour s’installer sur son tas de fumier, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 25v-26r (c) Biblioteca Vaticana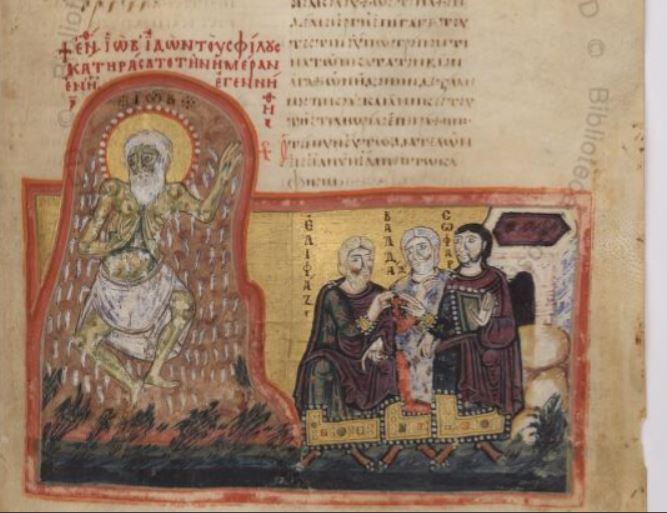 Job maudit le jour de sa naissance devant Eliphas, Baldad et Sophar, fol 38r
Job maudit le jour de sa naissance devant Eliphas, Baldad et Sophar, fol 38r Première confrontation avec Eliphas, fol 50v
Première confrontation avec Eliphas, fol 50v Troisième confrontation avec Eliphas, fol 144v
Troisième confrontation avec Eliphas, fol 144v Quatrième confrontation avec Eliphas, fol 198r
Quatrième confrontation avec Eliphas, fol 198r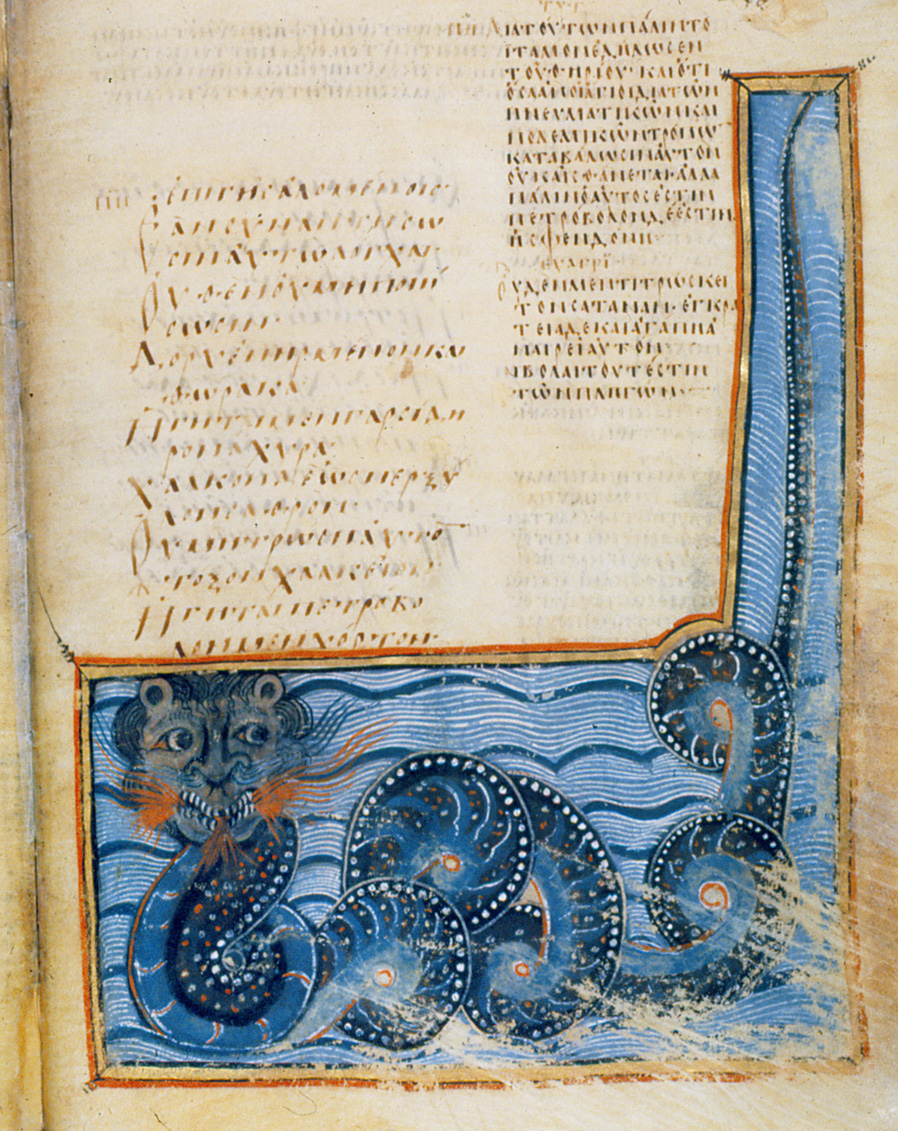 Le Léviathan, 800-20 Vat. Gr. 749 fol 238r (c) Biblioteca Vaticana
Le Léviathan, 800-20 Vat. Gr. 749 fol 238r (c) Biblioteca Vaticana Les messagers devant Job, fol 17r (fig 54)
Les messagers devant Job, fol 17r (fig 54)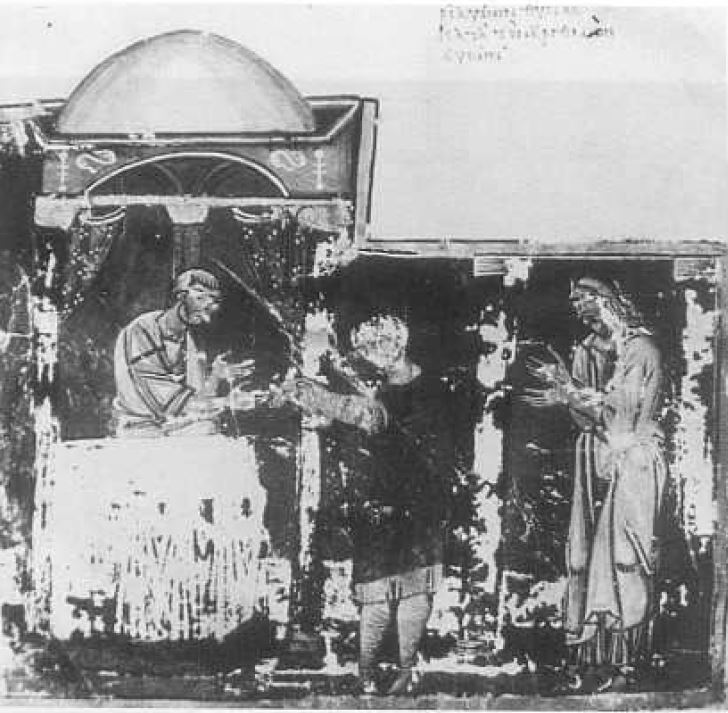 Job offre un agneau en sacrifice, fol 7v (fig 19)
Job offre un agneau en sacrifice, fol 7v (fig 19)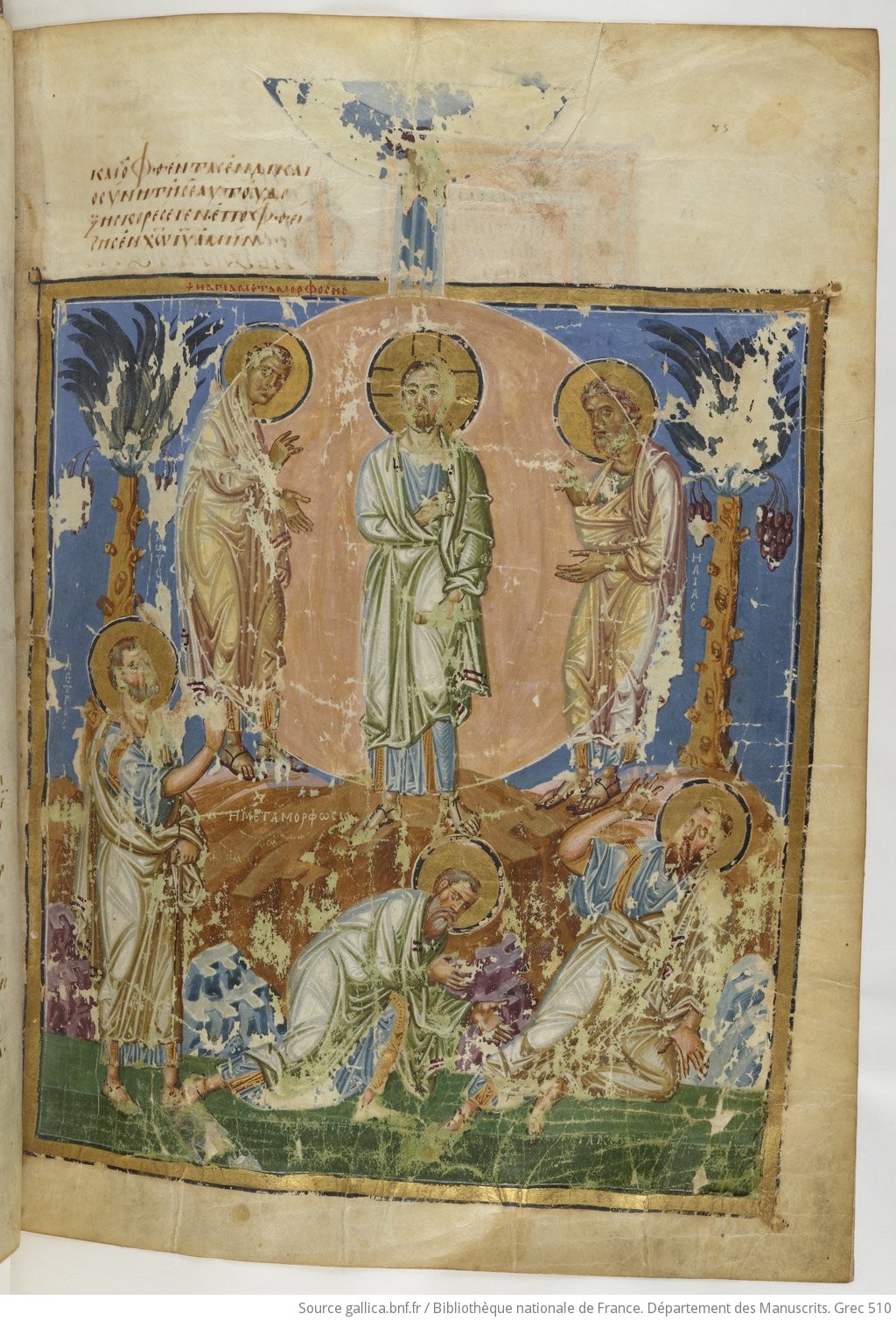
 Homélie sur le Baptême, fol 264v
Homélie sur le Baptême, fol 264v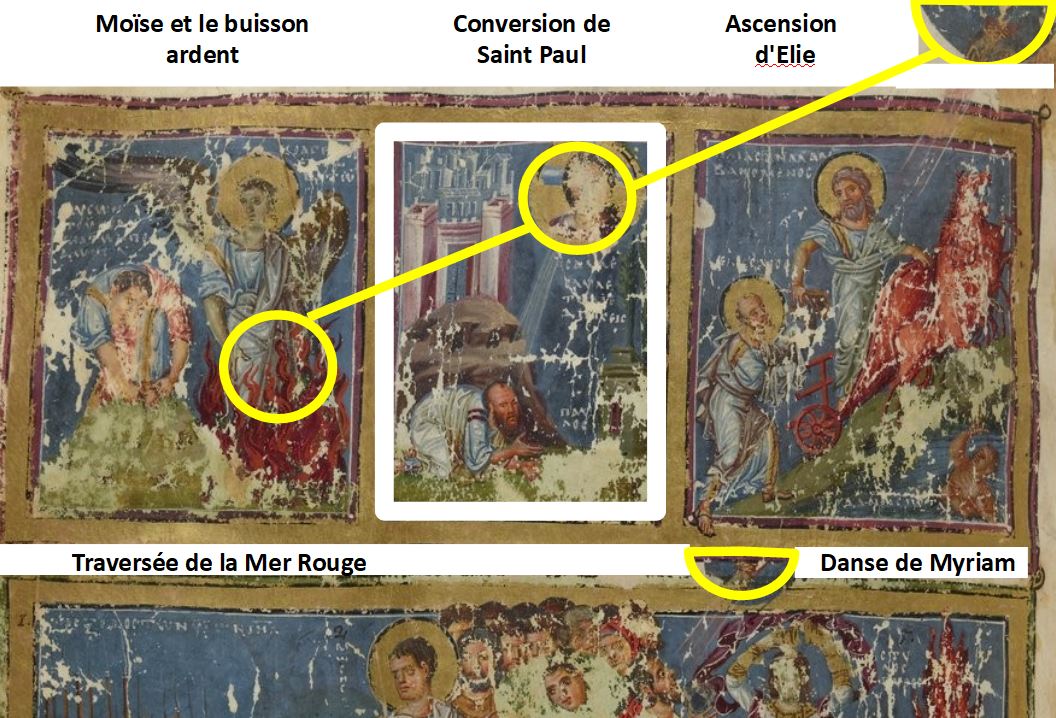
 Le sacrifice d’Isaac (en haut à droite), fol 174v
Le sacrifice d’Isaac (en haut à droite), fol 174v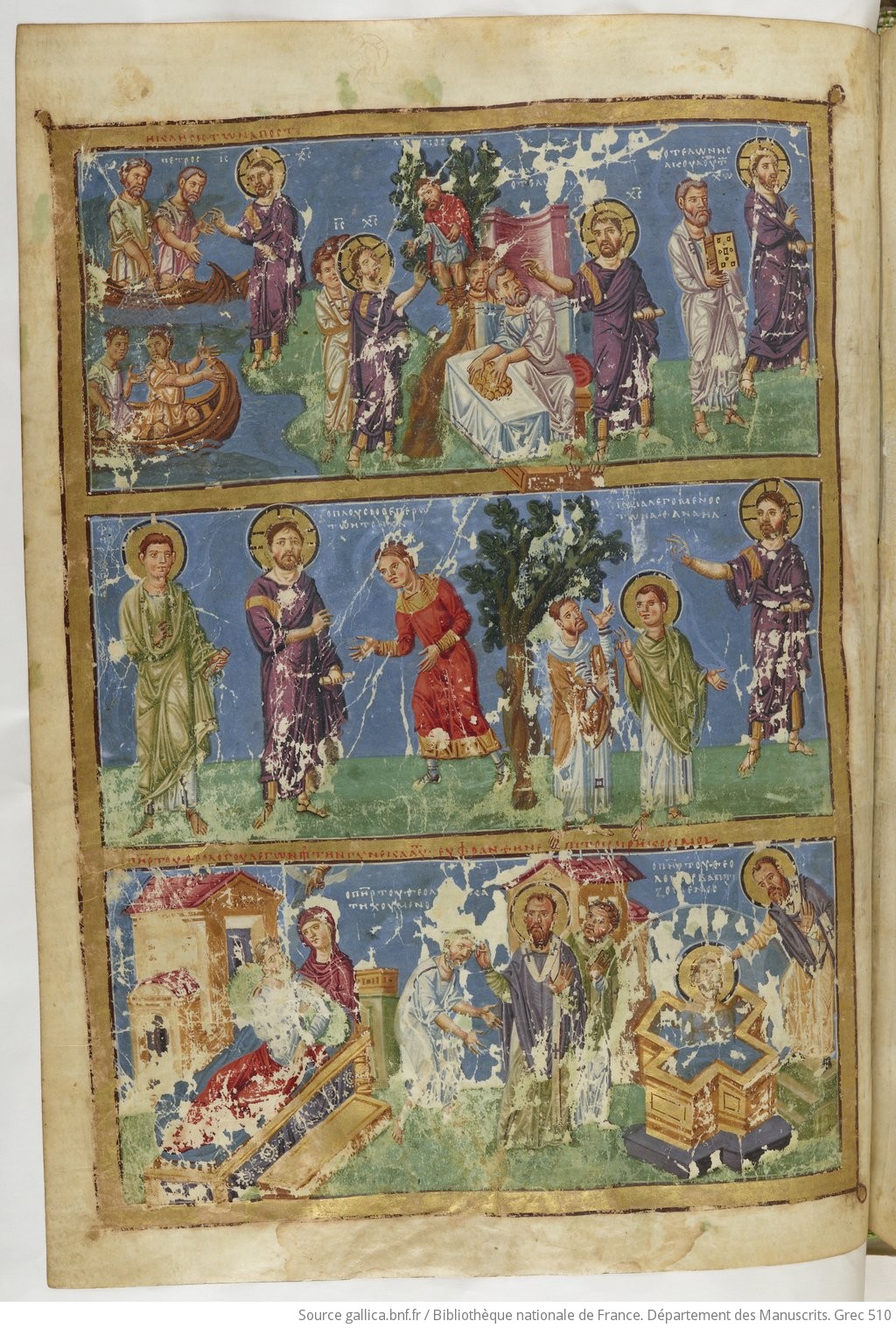 Histoire du père de Grégoire (registre inférieur) fol 87v
Histoire du père de Grégoire (registre inférieur) fol 87v La Vision des ossements desséchés, fol 438v
La Vision des ossements desséchés, fol 438v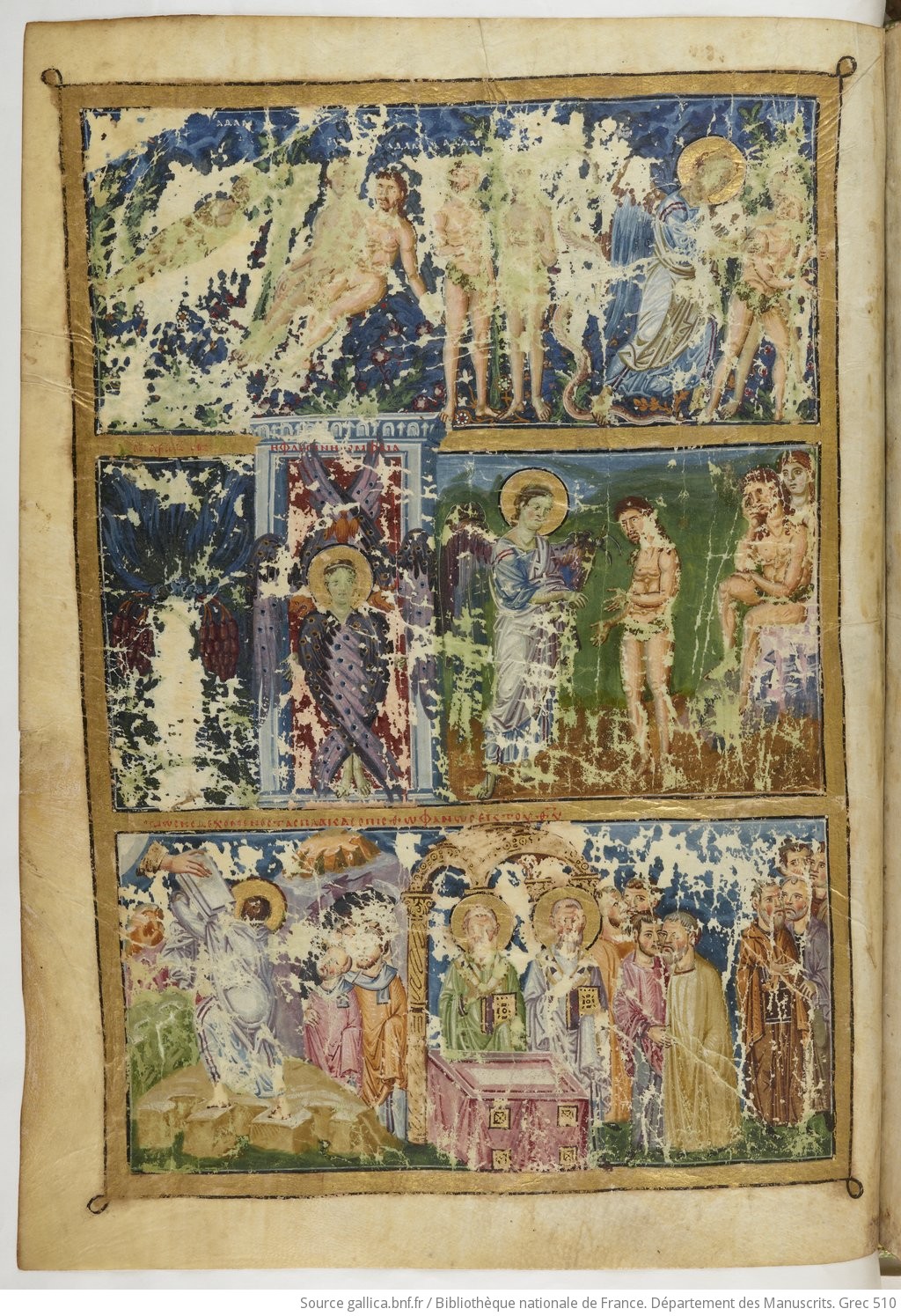 Homélie sur la Paix, fol 52v
Homélie sur la Paix, fol 52v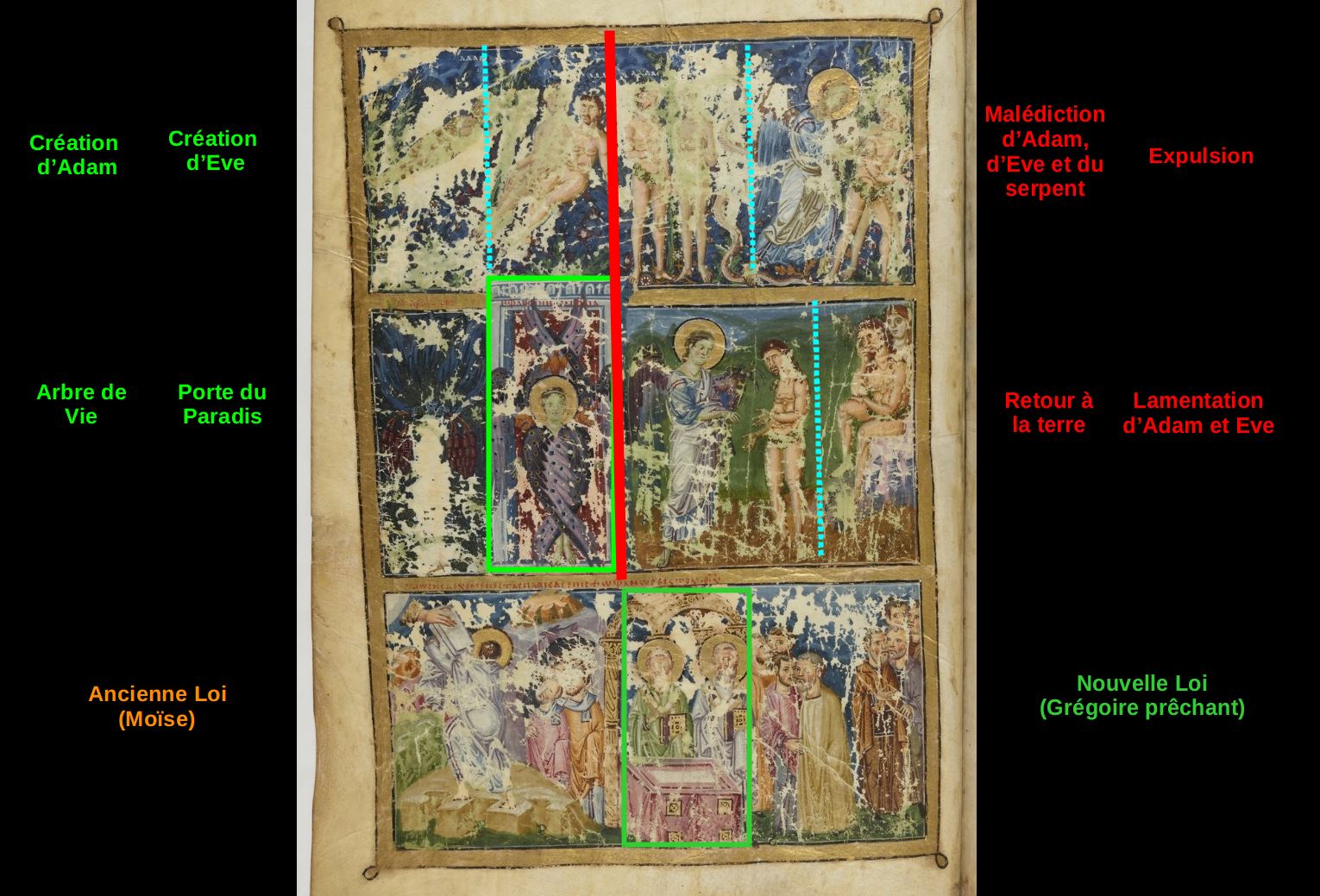
 Crucifixion, fol 30v
Crucifixion, fol 30v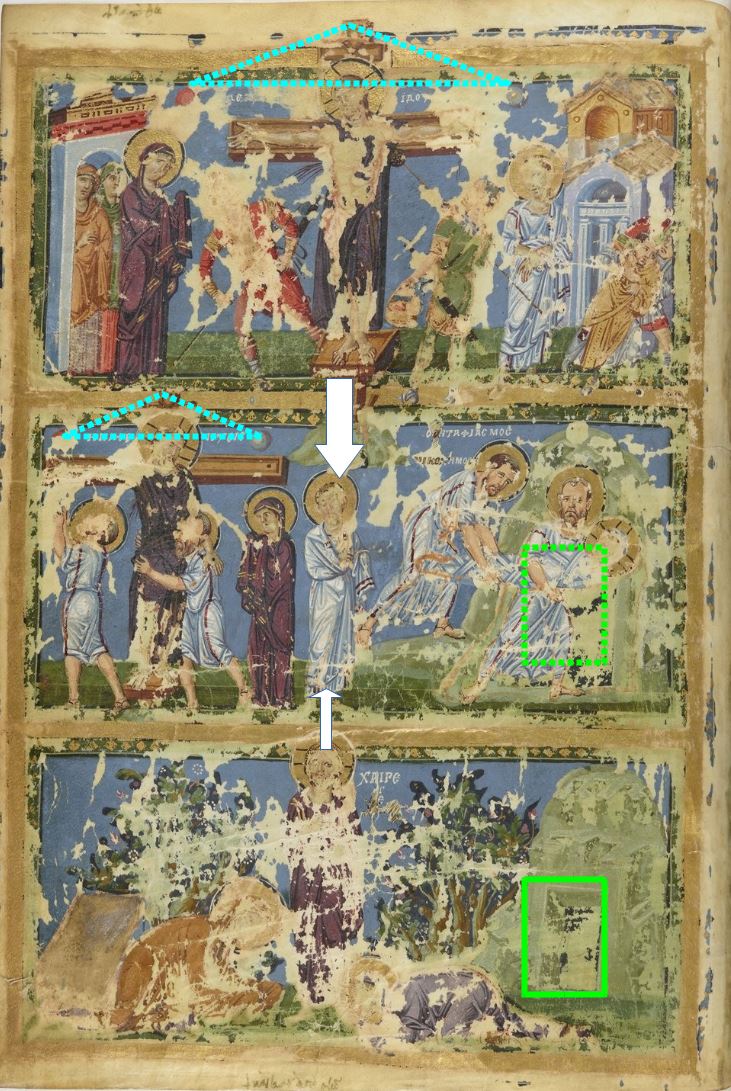
 Homélie « A mon père »
Homélie « A mon père »
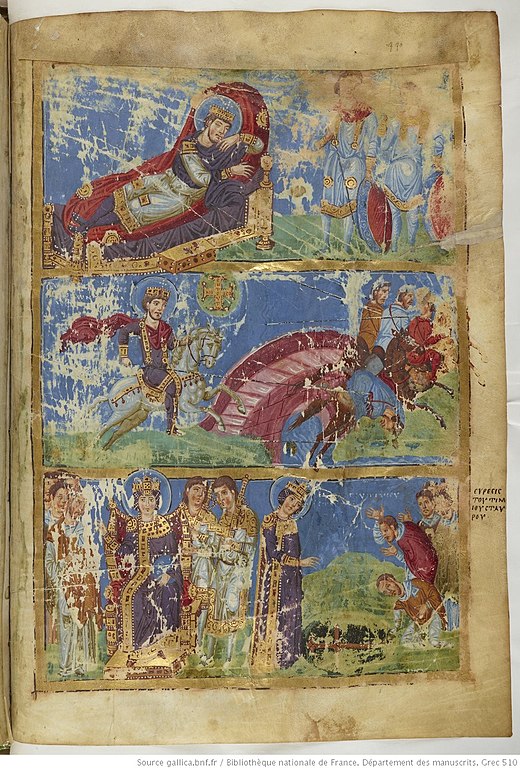 Scènes de la vie de Constantin, fol 440r
Scènes de la vie de Constantin, fol 440r Les cavaliers Israélites poursuivent les Amalécites (registre central), fol 424v
Les cavaliers Israélites poursuivent les Amalécites (registre central), fol 424v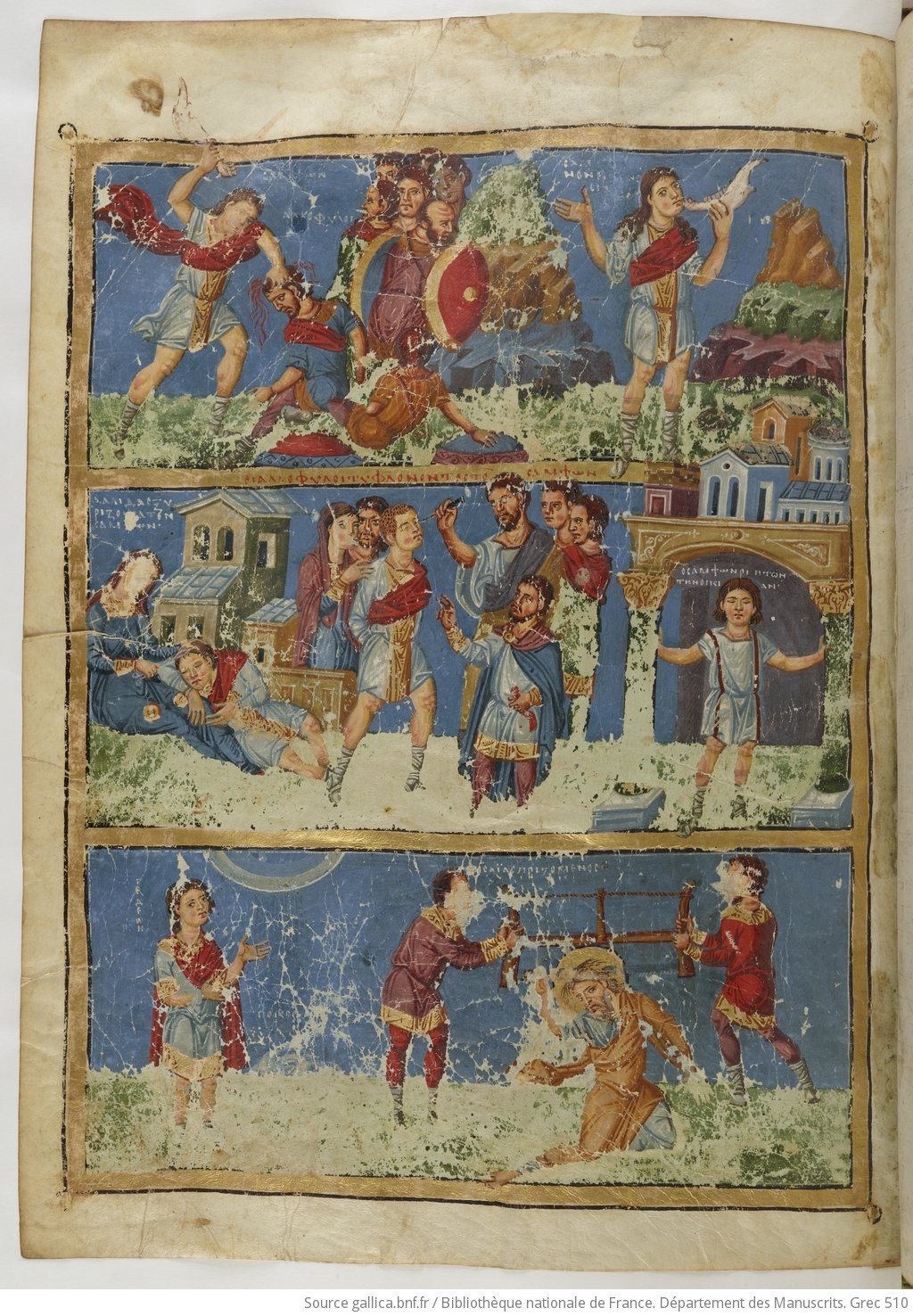 Scènes de la vie de Samson, fol 347v
Scènes de la vie de Samson, fol 347v La parabole du Bon Samaritain (registre médian), fol 143v
La parabole du Bon Samaritain (registre médian), fol 143v Scènes de la vie de Cyprien, fol 332v
Scènes de la vie de Cyprien, fol 332v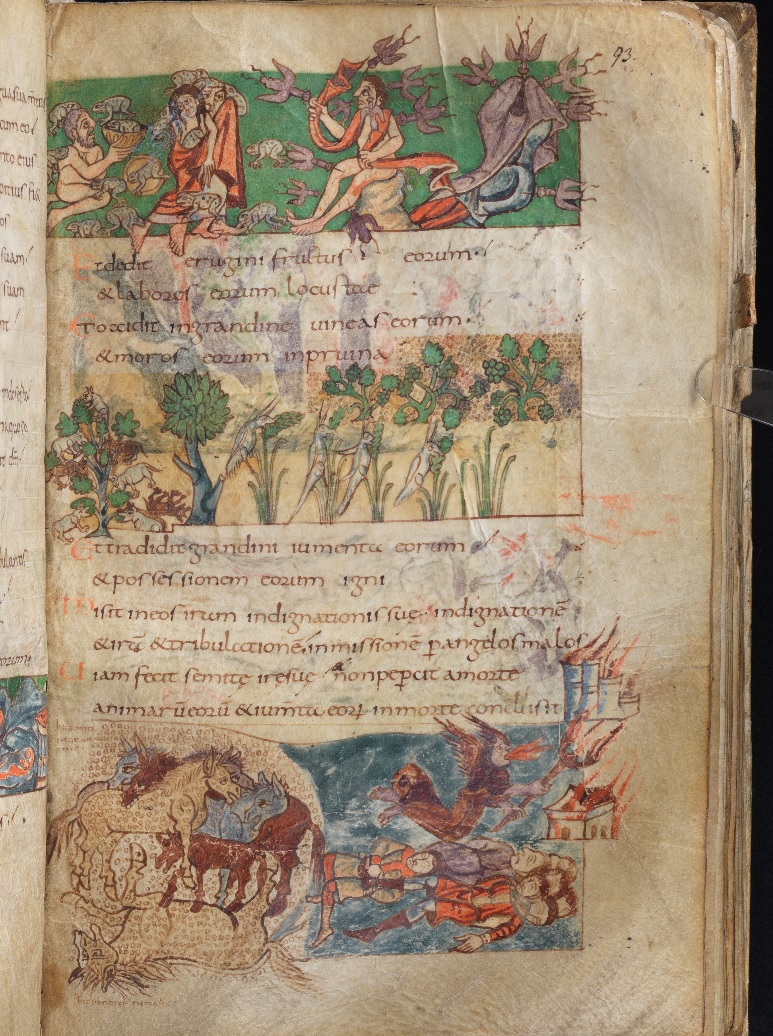 Les Plaies d’Egypte (Ps 77,45-50), fol 93r
Les Plaies d’Egypte (Ps 77,45-50), fol 93r David repousse ses ennemis (Psaume 26, 2-3), fol 32v
David repousse ses ennemis (Psaume 26, 2-3), fol 32v David fuit devant Saül (Psaume 54 ,4-7) fol 66v
David fuit devant Saül (Psaume 54 ,4-7) fol 66v Le jeune David est poursuivi par Saül (Psaume 17,3-4), fol 19r
Le jeune David est poursuivi par Saül (Psaume 17,3-4), fol 19r Le pauvre fuit vers la main de Dieu (Psaume 34,10), fol 43r
Le pauvre fuit vers la main de Dieu (Psaume 34,10), fol 43r
 Majestas Domini (Ps 17,11), fol 19v
Majestas Domini (Ps 17,11), fol 19v Moïse (suivi par Aaron) fait jaillir l’eau du rocher avec sa verge (Psaume 77,20), fol 91v
Moïse (suivi par Aaron) fait jaillir l’eau du rocher avec sa verge (Psaume 77,20), fol 91v Le Christ entre deux taureaux, (Psaume 21,13) fol 26r
Le Christ entre deux taureaux, (Psaume 21,13) fol 26r Le jugement de Salomon (Psaume 71,1 ), fol 83v
Le jugement de Salomon (Psaume 71,1 ), fol 83v
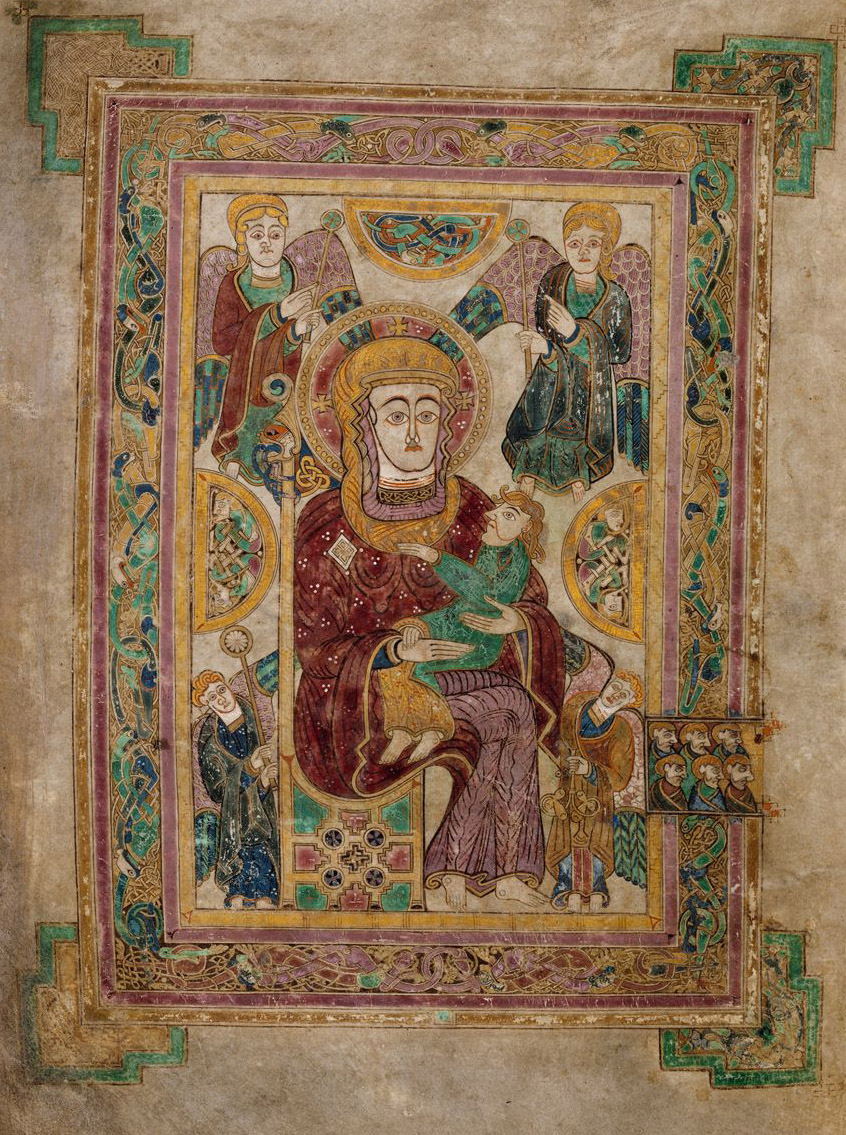 Vierge à l’Enfant, fol 7v
Vierge à l’Enfant, fol 7v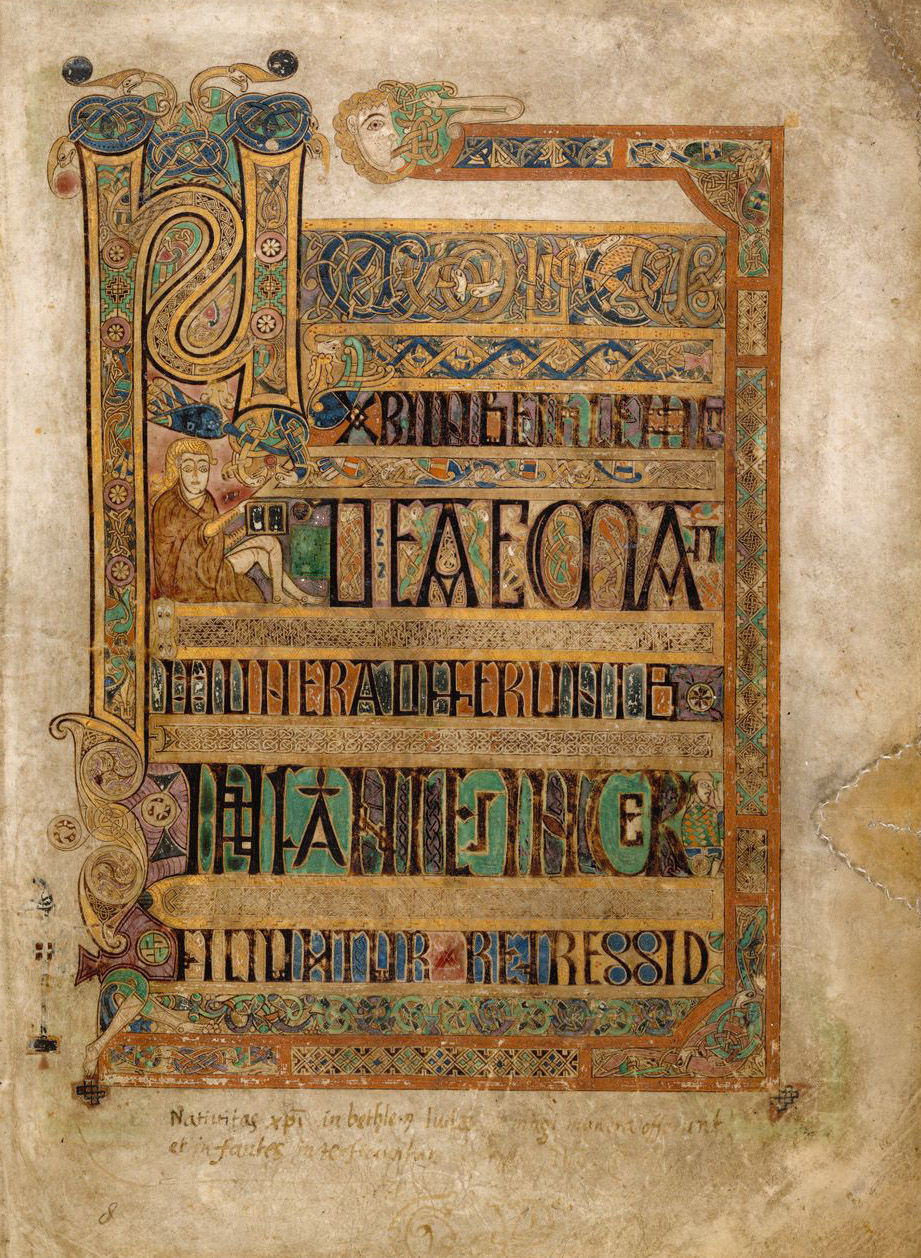 Breves causae de Matthieu 1-3, fol 8r
Breves causae de Matthieu 1-3, fol 8r « Tunc cruxifixerant XRI cum eo duos latrones », fol 124r
« Tunc cruxifixerant XRI cum eo duos latrones », fol 124r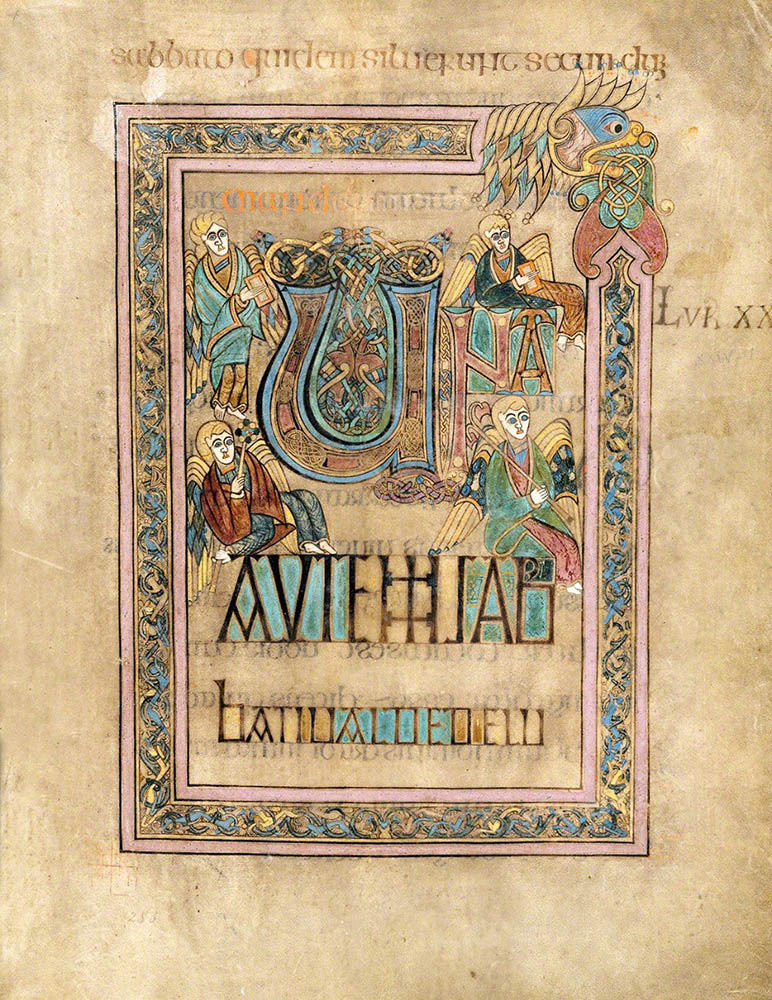 Transition entre Luc 23 et Luc 24, fol 285r
Transition entre Luc 23 et Luc 24, fol 285r
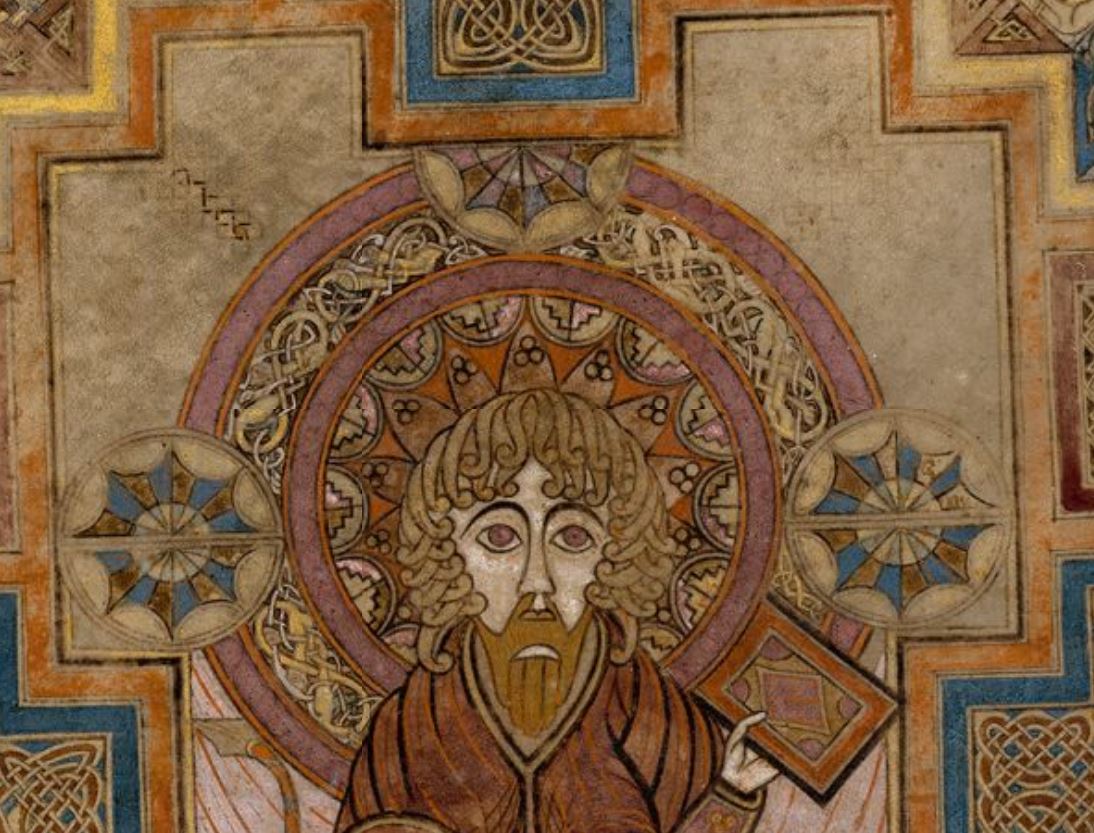


 Saint Matthieu
Saint Matthieu Saint Luc
Saint Luc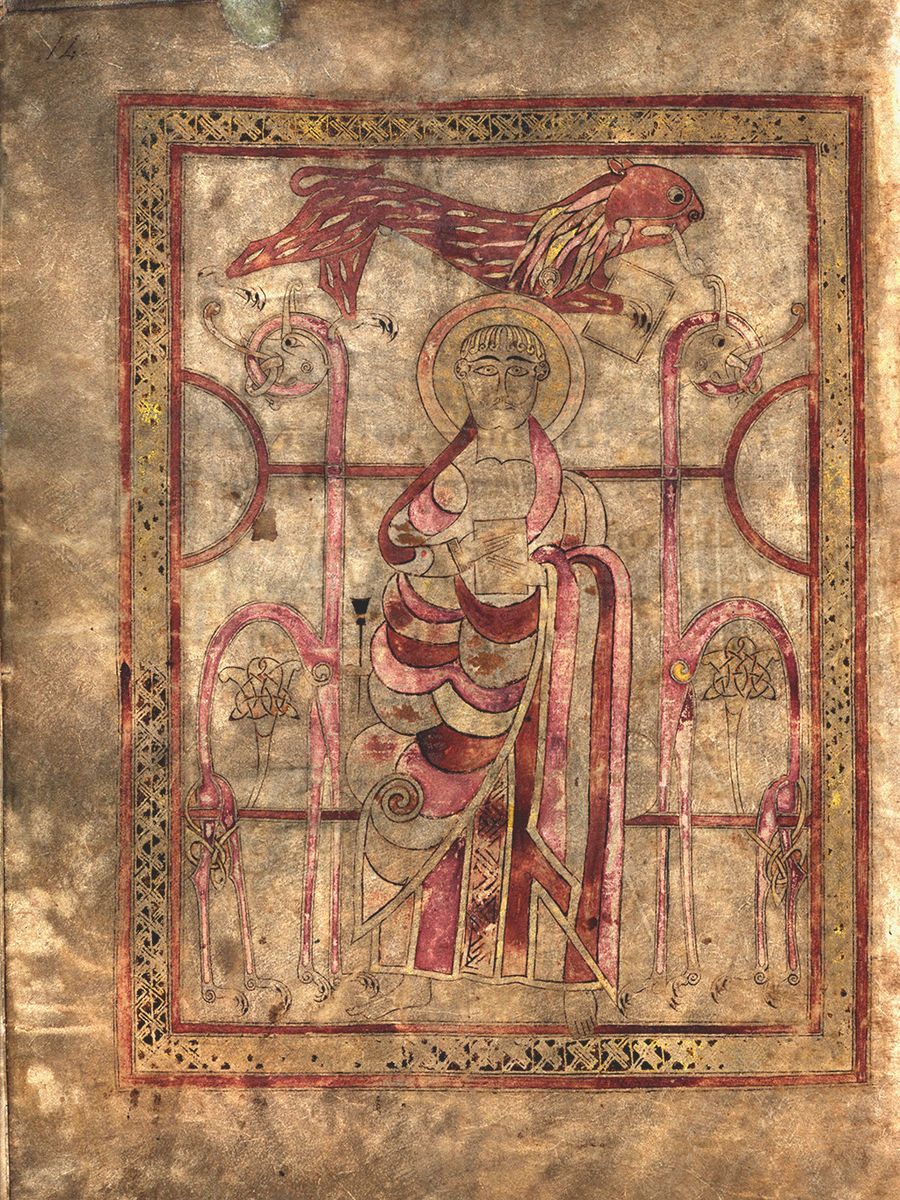 Saint Marc
Saint Marc