Interprétations

Commençons par le cas le plus intéressant par les énigmes qu’il pose, celui des revers à thème allégorique.
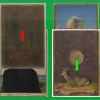
Les tout premiers portraits réalistes étaient des objets officiels et de grand prix, ayant à voir avec la Renommée et avec l’Immortalité. Ils étaient donc très souvent protégés par un couvercle de bois, lui-aussi peint et parfois tout aussi richement, qu’on ne faisait coulisser que dans les grandes occasions.

Le revers à thème religieux relèvent-ils de la même logique que les revers allégoriques, fournissant un portait abstrait mas en puisant à un registre chrétiens ? Où relèvent-il d’une logique propre ? Nous allons voir que les exemples, peu nombreux, relèvent d’intention variées.

Ce premier article est consacré aux revers qui fonctionnent, à la manière d’un sceau, en tant que marque de propriété ou d’élément d’authentification.
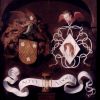
Cet article est consacré aux diptyques conjugaux à revers armoriés, qui ne concernent que les pays du Nord (Allemagne, Hollande).
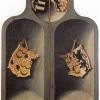
Certains diptyques ou triptyques ont pour fonction de mettre en scène le ou les donateurs face à l’objet de la dévotion. Parfois leurs armoiries s’ajoutent à cette présence, parfois elles s’y substituent.

L’ange porteur de couronne (stéphanophore) est un motif très courant. Cet article est consacré à une variante gothique très particulière, où l’ange élève symétriquement deux couronnes de part et d’autre de sa tête.

Cet article présente les rares tympans gothiques où l’on retrouve ce motif dans le contexte du Jugement dernier. Pour mieux comprendre son apparition, commençons par présenter les quelques tympans romans où figurent le Soleil et la Lune.

Deux panneaux jumeaux de Memling sont doublement énigmatiques : par leur fonction, à une période où la notion de « pendants » se s’est pas encore détachée d’une utilisation pratique comme panneaux d’un retable ; par leur sujet profane, à une période où la quasi totalité des diptyques et triptyques s’inscrivent dans un cafre dévotionnel (voir Les […]




