= ICONOGRAPHIE =

Après les calvaires vus de biais germaniques, passons un peu plus au Nord, où une formule moins excentrique va permettre de concilier la modernité de la perspective avec la centralité de la Croix.
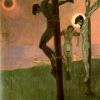
A partir du 17ème siècle, la formule reste rare, mais il serait fastidieux d’en faire un inventaire exhaustif.
Ce chapitre se contente donc de présenter quelques réalisations frappantes, et quelques cas où la filiation est certaine.

Adam, l’arbre au serpent et Eve : cet ordre qui semble naturel a-t-il à voir avec le statut du couple ? Cet article passe en revue les exceptions, selon les époques, et s’interroge sur leur cause.

Les nus de loin les plus courants, Adam et Eve, sont pratiquement toujours représentés de face. Dürer introduit l’exception consistant à faire tourner le dos à l’un, à l’autre ou aux deux, Cet article étudie la généalogie des différentes formules, selon la scène où Adam et Eve apparaissent : Chute de l’Homme, Expulsion du Paradis, Limbes, Comparution devant Dieu.

Ce premier article classe les nus de dos d’après le contexte dans lequel ils apparaissent : le bain, le combat (duels, enlèvements, batailles, défilés triomphaux), la danse.

Ce second article examine les nus de dos qui apparaissent pour des héros particuliers ou dans des iconographies spécifiques.
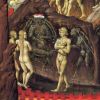
Avec la fin de l’Antiquité, le nu de dos, et même la vue de dos, disparaissent presque complètement. A la fin du Moyen-Age, il est réintroduit précautionneusement, du bout de la cuillère, pour épicer la représentation des Enfers italiens.

Après leur acclimatation en Enfer, les nus de dos commencent vers 1435 à se présenter à la Porte du Paradis (Lochner) pour y pénétrer vers 1500 (Bosch). Juste avant la Renaissance, ils colonisent de nouveaux contextes : didactiques, érotiques ou paragoniens.





